 |
| John Everett Millais. La mort d'Ophélie. 1852 |
LES MODERNITÉS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES À L'ÈRE DE L'ANUS MUNDI (2)
LE SYMBOLISME
Nous désignons par le terme d'Anus Mundi, terme utilisé
à Auschwitz, la période de régression de la civilisation
occidentale entre 1860 et 1945 (80 ans) qui sépare les dé-
buts de la Guerre de Sécession et la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Lorsque Émile Zola écrivit dans sa critique
d’art que «Gustave Moreau s’est lancé
dans le symbolisme», ce n’était sûrement pas pour l’en
féliciter. Le mouvement naturaliste n’éprouvait aucune sympathie pour le
mouvement symboliste qui représentait tout ce qu’il méprisait. Cette tendance –
le symbolisme - «s’opposant au réalisme
et aussi à l’impressionnisme qui en est l’expression suprême (les
impressionnistes disent mieux voir la nature telle qu’elle est réellement que
ne font les réalistes de l’école de Courbet), elle présente des princesses de
rêve et des chevaliers de légende errant dans des parcs mystérieux parmi des
hippogriffes et des chimères, des paysans extatiques priant au milieu de landes
embrunées, des filles-fleurs dansant sur des prairies émaillées, des barques
montées par des personnages nimbés voguant sur des lacs irréels, des paysages
d’îles bienheureuses, des pastorales bibliques ou exotiques, des scènes de
mystères orphiques ou chrétiens. Le tout chargé d’intentions, dominé aussi par
le souci, alors assez nouveau, du “décoratif”».
Si l’on se rappelle cette binarité dont nous avons parlée dans le sous-chapitre
précédent, le symbolisme appartiendrait au courant d’art porté par l’émotion et
l’ornementation, comme le Baroque ou le Romantisme. On le retrouve partout en Occident, sous des expériences
formelles davantage diversifiées que le réalisme et le naturalisme.
 |
| J. W. Waterhouse. The Lady of Shallot 1888. |
On peut affirmer sans trop soulever de houles
que la première forme du symbolisme est apparue en  Angleterre avec le courant
dit des Préraphaélites. Ce courant
artistique avait ses théoriciens et ses praticiens. Comme les réalistes et les
naturalistes, préraphaélites et symbolistes réagissaient contre la seconde
Révolution industrielle du milieu du XIXe siècle. Ils réagissaient, mais en faisant
la promotion d’autres valeurs et références stylistiques que les premiers.
L’esprit symboliste combattit contre ce «caractère
presque exclusivement utilitaire et pratique de la nouvelle civilisation
industrielle, qui n’avait pas eu de précédent, [et commençait] vers la fin du XIXe siècle à inquiéter
sérieusement quelques réformateurs. Ces hommes, John Ruskin (1819-1900),
Matthew Arnold (1822-1888) et William Morris (1834-1896) apparurent tous en
Grande-Bretagne, le premier pays qui ait vu le triomphe de l’industrialisme.
Ils virent que la nouvelle abondance et le nouveau confort pourvoyaient de plus
en plus aux besoins prosaïques, pratiques et terre-à-terre des hommes et des
femmes, dépouillaient la vie en ce monde de quelque chose de sa saveur, au
moment même où de plus en plus de gens mettaient tous leurs espoirs dans cette
existence temporelle. Ces espoirs mêmes séchaient sur pied. Avec le
développement du machinisme et la multiplication des produits et des services,
le travail, pour l’homme et la femme du commun, devenait moins intéressant et
moins attrayant. L’amour du travail pour le travail, pour ses produits directs,
diminuait en même temps que la capacité pour les spectateurs de contempler avec
joie les résultats d’un bon travail».
Ruskin et Morris étaient peintres, poètes, esthètes, critiques d’art,
philosophes sociaux. Ils n’étaient pas moins critiques de la société
industrielle et capitaliste que Courbet ou Zola, mais au lieu de regarder le présent
en pleine figure, ils détournaient le regard vers le passé. Ils idéalisaient un
Moyen Âge qui avait peu à voir avec la société féodale. Plus précisément, ils
pensaient rajouter un peu de vie dans un monde déshydraté en insérant des
valeurs nobles dans une société bourgeoise, «car lancer l’anathème contre la civilisation des machines, contre le
capitalisme industriel, contre les structures fondées sur la concurrence et la
compétition - outils majeurs de la “grande puissance de l’Europe moderne”
disait W. Morris - ce sera toujours “aller à contre-courant”. Tout ceci est
vrai - Barthes, transparent, accuse : “Il est aucun discours avec lequel
l’argent soit compatible.” Il est d’autant plus absurde de voir les livres de
Ruskin se vendre très chers. Car leur imprimeur G. Allen les fait exécuter
“loin des usines inesthétiques, au milieu des champs de fleurs”. On dit même
que ces précieux livres n’étaient jamais expédiés par chemin de fer, aucun
“objet de laideur” ne devant “participer à leur diffusion”. Il y a néanmoins,
entre le programme des esthéticiens et celui des esthètes, des rencontres
imprévues, sinon, des uns sur les autres, des effets inattendus. Ruskin et
William Morris, pour avoir recommandé l’insertion de l’art à tous les paliers
de la vie en arrivèrent à voir se promener en plein jour et au plein cœur de
Londres “des jeunes filles vêtues de costumes du Moyen Âge” et, au cours de
certaines soirées, “ces mêmes femmes apparaître dans des robes copiées d’après
d’anciens tableaux, avec des lys dans les cheveux”».
Ce retour au symboles médiévaux occupait une place importante dans leur
réformisme socialiste, la question demeurant comment opérer cette synthèse
impossible. «Comment donc [ce] socialisme esthétique va-t-il concilier sa
“haine de la civilisation moderne” et le projet “d’offrir au travailleur une
vie à laquelle la perception de la beauté, c’est-à-dire la jouissance du
plaisir véritable, apparaîtra aussi nécessaire que le pain quotidien”? Comment
va-t-il concilier une opération de rénovation, sa foi dans le Moyen Âge et son
hostilité à la machine? Il est des contradictions qu’il faut pouvoir assumer.
Lorsqu’on l’on ose penser. Et créer. À la fois. Simultanément. L’un dans
l’autre».
Angleterre avec le courant
dit des Préraphaélites. Ce courant
artistique avait ses théoriciens et ses praticiens. Comme les réalistes et les
naturalistes, préraphaélites et symbolistes réagissaient contre la seconde
Révolution industrielle du milieu du XIXe siècle. Ils réagissaient, mais en faisant
la promotion d’autres valeurs et références stylistiques que les premiers.
L’esprit symboliste combattit contre ce «caractère
presque exclusivement utilitaire et pratique de la nouvelle civilisation
industrielle, qui n’avait pas eu de précédent, [et commençait] vers la fin du XIXe siècle à inquiéter
sérieusement quelques réformateurs. Ces hommes, John Ruskin (1819-1900),
Matthew Arnold (1822-1888) et William Morris (1834-1896) apparurent tous en
Grande-Bretagne, le premier pays qui ait vu le triomphe de l’industrialisme.
Ils virent que la nouvelle abondance et le nouveau confort pourvoyaient de plus
en plus aux besoins prosaïques, pratiques et terre-à-terre des hommes et des
femmes, dépouillaient la vie en ce monde de quelque chose de sa saveur, au
moment même où de plus en plus de gens mettaient tous leurs espoirs dans cette
existence temporelle. Ces espoirs mêmes séchaient sur pied. Avec le
développement du machinisme et la multiplication des produits et des services,
le travail, pour l’homme et la femme du commun, devenait moins intéressant et
moins attrayant. L’amour du travail pour le travail, pour ses produits directs,
diminuait en même temps que la capacité pour les spectateurs de contempler avec
joie les résultats d’un bon travail».
Ruskin et Morris étaient peintres, poètes, esthètes, critiques d’art,
philosophes sociaux. Ils n’étaient pas moins critiques de la société
industrielle et capitaliste que Courbet ou Zola, mais au lieu de regarder le présent
en pleine figure, ils détournaient le regard vers le passé. Ils idéalisaient un
Moyen Âge qui avait peu à voir avec la société féodale. Plus précisément, ils
pensaient rajouter un peu de vie dans un monde déshydraté en insérant des
valeurs nobles dans une société bourgeoise, «car lancer l’anathème contre la civilisation des machines, contre le
capitalisme industriel, contre les structures fondées sur la concurrence et la
compétition - outils majeurs de la “grande puissance de l’Europe moderne”
disait W. Morris - ce sera toujours “aller à contre-courant”. Tout ceci est
vrai - Barthes, transparent, accuse : “Il est aucun discours avec lequel
l’argent soit compatible.” Il est d’autant plus absurde de voir les livres de
Ruskin se vendre très chers. Car leur imprimeur G. Allen les fait exécuter
“loin des usines inesthétiques, au milieu des champs de fleurs”. On dit même
que ces précieux livres n’étaient jamais expédiés par chemin de fer, aucun
“objet de laideur” ne devant “participer à leur diffusion”. Il y a néanmoins,
entre le programme des esthéticiens et celui des esthètes, des rencontres
imprévues, sinon, des uns sur les autres, des effets inattendus. Ruskin et
William Morris, pour avoir recommandé l’insertion de l’art à tous les paliers
de la vie en arrivèrent à voir se promener en plein jour et au plein cœur de
Londres “des jeunes filles vêtues de costumes du Moyen Âge” et, au cours de
certaines soirées, “ces mêmes femmes apparaître dans des robes copiées d’après
d’anciens tableaux, avec des lys dans les cheveux”».
Ce retour au symboles médiévaux occupait une place importante dans leur
réformisme socialiste, la question demeurant comment opérer cette synthèse
impossible. «Comment donc [ce] socialisme esthétique va-t-il concilier sa
“haine de la civilisation moderne” et le projet “d’offrir au travailleur une
vie à laquelle la perception de la beauté, c’est-à-dire la jouissance du
plaisir véritable, apparaîtra aussi nécessaire que le pain quotidien”? Comment
va-t-il concilier une opération de rénovation, sa foi dans le Moyen Âge et son
hostilité à la machine? Il est des contradictions qu’il faut pouvoir assumer.
Lorsqu’on l’on ose penser. Et créer. À la fois. Simultanément. L’un dans
l’autre».
 |
| Waterhouse. La Belle Dame sans Merci 1893 |
Il fallait beaucoup d’imagination pour penser
qu’une telle synthèse fût réalisable par les arts, la poésie et une
transformation de l’Être en soi au point que la jouissance du plaisir puisse
devenir aussi nécessaire que le travail et le pain quotidien. Ruskin et Morris
étaient de grands utopistes. Comme le rappelle Alberto Manguel, ce furent les «pré-raphaélites, qui ont introduit [la
notion] d’anachronisme»,
non tant dans les considérations historiennes que dans la célébration
quotidienne de la vie qu’ils souhaitaient. Partis d’un archaïsme appelé à se
diffuser partout en Occident au cours des années à venir, l’anachronisme
consistait à trahir ce même Moyen Âge qu’ils entendaient ramener à la vie par
des manifestations poétiques, dramatiques et artistiques. Ce goût du Moyen Âge,
les préraphaélites l’empruntèrent au romantisme anglais du tournant du XIXe
siècle beaucoup plus qu’à la résurrection des textes médiévaux. Déjà, le poète
Keats exprimait tout ce que seront les pontifes des préraphaélites; ainsi «dans La Belle Dame sans Merci : le poème s’ouvre sur l’errance d’un
chevalier pâle et maladif dans un paysage silencieux de fin d’automne».
 Encore ici, c’est dans le contexte du Printemps des peuples que le premier
cercle préraphaélite apparut : «La Preraphaelite
Brotherhood fut fondée en 1848 par
William Dyce, Ford Madox Brown et Dante Gabriel Rossetti. Les deux premiers
avaient été en contact avec les nazaréens de Rome, et le point de départ des
préraphaélites est à peu de chose près le même. L’art, la religion et l’éthique
étaient étroitement liés; l’étude de la nature prit une place centrale, et
naturellement l’étude de l’art avant Raphaël. Les artistes anglais
s’intéressaient cependant tout spécialement à l’art décoratif. Holman Hunt,
Edward Burne-Jones, John E. Everett Millais et le jeune William Morris se
joignent bientôt au groupe. Leurs œuvres allaient du naturalisme le plus cru
jusqu’au romantisme médiéval le plus sentimental et le plus mystique. C’est
cependant chez les derniers artistes de cette école que nous pouvons trouver
des tendances menant droit à l’Art Nouveau…».
Encore ici, c’est dans le contexte du Printemps des peuples que le premier
cercle préraphaélite apparut : «La Preraphaelite
Brotherhood fut fondée en 1848 par
William Dyce, Ford Madox Brown et Dante Gabriel Rossetti. Les deux premiers
avaient été en contact avec les nazaréens de Rome, et le point de départ des
préraphaélites est à peu de chose près le même. L’art, la religion et l’éthique
étaient étroitement liés; l’étude de la nature prit une place centrale, et
naturellement l’étude de l’art avant Raphaël. Les artistes anglais
s’intéressaient cependant tout spécialement à l’art décoratif. Holman Hunt,
Edward Burne-Jones, John E. Everett Millais et le jeune William Morris se
joignent bientôt au groupe. Leurs œuvres allaient du naturalisme le plus cru
jusqu’au romantisme médiéval le plus sentimental et le plus mystique. C’est
cependant chez les derniers artistes de cette école que nous pouvons trouver
des tendances menant droit à l’Art Nouveau…».
 |
| W. H. Hunt. My Beautiful Lady. The Germ |
Ce cercle d’initiés se donna, deux ans plus tard, un premier organe de
presse : «Le périodique préraphélite
The Germ qui sortit en 1850 se
proposait de resserrer ces liens [entre les beaux-arts, la littérature, la
musique et l’art décoratif], et son
sous-titre est assez significatif : Thoughts towards Nature in Poetry,
Literature and Arts. Mais comment ces
courants littéraires se traduisaient-ils en théorie artistique et en pratique?
William Morris, qui avait la plume aussi sûre que le pinceau, a dit : “Si un
type est incapable de composer un poème épique en tissant une tapisserie, il ne
fera jamais rien de bon.” La fameuse formule de Dante Gabriel Rossetti traduit
la même pensée : “L’homme qui est quelque peu poète devrait être peintre. Le
prochain Keats devrait être un peintre”. Tous les préraphaélites, Rossetti,
Hunt, Burne Jones et Madox Brown dessinaient des meubles et des textiles ou
contribuaient d’une manière ou d’une autre au dessin industriel».
C’était l’aveu d’une continuité qui contrastait avec la rupture d’avec le
romantisme qui marquait la volonté des réalistes. Aussi, «le préraphaélisme tient d’une certaine manière une place isolée dans la
peinture européenne; il a un caractère spécifiquement britannique et ne joue
qu’un rôle restreint dans l’évolution de la peinture sur le continent. Ses
tendances en peinture ne sont pas orientées vers les valeurs picturales, mais
vers les valeurs linéaires et littéraires, et il exercera une plus grande
influence sur les arts graphiques et les arts appliqués. Cependant, la peinture
préraphaélite aura une importance toute spéciale en Belgique et en Hollande».
À plus long terme, c’est à travers l’émergence du Modern Style durant la première décennie du XXe siècle que les
thèmes préraphaélites seront diffusés sur une plus vaste échelle dans
l’ensemble de l’Occident.
 |
| Medea d’Evelyn De Morgan, 1889, en style Quattrocento. |
Le terme de préraphaélite
renvoie à une volonté de revenir à une peinture à la limite du gothique et
de la Renaissance, opérant une synthèse qui soumettrait les thèmes de l’âge
gothique aux formes de l’art renaissant. Ce syncrétisme fut exposé à plusieurs
reprises par Ruskin qui affirmait, «dans
l’une des conférences sur l’architecture qu’il donne en 1854 : “Le sujet sur
lequel je voudrais attirer votre attention ce soir est la conséquence logique
et naturelle d’un schisme qui s’est produit parmi les artistes anglais voici
quelques années. Ce schisme, ou plutôt l’hérésie qui y conduisit, comme vous le
savez, fut provoqué par un petit groupe de jeunes gens qui, pour l’essentiel,
affirmaient que les principes régissant l’enseignement de l’art de ces trois
cents dernières années étaient erronés, et que les principes qui devraient nous
guider étaient ceux qui prévalaient avant l’époque de Raphaël. En les adoptant,
et afin de sceller leur union, ces jeunes gens prirent le nom malheureux et un
peu incongru de Frères Pré-Raphaélites. […] Permettez-moi de dissiper sur-le-champ les doutes qui subsistent dans
votre esprit et de contredire toutes ces calomnies. Le Préraphaélisme n’a qu’un
seul principe, la vérité absolue et sans partage dans tout ce qu’il réalise et
obtient dans le moindre détail d’après, et seulement d’après nature”».
À la réalité des réalistes, les préraphaélites préféraient la vérité, qui n’est pas un concept plus
clair. Sans doute l’important résidait-il moins dans le manifeste que dans la volonté de former une école opposée à
l’académisme ambiant, le tout regroupé dans ce cercle sélect d’artistes et de
poètes dissidents, «…la “confrérie
préraphaélite” [eut} un impact
immédiat à partir des antécédents du premier art italien qu’ils se sont
eux-mêmes assignés comme textes de base, références perturbantes et protection
contre leur propre environnement formel. Leur poétique - aussi désaliénante
qu’enracinante - est faite d’itinéraires détournés. Qui suivent deux voies.
L’une ravive les mythes, réanime l’histoire. L’autre exige la contemplation,
l’observation, l’analyse visuelle du paysage, mimétisé jusqu’aux confins de
l’illusion absolue. Dans les deux cas l’objectif déclaré est identique :
révéler le “vrai”, comme idéal moral, associer l’éthique et l’esthétique. Ils
étaient sept : William Holman Hunt, peintre; John-Everest Millais, peintre;
Dante Gabriel Rossetti, peintre et poète; Thomas Woolner, statuaire; James
Collinson, peintre; Frederic-George Stephens, peintre d’abord, critique
ensuite; William Michael Rossetti, frère de Dante Gabriel, écrivain d’art, qui
stimulés par les principes avancés par les Modern Painters de Ruskin et la
poésie de Keats, s’étaient réunis en 1848 pour constituer le PreRaphaelite
Brotherhood, dont les initiales P.R.B.
devaient apparaître sous leurs œuvres comme signature et signe communautaire.
Dante Gabriel Rossetti, dont on vante volontiers l’imagination, l’enthousiasme,
les curiosités spirites, la “vocation de fils de carbonaro à créer les sociétés
plus ou moins secrètes” semble bien avoir eu l’idée de cette pseudo-confrérie
et celle d’un house-organe qui exposerait les idées du groupe».
Cette volonté organisationnelle contrasta avec leurs vis-à-vis du continent qui
restaient des groupes non formalisés, partageant certains thèmes ou certaines
façons d’interpréter l’art mais sans la volonté manifeste de créer une société
particulière. Le groupe britannique opposait l’artisanat traditionnel à la
modernité industrielle : «La contribution
personnelle la plus importante fut cependant celle de William Morris;
nouvellement marié et plein d’optimisme, il déménage à Red House en 1860, et
l’année suivante sa firme prend forme, avec ses bureaux installés au 8, LionSquare […]. C’est là, dans un décor
presque bucolique, que travaillaient William Morris, Philippe Webb, les
préraphaélites Ford Madox Brown et Edward Burne Jones, ainsi que parfois Dante
Gabriel Rossetti et le curieux mathématicien Ch. J. Faulkner. Le septième
membre de la firme était Peter Marshall, un ami de Madox Brown, ingénieur de
son métier, mais comme les autres, passionné par les arts décoratifs. À partir
de 1870, on peut noter l’influence exercée sur le goût de l’époque par Morris
et son mouvement, la firme participe à des expositions internationales et sa
production pratiquement couvre toutes les branches des arts appliqués».
voisin le grand
peintre américain James McNeill Whistler, ami de Marcel Proust».
Proust qui, «très influencé par la
littérature anglaise», traduira «Ruskin,
qui le convertit à sa religion de la beauté aussi bien en art que dans la
nature, et il devait quelques-unes de ses préoccupations morales à George
Eliot. Quant à son penchant dévastateur à l’analyse et à ses longues
digressions à caractère scientifique sur la botanique et l’entomologie, elles
nous rappellent que son père était un docteur éminent, et que son milieu était
un milieu de médecins».
Ces informations convergent vers la vision féminine langoureuse qui baigna
l’œuvre peinte de Rossetti : «Ensemble
complexe, lascif et sensuel, cruel et vénéneux. Il fonde une typologie dont va
hériter tout le symbolisme européen. Qu’il soit plastique ou littéraire, il est
le même. Partout. Et atteint un tel degré de tension qu’il paraît être ce
qu’exprime si fortement René Char : “l’amour réalisé du désir demeuré désir”.
Partout la même vision, dont on pourrait dire qu’elle est spéculaire, paraît
liée aux mêmes fantasmes hallucinatoires; sans doute parce que tous ont une
structure commune, qu’il faudrait pouvoir identifier au-delà de la donnée
biographique. Ce tout, comme sous-ensemble plastique, est marqué par l’emphase
formelle. Et débouche sur une matrice: une image de femme telle qu’elle paraît
toujours empruntée au même modèle».
Comme Guerrand le rappelle, à propos du Modern Style : «Voilà
donc un art très féminin : le visage et la forme de la femme y tiennent,
effectivement, une grande place. C’est le type préraphaélite, incarné jadis par
Elisabeth Siddal, la femme de Rossetti - morte à vingt-neuf ans - ou Jane
Burden, l’épouse de W. Morris. Les yeux sont mélancoliques, les paupières
lourdes, la lèvre supérieure sensuelle. Le visage, entouré de boucles cuivrées
et supporté par un long cou, essaie d’exprimer une mystérieuse souffrance. Ce
type reviendra chez Aubrey Beardsley qui l’interprètera sensuellement, tandis
que les deux sœurs Macdonald ont au contraire développé son aspect sophistiqué.
Retour à la tradition baroque que cet allongement qui sera particulièrement
caractéristique chez les décorateurs de l’Art Nouveau. N’est-ce pas Jean
Lorrain, le meilleur chroniqueur fin-de-siècle, qui décrivait la danseuse
américaine Loïe Fuller, parfait incarnation des tendances nouvelles, comme
“longue éthérée, botticellienne"? Un retour à Botticelli et à l’École de Parme
- “la Madone au long cou” du
 |
| D. G. Rossetti. Elisabeth Siddal |
Parmesan - est ici manifeste. Reste que ces
créatures paraissent maintenant dans des endroits tout à fait inattendus. Les
sœurs Macdonald les avaient d’abord utilisées pour des affiches ou pour leurs
ouvrages d’argent ou de cuivre battu. Jusque-là, rien que des très classique».
Rossetti, malgré une vie brève, imposa à la fois ses thèmes et son style à
l’ensemble du groupe. Il était le seul à produire une peinture qui rayona
suffisamment pour asseoir les théories que ses amis de la confrérie publiaient
dans leur revue. Ruskin et Morris, eux, s’intéressaient davantage à
l’architecture : «L’exaltation de
l’architecture gothique, chez Pugin et plus encore chez Ruskin, s’appuie sur la
mise en opposition de la foi religieuse et communautaire médiévale avec la
désagrégation morale et sociale de l’âge industriel. Le gothique contre le
machinisme… Le médiévalisme du groupe des préraphaélites se veut dénonciation
des dégénérescences esthétiques et éthiques contemporaines. Mais c’est aussi en
Angleterre, et sous les auspices de Ruskin, qu’est forgée l’alliance entre la
plus avancée modernité technologique et l’archaïsme stylistique : la construction
gothique de métal. En 1860 est inauguré le Musée d’histoire naturelle d’Oxford,
chef-d’œuvre d’architecture à poutrelles de fonte dont les ogives supportent
une toiture en verrière. Innovation technique et tradition stylistique…»
L’architecture préraphaélite poursuivait donc dans la voie amorcée par le
néo-gothique apparu à l’époque romantique, cachant derrière des formes
apparentes du gothique une structure architecturale d’acier absolument moderne. Derrière l’archaïsme
triomphait tout de même la modernité apportée par la révolution industrielle.
Il n’est pas suffisant pour qualifier ce style de
féminin, même si le modèle d’Ophélie flottant sur les eaux (Millais) demeure le nec plus ultra du préraphaélisme.
L’essence féminine du style s’exprimait tout autant par des formes marines, des
végétaux aquatiques, des nuages chargés de pluie; la découpe ciselée des
feuilles  n’allait pas sans évoquer l’hymne à la nature de Walt Whitman. La
nature, ici, contrairement au réaliste, n’étant pas vue sous son angle de
réalité absolue opposée à l’artificiel de l’industrie humaine. C’est la
sensibilité féminine à fleur de peau chez cet homme quand même rude et
volontaire qu’était Whitman, qui toucha poètes et artistes préraphaélites. Une
correspondance entre le poète américain et le cercle s’engagea : «Les premières éditions des Feuilles
d’herbe ont assez vivement impressionné
les entourages de Carlyle, de Ruskin, des deux Rossetti et de Swinburne pour
que l’édition de 1860 ait rencontré une audience sensiblement plus large. […] À ce propos une correspondance s’engage
entre Rossetti et Whitman, dont la première conséquence est de sceller entre
n’allait pas sans évoquer l’hymne à la nature de Walt Whitman. La
nature, ici, contrairement au réaliste, n’étant pas vue sous son angle de
réalité absolue opposée à l’artificiel de l’industrie humaine. C’est la
sensibilité féminine à fleur de peau chez cet homme quand même rude et
volontaire qu’était Whitman, qui toucha poètes et artistes préraphaélites. Une
correspondance entre le poète américain et le cercle s’engagea : «Les premières éditions des Feuilles
d’herbe ont assez vivement impressionné
les entourages de Carlyle, de Ruskin, des deux Rossetti et de Swinburne pour
que l’édition de 1860 ait rencontré une audience sensiblement plus large. […] À ce propos une correspondance s’engage
entre Rossetti et Whitman, dont la première conséquence est de sceller entre
 les deux hommes une ferme amitié et la seconde de dissuader le poète
d’envisager la publication intégrale de son œuvre en Angleterre. […] dans une introduction, W.-M. Rossetti
déclare que l’auteur des Feuilles d’herbe “a réalisé l’œuvre la plus grande de notre période en poésie”.
C’est le triomphe en Europe – sauf un bémol de la part de la critique
française - : «les témoignages venus
d’Europe ne cessent d’affluer. Tandis qu’à l’envoi des Feuilles d’herbe Tennyson répond par une invitation,
Swinburne publie son poème À Walt Whitman en Amérique et Edward Dowdes
son essai Poésie de la démocratie. En
1868 Ferdinand Freiligrath a révélé Whitman à l’Allemagne. Trois ans plus tard
Rudolf Schmidt traduit en danois Perspectives démocratiques. En France, hélas, la Revue des deux
mondes accorde avec condescendance au
poète américain des dons estimables en dépit de son “répugnant matérialisme”.
Par bonheur un article d’Émile Blémont, dans la Renaissance artistique et
littéraire, contient une apostrophe qui
sauve l’honneur…».
La réception britannique fut un succès tant le terrain avait été préparé
puisque «cette vision de la nature est en
partie héritée des théoriciens du mouvement préraphaélite. John Ruskin et
William Morris considéraient la nature comme une source d’inspiration, et
reviennent continuellement sur ce sujet. John Sedding, élève enthousiaste de
Morris, le formule ainsi : “Laissez tomber cette ennuyeuse traduction des vieux
styles, et traduisez plutôt la nature!” L’évolution en cours pendant la période
de l’Art Nouveau a des racines dans le naturalisme».
Un naturalisme qui va retrouver celui de Zola sous un aspect fort différent, mais
nous y reviendrons.
les deux hommes une ferme amitié et la seconde de dissuader le poète
d’envisager la publication intégrale de son œuvre en Angleterre. […] dans une introduction, W.-M. Rossetti
déclare que l’auteur des Feuilles d’herbe “a réalisé l’œuvre la plus grande de notre période en poésie”.
C’est le triomphe en Europe – sauf un bémol de la part de la critique
française - : «les témoignages venus
d’Europe ne cessent d’affluer. Tandis qu’à l’envoi des Feuilles d’herbe Tennyson répond par une invitation,
Swinburne publie son poème À Walt Whitman en Amérique et Edward Dowdes
son essai Poésie de la démocratie. En
1868 Ferdinand Freiligrath a révélé Whitman à l’Allemagne. Trois ans plus tard
Rudolf Schmidt traduit en danois Perspectives démocratiques. En France, hélas, la Revue des deux
mondes accorde avec condescendance au
poète américain des dons estimables en dépit de son “répugnant matérialisme”.
Par bonheur un article d’Émile Blémont, dans la Renaissance artistique et
littéraire, contient une apostrophe qui
sauve l’honneur…».
La réception britannique fut un succès tant le terrain avait été préparé
puisque «cette vision de la nature est en
partie héritée des théoriciens du mouvement préraphaélite. John Ruskin et
William Morris considéraient la nature comme une source d’inspiration, et
reviennent continuellement sur ce sujet. John Sedding, élève enthousiaste de
Morris, le formule ainsi : “Laissez tomber cette ennuyeuse traduction des vieux
styles, et traduisez plutôt la nature!” L’évolution en cours pendant la période
de l’Art Nouveau a des racines dans le naturalisme».
Un naturalisme qui va retrouver celui de Zola sous un aspect fort différent, mais
nous y reviendrons.
Les préraphaélites se montraient plus soucieux
de la question sociale que des questions politiques. S’ils s’opposient aux
méfaits de l’industrialisation et de l’urbanisation, ils considéraient que
c’était à l’art d’aménager la vie afin de rendre les humains plus heureux.
Prenons William Morris, par exemple : «Alors
 déjà des préoccupations d’ordre social l’animent, l’inquiètent, le sollicitent.
L’art devrait avoir, ou retrouver, un sens, une fonction communautaires. Il
devrait s’intégrer à la vie quotidienne du plus grand nombre. Ce sont les idées
défendues par Ruskin et Carlyle. Lui entend leur donner substance en réalité.
Il fonde en 1861, avec Brown, Rossetti, Arthur Hughes, un atelier collectif
d’artistes-artisans, point de départ du mouvement Arts and Crafts où l’on trouve quelques-uns des arguments
fondamentaux de l’Art Nouveau. L’essentiel de sa doctrine est réuni dans un
texte qu’il expose le 13 novembre 1887 à la section de Hammersmith de la Socialist League. Il est intitulé : la Société du futur : “Il s’agit d’une société qui ne connaît
pas la signification des vocables riche et pauvre, ni les droits de la
propriété, ni la loi ni la légalité, pas plus que la nationalité, une société
qui n’a pas conscience d’être gouvernée, où l’égalité de condition est une
évidence, et où personne n’est récompensé pour avoir servi la communauté en
ayant reçu le pouvoir de lui porter atteinte. Il s’agit d’une société qui a
conscience de conserver à la vie sa simplicité, de renoncer à certaines victoires
sur la nature, remportées autrefois, afin d’être plus
déjà des préoccupations d’ordre social l’animent, l’inquiètent, le sollicitent.
L’art devrait avoir, ou retrouver, un sens, une fonction communautaires. Il
devrait s’intégrer à la vie quotidienne du plus grand nombre. Ce sont les idées
défendues par Ruskin et Carlyle. Lui entend leur donner substance en réalité.
Il fonde en 1861, avec Brown, Rossetti, Arthur Hughes, un atelier collectif
d’artistes-artisans, point de départ du mouvement Arts and Crafts où l’on trouve quelques-uns des arguments
fondamentaux de l’Art Nouveau. L’essentiel de sa doctrine est réuni dans un
texte qu’il expose le 13 novembre 1887 à la section de Hammersmith de la Socialist League. Il est intitulé : la Société du futur : “Il s’agit d’une société qui ne connaît
pas la signification des vocables riche et pauvre, ni les droits de la
propriété, ni la loi ni la légalité, pas plus que la nationalité, une société
qui n’a pas conscience d’être gouvernée, où l’égalité de condition est une
évidence, et où personne n’est récompensé pour avoir servi la communauté en
ayant reçu le pouvoir de lui porter atteinte. Il s’agit d’une société qui a
conscience de conserver à la vie sa simplicité, de renoncer à certaines victoires
sur la nature, remportées autrefois, afin d’être plus  humaine et moins
mécanique, et qui désire sacrifier quelque chose à cette fin. Elle serait
divisée en petites communautés variant beaucoup dans les limites autorisées par
l’éthique sociale et qui ne rivalisent pas entre elles, regardant avec aversion
l’idée d’une race élue».
Cette adhésion arrivait bien tardivement pour un militant qui, depuis 30 ans,
parlait de la rupture avec la tradition issue de la Renaissance : «L’adhésion de Morris au socialisme date de
1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste et en poète, d’abord soucieux de
son œuvre. Il a cependant protesté contre les massacres de populations
chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur des Irlandais affamés.
Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier parti socialiste organisé
en Angleterre - est un pas décisif que les Conservateurs ne pardonneront pas au
tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans la presse. Morris ne s’entendra
d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de parti : il fondera son propre
mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera les conférences pour prouver à
ses auditeurs que l’organisation industrielle qu’ils subissent est incompatible
avec toute idée de bonheur et de beauté».
Socialisme utopique, moins enrégimenté que dans le phalanstère de Fourier ou
l’embrigadement partisan des marxistes-léninistes, la logique du mouvement
social s’inscrivait davantage dans la mouvance artistique plutôt que dans la
lutte violente contre les injustices issues de l’organisation du travail et la
séparation du Capital et du Travail. Socialisme rétrograde, qui regardait en
arrière vers la société pré-industrielle comme modèle de valeurs et de morales,
la tendance préraphaélite ne s’assimilait pas au mouvement des travailleurs.
humaine et moins
mécanique, et qui désire sacrifier quelque chose à cette fin. Elle serait
divisée en petites communautés variant beaucoup dans les limites autorisées par
l’éthique sociale et qui ne rivalisent pas entre elles, regardant avec aversion
l’idée d’une race élue».
Cette adhésion arrivait bien tardivement pour un militant qui, depuis 30 ans,
parlait de la rupture avec la tradition issue de la Renaissance : «L’adhésion de Morris au socialisme date de
1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste et en poète, d’abord soucieux de
son œuvre. Il a cependant protesté contre les massacres de populations
chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur des Irlandais affamés.
Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier parti socialiste organisé
en Angleterre - est un pas décisif que les Conservateurs ne pardonneront pas au
tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans la presse. Morris ne s’entendra
d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de parti : il fondera son propre
mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera les conférences pour prouver à
ses auditeurs que l’organisation industrielle qu’ils subissent est incompatible
avec toute idée de bonheur et de beauté».
Socialisme utopique, moins enrégimenté que dans le phalanstère de Fourier ou
l’embrigadement partisan des marxistes-léninistes, la logique du mouvement
social s’inscrivait davantage dans la mouvance artistique plutôt que dans la
lutte violente contre les injustices issues de l’organisation du travail et la
séparation du Capital et du Travail. Socialisme rétrograde, qui regardait en
arrière vers la société pré-industrielle comme modèle de valeurs et de morales,
la tendance préraphaélite ne s’assimilait pas au mouvement des travailleurs.
Le symbolisme français, comme les préraphaélites
britanniques, s’est défini en réaction contre la pensée philosophique dominante
du milieu du XIXe siècle. Comme l’écrit l’historien américain Eugen Weber, «les symbolistes inauguraient une réaction
contre le positivisme et le matérialisme, contre Taine et Zola. Ils se
proclamaient idéalistes et, aux sombres études sociales des romanciers
naturalistes ils opposaient des créations plus légères, plus suggestives, des
tableaux de légende et de rêve. C’était une brise de mysticisme et d’illusion
qui soufflait sur la littérature, le goût de l’au-delà, les recherches
spiritistes et occultistes revenaient en vogue. D’ailleurs, le souci d’une
certaine science ou, du moins, son image, n’étaient pas tout à fait absents de
ces préoccupations».
En ce sens, le symbolisme  prenait de front les tendances réalistes et
naturalistes dans lesquelles il ne voyait qu’une poursuite des valeurs de la
société industrielle : «De là encore
une volonté de se démarquer face au Réalisme régnant, par crainte de voir les
Naturalistes “monter à l’assaut de l’avenir” (Castagnary), cette attitude se
confondant avec une hostilité profonde à l’égard de l’émancipation sociale
(hors celle de William Morris) et la crainte, conséquente, de voir la gauche
s’attaquer aux privilèges de la classe dominante. Dans cette perspective le
sous-ensemble symboliste des années 1870-1900 peut être simultanément
appréhendé comme structure idéologique qui incorporerait les informations d’un
milieu (circonscription physique et sociale) et de l’histoire des paradigmes préexistants, comme engagement
politique qui marquerait l’opposition au positivisme et au matérialisme
historique (opposition qui coïnciderait avec l’“avènement de la science” et
l’épanouissement du mythe du progrès), comme champ sémantique orienté vers
l’anéantissement de l’art à partir de l’angoisse, de la détresse, de la déroute
suscitée par les bouleversements de l’environnement, l’inflation urbaine, les
transformations techniques et économiques, comme manifestation d’une opposition
plus ou moins prononcée au stade de la thermodynamique, producteur massif de la
vapeur qui “siffle et fume pour marcher vers un but auquel on ne croit pas”
(Villiers de l’Isle-Adam)».
À la réalité, le symbolisme opposa la
vérité. Ce fut d’ailleurs le paradoxe
d’Oscar Wilde concernant l’axiome de l’art pour l’art, entendu que «l’art n’exprime pas les siècles. Il
n’exprime jamais rien que lui-même. Une noble passion, un grand moment de la
pensée humaine ont moins d’importance pour l’art qu’une forme inédite ou un
procédé
prenait de front les tendances réalistes et
naturalistes dans lesquelles il ne voyait qu’une poursuite des valeurs de la
société industrielle : «De là encore
une volonté de se démarquer face au Réalisme régnant, par crainte de voir les
Naturalistes “monter à l’assaut de l’avenir” (Castagnary), cette attitude se
confondant avec une hostilité profonde à l’égard de l’émancipation sociale
(hors celle de William Morris) et la crainte, conséquente, de voir la gauche
s’attaquer aux privilèges de la classe dominante. Dans cette perspective le
sous-ensemble symboliste des années 1870-1900 peut être simultanément
appréhendé comme structure idéologique qui incorporerait les informations d’un
milieu (circonscription physique et sociale) et de l’histoire des paradigmes préexistants, comme engagement
politique qui marquerait l’opposition au positivisme et au matérialisme
historique (opposition qui coïnciderait avec l’“avènement de la science” et
l’épanouissement du mythe du progrès), comme champ sémantique orienté vers
l’anéantissement de l’art à partir de l’angoisse, de la détresse, de la déroute
suscitée par les bouleversements de l’environnement, l’inflation urbaine, les
transformations techniques et économiques, comme manifestation d’une opposition
plus ou moins prononcée au stade de la thermodynamique, producteur massif de la
vapeur qui “siffle et fume pour marcher vers un but auquel on ne croit pas”
(Villiers de l’Isle-Adam)».
À la réalité, le symbolisme opposa la
vérité. Ce fut d’ailleurs le paradoxe
d’Oscar Wilde concernant l’axiome de l’art pour l’art, entendu que «l’art n’exprime pas les siècles. Il
n’exprime jamais rien que lui-même. Une noble passion, un grand moment de la
pensée humaine ont moins d’importance pour l’art qu’une forme inédite ou un
procédé  nouveau. L’art “détourne les yeux” du réel. Il développe et dévoile solitairement sa propre perfection.
Il ne prend dans la réalité qu’un point de départ, et c’est pour le dépasser
aussitôt en exprimant de “belles
choses fausses”. L’artiste, de ce point
de vue, est le menteur superbement doué, et le style - rituel plus important
que le contenu du culte - est l’ensemble des savants moyens qui nous font
accepter et chérir comme vraies ces chimères».
Le même Wilde affirmait, a contrario,
«dans La Décadence du Mensonge […], que la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, il supprime
très consciemment la partie la plus évidente de la vérité pour n’en retenir que
la partie la moins connue. Et le bien
plus est, ici, le petit coup de pouce
qui achève de créer le paradoxe».
Si l’art n’est qu’une interprétation faussée de la réalité, mais que le réel
lui-même imite l’art, alors le mensonge ne peut être que partout, dans le réel
comme dans l’art, et l’artiste perd ce privilège d’être le menteur superbement doué, d’où une vacuité du travail de l’artiste.
La seule façon d’échapper au paradoxe imposait de franchir le seuil de la
métaphysique.
nouveau. L’art “détourne les yeux” du réel. Il développe et dévoile solitairement sa propre perfection.
Il ne prend dans la réalité qu’un point de départ, et c’est pour le dépasser
aussitôt en exprimant de “belles
choses fausses”. L’artiste, de ce point
de vue, est le menteur superbement doué, et le style - rituel plus important
que le contenu du culte - est l’ensemble des savants moyens qui nous font
accepter et chérir comme vraies ces chimères».
Le même Wilde affirmait, a contrario,
«dans La Décadence du Mensonge […], que la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, il supprime
très consciemment la partie la plus évidente de la vérité pour n’en retenir que
la partie la moins connue. Et le bien
plus est, ici, le petit coup de pouce
qui achève de créer le paradoxe».
Si l’art n’est qu’une interprétation faussée de la réalité, mais que le réel
lui-même imite l’art, alors le mensonge ne peut être que partout, dans le réel
comme dans l’art, et l’artiste perd ce privilège d’être le menteur superbement doué, d’où une vacuité du travail de l’artiste.
La seule façon d’échapper au paradoxe imposait de franchir le seuil de la
métaphysique.
 |
M. Dallamaro. Il dio chiamato Dorian. 1970
|
Wilde était bien l’élève des préraphaélites.
Rossetti, Morris, Ruskin… et leurs ennemis étaient les siens : «Prenant fortement position contre les
tentatives de son époque pour transporter en bloc dans le roman les méthodes de
la science, Wilde dénonce, dans le premier des dialogues, le Naturalisme de
Zola, et même tout réalisme systématique, comme l’hérésie la plus monstrueuse
dont l’art ait jamais eu à souffrir. Et l’on voit là la raison profonde de
cette position. L’art ne saurait être réduit, sans déchoir, à copier
servilement le réel, à fournir objectivement des documents humains, à découper des tranches de vie, à n’être plus, en somme, qu’une sorte de
petite science artistique. Pour Wilde, l’art est aussi indépendant de la vie
qu’on peut l’imaginer. Il imite la vie bien moins que celle-ci ne l’imite. Il
imite même la nature bien moins que celle-ci ne l’imite…».
Wilde était sensible aux limites des prétentions du naturalisme critique de
Zola. Nous savons depuis que, devant les confessions d’un uranien avouant son penchant homosexuel, Zola eut une réaction méprisante
et «homophobe». Il y avait donc une vérité qui ne plaisait pas à la réalité
et trahissait la reconstruction littéraire d’une nature à l’échelle des
jugements moraux de l’auteur. Wilde préféra  alors se rallier au mysticisme des
Rossetti et des Moreau, où la vérité transcende
la réalité, tant le réalisme et le
naturalisme s’abîmaient dans ce projet (stérile) de reproduire
une réalité que tout le monde connaissait, comme le rappelait Renan. «La vie, en effet, passe. L’art demeure. Il
sauve de la mort non seulement le nom de l’artiste, mais les fragments du réel
que sa magie a transfigurés. L’art, au surplus, manifeste la seule liberté qui
reste en notre pouvoir. Car l’action non seulement meurt au moment de son
énergie, mais étroitement soumise aux circonstances du temps et de l’espace,
elle ne connaît ni sa propre origine, ni ses propres conséquences. Dans
l’individu même où elle apparaît, elle est toujours nécessaire. Car elle est déterminée par ce principe d’hérédité où Wilde, avec une satisfaction qui
paraîtra quelque peu hâtive, voit la négation de toute responsabilité morale.
Plus légitimement, il y trouve une autorisation de s’abandonner à la vie
contemplative. Cette contemplation,
cependant, ne prendra pas pour objet le monde de la pensée abstraite. […] Seule la contemplation artistique peut nous
satisfaire pleinement, car même dans ses plus humbles manifestations, elle
parle à la fois aux sens et à l’âme».
Wilde, théoricien de l’esthétisme, transposait la sensibilité des préraphaélites
dans l’œuvre romanesque et en particulier dans Le portrait de Dorian Gray, dans lequel temps, mystère, beauté,
vieillissement, épuisement et mort se donnaient rendez-vous.
alors se rallier au mysticisme des
Rossetti et des Moreau, où la vérité transcende
la réalité, tant le réalisme et le
naturalisme s’abîmaient dans ce projet (stérile) de reproduire
une réalité que tout le monde connaissait, comme le rappelait Renan. «La vie, en effet, passe. L’art demeure. Il
sauve de la mort non seulement le nom de l’artiste, mais les fragments du réel
que sa magie a transfigurés. L’art, au surplus, manifeste la seule liberté qui
reste en notre pouvoir. Car l’action non seulement meurt au moment de son
énergie, mais étroitement soumise aux circonstances du temps et de l’espace,
elle ne connaît ni sa propre origine, ni ses propres conséquences. Dans
l’individu même où elle apparaît, elle est toujours nécessaire. Car elle est déterminée par ce principe d’hérédité où Wilde, avec une satisfaction qui
paraîtra quelque peu hâtive, voit la négation de toute responsabilité morale.
Plus légitimement, il y trouve une autorisation de s’abandonner à la vie
contemplative. Cette contemplation,
cependant, ne prendra pas pour objet le monde de la pensée abstraite. […] Seule la contemplation artistique peut nous
satisfaire pleinement, car même dans ses plus humbles manifestations, elle
parle à la fois aux sens et à l’âme».
Wilde, théoricien de l’esthétisme, transposait la sensibilité des préraphaélites
dans l’œuvre romanesque et en particulier dans Le portrait de Dorian Gray, dans lequel temps, mystère, beauté,
vieillissement, épuisement et mort se donnaient rendez-vous.
 |
| Aubrey Beardsley. Edgar Poe |
D’où qu’il nous apparaît que le symbolisme
entrouvrait des portes qui menaient ailleurs, sur des considérations
métaphysiques, sur les rapports de l’art et de la vie, ou de la réalité; des
portes qui débouchaient sur le merveilleux (côté médiéval) ou le fantastique,
le bizarre ou le grotesque (côté romantique) : «deux tendances opposées et successives : l’apogée du réalisme bourgeois
antiromantique, puis la dissolution de ce réalisme accompagnée du décadentisme
et du goût du péché. C’est aussi le développement de la presse, donc du nombre
des lecteurs pressés, et par voie de conséquence, en même temps que des
feuilletons, on écrit pour elle beaucoup de nouvelles. Pratiquement tous les
grands auteurs en donnent aux journaux. À un public de plus en plus sceptique
et sophistiqué, donc moins enclin à confondre l’art et la vie, on peut offrir
de vrais fantômes, de préférence dans des histoires courtes car la peur dans la
lecture risque de ne pas durer longtemps chez le lecteur incrédule dans la vie.
Réalisme et humour servent à jouer avec ce scepticisme, à l’utiliser, comme dit
joliment Raphael Llopis…: procédés cultivés par Edgar Poe, qui parviennent à
maturité avec Sheridan Le Fanu connaissent leur apogée à l’époque de l’orfèvre
des orfèvres en cette matière. M. R. James. Pourtant, après Hoffman le réalisme
ne sert plus guère le fantastique allemand à qui il faut du nébuleux, du vague;
aussi bien cette littérature a-t-elle tendance à disparaître en Allemagne, une
fois passé l’apogée du romantisme, et ce jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il n’en
va pas de même en France, ni  surtout, bien sûr, en Angleterre et aux
États-Unis. […] Pendant toute cette
période, surtout dans la seconde moitié, on cultive volontiers dans les arts en
général un climat d’étrangeté, qui s’accorde assez bien avec le numineux que
sécrètent les récits fantastiques. Un autre élément littéraire favorable est le
roman policier…».
Les conversions de Wilde et de Verlaine lors de leur période de détention après
les scandales qui les mirent en valeur provenaient possiblement de cette
intrusion dans le domaine métaphysique. Mais leur religiosité relevait peu du
catholicisme authentique : «Sans être
religieux, le symbolisme offre d’autres perspectives sur les richesses de la
personne humaine. Le Roman Russe
d’Eugène-Melchior de Vogüé qui fait appel aux “puissances invincibles du désir
et du rêve”, lui ouvre en 1885 les horizons nostalgiques de l’âme slave, et le
drame ibsenien lui apporte l’affirmation de la dignité de l’âme. Est-il besoin
de le rappeler? plusieurs de ses plus grands poètes ont des accents chrétiens :
le remords arrache des prières à Verlaine et les vers de Rimbaud évoquent une
charité qui est amour».
Était-ce parce que ces importations ne trouvaient pas racines dans leurs âmes
que ces conversions durèrent le temps
de la persécution et s’évanouirent une fois les forçats retournés à la liberté?
L’avenir de la tendance symboliste lui-même en sera hypothéqué, tant, selon
l’anthropologue Gilbert Durand, «le
mouvement symboliste est bien le signe d’une saturation des visions du monde
trop contingentées par l’idéologie du progressisme scientifique dont le
néo-impressionnisme fut l’un des paradigmes».
Si le réalisme s’associait à la foi religieuse du scientisme, le symbolisme chercha
plutôt du côté de l’occulte, allant jusqu’à inverser, chez un Félicien Rops, le
culte catholique pour la démonolâtrie. Le diable de Baudelaire donnait à se
manifester dans les arts alors que son adversaire venait d’être proclamé mort
par Nietzsche. Mais, faut-il le préciser? le symbolisme n’a pas été créé pour
servir les sciences occultes, mais son
approche de l’art et de la littérature, à elles aussi, entrouvrait ses
portes.
surtout, bien sûr, en Angleterre et aux
États-Unis. […] Pendant toute cette
période, surtout dans la seconde moitié, on cultive volontiers dans les arts en
général un climat d’étrangeté, qui s’accorde assez bien avec le numineux que
sécrètent les récits fantastiques. Un autre élément littéraire favorable est le
roman policier…».
Les conversions de Wilde et de Verlaine lors de leur période de détention après
les scandales qui les mirent en valeur provenaient possiblement de cette
intrusion dans le domaine métaphysique. Mais leur religiosité relevait peu du
catholicisme authentique : «Sans être
religieux, le symbolisme offre d’autres perspectives sur les richesses de la
personne humaine. Le Roman Russe
d’Eugène-Melchior de Vogüé qui fait appel aux “puissances invincibles du désir
et du rêve”, lui ouvre en 1885 les horizons nostalgiques de l’âme slave, et le
drame ibsenien lui apporte l’affirmation de la dignité de l’âme. Est-il besoin
de le rappeler? plusieurs de ses plus grands poètes ont des accents chrétiens :
le remords arrache des prières à Verlaine et les vers de Rimbaud évoquent une
charité qui est amour».
Était-ce parce que ces importations ne trouvaient pas racines dans leurs âmes
que ces conversions durèrent le temps
de la persécution et s’évanouirent une fois les forçats retournés à la liberté?
L’avenir de la tendance symboliste lui-même en sera hypothéqué, tant, selon
l’anthropologue Gilbert Durand, «le
mouvement symboliste est bien le signe d’une saturation des visions du monde
trop contingentées par l’idéologie du progressisme scientifique dont le
néo-impressionnisme fut l’un des paradigmes».
Si le réalisme s’associait à la foi religieuse du scientisme, le symbolisme chercha
plutôt du côté de l’occulte, allant jusqu’à inverser, chez un Félicien Rops, le
culte catholique pour la démonolâtrie. Le diable de Baudelaire donnait à se
manifester dans les arts alors que son adversaire venait d’être proclamé mort
par Nietzsche. Mais, faut-il le préciser? le symbolisme n’a pas été créé pour
servir les sciences occultes, mais son
approche de l’art et de la littérature, à elles aussi, entrouvrait ses
portes.
 |
| Dante Gabriel Rossetti. Pandore, 1871. |
 |
| John Collier. Lady Godiva, 1898. |
Comme le préraphaélisme de l’autre côté de la
Manche, «le symbolisme est une quête de
sens essentiellement teintée de nostalgie face à la réalité existentielle à
laquelle il fait face en cette fin de siècle. L’effort esthétique du symbolisme
se situe tout entier dans un acte de révélation d’une réalité absente ou
perdue. Il s’agit de “rendre tangible une qualité inconnue, une valeur
recherchée”, note M. Gibson. Cette observation permet de saisir la puissance du
sentiment d’idéalisme qui habite le mouvement. Il s’agit d’évoquer, de suggérer
un univers qui dans son essence appartient à l’imaginaire. Le symbolisme se
caractérise avant tout comme un irréalisme, mais, plus encore, il adopte une
position que l’on peut qualifier d’anti-réaliste. En effet, le réel auquel il
est confronté est reçu par le mouvement comme inconsistant et brimant les
capacités de l’esprit. Les vertus de celui-ci ne peuvent être révélées que dans
l’univers de l’imaginaire qui s’inscrit contre une réalité que le symbolisme
cherche constamment à dépasser. Il s’agit, en fait de toucher aux dimensions de
l’être qui ne peuvent être atteintes qu’en accédant au domaine du caché, de
l’invisible».
Contrairement à la virilité dégagée par les œuvres de Courbet ou les écrits de
Zola, le symbolisme va offrir une peinture éthérée, liquide, fantastique; ses
peintres seront «ces Maniéristes du XIXe
siècle […]. Je veux simplement situer
les Symbolistes, de manière à attirer quelque peu l’attention sur eux, de même
que sur leurs tenants et aboutissants, et pour la même raison. On peut faire
état, je
 |
| Maurice Denis. Daphnis et Chloé. |
crois, parmi leurs précurseurs, de “primitivistes” tels que les
Nazaréens et les Préraphaélites. Bien que datant des premières décennies du
siècle, des œuvres comme celles de Pforr, J.-Everett Millais, Burne-Jones ou
Rossetti témoignent déjà de l’aisance doucereuse et du pseudo-mysticisme de
serres chaudes qui caractériseront les œuvres proprement symbolistes des années
80. Cette fadeur de dragée est exquise sous le palais et, effectivement, nous
le retrouverons intacte devant la Teteninsel de Böcklin et l’Ève de
Lévy-Dhurmer. Les traits communs des néo-primitifs et des Symbolistes sont
cette même “manière” de rechercher l’affectation des poses et des sentiments en
les exprimant par la mollesse du tracé et la délicieuse mièvrerie du coloris. […] On peut aussi penser, au-delà de l’école de
Pont-Aven, restituer son milieu originel à l’œuvre d’un Gauguin, trop souvent
isolé, en évoquant le Bonnard des débuts, Paul Sérusier et Maurice Denis, par
exemple. À l’extrême fin du siècle, enfin, avec Aubrey Beardslay et Gustave
Moreau, nous trouvons les dernières incarnations - et peut-être les
 |
| D. G. Rossetti. Sibylla Palmifera |
plus
brillantes - de ce style symboliste, et tout à la fois les premières amorces de
ce qui, autour de 1900, deviendra l’“Art nouveau”. Toute cassure, à ce niveau,
ne peut d’ailleurs être qu’artificielle : le “Modern Style” prolonge le
symbolisme, à cette différence près peut-être qu’il le superficialise, c’est-à-dire
qu’il cultivera la grâce pour elle-même, sans plus aucune caution obligée sur
le plan esthétique ou idéologique: le motif floral, triomphant, pourra
désormais se passer d’évoquer l’ombre d’Ophélie…».
Ayant totalement assimilé le caractère féminin déjà souligné à propos des
œuvres préraphaélites le Modern
Style pourra, au tournant du siècle, le diffuser à profusion avec les
motifs floraux comme ornement d’intérieur : «L’esprit fin du siècle se manifeste par le raffinement esthétique, le
culte de l’art et de la beauté sensuelle et nous vaut les excentricités de l’“aestheticLady” vêtue de “drapés sinueux et de
verts extraordinaires”, ses recherches de langage et son âme “intense” […]. Le culte de “l’art pour l’art”, le désir
agressif d’épanouissement esthétique et sensuel, la quête d’originalité font
partie d’une révolte contre la tyrannie de la respectabilité bourgeoise, contre
le conformisme moral et social de l’ère victorienne. Cette explosion de
“nouveauté” comporte en même temps une mise en question du code de valeur des
cinquante années précédentes, notamment de la famille, du mariage chrétien et
bourgeois et des idées reçues sur la “féminité”. Esthétisme - avec certains
aspects décadents des dessins d’Aubrey Beardsley et des œuvres d’Oscar Wilde -
individualisme exacerbé, certes, mais aussi prise de conscience sociale aiguë,
aspirations utopiques à une société plus juste où l’individu pourra vivre une
vie meilleure».
Le paradoxe du symbolisme fut que, tout en étant plus qu’une critique un refus
de la modernité technologique et démocratique, il était un parfait représentant
de la mentalité de l’époque : une nostalgie, un spiritualisme, un goût
malsain pour le dégénéré mais aussi une volonté d’accéder pour le plus grand
nombre au bonheur .
 |
| Arnold Böcklin. L'Île de la Mort, 1880, |
La comparaison avec le maniérisme est juste.
L’art symboliste, qu’il soit préraphaélite ou continental, avait pour but de
répondre, par la légèreté de lignes ondulées, à l’épuisement de l’espace
figuratif de la perspective italienne : «Une chose paraît certaine, en tous cas : c’est, dans le secteur
pictural, l’attachement aux processus les plus classiques de la mimesis et une
tentative de réinvestir une syntaxe fatiguée par plus de quatre siècles d’usage
en la manipulant pour donner une substance iconique à l’image rêvée : c’est là
que les “marginaux” symbolistes s’inscrivent à distance de l’art  “officiel”
tout en portant délibérément leur démarche sur le front idéaliste. De là les
points d’appui qu’ils prennent dans la légende grecque, celtique,
judéo-chrétienne : pour culturaliser leur production et la rendre accessible
seulement à une classe».
Car tout cela ne s’adresse pas au commun des mortels, contrairement aux
tableaux historiques de Courbet. Le Manifeste symbolique rédigé par le critique
d’art G. Albert Aurier, en 1891, se termine par ces cinq points qui entendent
résumer l’essentiel du mouvement : «Donc,
pour enfin se résumer et conclure, l’œuvre d’art telle qu’il m’a plu de la
logiquement évoquer sera : 1° idéiste, puisque son idéal unique sera l’expression
de l’Idée; 2° symboliste, puisqu’elle
exprimera cette Idée par des formes; 3° synthétique, puisqu’elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de
compréhension générale; 4° subjective,
puisque l’objet n’y sera jamais considéré en tant qu’objet, mais en tant que
signe d’idée perçue par le sujet; 5° (c’est une conséquence) décorative, car la peinture décorative proprement
dite, telle que l’ont comprise les Égyptiens, très probablement les Grecs et
les Primitifs, n’est rien autre chose qu’une manifestation d’art à la fois
subjective, synthétique, symboliste et idéiste».
On ne pouvait guère mieux résumer ce qu’on retrouvait dans les tableaux
symbolistes. Quelques années plus tard, en 1895, un second manifeste, celui de
Maurice Denis, préciserait qu’il faut «se
rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de bataille, une
“officiel”
tout en portant délibérément leur démarche sur le front idéaliste. De là les
points d’appui qu’ils prennent dans la légende grecque, celtique,
judéo-chrétienne : pour culturaliser leur production et la rendre accessible
seulement à une classe».
Car tout cela ne s’adresse pas au commun des mortels, contrairement aux
tableaux historiques de Courbet. Le Manifeste symbolique rédigé par le critique
d’art G. Albert Aurier, en 1891, se termine par ces cinq points qui entendent
résumer l’essentiel du mouvement : «Donc,
pour enfin se résumer et conclure, l’œuvre d’art telle qu’il m’a plu de la
logiquement évoquer sera : 1° idéiste, puisque son idéal unique sera l’expression
de l’Idée; 2° symboliste, puisqu’elle
exprimera cette Idée par des formes; 3° synthétique, puisqu’elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de
compréhension générale; 4° subjective,
puisque l’objet n’y sera jamais considéré en tant qu’objet, mais en tant que
signe d’idée perçue par le sujet; 5° (c’est une conséquence) décorative, car la peinture décorative proprement
dite, telle que l’ont comprise les Égyptiens, très probablement les Grecs et
les Primitifs, n’est rien autre chose qu’une manifestation d’art à la fois
subjective, synthétique, symboliste et idéiste».
On ne pouvait guère mieux résumer ce qu’on retrouvait dans les tableaux
symbolistes. Quelques années plus tard, en 1895, un second manifeste, celui de
Maurice Denis, préciserait qu’il faut «se
rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de bataille, une  femme nue ou
une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées.” [L’auteur ajoute, en 1895 : “et
pour le plaisir des yeux”]. «Sur ce
document s’articule, en 1892, l’article-manifeste qu’Albert Aurier donne à la Revue
Encyclopédique quelques mois avant sa
mort : “De toute part, précise le poète, on revendique le droit au rêve, le
droit aux pâturages de l’azur, le droit à l’envolement vers les étoiles niées
de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, l’imitation
imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la
gloire d’être aussi fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne
contente plus aucun peintre, aucun sculpteur digne de ce nom”. Ici apparaît
l’une des alternatives du symbolisme : celle qui opte pour “l’expression par le
décor, par l’harmonie des formes et des couleurs”. À ce niveau l’œuvre prétend
être un “équivalent décoratif” à “toute émotion humaine”. Pour Maurice Denis le
symbolisme est “l’expression des émotions et des pensées humaines par des
correspondants esthétiques”. La tendance ramène le symbolisme à une structure
de surface, celle qui va soutenir le développement du Modern Style, vu comme
phénomène formel et visuel “ornemental”, “décoratif”; moyen apparemment
innocent de mettre entre parenthèses les réalités socio-politiques
environnantes tout en incorporant un comportement viscéral à la pratique signifiante
: contradictoirement les conduites du corps vont, dans l’Art Nouveau des années
1890-1900, recouvrir l’hypo-symbolisme
tel qu’il est circonscrit par M. Denis à partir d’une conscience religieuse
très prononcée (sans jamais atteindre l’acuité du sens du sacré inhérent à la
démarche de Gauguin)».
Le symbolisme semblait mener aussi directement au post-impressionnisme que
l’impressionnisme était sorti du réalisme, le tout allant se fondre dans
l’expressionnisme. La convergence de
tendances aussi opposées dans leur trajectoire semblait attirer les artistes
depuis l’affrontement de 1870.
femme nue ou
une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées.” [L’auteur ajoute, en 1895 : “et
pour le plaisir des yeux”]. «Sur ce
document s’articule, en 1892, l’article-manifeste qu’Albert Aurier donne à la Revue
Encyclopédique quelques mois avant sa
mort : “De toute part, précise le poète, on revendique le droit au rêve, le
droit aux pâturages de l’azur, le droit à l’envolement vers les étoiles niées
de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, l’imitation
imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la
gloire d’être aussi fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne
contente plus aucun peintre, aucun sculpteur digne de ce nom”. Ici apparaît
l’une des alternatives du symbolisme : celle qui opte pour “l’expression par le
décor, par l’harmonie des formes et des couleurs”. À ce niveau l’œuvre prétend
être un “équivalent décoratif” à “toute émotion humaine”. Pour Maurice Denis le
symbolisme est “l’expression des émotions et des pensées humaines par des
correspondants esthétiques”. La tendance ramène le symbolisme à une structure
de surface, celle qui va soutenir le développement du Modern Style, vu comme
phénomène formel et visuel “ornemental”, “décoratif”; moyen apparemment
innocent de mettre entre parenthèses les réalités socio-politiques
environnantes tout en incorporant un comportement viscéral à la pratique signifiante
: contradictoirement les conduites du corps vont, dans l’Art Nouveau des années
1890-1900, recouvrir l’hypo-symbolisme
tel qu’il est circonscrit par M. Denis à partir d’une conscience religieuse
très prononcée (sans jamais atteindre l’acuité du sens du sacré inhérent à la
démarche de Gauguin)».
Le symbolisme semblait mener aussi directement au post-impressionnisme que
l’impressionnisme était sorti du réalisme, le tout allant se fondre dans
l’expressionnisme. La convergence de
tendances aussi opposées dans leur trajectoire semblait attirer les artistes
depuis l’affrontement de 1870.
 |
| Frank Dicksee. La Belle Dame sans Merci |
En effet. «même
si la guerre franco-allemande de 1870 a galvanisé la conscience des
nationalités, des traverses idéologiques relient les différences, aussi
dialectiques soient-elles, car c’est le même objectif politique que poursuivent
Puvis de Chavannes et Hans von Marées, Böcklin et Rossetti, Anselm Feuerbach et
Gustave Moreau : maintenir à l’image “classique” sa vocation allusive et son
pouvoir d’illusion, faire échec à l’impact socio-culturel de la peinture
élaborée en prise directe sur le tissu social, établir une distanciation
suffisante entre la fonction poétique et la fonction pratique de l’image pour
qu’elle puisse à la fois qualifier le “génie” national et protéger les ancrages
de la bourgeoisie triomphante»,
Cette position réactionnaire, on l’a dit, invitait l’archaïsme, la quête d’un
passé imbu de sens que la modernité et le réalisme avaient chassés. Les
symbolistes étaient toutefois loin de se concerter afin de créer un nouveau
langage; entre eux, c’était plutôt la dispute, comme parmi les poètes : «Le nombre limité de ceux qui comprenaient la
poésie symboliste ne présentait pas toujours un front uni. Ils étaient divisés
par des jalousies mesquines aussi bien que par des divergences de théorie et
d’interprétation. En effet, la multitude de petites revues fondées en ces
 années, s’adressant toutes plus ou moins au même cercle restreint de lecteurs,
semble refléter les querelles intestines dont souffrait le symbolisme. Chaque
dissident paraît avoir publié presque automatiquement un autre périodique. Il y
eut également de fréquentes et contradictoires déclarations quant à savoir
quels étaient, sur le nouveau mouvement, les exposés autorisés».
L’ésotérisme du genre contribuait sans doute beaucoup à cette difficulté de
trouver une tonalité commune. Les peintres, eux, se distribuèrent selon les
écoles de poésie symboliste : «Quelquefois,
Seurat, avec Signac, Dubois-Pillet et Charles Henry, se joignait à un groupe de
poètes et d’écrivains à la Brasserie Gambrinus où, de 1884 à 1886, se réunissaient presque tous les soirs Jean
Moréas, Gustave Kahn, Félix Fénéon, Paul Adam, Édouard Dujardin, éditeur de La
Revue wagnérienne, Teodor de Wyzewa,
critique hostile aux théories de Seurat, Jean Ajalbert, Maurice Barrès, Jules
Laforgue et leurs amis. C’est dans cette brasserie qu’avaient été fondées La
Revue indépendante et l’éphémère revue La
Vogue; c’est là que, selon Jules
Christophe, “naquit du dégoût des grossières, toutes extérieures et déjà
vieilles formules naturalistes, le symbolisme, enquêteur d’âmes, de nuances
fragiles, de commas sensationnels, de fugitives et combien - quelquefois - douloureuses ou intensives impressions, donc art ésotérique, forcément
aristocratique, un peu
années, s’adressant toutes plus ou moins au même cercle restreint de lecteurs,
semble refléter les querelles intestines dont souffrait le symbolisme. Chaque
dissident paraît avoir publié presque automatiquement un autre périodique. Il y
eut également de fréquentes et contradictoires déclarations quant à savoir
quels étaient, sur le nouveau mouvement, les exposés autorisés».
L’ésotérisme du genre contribuait sans doute beaucoup à cette difficulté de
trouver une tonalité commune. Les peintres, eux, se distribuèrent selon les
écoles de poésie symboliste : «Quelquefois,
Seurat, avec Signac, Dubois-Pillet et Charles Henry, se joignait à un groupe de
poètes et d’écrivains à la Brasserie Gambrinus où, de 1884 à 1886, se réunissaient presque tous les soirs Jean
Moréas, Gustave Kahn, Félix Fénéon, Paul Adam, Édouard Dujardin, éditeur de La
Revue wagnérienne, Teodor de Wyzewa,
critique hostile aux théories de Seurat, Jean Ajalbert, Maurice Barrès, Jules
Laforgue et leurs amis. C’est dans cette brasserie qu’avaient été fondées La
Revue indépendante et l’éphémère revue La
Vogue; c’est là que, selon Jules
Christophe, “naquit du dégoût des grossières, toutes extérieures et déjà
vieilles formules naturalistes, le symbolisme, enquêteur d’âmes, de nuances
fragiles, de commas sensationnels, de fugitives et combien - quelquefois - douloureuses ou intensives impressions, donc art ésotérique, forcément
aristocratique, un peu  “fumiste”, si l’on veut, où se trouve comme un désir de
mystification qui se venge de l’universelle sottise, art qui se réclame de la
science et du rêve, évocateur de schémas, c’est-à-dire de toute forme existante
dans l’entendement et en dehors de la matière même, art spiritualiste et
pyrrhonien, nihiliste, religieux et athée, même wagnérien”».
Encore une fois, c’était une commune haine du réalisme et du naturalisme qui réunissaient
ceux que l’on rassembla sous l’étiquette symboliste
plutôt qu’un projet artistique ou littéraire commun Alors que les écrivains, Aurier ou Denis, donnaient leur
définition du symbolisme, ce furent le post-impressionniste «Gauguin et les synthétistes» (Pont Aven) qui exprimèrent «une thèse […] à laquelle nous donnons le nom de Symbolisme
: l’œuvre d’art n’est pas expressive mais représentative, elle est un
corrélatif du sentiment et non pas une expression du sentiment».
Malgré les dissensions, la caractéristique de l’équivalent demeurait le sens commun du mouvement symboliste.
On aurait tort toutefois de croire que la
tendance symboliste ne fit pas d’efforts dans le but de s’affirmer avec la même
autorité rebelle que leurs adversaires. Comme les impressionnistes, les
symbolistes réfléchissaient sur les mécanismes de la vue, mais plutôt que d’y
chercher la reproduction parfaite de la perception oculaire, ils orientaient
leurs recherches vers la suggestivité des perceptions avec les sensibilités psychologiques :
«Étant donné la structure de l’œil et sa
physiologie, le mécanisme des associations et les lois de la sensibilité
(telles du moins que nous les connaissons encore), ils en tirèrent les lois de
l’œuvre d’art et obtinrent tout de suite en s’y conformant des expressions plus
intenses. Dès lors, au lieu de chercher, toujours en vain, à restituer telles
quelles leurs sensations, ils s’appliquèrent à y substituer des
“fumiste”, si l’on veut, où se trouve comme un désir de
mystification qui se venge de l’universelle sottise, art qui se réclame de la
science et du rêve, évocateur de schémas, c’est-à-dire de toute forme existante
dans l’entendement et en dehors de la matière même, art spiritualiste et
pyrrhonien, nihiliste, religieux et athée, même wagnérien”».
Encore une fois, c’était une commune haine du réalisme et du naturalisme qui réunissaient
ceux que l’on rassembla sous l’étiquette symboliste
plutôt qu’un projet artistique ou littéraire commun Alors que les écrivains, Aurier ou Denis, donnaient leur
définition du symbolisme, ce furent le post-impressionniste «Gauguin et les synthétistes» (Pont Aven) qui exprimèrent «une thèse […] à laquelle nous donnons le nom de Symbolisme
: l’œuvre d’art n’est pas expressive mais représentative, elle est un
corrélatif du sentiment et non pas une expression du sentiment».
Malgré les dissensions, la caractéristique de l’équivalent demeurait le sens commun du mouvement symboliste.
On aurait tort toutefois de croire que la
tendance symboliste ne fit pas d’efforts dans le but de s’affirmer avec la même
autorité rebelle que leurs adversaires. Comme les impressionnistes, les
symbolistes réfléchissaient sur les mécanismes de la vue, mais plutôt que d’y
chercher la reproduction parfaite de la perception oculaire, ils orientaient
leurs recherches vers la suggestivité des perceptions avec les sensibilités psychologiques :
«Étant donné la structure de l’œil et sa
physiologie, le mécanisme des associations et les lois de la sensibilité
(telles du moins que nous les connaissons encore), ils en tirèrent les lois de
l’œuvre d’art et obtinrent tout de suite en s’y conformant des expressions plus
intenses. Dès lors, au lieu de chercher, toujours en vain, à restituer telles
quelles leurs sensations, ils s’appliquèrent à y substituer des  équivalents. Il y avait donc étroite correspondance
entre des formes et des émotions. Les phénomènes signifient des états d’âme, et
c’est le symbolisme. La matière est devenue expressive et la chair s’est faite
le verbe. […] Le symbolisme s’appuie
donc tout entier sur une de ces vérités très simples que confirment à la fois,
depuis les temps les plus reculés, la tradition et l’expérience. […] En fait, et c’est ici que le symbolisme
historique des années 1870-1900 trouve sa véritable dimension, la “conscience
du symbole”, pour mettre en échec le réalisme positiviste ou le “naturalisme”
a, contradictoirement, marqué un retour à l’état de nature, à l’homme en qui
l’expérience primordiale survit dans l’expérience individuelle».
Pour illustrer le type de penser auquel conduisait le symbolisme, il suffit de
mentionner le nom, en photographie, d’«Émile
Joachim Constant Puyo (1857-1933) [qui]
a laissé une description de l’éclairage compliqué auquel il a eu recours pour
réaliser sa “Tête de Gorgone”; “…je dirais que je voulais plonger les orbites
dans l’ombre, mettre le front et le nez en lumière, et faire ressortir les
contours qui forment le cadre osseux du visage. Pour produire cet effet, j’ai
enveloppé une lampe dans un tissu et je l’ai placée à une distance de 50
centimètres au-dessus du front; la lumière frappe directement l’os frontal et
l’arête du nez…” Pour le choix de ses sujets, il s’inscrivait comme nombre
d’artistes des années 1890 dans le courant de “l’imagination décadente”».
Le plus honorable que l’on puisse dire de la recherche symboliste, c’est
qu’elle consistait à «découvrir par le
langage un monde transcendant [et que ce fut là] la préoccupation de bien des artistes. Par là se rénovait dans tous
les pays, depuis le symbolisme, une langue que le naturalisme avait réduite à
la banalité de la vie quotidienne».
Cela, les écrivains furent les mieux placés pour le formuler.
équivalents. Il y avait donc étroite correspondance
entre des formes et des émotions. Les phénomènes signifient des états d’âme, et
c’est le symbolisme. La matière est devenue expressive et la chair s’est faite
le verbe. […] Le symbolisme s’appuie
donc tout entier sur une de ces vérités très simples que confirment à la fois,
depuis les temps les plus reculés, la tradition et l’expérience. […] En fait, et c’est ici que le symbolisme
historique des années 1870-1900 trouve sa véritable dimension, la “conscience
du symbole”, pour mettre en échec le réalisme positiviste ou le “naturalisme”
a, contradictoirement, marqué un retour à l’état de nature, à l’homme en qui
l’expérience primordiale survit dans l’expérience individuelle».
Pour illustrer le type de penser auquel conduisait le symbolisme, il suffit de
mentionner le nom, en photographie, d’«Émile
Joachim Constant Puyo (1857-1933) [qui]
a laissé une description de l’éclairage compliqué auquel il a eu recours pour
réaliser sa “Tête de Gorgone”; “…je dirais que je voulais plonger les orbites
dans l’ombre, mettre le front et le nez en lumière, et faire ressortir les
contours qui forment le cadre osseux du visage. Pour produire cet effet, j’ai
enveloppé une lampe dans un tissu et je l’ai placée à une distance de 50
centimètres au-dessus du front; la lumière frappe directement l’os frontal et
l’arête du nez…” Pour le choix de ses sujets, il s’inscrivait comme nombre
d’artistes des années 1890 dans le courant de “l’imagination décadente”».
Le plus honorable que l’on puisse dire de la recherche symboliste, c’est
qu’elle consistait à «découvrir par le
langage un monde transcendant [et que ce fut là] la préoccupation de bien des artistes. Par là se rénovait dans tous
les pays, depuis le symbolisme, une langue que le naturalisme avait réduite à
la banalité de la vie quotidienne».
Cela, les écrivains furent les mieux placés pour le formuler.
Contrairement au réalisme qui se transforma en
naturalisme grâce au travail des romanciers, «l’époque symboliste se désintéresse du “roman”. On n’y croit plus aux
récits bien faits. Ils sont pédants : et, de  l’essentiel, ils ne disent
rien. On croit davantage à la poésie parce que, même évanescente - et à vrai
dire cette époque ne donna aucun chef-d’œuvre poétique -, la poésie joue entre
plusieurs épaisseurs de la réalité, suggère toujours ce que l’on ne dit pas, et
ne prétend pas “expliquer”, comme le roman, tout ce qui se passe…».
Ce furent donc les poètes qui se chargèrent de représenter la tendance
symboliste en littérature. Le poète français le plus retenu, en tant que
théoricien du mouvement plutôt que par ses œuvres elles-mêmes, maintenant oubliées,
c’est Jean Moréas poète français d’origine grecque (1856-1910). Il appartenait
à cette nouvelle génération en réaction «contre
le naturalisme littéraire et son “manque de mystère”, ses descriptions
soigneuses plutôt que la suggestion et l’évocation de “climats”. Ainsi, en
automne 1886, Jean Moréas publia son Manifeste du symbolisme fort discuté, annonçant les principes d’une
nouvelle conception littéraire. Moréas était vaillamment soutenu par Gustave Kahn qui venait précisément de mettre le point final à un volume de poésies,
écrites en ce qu’il appelait “vers libres”, dont le dédain pour la syntaxe
traditionnelle
l’essentiel, ils ne disent
rien. On croit davantage à la poésie parce que, même évanescente - et à vrai
dire cette époque ne donna aucun chef-d’œuvre poétique -, la poésie joue entre
plusieurs épaisseurs de la réalité, suggère toujours ce que l’on ne dit pas, et
ne prétend pas “expliquer”, comme le roman, tout ce qui se passe…».
Ce furent donc les poètes qui se chargèrent de représenter la tendance
symboliste en littérature. Le poète français le plus retenu, en tant que
théoricien du mouvement plutôt que par ses œuvres elles-mêmes, maintenant oubliées,
c’est Jean Moréas poète français d’origine grecque (1856-1910). Il appartenait
à cette nouvelle génération en réaction «contre
le naturalisme littéraire et son “manque de mystère”, ses descriptions
soigneuses plutôt que la suggestion et l’évocation de “climats”. Ainsi, en
automne 1886, Jean Moréas publia son Manifeste du symbolisme fort discuté, annonçant les principes d’une
nouvelle conception littéraire. Moréas était vaillamment soutenu par Gustave Kahn qui venait précisément de mettre le point final à un volume de poésies,
écrites en ce qu’il appelait “vers libres”, dont le dédain pour la syntaxe
traditionnelle  inquiéta Mallarmé».
Comme Zola dans son Roman naturaliste, Moréas
annonçait une nouvelle ère artistique et poétique : «Buts et moyens étaient définis par Moréas dans son manifeste : “La
poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins,
ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l’Idée,
demeurerait sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée
des somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel
de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée
en soi… “Pour la traduction exacte de sa synthèse, il faut au symbolisme un
style archétype et complexe: d’impollués vocables, la période qui s’arc-boute,
alternant avec la période aux défaillances ondulées, les pléonasmes
significatifs, les mystérieuses ellipses, l’anacoluthe en suspens, tout trope
hardi et multiforme : enfin, la bonne langue.” Et Moréas continuait en répétant
: “L’art ne saurait chercher en l’objectif qu’un simple point de départ
extrêmement succint”».
Il se trouvait que «dans sa théorie de la
poésie, Kahn explique l’utilisation d’impulsions dynamogéniques ou inhibitoires
dans le vers, l’assonance, la continuité et d’autres éléments de rythme et de
structure qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’il était influencé par le Cercle
chromatique (1888) de son ami. En cet
ouvrage, Henry analyse la langue et la musique d’une manière analogue à son
analyse des couleurs, sa théorie de la psychologie perceptuelle étant à base de
ses études sur les trois branches de l’art : peinture, poésie et musique. Kahn
établit des rapports entre émotions et sons et rythme comme le fait Henyi».
inquiéta Mallarmé».
Comme Zola dans son Roman naturaliste, Moréas
annonçait une nouvelle ère artistique et poétique : «Buts et moyens étaient définis par Moréas dans son manifeste : “La
poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins,
ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l’Idée,
demeurerait sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée
des somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel
de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée
en soi… “Pour la traduction exacte de sa synthèse, il faut au symbolisme un
style archétype et complexe: d’impollués vocables, la période qui s’arc-boute,
alternant avec la période aux défaillances ondulées, les pléonasmes
significatifs, les mystérieuses ellipses, l’anacoluthe en suspens, tout trope
hardi et multiforme : enfin, la bonne langue.” Et Moréas continuait en répétant
: “L’art ne saurait chercher en l’objectif qu’un simple point de départ
extrêmement succint”».
Il se trouvait que «dans sa théorie de la
poésie, Kahn explique l’utilisation d’impulsions dynamogéniques ou inhibitoires
dans le vers, l’assonance, la continuité et d’autres éléments de rythme et de
structure qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’il était influencé par le Cercle
chromatique (1888) de son ami. En cet
ouvrage, Henry analyse la langue et la musique d’une manière analogue à son
analyse des couleurs, sa théorie de la psychologie perceptuelle étant à base de
ses études sur les trois branches de l’art : peinture, poésie et musique. Kahn
établit des rapports entre émotions et sons et rythme comme le fait Henyi».
 Charles Henry (1859-1926), en effet, avait publié ses études sur le cercle chromatique qui représentait l’ordonnancement des couleurs (primaires et
secondaires) et n’en était pas moins un positiviste. Autant que les
impressionnistes, les symbolistes allaient puiser dans ce cercle chromatique les
éléments pour construire leurs peintures. Pour les poètes, le principe
similaire devait être trouvé dans la sonorité des rythmes, des vers, des
compositions. Comme le reconnaît Marcel Raymond : «Un des plus grands mérites des symbolistes est d’avoir pris conscience
de ces phénomènes complexes. “En écriture, de par l’abondance, je procède
musiciennement, perchant les mots sur les portées d’orchestration : voici les
cordes et les bois, voilà les cuivres et la batterie…” Ces affirmations
pittoresques, qui sont de Saint-Pol-Roux, nous laissent voir comment une vertu,
poussée à l’extrême, peut se retourner contre elle-même. L’usage systématique a
conduit à une nouvelle servitude et à deux erreurs principales, semble-t-il :
D’abord, les symbolistes ont trop souvent sacrifié la musicalité intérieure aux
simples jeux de
Charles Henry (1859-1926), en effet, avait publié ses études sur le cercle chromatique qui représentait l’ordonnancement des couleurs (primaires et
secondaires) et n’en était pas moins un positiviste. Autant que les
impressionnistes, les symbolistes allaient puiser dans ce cercle chromatique les
éléments pour construire leurs peintures. Pour les poètes, le principe
similaire devait être trouvé dans la sonorité des rythmes, des vers, des
compositions. Comme le reconnaît Marcel Raymond : «Un des plus grands mérites des symbolistes est d’avoir pris conscience
de ces phénomènes complexes. “En écriture, de par l’abondance, je procède
musiciennement, perchant les mots sur les portées d’orchestration : voici les
cordes et les bois, voilà les cuivres et la batterie…” Ces affirmations
pittoresques, qui sont de Saint-Pol-Roux, nous laissent voir comment une vertu,
poussée à l’extrême, peut se retourner contre elle-même. L’usage systématique a
conduit à une nouvelle servitude et à deux erreurs principales, semble-t-il :
D’abord, les symbolistes ont trop souvent sacrifié la musicalité intérieure aux
simples jeux de  sonorités; de là l’abus des “cordes” et des “cuivres”. En
outre, justement soucieux des rapports du son et de la pensée, ils ont eu le
tort - quelques-uns d’entre eux, du moins; je songe surtout à René Ghil - de
négliger les divergences individuelles pour la satisfaction de formuler des
lois, des principes, des recettes qui n’ont qu’une valeur de fantaisie. Erreurs
assez manifestes, qui ont enseigné la prudence à leurs successeurs. Il en est
de fait que le rêve de la “fusion des arts”, depuis quelque trente ans, ne
hante plus guère l’imagination de nos contemporains; d’ailleurs, c’est avec les
peintres plutôt qu’avec les musiciens que les représentants des jeunes écoles
ont fait alliance».
Il ne faut pas oublier le fait que les poètes symbolistes furent grandement
influencés par la musique de Wagner, et celle de Verdi non plus ne devait pas
les laisser indifférents. Est-il donc normal, aussi, qu’aux chromatismes de la
peinture, les poètes substituèrent ceux de la musique? Toutes ces approches, à leur tour,
suscitèrent l’inquiétude parmi les académiciens pour qui le symbolisme n’était
qu’un art décadent : «Jean Moréas, cependant, sourcilla au mot
“décadent”; il voyait, au contraire, les caractéristiques d’une renaissance
dans “l’abus de la pompe, l’étrangeté de la métaphore, un vocabulaire neuf où
les harmonies se combinent avec des couleurs et des lignes”. Et Gustave Kahn ne
fut pas long à déclarer sans équivoque : “Bien que toute étiquette soit vaine,
nous nous devons pour l’information exacte des attentifs, de rappeler que
décadent se prononce symboliste”».
Refusé ou accepté, le qualificatif de décadent ne bouleversa pas davantage les
symbolistes.
sonorités; de là l’abus des “cordes” et des “cuivres”. En
outre, justement soucieux des rapports du son et de la pensée, ils ont eu le
tort - quelques-uns d’entre eux, du moins; je songe surtout à René Ghil - de
négliger les divergences individuelles pour la satisfaction de formuler des
lois, des principes, des recettes qui n’ont qu’une valeur de fantaisie. Erreurs
assez manifestes, qui ont enseigné la prudence à leurs successeurs. Il en est
de fait que le rêve de la “fusion des arts”, depuis quelque trente ans, ne
hante plus guère l’imagination de nos contemporains; d’ailleurs, c’est avec les
peintres plutôt qu’avec les musiciens que les représentants des jeunes écoles
ont fait alliance».
Il ne faut pas oublier le fait que les poètes symbolistes furent grandement
influencés par la musique de Wagner, et celle de Verdi non plus ne devait pas
les laisser indifférents. Est-il donc normal, aussi, qu’aux chromatismes de la
peinture, les poètes substituèrent ceux de la musique? Toutes ces approches, à leur tour,
suscitèrent l’inquiétude parmi les académiciens pour qui le symbolisme n’était
qu’un art décadent : «Jean Moréas, cependant, sourcilla au mot
“décadent”; il voyait, au contraire, les caractéristiques d’une renaissance
dans “l’abus de la pompe, l’étrangeté de la métaphore, un vocabulaire neuf où
les harmonies se combinent avec des couleurs et des lignes”. Et Gustave Kahn ne
fut pas long à déclarer sans équivoque : “Bien que toute étiquette soit vaine,
nous nous devons pour l’information exacte des attentifs, de rappeler que
décadent se prononce symboliste”».
Refusé ou accepté, le qualificatif de décadent ne bouleversa pas davantage les
symbolistes.
Pour ces raisons,
l’esthétisme devint un caractère attribué au symbolisme. De l’art pour l’art à
l’ornementation lourde et chargée, le symbolisme semblait se perdre dans son
langage – s’il en avait un, malgré les présupposés de ses théoriciens -, et
pour l’opinion établie, ils «étaient
obscurs et excentriques  avec héroïsme et arrogance, fiers d’être incompris.
Leur prédilection pour une syntaxe bizarre et anticonventionnelle, épicée de
mots précieux, archaïques et inusités (déterrés des profondeurs des
dictionnaires ou exhumés des textes du passé, s’ils n’étaient pas forgés par
les différents membres du groupe), prit de telles proportions que Paul Adam
sentit bientôt l’urgence de publier un Petit Glossaire pour servir à
l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Tandis que ces auteurs cultivaient consciemment un style qui les
coupait des masses, ils trouvaient, dans leur inaccessibilité même,
confirmation de leur originalité, partageant l’opinion de Wyzewa que “la valeur
esthétique d’une œuvre d’art est toujours en raison inverse du nombre des esprits
qui peuvent la comprendre”. Huysmans l’avait déjà dit dans À rebours : “Si le plus bel air du monde devient
vulgaire, insupportable, dès que le public le fredonne, dès que les orgues s’en
emparent, l’œuvre d’art qui ne demeure pas indifférente aux artistes, qui n’est
point contestée par les sots, qui ne se contente pas de susciter l’enthousiasme
avec héroïsme et arrogance, fiers d’être incompris.
Leur prédilection pour une syntaxe bizarre et anticonventionnelle, épicée de
mots précieux, archaïques et inusités (déterrés des profondeurs des
dictionnaires ou exhumés des textes du passé, s’ils n’étaient pas forgés par
les différents membres du groupe), prit de telles proportions que Paul Adam
sentit bientôt l’urgence de publier un Petit Glossaire pour servir à
l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Tandis que ces auteurs cultivaient consciemment un style qui les
coupait des masses, ils trouvaient, dans leur inaccessibilité même,
confirmation de leur originalité, partageant l’opinion de Wyzewa que “la valeur
esthétique d’une œuvre d’art est toujours en raison inverse du nombre des esprits
qui peuvent la comprendre”. Huysmans l’avait déjà dit dans À rebours : “Si le plus bel air du monde devient
vulgaire, insupportable, dès que le public le fredonne, dès que les orgues s’en
emparent, l’œuvre d’art qui ne demeure pas indifférente aux artistes, qui n’est
point contestée par les sots, qui ne se contente pas de susciter l’enthousiasme
 de quelques-uns devient, elle aussi, par cela même, pour les initiés, polluée,
banale, presque repoussante”».
Cette volonté d’être des artistes d’élite produisant pour les élites
contribuait à fermer la tendance sur elle-même. Alors que le réalisme ouvrira
sur le naturalisme, puis la Neue
Sachlichkeit allemande, enfin le réalisme socialiste (et évitons d’aller
jusqu’à son antithèse, le réalisme fantastique), le symbolisme finira par
mourir sur lui-même et sa résurrection ne se produira qu’un siècle plus tard,
avec la floraison de l’esthétique du New
Age. Ce qu’on appelait le décadentisme
peut être pris pour une caricature du symbolisme, ce dont se gardait non seulement
Moréas, mais surtout Mallarmé. Dans une entrevue, le poète du coup de dés, exprimait ainsi ses
vues : «“Dans une société sans
stabilité, sans unité, il ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. De
cette organisation sociale inachevée, qui explique en même temps l’inquiétude
des esprits, naît l’inexpliqué besoin d’individualité dont les manifestations
littéraires présentes sont le reflet direct.” Mallarmé continuait en
définissant les intentions des poètes symbolistes avec des mots qu’Aurier aurait
pu employer pour parler de l’art de Gauguin : “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème
qui est fait du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage
de ce mystère qui constitue le symbolisme :
évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou inversement,
choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrement”».
Outre qu’excellent poète, Mallarmé allait directement au but du projet
symboliste.
de quelques-uns devient, elle aussi, par cela même, pour les initiés, polluée,
banale, presque repoussante”».
Cette volonté d’être des artistes d’élite produisant pour les élites
contribuait à fermer la tendance sur elle-même. Alors que le réalisme ouvrira
sur le naturalisme, puis la Neue
Sachlichkeit allemande, enfin le réalisme socialiste (et évitons d’aller
jusqu’à son antithèse, le réalisme fantastique), le symbolisme finira par
mourir sur lui-même et sa résurrection ne se produira qu’un siècle plus tard,
avec la floraison de l’esthétique du New
Age. Ce qu’on appelait le décadentisme
peut être pris pour une caricature du symbolisme, ce dont se gardait non seulement
Moréas, mais surtout Mallarmé. Dans une entrevue, le poète du coup de dés, exprimait ainsi ses
vues : «“Dans une société sans
stabilité, sans unité, il ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. De
cette organisation sociale inachevée, qui explique en même temps l’inquiétude
des esprits, naît l’inexpliqué besoin d’individualité dont les manifestations
littéraires présentes sont le reflet direct.” Mallarmé continuait en
définissant les intentions des poètes symbolistes avec des mots qu’Aurier aurait
pu employer pour parler de l’art de Gauguin : “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème
qui est fait du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage
de ce mystère qui constitue le symbolisme :
évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou inversement,
choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrement”».
Outre qu’excellent poète, Mallarmé allait directement au but du projet
symboliste.
Le rayonnement de la poésie symboliste fut
d’ordre international : «De
l’esthétisme que Stefan George, né en 1868, connut, après ses études à Bingen
et à Darmstadt, dans ses voyages en Italie, en France,  en Angleterre, en
Espagne, il prit le meilleur en en tirant l’idée d’une fonction spéciale du
poète. Il connut Verlaine, Mallarmé, et Wilde; la rencontre d’HOFMANNSTHAL, en 1891, à Vienne, eut une grande importance
dans sa vie, et plus tard son ami viennois collaborera aux Cahiers pour l’art. De ce périodique naîtra autour de George
une école qui rend sa place à l’essai en Allemagne, et lutte contre la tendance
à l’érudition sans originalité, contre l’école historique aussi. Elle suscitera
de nombreux essayistes : Friedrich Gundolf, Ernst Bertram, Berthold Vallentin,
Max Kommerell, Robert Boehringer. Mais ce cercle qui se formait autour de
George vint à prendre un autre sens. Il se souda en une volonté d’aristocratie
de l’art et il fit naître en lui l’esprit de la bande, le goût de l’ésotérisme.
Un nietzschéisme de plus en plus hautain y domina, et le groupe d’amitié virile
- et aussi équivoque - qui entoura Stefan George, et lui donna, avant 1914, le
nom de führer, préfigure par certains
côtés d’autres groupes semblables qui se formeront après la guerre, et rallièrent
rapidement le nazisme. Chez George, et dans le “George-Ring”, le privilège
aristocratique conféré par la voyance poétique, tourna vite à l’orgueil
nietzschéen».
On ne peut donc négliger une portée idéologique du symbolisme allemand sur le
nationalisme au début du XXe siècle, privilège que le cercle qui entourait
Mallarmé n’eut pas. En France, outre les décadents sulfureux, le symbolisme
s’abîma (ou ressuscita joyeusement) dans le théâtre d’Alfred Jarry. Il ne faut
pas sous-estimer l’influence que la poétique de Mallarmé eut sur Jarry : «Pour les symbolistes - et surtout Mallarmé,
le langage était doué de significations mystérieuses qui augmentaient avec le
nombre des directions différentes que chaque mot pouvait indiquer. Jarry
professait une théorie de l’expression poétique semblable et tout aussi hardie;
il prétendait que tous les sens que l’on peut trouver dans un texte sont
également légitimes. Il n’y a pas de sens véritable et unique qui écarterait
les autres comme erronés».
Et la vérité dans tout cela? Elle
avait éclaté, comme il se devait, sous les forces centrifuges du mouvement. À
cela, Pirandello aurait répondu par sa pièce théâtrale : À chacun sa vérité. D’où, par
corollaire, l’inexistence de la réalité des réalistes. La perception finissait
par l’emporter sur l’observation.
en Angleterre, en
Espagne, il prit le meilleur en en tirant l’idée d’une fonction spéciale du
poète. Il connut Verlaine, Mallarmé, et Wilde; la rencontre d’HOFMANNSTHAL, en 1891, à Vienne, eut une grande importance
dans sa vie, et plus tard son ami viennois collaborera aux Cahiers pour l’art. De ce périodique naîtra autour de George
une école qui rend sa place à l’essai en Allemagne, et lutte contre la tendance
à l’érudition sans originalité, contre l’école historique aussi. Elle suscitera
de nombreux essayistes : Friedrich Gundolf, Ernst Bertram, Berthold Vallentin,
Max Kommerell, Robert Boehringer. Mais ce cercle qui se formait autour de
George vint à prendre un autre sens. Il se souda en une volonté d’aristocratie
de l’art et il fit naître en lui l’esprit de la bande, le goût de l’ésotérisme.
Un nietzschéisme de plus en plus hautain y domina, et le groupe d’amitié virile
- et aussi équivoque - qui entoura Stefan George, et lui donna, avant 1914, le
nom de führer, préfigure par certains
côtés d’autres groupes semblables qui se formeront après la guerre, et rallièrent
rapidement le nazisme. Chez George, et dans le “George-Ring”, le privilège
aristocratique conféré par la voyance poétique, tourna vite à l’orgueil
nietzschéen».
On ne peut donc négliger une portée idéologique du symbolisme allemand sur le
nationalisme au début du XXe siècle, privilège que le cercle qui entourait
Mallarmé n’eut pas. En France, outre les décadents sulfureux, le symbolisme
s’abîma (ou ressuscita joyeusement) dans le théâtre d’Alfred Jarry. Il ne faut
pas sous-estimer l’influence que la poétique de Mallarmé eut sur Jarry : «Pour les symbolistes - et surtout Mallarmé,
le langage était doué de significations mystérieuses qui augmentaient avec le
nombre des directions différentes que chaque mot pouvait indiquer. Jarry
professait une théorie de l’expression poétique semblable et tout aussi hardie;
il prétendait que tous les sens que l’on peut trouver dans un texte sont
également légitimes. Il n’y a pas de sens véritable et unique qui écarterait
les autres comme erronés».
Et la vérité dans tout cela? Elle
avait éclaté, comme il se devait, sous les forces centrifuges du mouvement. À
cela, Pirandello aurait répondu par sa pièce théâtrale : À chacun sa vérité. D’où, par
corollaire, l’inexistence de la réalité des réalistes. La perception finissait
par l’emporter sur l’observation.
Dans une pièce, de Rachilde (1860-1953) une amie
d’Alfred Jarry, Madame la Mort de
1891, la pièce met 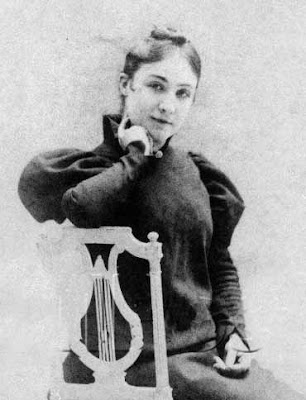 en scène un neurasthénique, Dartigny. Voici le commentaire
qu’en fait Dorothy Knowles : «Paul
Dartigny, âme très sensible, ayant tout essayé dans la vie, et dégoûté de tout,
aspire à l’anéantissement complet de son être. Cependant quelque chose en lui
se révolte contre cette solution, cherchant un au-delà païen où règne la
tranquillité et où la Mort, maîtresse absolue, sera son amante bien-aimée. Le
premier acte montre l’immense contraste entre le pessimisme désillusionné de
Dartigny et l’optimisme joyeux du bourgeois Jacques Durand. Durand et Lucile,
la maîtresse de Dartigny, pour servir leurs intérêts, essayent de le détourner
de ses idées de suicide mais l’abandonnent lorsque cet intérêt n’existe plus.
Après leur départ, celui-ci prend, dans la solitude de son fumoir, un cigare
empoisonné et se met tranquillement à fumer pour la dernière fois. Le décor du
deuxième acte représente un jardin, mais le véritable milieu est le cerveau du
héros. Là s’objectivent les deux idées qui l’obsèdent depuis longtemps, les
“moi” différents qui forment son être. Là, la vie, sous l’“apparence” de
Lucile, dispute avec la mort, une femme voilée, la possession de la victime. La
vie, par la bouche de Lucille, lui reproche de la quitter volontairement, pour
le retenir, essaie le pouvoir de tous ses charmes, évoquant leurs moments de
bonheur. La femme voilée, c’est l’attendue mais aussi l’inconnue, car
interrogée sur son être, elle répond “je ne sais pas”. Ces hallucinations
produites par le nérium
en scène un neurasthénique, Dartigny. Voici le commentaire
qu’en fait Dorothy Knowles : «Paul
Dartigny, âme très sensible, ayant tout essayé dans la vie, et dégoûté de tout,
aspire à l’anéantissement complet de son être. Cependant quelque chose en lui
se révolte contre cette solution, cherchant un au-delà païen où règne la
tranquillité et où la Mort, maîtresse absolue, sera son amante bien-aimée. Le
premier acte montre l’immense contraste entre le pessimisme désillusionné de
Dartigny et l’optimisme joyeux du bourgeois Jacques Durand. Durand et Lucile,
la maîtresse de Dartigny, pour servir leurs intérêts, essayent de le détourner
de ses idées de suicide mais l’abandonnent lorsque cet intérêt n’existe plus.
Après leur départ, celui-ci prend, dans la solitude de son fumoir, un cigare
empoisonné et se met tranquillement à fumer pour la dernière fois. Le décor du
deuxième acte représente un jardin, mais le véritable milieu est le cerveau du
héros. Là s’objectivent les deux idées qui l’obsèdent depuis longtemps, les
“moi” différents qui forment son être. Là, la vie, sous l’“apparence” de
Lucile, dispute avec la mort, une femme voilée, la possession de la victime. La
vie, par la bouche de Lucille, lui reproche de la quitter volontairement, pour
le retenir, essaie le pouvoir de tous ses charmes, évoquant leurs moments de
bonheur. La femme voilée, c’est l’attendue mais aussi l’inconnue, car
interrogée sur son être, elle répond “je ne sais pas”. Ces hallucinations
produites par le nérium
 |
E. Delâtre. La Mort en fourrure, 1897.
|
oleander
reproduisent symboliquement, en l’esprit de l’agonisant, le drame dépouillé de
ses contingences et réduit aux abstractions de la vie et de la mort se
disputant le suicidé. […] Ne pouvant,
ou ne voulant accepter le matérialisme comme solution, cette humanité préfère
payer ses déceptions d’un mysticisme certain. […] Le troisième acte cependant nous ramène à la vie réelle, avec le décor
habituel qui accompagne la mort : lamentations hypocrites, espoir de tirer des
bénéfices de l’événement, enfin toutes les vulgarités de la situation. Lucile
n’est plus une “apparence” mais elle-même; comme Durand, elle symbolise le sens
commun et pratique. Ensemble ils prouvent combien le “sens commun” est souvent
cruel, inconsciemment peut-être, pour les rêveurs».
Et le sens commun, comme il se
devait, se porta contre les symbolistes. Pendant qu’un Huysmans basculait du
décadentisme dans une conversion au catholicisme et que Jarry annonçait le
grotesque du monde ubuesque, la Première Guerre mondiale transforma l’un de ses
jeunes recrues, Henri Barbusse, en virulent communiste : «C’était un ancien écrivain symboliste qui,
avant la guerre, ne donnait pas l’impression d’être prédisposé au communisme.
Or Barbusse connaît la guerre comme combattant et il publie en 1916 un livre
qui a eu, à l’époque un immense succès Le Feu, journal d’une escouade. Récit très réaliste, long cri de révolte
contre la guerre, le livre se termine par cette déclaration : “Les 30 millions
d’esclaves jetés les uns sur les autres par le crime et l’erreur, dans la
guerre et la boue, lèvent leurs faces humaines où germe enfin une volonté.
L’avenir est dans les mains des esclaves et on voit bien que le vieux monde
sera changé par l’alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le nombre
et la misère sont infinis”».
Bref, pour reprendre une expression populaire, le symbolisme menait à tout… à condition d’en sortir.
Selon l’historien américain Eugen Weber, l’occultisme
serait la clef du symbolisme : «Nerval,
Barbey d’Aurévilly, Rimbaud, Villiers de l’Isle-Adam, Catulle Mendès,
Lautréamont, Charles Cros, Tristan Corbière, Jean Lorrain, Maurice Rollinat,
Jean Richepin, Maeterlinck, Léon Bloy, Huysmans, Alfred Jarry, Apollinaire».
Sans doute l’occultisme est-il une clef qui permet d’ouvrir une certaine porte du
symbolisme, mais contiendrait-il en lui toutes les dimensions du mouvement? Si
le scientisme fut la foi des réalistes et des naturalistes, quelles sont les
rapports entretenus entre le symbolisme et l’occultisme? Sont-ils de la même
nature? Nelly Émont tente dans un article lumineux de nous expliquer en quoi
l’occultisme a été le pourvoyeur du fantastique et comment, par ce biais, une
relation privilégiée s’est établie entre l’occultisme et le symbolisme :
«L’occultisme… repose…, sur une perception spécifique de la réalité.
Celle-ci perçue comme une se déploie de Dieu jusqu’au monde, sans aucune
déchirure. Il y a passage de l’un au multiple, de l’invisible au visible, du
surnaturel au naturel, ou plutôt ces catégories ne reflètent pour l’occultisme
qu’une incapacité de l’esprit de l’homme ordinaire à penser autrement qu’en
termes de rupture. De fait, l’invisible ne l’est qu’à celui qui ne sait pas regarder,
et le surnaturel n’apparaît comme tel qu’au regard de celui qui ne connaît pas
sa filiation divine. En réalité, les mondes s’interpénètrent, cependant
qu’existe un inter-monde qui occupe le statut d’intermédiaire entre Dieu et
l’homme. Pour désigner cet espace-temps, l’occultisme, reprend un terme qui
existe avant lui, mais auquel il va donner un sens nouveau, c’est celui
d’astral. Nous ne sommes plus dans un univers néo-platonicien, où le corps
astral désigne le véhicule éthéré que l’âme préexistante acquiert des diverses
étoiles et sphères qu’elle traverse au cours de sa descente dans le corps
terrestre. Nous ne sommes plus dans l’hermétisme tel qu’il s’exprime à la
Renaissance, où le monde astral désigne un univers dont il s’agit de capter les
forces et influences afin d’“attirer la vie du ciel” dans le but d’opérer une
magie naturelle et de participer ainsi à l’harmonie universelle. Le mondeastral de l’occultisme se distingue en ceci de ceux qui l’ont précédé qu’il a
deux origines précises. L’une est divine, l’autre est humaine. L’astral, nous
dit Éliphas Lévi, c’est d’abord une lumière, celle du premier jour de la
création, “une lumière pleine d’images, qui parle, et qui s’enroule autour
de tous les objets et de tous les globes de l’univers”. Cette lumière n’est ni bonne ni mauvaise : elle est une “force
aveugle”, un “médiateur plastique universel”, lieu dans lequel viennent
s’inscrire toutes les vibrations de la nature. Cette lumière est corps de Dieu.
L’ésotérisme, d’une manière générale, est toujours sensible à la corporéité du
spirituel comme à la spiritualisation de la matière. La lumière est donc
substantiellement palpable. Et comme le dieu synthèse de l’occultisme contient
en lui toutes oppositions, la force lumineuse qu’il projette est l’expression
de ces oppositions qui constituent sa nature. Cette lumière corporelle
détermine un monde spécifique, neutre, informel, pétri des oppositions divines
et prêt à s’animer.
 |
| Arthur Hugues. Étude pour Sir Galahd et la quête du Saint Graal. |
Si ce corps astral est production divine, il est
tout autant production de l’homme. C’est là une idée importante. Il faut voir
ici la version occultiste d’une idée chère à tout ésotérisme, à savoir que Dieu
a besoin du monde et de sa création pour se connaître. [Le Dieu de l’ésotérisme
présente cette particularité d’être toujours en devenir.] C’est ce que traduit
ainsi Jollivet-Castelot : “Par un certain côté, Dieu est l’être qui
devient sans cesse, car il y a une évolution de sa substance et ce Dieu ne
prend conscience de lui que par nous.” Toute
image mentale crée une forme. Cette affirmation vaut de la création divine :
c’est ce que Dieu imagine ou met en images qui donne vie au monde; mais elle
vaut également de l’homme, dieu en puissance. Il faut sans doute voir également
dans cette manière de concevoir la réalité la réaffirmation qu’il n’est point
tant question de faire de la théologie que de la psychologie. L’intériorisation
qui a consisté à se tourner vers soi pour y retrouver Dieu, plutôt que de
contempler Dieu d’abord, a largement été exploitées par les théosophes du
XVIIIe siècle. Dans le cas de l’occultisme, la lumière astrale que Dieu a
émanée de Lui reste cet intermonde sans forme tant que la pensée humaine n’est
pas venue la préciser. Mais dès que celle-ci intervient, il se crée des
atmosphères spécifiques, particulièrement impressionnantes lorsqu’elles
naissent dans des assemblées guidées par une même idée…».
 L’occultisme apparaît
ici sous la forme d’un double mouvement, celui de la kénose, la corporéité (masculine) du spirituel (féminin), et
l’évhémérisme, la spiritualisation (masculine) de la matière (féminine). Humain
et Dieu en même temps, le langage symboliste aurait pour but, par la
suggestivité, par l’équivalent, de
réconcilier finalement Dieu et le monde. Voilà surtout pourquoi l’image de la
femme est si importante dans l’Imaginaire symboliste. Elle est la médiatrice
des extrêmes. Selon la direction du mouvement, elle est l’une et/ou l’autre. Le
premier état correspond au discours uranien de l’âme (la psychée) féminine
revêtue d’un corps d’homme. Mais il peut être vu également comme la femme
morte, emportée par sa féminité ou son état de femme jusqu’à se noyer dans ses
propres eaux, enroulée par ses longs cheveux autour de algues et de la
végétation aquatique. Wilde et Rossetti réconciliés. Le second état serait l’équivalent
des figures cauchemardesques que l’on retrouvera dans les tableaux de Moreau et
de Redon. Le pouvoir de captation par le regard intense, le viol de la chair
par l’agressivité des passions, qu’elles soient masochistes ou tout simplement
sadiques, l’anarchie semée par des viragos qui agissent sous les ordres du
grand Satan de Félicien Rops, qui parcourt les villes, semant la haine,
L’occultisme apparaît
ici sous la forme d’un double mouvement, celui de la kénose, la corporéité (masculine) du spirituel (féminin), et
l’évhémérisme, la spiritualisation (masculine) de la matière (féminine). Humain
et Dieu en même temps, le langage symboliste aurait pour but, par la
suggestivité, par l’équivalent, de
réconcilier finalement Dieu et le monde. Voilà surtout pourquoi l’image de la
femme est si importante dans l’Imaginaire symboliste. Elle est la médiatrice
des extrêmes. Selon la direction du mouvement, elle est l’une et/ou l’autre. Le
premier état correspond au discours uranien de l’âme (la psychée) féminine
revêtue d’un corps d’homme. Mais il peut être vu également comme la femme
morte, emportée par sa féminité ou son état de femme jusqu’à se noyer dans ses
propres eaux, enroulée par ses longs cheveux autour de algues et de la
végétation aquatique. Wilde et Rossetti réconciliés. Le second état serait l’équivalent
des figures cauchemardesques que l’on retrouvera dans les tableaux de Moreau et
de Redon. Le pouvoir de captation par le regard intense, le viol de la chair
par l’agressivité des passions, qu’elles soient masochistes ou tout simplement
sadiques, l’anarchie semée par des viragos qui agissent sous les ordres du
grand Satan de Félicien Rops, qui parcourt les villes, semant la haine,  la
discorde et la guerre. Mais il peut être vu autrement, comme la maîtrise de
l’artisan qui façonne la matière dans le but de créer des objets ornementataux
parcourus de traits associés à la femme et devant servir à décorer les lieux
publics. Swinburne et Morris réconciliés à leur tour. Le discours occulte est
repris et transformé par le style symboliste. On y trouve là non pas une mais
plusieurs alternatives spirituelles potentielles à l’esprit en quête de
mystères et de symboles vivants. Il faut reconnaître toutefois que cette
démarche profite de deux adversités rendus incompatibles. D’un côté, il y a
l’échec du catholicisme nouveau qui «se
demande à quoi sert l’effort humain si la vie est soumise à des lois de fer
contre lesquelles on ne peut rien. L’intelligence peut se contenter de cette
négation, mais l’intelligence n’est pas tout; la science laisse l’âme
insatisfaite parce qu’elle donne au problème de la destinée une réponse
purement intellectuelle. Au-dessus des théories, il y a la vie, et la vie ne se
nourrit pas de documents décevants et de sèches analyses».
En face, la génération de jeunes esprits assoiffés de spiritualisme : «réagissant contre le naturalisme et le
scientisme à la mode, pressentait en lui un maître de l’inconnaissable qui
enveloppe toujours la condition humaine».
Entre les deux, «déjà la notion
d’initiation imprègne les esquisses de la mentalité symboliste».
Les mystères n’étaient plus ceux que l’on croyait jusqu’alors. Et ni
l’abaissement de Dieu dans une vulgaire enveloppe charnelle, ni une élévation
sociale qui ferait des esclaves par nature, des maîtres par l’action politique
ne tiennent devant la vérité. Le
symbolisme dérivait ainsi du merveilleux pour s’acheminer vers le fantastique,
et c’est dans cette dérive qu’il passa par l’ouverture donnant sur l’occultisme
et l’ésotérisme.
la
discorde et la guerre. Mais il peut être vu autrement, comme la maîtrise de
l’artisan qui façonne la matière dans le but de créer des objets ornementataux
parcourus de traits associés à la femme et devant servir à décorer les lieux
publics. Swinburne et Morris réconciliés à leur tour. Le discours occulte est
repris et transformé par le style symboliste. On y trouve là non pas une mais
plusieurs alternatives spirituelles potentielles à l’esprit en quête de
mystères et de symboles vivants. Il faut reconnaître toutefois que cette
démarche profite de deux adversités rendus incompatibles. D’un côté, il y a
l’échec du catholicisme nouveau qui «se
demande à quoi sert l’effort humain si la vie est soumise à des lois de fer
contre lesquelles on ne peut rien. L’intelligence peut se contenter de cette
négation, mais l’intelligence n’est pas tout; la science laisse l’âme
insatisfaite parce qu’elle donne au problème de la destinée une réponse
purement intellectuelle. Au-dessus des théories, il y a la vie, et la vie ne se
nourrit pas de documents décevants et de sèches analyses».
En face, la génération de jeunes esprits assoiffés de spiritualisme : «réagissant contre le naturalisme et le
scientisme à la mode, pressentait en lui un maître de l’inconnaissable qui
enveloppe toujours la condition humaine».
Entre les deux, «déjà la notion
d’initiation imprègne les esquisses de la mentalité symboliste».
Les mystères n’étaient plus ceux que l’on croyait jusqu’alors. Et ni
l’abaissement de Dieu dans une vulgaire enveloppe charnelle, ni une élévation
sociale qui ferait des esclaves par nature, des maîtres par l’action politique
ne tiennent devant la vérité. Le
symbolisme dérivait ainsi du merveilleux pour s’acheminer vers le fantastique,
et c’est dans cette dérive qu’il passa par l’ouverture donnant sur l’occultisme
et l’ésotérisme.
Comme le souligne
Antoine Faivre : «À cette
orientation de la psychologie correspondent, pendant la période fin-de-siècle,
une intériorisation du fantastique et une utilisation esthétique de la science
 positiviste : l’accent porte de moins en moins sur les fantômes proprement
dits, de plus en plus sur la hantise psychique des héros, par exemple dans The
Turn of the Screw de Henry James (1898)
et Dracula». Même apolitique, le
symbolisme devenait un milieu où les idées politiques de droites s’associaient
volontiers à l’attrait pour l’ésotérisme : «Le symbolisme développe des formes plus nettes d’apolitisme, par
l’individualisme artistique et le culte exclusif de la beauté. De là, les
expériences d’écriture les plus audacieuses : instrumentisme de René Ghil,
théâtre du silence chez Maeterlinck (La Princesse Maleine, 1890), hermétisme médiéval de César-Antéchrist (1895) de Jarry. Et encore, de remarquables
excentricités : culte du revolver chez Jarry, satanisme de Guaita et de
Huysman, ésotérisme de Péladan… Auteur d’Istar et de la série intitulée La Décadence latine, Joséphin Péladan, dit “le Sâr Péladan”,
positiviste : l’accent porte de moins en moins sur les fantômes proprement
dits, de plus en plus sur la hantise psychique des héros, par exemple dans The
Turn of the Screw de Henry James (1898)
et Dracula». Même apolitique, le
symbolisme devenait un milieu où les idées politiques de droites s’associaient
volontiers à l’attrait pour l’ésotérisme : «Le symbolisme développe des formes plus nettes d’apolitisme, par
l’individualisme artistique et le culte exclusif de la beauté. De là, les
expériences d’écriture les plus audacieuses : instrumentisme de René Ghil,
théâtre du silence chez Maeterlinck (La Princesse Maleine, 1890), hermétisme médiéval de César-Antéchrist (1895) de Jarry. Et encore, de remarquables
excentricités : culte du revolver chez Jarry, satanisme de Guaita et de
Huysman, ésotérisme de Péladan… Auteur d’Istar et de la série intitulée La Décadence latine, Joséphin Péladan, dit “le Sâr Péladan”,  crée avec Guaita l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix, qu’il refonde en Ordre de la Rose-Croix
catholique et esthétique du Temple et du Graal en 1891. Il s’attire de cruels
sobriquets: on l’appelle tour à tour “le Sâr Pédalant” ou bien “Artaxerfesse”.
Malgré cela, ce “Mage d’Épinal” joue un rôle important dans la constitution du
symbolisme et dans le culte fin de siècle de la beauté musicale, poétique et
picturale. La cérémonie d’ouverture du Salon de la Rose-Croix, chez le grand
collectionneur Durand-Ruel, obtient un grand succès, en attirant soixante
artistes et vingt mille Parisiens. Naturellement, Péladan déteste Zola, qu’il
qualifie de pourceau».
Qu’importe la naïveté des symbolistes, les mages savaient qui, dans la société,
était prêt à les nourrir, ce qui n’égara pas un esprit critique comme celui de l’anarcho-syndicaliste
Fernand Pelloutier, animateur des Bourses du Travail, qui dénonçait dans ses
conférences le stade ultime d’abaissement idéologique et politique où conduisait
cette fascination pour l’occulte : ainsi, «en 1896, c’est
crée avec Guaita l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix, qu’il refonde en Ordre de la Rose-Croix
catholique et esthétique du Temple et du Graal en 1891. Il s’attire de cruels
sobriquets: on l’appelle tour à tour “le Sâr Pédalant” ou bien “Artaxerfesse”.
Malgré cela, ce “Mage d’Épinal” joue un rôle important dans la constitution du
symbolisme et dans le culte fin de siècle de la beauté musicale, poétique et
picturale. La cérémonie d’ouverture du Salon de la Rose-Croix, chez le grand
collectionneur Durand-Ruel, obtient un grand succès, en attirant soixante
artistes et vingt mille Parisiens. Naturellement, Péladan déteste Zola, qu’il
qualifie de pourceau».
Qu’importe la naïveté des symbolistes, les mages savaient qui, dans la société,
était prêt à les nourrir, ce qui n’égara pas un esprit critique comme celui de l’anarcho-syndicaliste
Fernand Pelloutier, animateur des Bourses du Travail, qui dénonçait dans ses
conférences le stade ultime d’abaissement idéologique et politique où conduisait
cette fascination pour l’occulte : ainsi, «en 1896, c’est  incontestablement au symbolisme que Pelloutier en a. Les
symbolistes ont été pour la plupart, en cette fin de siècle, influencés par
diverses formes d’ésotérisme, dont le poète ésotérique Jules Bois - cité par
Pelloutier - a fait l’inventaire dans son livre le Satanisme et la Magie (1895). On sait d’autre part l’existence
vers 1888 d’un groupe d’ésotéristes groupés autour de Stanislas de Guaïta, ami
de Barrès, Augustin Chaboseau, auteur d’un Essai sur la philosophie
bouddhique, Papus et Joséphin Péladan, le
“sar”, qui constituera bientôt une Rose-Croix catholique dissidente avec Élémir
Bourges, après la mise à l’Index de la Rose-Croix. D’autre part, une nouvelle
forme d’exotisme, la théosophie, s’inspirant des théogonies extrême-orientales
et du culte d’Isis se répand en France, sous l’influence de Mme Blavatsky à
partir de 1880. En témoignent la fondation de la loge Isis en 1887 et la
création de la revue le Lotus rouge. Rappelons aussi l’Isis de Villiers de l’Isle-Adam en 1862. Enfin,
l’érotisme ésotérique est à la mode; les messes noires évoquées par Pelloutier,
ce sont par exemple celles du fameux abbé Boulian, disciple de Vintras et
organisateur à Lyon d’un “culte marial” d’un genre spécial. Huysmans le prit au
sérieux, et le mit en scène dans Là-bas».
Comment, dans l’urgence des crises sociales, ne pas se révolter de voir les
esthètes se régaler de cette nourriture indigeste pour l’esprit mais si
suggestible pour exciter les sens et affiner la sensibilité?
incontestablement au symbolisme que Pelloutier en a. Les
symbolistes ont été pour la plupart, en cette fin de siècle, influencés par
diverses formes d’ésotérisme, dont le poète ésotérique Jules Bois - cité par
Pelloutier - a fait l’inventaire dans son livre le Satanisme et la Magie (1895). On sait d’autre part l’existence
vers 1888 d’un groupe d’ésotéristes groupés autour de Stanislas de Guaïta, ami
de Barrès, Augustin Chaboseau, auteur d’un Essai sur la philosophie
bouddhique, Papus et Joséphin Péladan, le
“sar”, qui constituera bientôt une Rose-Croix catholique dissidente avec Élémir
Bourges, après la mise à l’Index de la Rose-Croix. D’autre part, une nouvelle
forme d’exotisme, la théosophie, s’inspirant des théogonies extrême-orientales
et du culte d’Isis se répand en France, sous l’influence de Mme Blavatsky à
partir de 1880. En témoignent la fondation de la loge Isis en 1887 et la
création de la revue le Lotus rouge. Rappelons aussi l’Isis de Villiers de l’Isle-Adam en 1862. Enfin,
l’érotisme ésotérique est à la mode; les messes noires évoquées par Pelloutier,
ce sont par exemple celles du fameux abbé Boulian, disciple de Vintras et
organisateur à Lyon d’un “culte marial” d’un genre spécial. Huysmans le prit au
sérieux, et le mit en scène dans Là-bas».
Comment, dans l’urgence des crises sociales, ne pas se révolter de voir les
esthètes se régaler de cette nourriture indigeste pour l’esprit mais si
suggestible pour exciter les sens et affiner la sensibilité?
Le fantastique,
voilà l’atmosphère qui finit par s’imposer dans l’espace pictural symboliste.
Si on peut retrouver du fantastique dans toutes les œuvres poétiques ou
artistiques de la veine symboliste, on ne peut conclure qu’il y ait trace
d’ésotérisme dans toutes ces équivalences.
La volonté de suggérer dépendait trop des créateurs pour se laisser
imposer, même par les grands maîtres de l’occultisme, le traitement des sujets
choisis. Un rapide tour d’horizon des grands maîtres du symbolisme nous le
démontrera assez bien. Gustave Moreau, Odilon Redon, James Ensor, à l’exemple
de Rossetti, partageaient des thèmes similaires puisés dans les œuvres d’Edgar
Poe ou les légendes médiévales revues et corrigées par les romantiques, à
l’exemple du fameux modèle d’Ossian
de Macpherson à la fin du XVIIIe siècle. Ils reprenaient aussi le répertoire
passé en commençant par l’univers terrifiant de Goya, les allégories puisées
dans l’ensemble de l’œuvre plastique de William Blake, les têtes coupées de
Géricault, les songes effrayants de Fuseli, l’érotisme sanglant tiré de La mort de Sardanapale de Delacroix,
étaient tous de meilleures références que la vaticination des maîtres de
l’ésotérisme dans la galerie de Durand-Ruel.
 |
| John Henry Fuseli. Le cauchemar, 1781. |
 |
| Gustave Moreau. Jupiter et Sémélé, 1895. |
Gustave Moreau
(1826-1898), peintre, graveur, dessinateur et sculpteur, imprégné de
mysticisme, demeure aujourd’hui la première référence de l’art symboliste. Pour
le critique littéraire Gaétan Picon, il n’y a qu’une œuvre peinte qui
correspond vraiment à la poésie symboliste de la fin du XIXe siècle : «Il ne s’agit pas  seulement d’œuvres qui,
comme celles de Mallarmé et de Rimbaud, échappent à la classification - mais de
la poésie symboliste dans son ensemble, fût-ce dans ses expressions mineures :
“pureté”, “tenue” culte de la “noblesse d’expression”, c’est tout cela, se
rappelle Breton, qui le “dignifiait” à ses yeux. Et il cite Paul Fort, René
Ghil, Saint-Pol Roux, Jean Royère (directeur de La Phalange, qui publie ses premiers vers). Francis
Vielé-Griffin, Pierre Louÿs, Huysmans (qu’il ne sépare pas des poètes). Le
peintre qui correspond à cette beauté symboliste, et qui a été la première
admiration de Breton dans l’ordre plastique, c’est Gustave Moreau…».
Les œuvres de Moreau sont, en effet, imbues d’étrangetés inquiétantes. Certaines
de ses compositions rappellent l’art de Monsu Desiderio du XVIIe siècle.
D’autres s’inscriraient dans la veine des préraphaélites. Son Jupiter et Sémélé est entièrement dominé
par le regard ahuri du dieu. C’est ce qui permet au critique Jean Paris d’écrire :
«On peut parler ainsi, chez Gustave
Moreau, d’un regard dévorant. D’un regard dont, étrangement, la spiritualité
s’exprime par
seulement d’œuvres qui,
comme celles de Mallarmé et de Rimbaud, échappent à la classification - mais de
la poésie symboliste dans son ensemble, fût-ce dans ses expressions mineures :
“pureté”, “tenue” culte de la “noblesse d’expression”, c’est tout cela, se
rappelle Breton, qui le “dignifiait” à ses yeux. Et il cite Paul Fort, René
Ghil, Saint-Pol Roux, Jean Royère (directeur de La Phalange, qui publie ses premiers vers). Francis
Vielé-Griffin, Pierre Louÿs, Huysmans (qu’il ne sépare pas des poètes). Le
peintre qui correspond à cette beauté symboliste, et qui a été la première
admiration de Breton dans l’ordre plastique, c’est Gustave Moreau…».
Les œuvres de Moreau sont, en effet, imbues d’étrangetés inquiétantes. Certaines
de ses compositions rappellent l’art de Monsu Desiderio du XVIIe siècle.
D’autres s’inscriraient dans la veine des préraphaélites. Son Jupiter et Sémélé est entièrement dominé
par le regard ahuri du dieu. C’est ce qui permet au critique Jean Paris d’écrire :
«On peut parler ainsi, chez Gustave
Moreau, d’un regard dévorant. D’un regard dont, étrangement, la spiritualité
s’exprime par  l’instinct animal de la manducation. Dans une époque où
l’artiste, aliéné, tiendra bientôt le symbole pour une possession, c’est par
l’œil que ce métaphysicien a choisi de conquérir sa plus haute réalité. La
vision sera moins pour lui un substitut d’appropriation qu’une vraie
déglutition du monde, à la façon de ces bêtes qui sur leurs proies lancent
tentacules ou filets, pour s’en repaître en un éclair. Car l’œil mange. Il y
avait jadis en Italie, écrit Gaston Bachelard citant le Dictionnaire
infernal de Collin de Plancy, “des
sorcières qui, d’un seul regard, mangeaient le
cœur des hommes et le dedans des concombres”. Et Merleau-Ponty : “Ce
n’est pas un hasard si souvent, dans la peinture hollandaise, et dans beaucoup
d’autres, un intérieur désert est “digéré” par l’œil rond du miroir. Ce regard
préhumain est l’emblème de celui du peintre.” C’est pourquoi il sera chargé d’accomplir
dans l’imaginaire un acte interdit dans la réalité. De la Sphynge ou de l’Hydre
gorgées de sang humain à la Vierge repue de martyrs, du Cyclope “mangeant des
yeux” sa Galatée à Diomède dévoré par ses chevaux, la peinture de Moreau,
malgré son statisme, est le lieu d’une constante anthropophagie. Tous les
mécanismes fascinateurs qu’elle met en jeu de plus en plus subtils, compliqués,
efficaces, n’ont d’autre fin que cette prédation, cette dévoration fulgurante
des apparences…».
L’œil sera également un
l’instinct animal de la manducation. Dans une époque où
l’artiste, aliéné, tiendra bientôt le symbole pour une possession, c’est par
l’œil que ce métaphysicien a choisi de conquérir sa plus haute réalité. La
vision sera moins pour lui un substitut d’appropriation qu’une vraie
déglutition du monde, à la façon de ces bêtes qui sur leurs proies lancent
tentacules ou filets, pour s’en repaître en un éclair. Car l’œil mange. Il y
avait jadis en Italie, écrit Gaston Bachelard citant le Dictionnaire
infernal de Collin de Plancy, “des
sorcières qui, d’un seul regard, mangeaient le
cœur des hommes et le dedans des concombres”. Et Merleau-Ponty : “Ce
n’est pas un hasard si souvent, dans la peinture hollandaise, et dans beaucoup
d’autres, un intérieur désert est “digéré” par l’œil rond du miroir. Ce regard
préhumain est l’emblème de celui du peintre.” C’est pourquoi il sera chargé d’accomplir
dans l’imaginaire un acte interdit dans la réalité. De la Sphynge ou de l’Hydre
gorgées de sang humain à la Vierge repue de martyrs, du Cyclope “mangeant des
yeux” sa Galatée à Diomède dévoré par ses chevaux, la peinture de Moreau,
malgré son statisme, est le lieu d’une constante anthropophagie. Tous les
mécanismes fascinateurs qu’elle met en jeu de plus en plus subtils, compliqués,
efficaces, n’ont d’autre fin que cette prédation, cette dévoration fulgurante
des apparences…».
L’œil sera également un  élément-clef dans l’œuvre d’Odilon Redon. Qui ne fut
pas touché par cette tête décollée suspendue dans le vide dans L’Apparition (1875), saint Jean-Baptiste
apparaissant à Salomé au moment où s’achève la danse sacrificielle. L’obsession
de la castration domine l’œuvre de Moreau, telle cette Jeune fille thrace portant la tête d’Orphée : «Épreuve de vérité. Écho de l’expérience
anxiogène du célibataire. Où le complexe d’Œdipe entre en résonance avec le
complexe de castration. Plasticité de la libido. Est-ce par hasard que le
visage de la jeune femme rappelle les traits du portrait de la mère du peintre?
Tel que nous le donne une vieille photographie. Et qu’il rappelle aussi, note
Ernest Chesneau, “la Salomé des livres saints qui contemplait, elle aussi, mais
de quel regard, la tête coupée de saint Jean-Baptiste”».
Prométhée et son aigle, saint Sébastien et ses flèches, la Sphynge et Œdipe sur
fond d’atmosphère aqueuse, des femmes alanguies dont on ne sait si elles sont
vivantes ou mortes, des prétendants de Pénélope, enfin la débauche juchée sur
un piédestal, venant de déboulonner un saint de la tradition
élément-clef dans l’œuvre d’Odilon Redon. Qui ne fut
pas touché par cette tête décollée suspendue dans le vide dans L’Apparition (1875), saint Jean-Baptiste
apparaissant à Salomé au moment où s’achève la danse sacrificielle. L’obsession
de la castration domine l’œuvre de Moreau, telle cette Jeune fille thrace portant la tête d’Orphée : «Épreuve de vérité. Écho de l’expérience
anxiogène du célibataire. Où le complexe d’Œdipe entre en résonance avec le
complexe de castration. Plasticité de la libido. Est-ce par hasard que le
visage de la jeune femme rappelle les traits du portrait de la mère du peintre?
Tel que nous le donne une vieille photographie. Et qu’il rappelle aussi, note
Ernest Chesneau, “la Salomé des livres saints qui contemplait, elle aussi, mais
de quel regard, la tête coupée de saint Jean-Baptiste”».
Prométhée et son aigle, saint Sébastien et ses flèches, la Sphynge et Œdipe sur
fond d’atmosphère aqueuse, des femmes alanguies dont on ne sait si elles sont
vivantes ou mortes, des prétendants de Pénélope, enfin la débauche juchée sur
un piédestal, venant de déboulonner un saint de la tradition
 |
| Gustave Moreau Salomé dansant devant l'apparition de la tête de saint Jean-Baptiste. 1875. |
Moreau avait une
drôle de prétention. Il «pensait qu’il
détenait un “message synoptique” et qu’il révélerait “dans ses tableaux la
vérité sous-jacente à tous les mythes et à toutes les religions”»,
et cette prétention satisfaisait à l’esprit
du temps : «“Monsieur Gustave
Moreau est un artiste  extraordinaire, unique. C’est un mystérieux enfermé en
plein Paris, dans une cellule où ne pénètre même plus le bruit de la vie
contemporaine qui bat furieusement pourtant les portes du cloître. Abîmé dans
l’extase, il voit resplendir les féeriques visions, les sanglantes apothéoses
des autres âges” (J.-K. Huysmans). Cet artiste est un visionnaire hanté par le
secret des vieilles théogonies, le symbolisme des races primitives. Sa peinture
grandiose et marmoréenne possède une saveur bizarre. Elle est comme “un
enchantement singulier, une incantation vous remuant jusqu’au fond des
entrailles, comme celle de certains poèmes de Baudelaire…” (ibid.) Œuvres
déconcertantes où se trouvent confrontés sur une même surface esprit et
matière, sans aucune communion possible. Étranges figures isolées, silencieuses
et superbes, qui ne prennent aucune part apparente au drame qui les entoure,
foudroyées dans une immobilité contemplative, une indifférente mollesse. Oui,
les personnages de Gustave Moreau ont quelque chose “de beaux animaux à
tristesse végétale”. Ses Salomés, “avec leur charme de grandes fleurs passives
et vénériennes, poussées dans des siècles sacrilèges et jusqu’à nous épanouies
par l’occulte pouvoir des damnables souvenirs” (J. Lorrain), sont terriblement
inquiétantes».
En 1889, c’est à la manière de
Gustave Moreau que le publiciste, auteur de La
France juive, Édouard Drumont, décrivait, «autour du lit de pourpre et de fumier où se meurt cette société en
décomposition, le Peuple attend».
C’était l’époque de la crise boulangiste et, comme tant d’autres, il attendait
le coup mortel qui serait porté à la République, coup qui ne vint pas.
extraordinaire, unique. C’est un mystérieux enfermé en
plein Paris, dans une cellule où ne pénètre même plus le bruit de la vie
contemporaine qui bat furieusement pourtant les portes du cloître. Abîmé dans
l’extase, il voit resplendir les féeriques visions, les sanglantes apothéoses
des autres âges” (J.-K. Huysmans). Cet artiste est un visionnaire hanté par le
secret des vieilles théogonies, le symbolisme des races primitives. Sa peinture
grandiose et marmoréenne possède une saveur bizarre. Elle est comme “un
enchantement singulier, une incantation vous remuant jusqu’au fond des
entrailles, comme celle de certains poèmes de Baudelaire…” (ibid.) Œuvres
déconcertantes où se trouvent confrontés sur une même surface esprit et
matière, sans aucune communion possible. Étranges figures isolées, silencieuses
et superbes, qui ne prennent aucune part apparente au drame qui les entoure,
foudroyées dans une immobilité contemplative, une indifférente mollesse. Oui,
les personnages de Gustave Moreau ont quelque chose “de beaux animaux à
tristesse végétale”. Ses Salomés, “avec leur charme de grandes fleurs passives
et vénériennes, poussées dans des siècles sacrilèges et jusqu’à nous épanouies
par l’occulte pouvoir des damnables souvenirs” (J. Lorrain), sont terriblement
inquiétantes».
En 1889, c’est à la manière de
Gustave Moreau que le publiciste, auteur de La
France juive, Édouard Drumont, décrivait, «autour du lit de pourpre et de fumier où se meurt cette société en
décomposition, le Peuple attend».
C’était l’époque de la crise boulangiste et, comme tant d’autres, il attendait
le coup mortel qui serait porté à la République, coup qui ne vint pas.
 Le second maître de
la peinture symboliste fut Odilon Redon (1840-1916), pas moins dérangeant que
Moreau. Nous naviguons toujours dans l’âme féminine trouble des formes
ondulées : coiffures, végétaux, reflets des pierres précieuses et l’onde -
très différent de ceux des impressionnistes -, sur lequel va apparaître
bientôt, porté par le courant, le cadavre d’Ophélie, morte noyée. Là encore, le
ballon en forme de globe oculaire qui s’apprête à se poser à la surface du lac;
ces femmes fantomatiques issues de l’une de ces séances spirites tenues à
Jersey chez l’exilé Hugo ou à Paris devant les savants rassemblés par
Flammarion et Janet, parce qu’ils sont dessinés au fusain, angoissent davantage
le spectateur. La thèse esthétique de Redon est simple : «Tout en reconnaissant comme base la
nécessité de la réalité vue […] l’art
véritable est dans la réalité sentie».
Comme Gustave Moreau, «sur un plan
esthétique, la démarche de Redon équivaut à une initiation, une descente dans
l’Inferno du corps, de l’inconscient.
Et ainsi va naître, écrit John Rewald, “cet univers bizarre de créatures
improbables, investies d’une vie à elles, respirant en dépit de leurs
grotesques anomalies selon des lois secrètes qu’aucun Darwin ne pouvait
découvrir”. Bestiaire de la nuit où tout s’anime d’une fièvre diffuse,
élémentaire, où toute apparition en appellent d’autres suivant d’obscures
mutations, comme au sein d’un rêve interminable, qui doit peu, en fin de
compte, au laborieux fantastique…».
Pour
Le second maître de
la peinture symboliste fut Odilon Redon (1840-1916), pas moins dérangeant que
Moreau. Nous naviguons toujours dans l’âme féminine trouble des formes
ondulées : coiffures, végétaux, reflets des pierres précieuses et l’onde -
très différent de ceux des impressionnistes -, sur lequel va apparaître
bientôt, porté par le courant, le cadavre d’Ophélie, morte noyée. Là encore, le
ballon en forme de globe oculaire qui s’apprête à se poser à la surface du lac;
ces femmes fantomatiques issues de l’une de ces séances spirites tenues à
Jersey chez l’exilé Hugo ou à Paris devant les savants rassemblés par
Flammarion et Janet, parce qu’ils sont dessinés au fusain, angoissent davantage
le spectateur. La thèse esthétique de Redon est simple : «Tout en reconnaissant comme base la
nécessité de la réalité vue […] l’art
véritable est dans la réalité sentie».
Comme Gustave Moreau, «sur un plan
esthétique, la démarche de Redon équivaut à une initiation, une descente dans
l’Inferno du corps, de l’inconscient.
Et ainsi va naître, écrit John Rewald, “cet univers bizarre de créatures
improbables, investies d’une vie à elles, respirant en dépit de leurs
grotesques anomalies selon des lois secrètes qu’aucun Darwin ne pouvait
découvrir”. Bestiaire de la nuit où tout s’anime d’une fièvre diffuse,
élémentaire, où toute apparition en appellent d’autres suivant d’obscures
mutations, comme au sein d’un rêve interminable, qui doit peu, en fin de
compte, au laborieux fantastique…».
Pour  Redon, le symbolisme est un jeu assez simple de l’Imaginaire : «Qu’ai-je mis en mes ouvrages pour leur
suggérer tant de subtilités? J’y ai mis une petite porte ouverte sur le
mystère. J’ai fait des fictions. C’est à eux d’aller plus loin».
Eux, c’est-à-dire aux spectateurs. Ses fusains et ses toiles, moins chargés que
celles de Moreau, apparaissent pour certains, comme de vrais figures sorties de
l’inconscient. Comme en parlait le critique Aurier en 1891 : «Odilon Redon, dont les lithographies sont
des cauchemars. Le doigt de [cet] artiste semble déchirer, autour de nous, le
voile de tous les mystères… et sa bouche semble nous crier que le résultat de
toute science humaine, de toute pensée est un frisson de peur dans l’infini de
la nuit». Redon semble s’amuser de
ces frayeurs, un peu comme son modèle littéraire Edgar Poe. Ainsi, lorsqu’il
affirme que «le sens du mystère, c’est
d’être tout le temps dans l’équivoque, dans les double, triple aspects, des
soupçons d’aspect (images dans images), formes qui vont être, ou qui le seront
selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que suggestives,
puisqu’elles apparaissent».
N’est-ce pas là une évocation au poème de Poe, du rêve dans le rêve? Voilà sans doute pourquoi «Redon fut incompris jusqu’à la fin du siècle car il peignait des objets
et des êtres qui n’existaient pas dans le monde mais seulement dans sa vision
subjective», seulement dans des
cauchemars qui surgissent dans des rêves. Cette subjectivité donnait le
symbolisme à son meilleur et le paradoxe réside dans le fait que ce sont les
écrivains symbolistes qui le comprirent le moins.
Redon, le symbolisme est un jeu assez simple de l’Imaginaire : «Qu’ai-je mis en mes ouvrages pour leur
suggérer tant de subtilités? J’y ai mis une petite porte ouverte sur le
mystère. J’ai fait des fictions. C’est à eux d’aller plus loin».
Eux, c’est-à-dire aux spectateurs. Ses fusains et ses toiles, moins chargés que
celles de Moreau, apparaissent pour certains, comme de vrais figures sorties de
l’inconscient. Comme en parlait le critique Aurier en 1891 : «Odilon Redon, dont les lithographies sont
des cauchemars. Le doigt de [cet] artiste semble déchirer, autour de nous, le
voile de tous les mystères… et sa bouche semble nous crier que le résultat de
toute science humaine, de toute pensée est un frisson de peur dans l’infini de
la nuit». Redon semble s’amuser de
ces frayeurs, un peu comme son modèle littéraire Edgar Poe. Ainsi, lorsqu’il
affirme que «le sens du mystère, c’est
d’être tout le temps dans l’équivoque, dans les double, triple aspects, des
soupçons d’aspect (images dans images), formes qui vont être, ou qui le seront
selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que suggestives,
puisqu’elles apparaissent».
N’est-ce pas là une évocation au poème de Poe, du rêve dans le rêve? Voilà sans doute pourquoi «Redon fut incompris jusqu’à la fin du siècle car il peignait des objets
et des êtres qui n’existaient pas dans le monde mais seulement dans sa vision
subjective», seulement dans des
cauchemars qui surgissent dans des rêves. Cette subjectivité donnait le
symbolisme à son meilleur et le paradoxe réside dans le fait que ce sont les
écrivains symbolistes qui le comprirent le moins.
C’est le cas du plus
célèbre d’entre tous, Joris-Karl Huysmans. Plus que la sensibilité du
peintre-poète, Huysmans, comme tant d’autres, prisa l’ésotérisme que semblaient
contenir les compositions de Redon :  «Bien
que quelques-uns des écrivains symbolistes fussent imperméables à l’art de
Redon, la plupart d’entre eux furent attirés par son ésotérisme, sa profonde
originalité, son mysticisme délicat et son inquiétante imagination».
Huysmans n’était pas hostile à Redon. Mais Redon lui apparaissait comme la fin
d’une tradition qui avait dominé au XIXe siècle : «“Si nous exceptons Goya et Gustave Moreau, dont Redon est, en somme,
dans ses parties saines, un bien lointain élève, écrivait Huysmans, nous ne lui
trouverons d’ancêtres que parmi des musiciens peut-être et certainement parmi
des poètes.” Parlant de “parties saines”, le romancier insinuait qu’il y en
avait de malsaines (ce côté maladif auquel Wyzewa était si sensible). Huysmans
devait dire dans À rebours que les
dessins de Redon étaient “en dehors de tout, ils sautaient pour la plupart
par-dessus les bornes de la peinture, ils innovaient un fantastique très
spécial de maladie et de délire”. Il est
«Bien
que quelques-uns des écrivains symbolistes fussent imperméables à l’art de
Redon, la plupart d’entre eux furent attirés par son ésotérisme, sa profonde
originalité, son mysticisme délicat et son inquiétante imagination».
Huysmans n’était pas hostile à Redon. Mais Redon lui apparaissait comme la fin
d’une tradition qui avait dominé au XIXe siècle : «“Si nous exceptons Goya et Gustave Moreau, dont Redon est, en somme,
dans ses parties saines, un bien lointain élève, écrivait Huysmans, nous ne lui
trouverons d’ancêtres que parmi des musiciens peut-être et certainement parmi
des poètes.” Parlant de “parties saines”, le romancier insinuait qu’il y en
avait de malsaines (ce côté maladif auquel Wyzewa était si sensible). Huysmans
devait dire dans À rebours que les
dessins de Redon étaient “en dehors de tout, ils sautaient pour la plupart
par-dessus les bornes de la peinture, ils innovaient un fantastique très
spécial de maladie et de délire”. Il est  possible que ce soit ce qui ait attiré
les poètes symbolistes : en effet, Redon se trouva bientôt l’objet d’une sorte
de louange intéressée qui était soulevée moins par la compréhension de son
œuvre que par l’approbation de ses tendances».
Ce sont les fusains de Redon qui livrent cet aspect malsain qu’y reconnaît Huysmans : «Le noir de Redon est un noir total que rien ne prostitue, un noir sourd
qui n’éveille aucune sensualité : “Il est agent de l’esprit bien plus que la
belle couleur de la palette ou du prisme.” L’austérité de ses fusains appartient
au silence des ténèbres. J’apprécie surtout le fantastique singulier de ses
dessins. Que se soit à travers l’expression de l’épouvantable araignée “logeant
au milieu de son corps une face humaine” (J.-K. Huysmans) ou celle des yeux
fous “jaillissant des visages humains, déformés, comme dans des verres de
bouteille, par le cauchemar” (ibid.), cet artiste demeure pour moi “le Prince
des mystérieux rêves, le Paysagiste des eaux souterraines et des déserts
bouleversés de lave (…) Le subtil Lithographe de la Douleur, le Nécroman du crayon, égaré pour le plaisir de quelques aristocrates de l’art,
dans le milieu démocratique du Paris moderne” (ibid.)».
Le Prince du rêve, son Cyclope, son Christ, ses arachnoïdes grimaçantes, enfin la mort masquée qui
sonne le glas, sont de ces noirs sourds
qui n’éveillent aucune sensualité. Rien que l’angoisse des ténèbres.
possible que ce soit ce qui ait attiré
les poètes symbolistes : en effet, Redon se trouva bientôt l’objet d’une sorte
de louange intéressée qui était soulevée moins par la compréhension de son
œuvre que par l’approbation de ses tendances».
Ce sont les fusains de Redon qui livrent cet aspect malsain qu’y reconnaît Huysmans : «Le noir de Redon est un noir total que rien ne prostitue, un noir sourd
qui n’éveille aucune sensualité : “Il est agent de l’esprit bien plus que la
belle couleur de la palette ou du prisme.” L’austérité de ses fusains appartient
au silence des ténèbres. J’apprécie surtout le fantastique singulier de ses
dessins. Que se soit à travers l’expression de l’épouvantable araignée “logeant
au milieu de son corps une face humaine” (J.-K. Huysmans) ou celle des yeux
fous “jaillissant des visages humains, déformés, comme dans des verres de
bouteille, par le cauchemar” (ibid.), cet artiste demeure pour moi “le Prince
des mystérieux rêves, le Paysagiste des eaux souterraines et des déserts
bouleversés de lave (…) Le subtil Lithographe de la Douleur, le Nécroman du crayon, égaré pour le plaisir de quelques aristocrates de l’art,
dans le milieu démocratique du Paris moderne” (ibid.)».
Le Prince du rêve, son Cyclope, son Christ, ses arachnoïdes grimaçantes, enfin la mort masquée qui
sonne le glas, sont de ces noirs sourds
qui n’éveillent aucune sensualité. Rien que l’angoisse des ténèbres.
 |
| Odilon Redon. Ecce Homo. |
 |
| Odilon Redon. Silence, 1911. |
Comme chez Moreau,
on retrouve, en peintures, ses Chimères, cette
inquiétante figure du Silence,
bloquée dans un utérus et portant ses deux doigts sur ses lèvres, des tableaux
à prétentions bouddhiques avec ses  lamas et ses fleurs volantes. Art féminin
hanté ici aussi par la castration, la dévoration par la femme cannibale, lignes
ondulées des airs et des eaux, fleurs mélancoliques morbides, l’œuvre de Redon
appartient à la même pensée que celle de Gustave Moreau : «Redon affirma toujours que son imagination
prenait racine dans l’observation de la nature, que ses dessins étaient
“vrais”, que les êtres fantastiques qu’il créait, les visions démoniaques qu’il
fixait en blanc et noir, appartenaient à un monde qui n’était jamais absolument
détaché de la réalité. Selon ses propres mots : “Toute mon originalité consiste
à faire vivre humainement des êtres invraisemblables selon les lois du
vraisemblable, en mettant, autant que possible, la logique du visible au
service de l’invisible.” Il put y réussir parce que les fantômes qui hantaient
ses rêves n’étaient pas de pures inventions comme celles de Moreau, ni des
images soigneusement polies comme celles de Puvis; c’étaient des êtres ou des
formes qu’il avait vus et qu’il faisait revivre dans un langage purement
lamas et ses fleurs volantes. Art féminin
hanté ici aussi par la castration, la dévoration par la femme cannibale, lignes
ondulées des airs et des eaux, fleurs mélancoliques morbides, l’œuvre de Redon
appartient à la même pensée que celle de Gustave Moreau : «Redon affirma toujours que son imagination
prenait racine dans l’observation de la nature, que ses dessins étaient
“vrais”, que les êtres fantastiques qu’il créait, les visions démoniaques qu’il
fixait en blanc et noir, appartenaient à un monde qui n’était jamais absolument
détaché de la réalité. Selon ses propres mots : “Toute mon originalité consiste
à faire vivre humainement des êtres invraisemblables selon les lois du
vraisemblable, en mettant, autant que possible, la logique du visible au
service de l’invisible.” Il put y réussir parce que les fantômes qui hantaient
ses rêves n’étaient pas de pures inventions comme celles de Moreau, ni des
images soigneusement polies comme celles de Puvis; c’étaient des êtres ou des
formes qu’il avait vus et qu’il faisait revivre dans un langage purement
 pictural. Il exécuta même des séries de lithographies et de dessins inspirés
par Poe et Flaubert, parvenant à des effets mystérieux par les lignes, les
contrastes et la composition, sans emprunter trop de symboles à la littérature.
Pour lui, la poésie n’était pas seulement un jeu de lignes, un assemblage de
couleurs; la poésie était partie inhérente de son imagination et de sa vision.
Il n’avait pas besoin de rechercher l’équivalent plastique de ses émotions
parce que ses œuvres n’étaient pas une traduction d’idées d’un moyen
d’expression dans un autre. Redon vivait dans un monde de rêves beaux et
inquiétants, inséparables de la réalité; ces rêves étant réels pour lui, il ne
prenait pas la peine de découvrir leur signification. Ce qu’il désirait,
c’était les exprimer avec les couleurs les plus voluptueuses, les plus
puissantes, ou les plus subtiles oppositions de blanc et noir. Or il n’était
pas facile, à une époque de naturalisme et de rationalisme, de trouver un
public pour les créations d’un esprit à la fois tourmenté et serein. Comme
c’était à prévoir, ceux qui voyaient poindre avec appréhension la littérature
symbolistes se sentaient également mal à l’aise devant l’art de Redon».
L’art symboliste ne parvenait, pas plus que l’art réaliste, à produire des
œuvres optimistes. Nous n’étions plus dans le XVIIIe siècle conquérant, avec
ses scènes grivoises, ces nus féminins rosés du rococo ou les fesses rondes des
néo-classiques combattants romains pour la délivrance des Sabines.
pictural. Il exécuta même des séries de lithographies et de dessins inspirés
par Poe et Flaubert, parvenant à des effets mystérieux par les lignes, les
contrastes et la composition, sans emprunter trop de symboles à la littérature.
Pour lui, la poésie n’était pas seulement un jeu de lignes, un assemblage de
couleurs; la poésie était partie inhérente de son imagination et de sa vision.
Il n’avait pas besoin de rechercher l’équivalent plastique de ses émotions
parce que ses œuvres n’étaient pas une traduction d’idées d’un moyen
d’expression dans un autre. Redon vivait dans un monde de rêves beaux et
inquiétants, inséparables de la réalité; ces rêves étant réels pour lui, il ne
prenait pas la peine de découvrir leur signification. Ce qu’il désirait,
c’était les exprimer avec les couleurs les plus voluptueuses, les plus
puissantes, ou les plus subtiles oppositions de blanc et noir. Or il n’était
pas facile, à une époque de naturalisme et de rationalisme, de trouver un
public pour les créations d’un esprit à la fois tourmenté et serein. Comme
c’était à prévoir, ceux qui voyaient poindre avec appréhension la littérature
symbolistes se sentaient également mal à l’aise devant l’art de Redon».
L’art symboliste ne parvenait, pas plus que l’art réaliste, à produire des
œuvres optimistes. Nous n’étions plus dans le XVIIIe siècle conquérant, avec
ses scènes grivoises, ces nus féminins rosés du rococo ou les fesses rondes des
néo-classiques combattants romains pour la délivrance des Sabines.
 |
| Edward Munch. Près du lit de la mort (la fièvre), 1915. |
Le troisième maître
du symbolisme est sans contredit Edward Munch (1863-1944). Compatriote d’Ibsen,
Munch a illustré dans des teintes symbolistes les angoisses profondes de
l’individu. La solitude, l’agonie, la  mort, le deuil, tous dans des décors
minimalistes propres aux intérieurs des foyers scandinaves : «Le projet que Munch développe est fascinant.
Dès qu’il échappe à la séduction spéculaire et que, sur la frayeur, il invente
l’onde du désir, la trace du cauchemar, l’intonation de l’angoisse, l’image
entre en crue. En subir l’emprise, ce n’est pas seulement éprouver une
expérience humaine. C’est se laisser fouetter par la puissance du langage.
Charnelle. Elle exprime, comme Mallarmé l’entend de la poésie, le “sens
mystérieux des aspects de l’existence”. Comme si l’aventure plastique se
passait, telle la vie littéraire, à révéler la présence, au dedans des accords
et significations. Comme Mallarmé, il faut, aurait pu dire Munch, “penser de
tout son corps”. Toute son œuvre, dès qu’elle abandonne la procédure mimétique
- c’est-à-dire dès
mort, le deuil, tous dans des décors
minimalistes propres aux intérieurs des foyers scandinaves : «Le projet que Munch développe est fascinant.
Dès qu’il échappe à la séduction spéculaire et que, sur la frayeur, il invente
l’onde du désir, la trace du cauchemar, l’intonation de l’angoisse, l’image
entre en crue. En subir l’emprise, ce n’est pas seulement éprouver une
expérience humaine. C’est se laisser fouetter par la puissance du langage.
Charnelle. Elle exprime, comme Mallarmé l’entend de la poésie, le “sens
mystérieux des aspects de l’existence”. Comme si l’aventure plastique se
passait, telle la vie littéraire, à révéler la présence, au dedans des accords
et significations. Comme Mallarmé, il faut, aurait pu dire Munch, “penser de
tout son corps”. Toute son œuvre, dès qu’elle abandonne la procédure mimétique
- c’est-à-dire dès  ces années parisiennes - et sans jamais avoir recours à la
matière historique, au discours mythique, est divagation de forces.
Ruissellement d’intempéries. Tension. La couleur, la tache, la ligne, le
graphe, le gramme sont subordonnés à une fonction centrale : faire écho aux
pulsions. Il est temps de dire de Munch
qu’il se roule dans la pâte: de telle sorte qu’il ébranle les unités
signifiantes traditionnelles (à l’inverse de la calligraphie de Moreau). De là
la censure en extase. La ligne en frisson. Le fluide étalement. Le spasme
visqueux. Écriture violente. Flottante. Désirante. À cordes. Voiles, voilures.
Jaillissante. Elle est jaillissement;
à rapprocher - démon de l’analogie - du feu fondamental, du phénomène d’effulgences
que J.-P Richard isole chez Mallarmé
comme donnée immédiate de la conscience créatrice, comme “mode forcené et quasi
physiologique” identifiable à la furie
comme “mouvement sauvage d’un génie qui se précipiterait hors de lui-même
ces années parisiennes - et sans jamais avoir recours à la
matière historique, au discours mythique, est divagation de forces.
Ruissellement d’intempéries. Tension. La couleur, la tache, la ligne, le
graphe, le gramme sont subordonnés à une fonction centrale : faire écho aux
pulsions. Il est temps de dire de Munch
qu’il se roule dans la pâte: de telle sorte qu’il ébranle les unités
signifiantes traditionnelles (à l’inverse de la calligraphie de Moreau). De là
la censure en extase. La ligne en frisson. Le fluide étalement. Le spasme
visqueux. Écriture violente. Flottante. Désirante. À cordes. Voiles, voilures.
Jaillissante. Elle est jaillissement;
à rapprocher - démon de l’analogie - du feu fondamental, du phénomène d’effulgences
que J.-P Richard isole chez Mallarmé
comme donnée immédiate de la conscience créatrice, comme “mode forcené et quasi
physiologique” identifiable à la furie
comme “mouvement sauvage d’un génie qui se précipiterait hors de lui-même  vers
le havre vague d’une expression. […]
tout indique que entre les deux hommes la sympathie que fonde l’imaginaire
biologique, la subversion topologique, la dimension cosmique du corps traversé
de contractions douloureuses. C’est pourquoi sans doute encore y a-t-il chez
Munch une figure de l’onde qui
pourrait être mise en regard de la figure mallarméenne du pli telle que la relève J.-P. Richard pour
joindre l’érotique au sensible : “le pli étant à la fois sexe, feuillage,
miroir, livre, tombeau”, toutes réalités que l’un et l’autre rassemblent en un
rêve spécifique d’intimité».
Mais également, angoisse, solitude et incommunicabilité hantises d’un monde bourgeois satisfait de
lui, mais inquiet; une classe qui avait appris à détourner le regard de la réalité devant laquelle elle se sentait saisie d'une anxiété qui ne lui laissait plus que deux options. Ou bien se retenir au point de refouler en elle son sentiment de détresse face à la condition humaine ou pousser le pire cri que l'on puisse entendre et qui résonnera devant les boucheries de la Seconde Guerre de Trente Ans (1914-1945).
vers
le havre vague d’une expression. […]
tout indique que entre les deux hommes la sympathie que fonde l’imaginaire
biologique, la subversion topologique, la dimension cosmique du corps traversé
de contractions douloureuses. C’est pourquoi sans doute encore y a-t-il chez
Munch une figure de l’onde qui
pourrait être mise en regard de la figure mallarméenne du pli telle que la relève J.-P. Richard pour
joindre l’érotique au sensible : “le pli étant à la fois sexe, feuillage,
miroir, livre, tombeau”, toutes réalités que l’un et l’autre rassemblent en un
rêve spécifique d’intimité».
Mais également, angoisse, solitude et incommunicabilité hantises d’un monde bourgeois satisfait de
lui, mais inquiet; une classe qui avait appris à détourner le regard de la réalité devant laquelle elle se sentait saisie d'une anxiété qui ne lui laissait plus que deux options. Ou bien se retenir au point de refouler en elle son sentiment de détresse face à la condition humaine ou pousser le pire cri que l'on puisse entendre et qui résonnera devant les boucheries de la Seconde Guerre de Trente Ans (1914-1945).
 |
| Edward Munch. Mort dans la chambre du patient, 1894. |
 |
| Edward Munch. Le cri, 1893 |
La réputation de Munch se diffusa à la manière de celle d'Ibsen. Venant des pays nordiques à l'apparence étrangère au reste du continent européen, elle s'élabora comme une vision inquiétante, dérangeante, du  développement des relations humaines. L'ambiance luthérienne y était pour quelque chose. L'inquiétude du salut domine un grand nombre de toiles du peintre. La modernité lui semble avoir tué l'esprit humain. Les scènes répétées de deuil, d'agonie, de veillée funèbre sont là pour rappeler la disparition d'un monde que l'on laisse s'échapper, sans penser même le retenir. Et l'épouvante s'empare de la fillette auprès de sa mère décédée (1901). Le sexe ne suffit pas à servir de truchement entre l'homme et la femme. Les lueurs des rayons crépusculaires du soleil nordique surprend le personnage du Cri et lui fait réaliser la raison que ce monde est en train de perdre pour des chimères de progrès et de bonheur. Le prix à payer est trop lourd. La faute de Judas retombe sur le commun des passants. Tous se détournent de la foi qui seule pourrait les sauver. Une panique folle s'empare des masques dénués d'âme dans le Golgotha. C'est par cette toile effarante que, en 1900, Munch célébra le dix-neufcentième anniversaire de naissance de Jésus. Ces inquiétudes inouïes qui envahirent l'esprit de Munch envahit également celui de beaucoup de ses contemporains, et le Belge James Ensor (1860-1949), qui devait être témoin de la catastrophe annoncée, rejoint non seulement les mêmes thèmes que ceux de Munch, mais également le même cynisme désespéré.
développement des relations humaines. L'ambiance luthérienne y était pour quelque chose. L'inquiétude du salut domine un grand nombre de toiles du peintre. La modernité lui semble avoir tué l'esprit humain. Les scènes répétées de deuil, d'agonie, de veillée funèbre sont là pour rappeler la disparition d'un monde que l'on laisse s'échapper, sans penser même le retenir. Et l'épouvante s'empare de la fillette auprès de sa mère décédée (1901). Le sexe ne suffit pas à servir de truchement entre l'homme et la femme. Les lueurs des rayons crépusculaires du soleil nordique surprend le personnage du Cri et lui fait réaliser la raison que ce monde est en train de perdre pour des chimères de progrès et de bonheur. Le prix à payer est trop lourd. La faute de Judas retombe sur le commun des passants. Tous se détournent de la foi qui seule pourrait les sauver. Une panique folle s'empare des masques dénués d'âme dans le Golgotha. C'est par cette toile effarante que, en 1900, Munch célébra le dix-neufcentième anniversaire de naissance de Jésus. Ces inquiétudes inouïes qui envahirent l'esprit de Munch envahit également celui de beaucoup de ses contemporains, et le Belge James Ensor (1860-1949), qui devait être témoin de la catastrophe annoncée, rejoint non seulement les mêmes thèmes que ceux de Munch, mais également le même cynisme désespéré.
 |
| Edward Munch. Le Golgotha, 1900. |
 |
| James Ensor. Autoportrait avec masques, 1899. |
James Ensor devait, comme Bosch à son époque,
rappeler à la bourgeoisie le mensonge qui constituait son optimisme alors
que la vérité résidait dans cette honte de soi, cet esprit de lucre et de luxe
qui n’avait rien du calme et de la
volupté que lui supposait Baudelaire. La mascarade du progrès n’impressionnait
plus, bien avant qu’elle ne finisse de jouer sous la pluie des obus : «Personne n’a mieux que lui sonné le glas de
l’art bourgeois et compris que la beauté devait se faire convulsive pour
traduire la pourriture dans laquelle nous vivons. Visionnaire, il a vu une
réalité au-dessus des réalités. Il a ressenti dans sa chair même l’esprit, la
vie de la matière, même dans la banalité des objets quotidiens. Certains
meubles sont hantés, les objets frissonnent. Témoin des préjugés, de la
mascarade de la vie et de la bêtise bourgeoise, le monde est apparu très vite
comme un milieu hostile : seuls la farce et le sarcasme pouvaient le corriger.
“Sa sensibilité fine comme le grain d’un bois rare et précieux a subi les coups
de rabot de la bêtise (…) il met comme une ardeur noire à dénaturer, à
déformer, à calomnier la vie” (É. Verhaeren). Ensor est l’inépuisable
fantaisiste qui nous entraîne dans le royaume de la fantasmagorie et de
l’hallucination, des diableries et des mascarades, qui éclabousse et provoque
le ricanement, celui qui invoque une légion de diablotins pour lutter contre
l’horreur environnante. Dans ces fantaisies grotesques, le plus souvent des
eaux-fortes: “l’impudeur, l’indécence, la scatologie même apparaissent” (ibid.)».
Par ses thématiques et le traitement de ses œuvres, Ensor, sans rompre avec le symbolisme, annonce la tombée des masques inquiétants. Le Gilles mélancolique, le Pierrot candide, la Pulcinella grimaçante, entourent ce masque de la Mort qui a pris la place qui est normalement celle d'Arlequin. Ces images infernales dans lesquelles Bosch avait plongé ses personnages ne trouvent plus d'équivalents heureux dans l'art symboliste (car s’il
existait un Jardin des délices du temps de Bosch, celui-ci semble s'être évanoui rendu au temps de Ensor); ne reste donc plus que la poésie de Verlaine pour pleurer les masques tombés :
Ce n'est plus le rêveur lunaire du vieil air
Qui riait aux aïeux dans les dessus de porte;
Sa gaîté, comme sa chandelle, hélas! est morte,
Et son spectre aujourd'hui nous hante, mince et clair.
Et voici que parmi l'effroi d'un long éclair
Sa pâle blouse a l'air, au vent froid qui l'emporte,
D'un linceul, et sa bouche est béante, de sorte
Qu'il semble hurler sous les morsures du ver.
Avec le bruit d'un vol d'oiseaux de nuit qui passe,
Ses manches blanches font vaguement par l'espace
Des signes fous auxquels personne ne répond.
Ses yeux sont deux grands trous où rampe du phosphore
Et la farine rend plus effroyable encore
Sa face exsangue au nez pointu de moribond.
Verlaine. «Pierrot», in Jadis et naguère.
 |
| James Ensor. La Mort et les masques, 1897. |
La poésie symboliste
française n’a découvert son premier génie que bien des années plus tard. Le
jeune  Isidore Ducasse, né à Montevideo en Uruguay, était mort de faim, à l'âge de 24 ans,
durant le siège de Paris en 1870. Fils d’une famille d’administrateurs à la
Chancellerie de Montevideo, fuyant la guerre civile en Uruguay, il sera
rattrapé par la guerre franco-prussienne. Revêtant les atours de la noblesse,
Ducasse signa ses œuvres poétiques du nom de comte de Lautréamont. Poésie en prose, les Chants de Maldoror ne seront publiés qu’en 1885 et vite lus par
Alfred Jarry qui qualifiera son auteur comme appartenant à l’univers de la pataphysique. Les surréalistes, un peu plus tard,
regarderons Lautréamont comme le premier des leurs. Pour Huysmans, déjà habitué
à l’art des Moreau et Redon, Lautréamont était leur frère en lettres et se
demanda : «Que diable pouvait faire
dans la vie l’homme qui a écrit d’aussi terribles rêves?», alors que Léon
Bloy lui consacra, dès 1890, une critique admirative intitulée Le cabanon de Prométhée. La force des
images est sans doute ce qui domine dans l’œuvre de Lautréamont, qui s’adresse
aux lecteurs avec une vive interpellation : «“Oui, bonne gens, c’est moi qui vous ordonne de brûler sur une pelle
rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute, aux lèvres de
vermouth, qui, répandant dans une lutte
Isidore Ducasse, né à Montevideo en Uruguay, était mort de faim, à l'âge de 24 ans,
durant le siège de Paris en 1870. Fils d’une famille d’administrateurs à la
Chancellerie de Montevideo, fuyant la guerre civile en Uruguay, il sera
rattrapé par la guerre franco-prussienne. Revêtant les atours de la noblesse,
Ducasse signa ses œuvres poétiques du nom de comte de Lautréamont. Poésie en prose, les Chants de Maldoror ne seront publiés qu’en 1885 et vite lus par
Alfred Jarry qui qualifiera son auteur comme appartenant à l’univers de la pataphysique. Les surréalistes, un peu plus tard,
regarderons Lautréamont comme le premier des leurs. Pour Huysmans, déjà habitué
à l’art des Moreau et Redon, Lautréamont était leur frère en lettres et se
demanda : «Que diable pouvait faire
dans la vie l’homme qui a écrit d’aussi terribles rêves?», alors que Léon
Bloy lui consacra, dès 1890, une critique admirative intitulée Le cabanon de Prométhée. La force des
images est sans doute ce qui domine dans l’œuvre de Lautréamont, qui s’adresse
aux lecteurs avec une vive interpellation : «“Oui, bonne gens, c’est moi qui vous ordonne de brûler sur une pelle
rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute, aux lèvres de
vermouth, qui, répandant dans une lutte  mélancolique entre le bien et le mal
des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait,
partout, le vide universel”. Poésie de révolte. Écriture dévorante (dévorante
du langage pré-établi), dégagée des convenances de l’art (faire avec les
entrailles du système verbal). Textes tendus. Sauvages. Pleins de “poisons”,
d’“émanations mortelles”. Véhicule des “eaux ironiques de l’éther” et de toutes
les images du “cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l’ombre”:
le symbolisme commence dès que le mot se déplace sur le curseur de l’imaginaire
et que, de surcroît, il s’engage, porté par l’onde pulsionnelle, sur l’axe de
la condensation métaphorique».
Les cauchemars de Redon renvoient, effectivement, à ceux de Lautréamont, pleins
de métamorphoses de l’être qui échappe à sa nature, voire à sa réalité :
mélancolique entre le bien et le mal
des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait,
partout, le vide universel”. Poésie de révolte. Écriture dévorante (dévorante
du langage pré-établi), dégagée des convenances de l’art (faire avec les
entrailles du système verbal). Textes tendus. Sauvages. Pleins de “poisons”,
d’“émanations mortelles”. Véhicule des “eaux ironiques de l’éther” et de toutes
les images du “cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l’ombre”:
le symbolisme commence dès que le mot se déplace sur le curseur de l’imaginaire
et que, de surcroît, il s’engage, porté par l’onde pulsionnelle, sur l’axe de
la condensation métaphorique».
Les cauchemars de Redon renvoient, effectivement, à ceux de Lautréamont, pleins
de métamorphoses de l’être qui échappe à sa nature, voire à sa réalité :
«Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me
regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma
peau, couverte de pus jaunâtre. Je ne connais pas l’eau des fleuves, ni la
rosée des nuages. Sur ma nuque, comme un fumier, pousse un  énorme champignon
aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n’ai pas bougé mes
membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et
composent, jusqu’à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie
d’ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, et qui n’est plus
de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il, si la pourriture
et les exhalaisons de mon cadavre (je n’ose pas dire corps) ne le nourrissaient
abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris
résidence, et, quand l’un d’eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde
qu’il ne s’en échappe un, et ne vienne gratter, avec sa bouche, le dedans de
votre oreille : il serait ensuite capable d’entrer dans votre cerveau.
Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse
perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim : il faut que chacun vivre.
Mais, quand un parti déjoue complètement les ruses de l’autre, ils ne trouvent
rien de mieux que de ne pas se gêner, et sucent la graisse délicate qui couvre
mes côtes : j’y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a
pris sa place : elle m’a rendu eunuque, cette infâme. Oh! si j’avais pu me
défendre avec mes bras paralysés; mais, je crois plutôt qu’ils se sont changés
en bûches. Quoi qu’il en soit, il importe de constater que le sang ne vient
plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons, qui ne croissent plus, ont
jeté à un chien, qui n’a pas refusé, l’intérieur de mes testicules :
l’épiderme, soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L’anus a été intercepté
par un crabe; encouragé par mon inertie, il garde l’entrée avec ses pinces, et
me fait beaucoup de mal! Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement
alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention
les deux parties charnues qui forment le derrière humain, et, se cramponnant à
leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression
constante, que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu’il est resté
deux monstres sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme
et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c’est un
glaive. Oui, oui… je n’y faisais pas attention… votre demande est juste. Vous
désirez savoir, n’est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans
mes reins? Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement; cependant, si je
me décide à prendre pour un souvenir ce qui n’est peut-être qu’un rêve, sachez
que l’homme, quand il a su que j’avais fait vœu de vivre avec la maladie et
l’immobilité jusqu’à ce que j’eusse vaincu le Créateur, marcha, derrière moi,
sur la pointe des pieds, mais, non pas si doucement, que je ne l’entendisse. Je
ne perçus plus rien, pendant un instant qui ne fut pas long…» (Chant IV).
énorme champignon
aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n’ai pas bougé mes
membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et
composent, jusqu’à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie
d’ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, et qui n’est plus
de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il, si la pourriture
et les exhalaisons de mon cadavre (je n’ose pas dire corps) ne le nourrissaient
abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris
résidence, et, quand l’un d’eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde
qu’il ne s’en échappe un, et ne vienne gratter, avec sa bouche, le dedans de
votre oreille : il serait ensuite capable d’entrer dans votre cerveau.
Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse
perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim : il faut que chacun vivre.
Mais, quand un parti déjoue complètement les ruses de l’autre, ils ne trouvent
rien de mieux que de ne pas se gêner, et sucent la graisse délicate qui couvre
mes côtes : j’y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a
pris sa place : elle m’a rendu eunuque, cette infâme. Oh! si j’avais pu me
défendre avec mes bras paralysés; mais, je crois plutôt qu’ils se sont changés
en bûches. Quoi qu’il en soit, il importe de constater que le sang ne vient
plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons, qui ne croissent plus, ont
jeté à un chien, qui n’a pas refusé, l’intérieur de mes testicules :
l’épiderme, soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L’anus a été intercepté
par un crabe; encouragé par mon inertie, il garde l’entrée avec ses pinces, et
me fait beaucoup de mal! Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement
alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention
les deux parties charnues qui forment le derrière humain, et, se cramponnant à
leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression
constante, que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu’il est resté
deux monstres sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme
et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c’est un
glaive. Oui, oui… je n’y faisais pas attention… votre demande est juste. Vous
désirez savoir, n’est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans
mes reins? Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement; cependant, si je
me décide à prendre pour un souvenir ce qui n’est peut-être qu’un rêve, sachez
que l’homme, quand il a su que j’avais fait vœu de vivre avec la maladie et
l’immobilité jusqu’à ce que j’eusse vaincu le Créateur, marcha, derrière moi,
sur la pointe des pieds, mais, non pas si doucement, que je ne l’entendisse. Je
ne perçus plus rien, pendant un instant qui ne fut pas long…» (Chant IV).
 |
| Sybille Ruppert. Hommage à K.S. |
Contrairement à la
métamorphose de Gregor Samsa dans la nouvelle de Kafka, qui se réveille un
matin métamorphosé en monstrueux insecte,
Maldoror nous raconte, étape par étape, les mutations de son corps et les
réflexions qu’y porte son esprit. Pour Lautréamont, «la réalité est trois fois pire que le rêve», voilà  pourquoi le
symbolisme, tout en étant unefu ite du monde réel, traverse l’épaisseur de la
réalité pour en étaler l’équivalent en
rêves démoniaques et en cauchemars effroyables. Aucun autre poète symboliste
n’alla aussi loin dans cette direction que Lautréamont. Pas même Rimbaud :
«La solution de la vie simple, de la voie
droite et de la tâche limitée qu’il accueille maintenant comme la vérité de son
existence renouvelée, n’est, elle-même, pas simple. Tout le monde le comprend :
à un tel instant, trois ans avant Rimbaud, après une expérience à la fois
analogue et fort différente (car, conduite tout entière à travers un livre où
pourtant sa vie a été de fond en comble mise à l’épreuve, cette expérience, par
son propre mouvement, l’a porté à ce point où il lui faut s’en détourner, la
rejeter et accueillir la rigueur “très sévère” de “l’heure nouvelle”),
Lautréamont - après avoir passé en enfer une saison toute semblable, même par
la nature de la hantise érotique - en est exactement à cet “Adieu” qui va jeter
Rimbaud dans le désert du Harrar. Mais le même “Adieu” jette Lautréamont dans
un désert bien plus lugubre, celui du bien, et l’on voit la différence. De même
que l’expérience qui a été celle de Rimbaud, par certains côtés plus
méthodique, plus théorique et plus volontaire, a cependant intéressé, autant
qu’on le présume, davantage sa vie, a été aussi bien une aventure vécue qu’une
aventure du langage, de même le congédiement de l’expérience n’a apparemment de
conséquences que pour la vie de Rimbaud et l’enferme dans cette vie comme dans
une tombe. Lautréamont qui n’a pu se délivrer de lui-même que par l’expérience
d’un livre, ne peut se délivrer de cette expérience que par un autre livre. Lui
aussi a inventé “de
pourquoi le
symbolisme, tout en étant unefu ite du monde réel, traverse l’épaisseur de la
réalité pour en étaler l’équivalent en
rêves démoniaques et en cauchemars effroyables. Aucun autre poète symboliste
n’alla aussi loin dans cette direction que Lautréamont. Pas même Rimbaud :
«La solution de la vie simple, de la voie
droite et de la tâche limitée qu’il accueille maintenant comme la vérité de son
existence renouvelée, n’est, elle-même, pas simple. Tout le monde le comprend :
à un tel instant, trois ans avant Rimbaud, après une expérience à la fois
analogue et fort différente (car, conduite tout entière à travers un livre où
pourtant sa vie a été de fond en comble mise à l’épreuve, cette expérience, par
son propre mouvement, l’a porté à ce point où il lui faut s’en détourner, la
rejeter et accueillir la rigueur “très sévère” de “l’heure nouvelle”),
Lautréamont - après avoir passé en enfer une saison toute semblable, même par
la nature de la hantise érotique - en est exactement à cet “Adieu” qui va jeter
Rimbaud dans le désert du Harrar. Mais le même “Adieu” jette Lautréamont dans
un désert bien plus lugubre, celui du bien, et l’on voit la différence. De même
que l’expérience qui a été celle de Rimbaud, par certains côtés plus
méthodique, plus théorique et plus volontaire, a cependant intéressé, autant
qu’on le présume, davantage sa vie, a été aussi bien une aventure vécue qu’une
aventure du langage, de même le congédiement de l’expérience n’a apparemment de
conséquences que pour la vie de Rimbaud et l’enferme dans cette vie comme dans
une tombe. Lautréamont qui n’a pu se délivrer de lui-même que par l’expérience
d’un livre, ne peut se délivrer de cette expérience que par un autre livre. Lui
aussi a inventé “de  nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs,
de nouvelles langues”, mais quand il “enterre” tout cela, quand il s’enterre
lui-même, c’est encore au sein de la littérature, et son reniement est un
reniement d’abord littéraire. En principe, il n’y a rien là de très
remarquable, et cette manière de se renier peut apparaître banale et non pas
exemplaire comme celle de Rimbaud. Et toutefois, un tel reniement banal, et
même par quelque côté gênant, déplaisant, prend à la fin la même signification
mythique et donne lieu à une énigme non moins étrange et non moins fabuleuse que
celle qui va auréoler Rimbaud».
Car la poésie symboliste n’atteint que très rarement un tel niveau de violence
et de fantastique. En général, comme le note Angenot, «cette poétique du premier moment “symboliste”, malgré son ostentation
d’“à vau-l’eau” de l’âme “dolente”, découvre parfois une musique sous les mots,
le pulsionnel sous le sémantique…».
À ce titre, les poètes se conformaient, avant même sa rédaction, au manifeste
de Maurice Denis. Pour eux, «le but
n’était plus de décrire ou de peindre la nature, mais de suggérer et de communiquer
les impressions des sens, d’une manière subtile et secrète, comme par exemple,
le firent Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Les symbolistes n’essayaient pas de
traduire leurs impressions par des moyens naturalistes, ou bien en faisant
appel à la raison, mais au contraire, de manière tout émotionnelle, par
l’emploi des rythmes musicaux, des sons et des associations suggestives».
Ce que réussirent au plus haut point Paul Verlaine et Arthur Rimbaud.
nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs,
de nouvelles langues”, mais quand il “enterre” tout cela, quand il s’enterre
lui-même, c’est encore au sein de la littérature, et son reniement est un
reniement d’abord littéraire. En principe, il n’y a rien là de très
remarquable, et cette manière de se renier peut apparaître banale et non pas
exemplaire comme celle de Rimbaud. Et toutefois, un tel reniement banal, et
même par quelque côté gênant, déplaisant, prend à la fin la même signification
mythique et donne lieu à une énigme non moins étrange et non moins fabuleuse que
celle qui va auréoler Rimbaud».
Car la poésie symboliste n’atteint que très rarement un tel niveau de violence
et de fantastique. En général, comme le note Angenot, «cette poétique du premier moment “symboliste”, malgré son ostentation
d’“à vau-l’eau” de l’âme “dolente”, découvre parfois une musique sous les mots,
le pulsionnel sous le sémantique…».
À ce titre, les poètes se conformaient, avant même sa rédaction, au manifeste
de Maurice Denis. Pour eux, «le but
n’était plus de décrire ou de peindre la nature, mais de suggérer et de communiquer
les impressions des sens, d’une manière subtile et secrète, comme par exemple,
le firent Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Les symbolistes n’essayaient pas de
traduire leurs impressions par des moyens naturalistes, ou bien en faisant
appel à la raison, mais au contraire, de manière tout émotionnelle, par
l’emploi des rythmes musicaux, des sons et des associations suggestives».
Ce que réussirent au plus haut point Paul Verlaine et Arthur Rimbaud.
 |
| Henri Fantin-Latour. Le coin de table, (détail), 1872. |
Pour Verlaine,
rappelle Étiemble, le mot «symbolisme constitue
un “pur pléonasme, puisque l’essence de la poésie est symbole”. […] pourquoi ne
crierais-je pas, avec Paul Verlaine encore :
À bas le Symbolisme, mythe
Et termite, et encore à bas
Verlaine hésitait à considérer le symbolisme
comme un autre parmi tant de mouvements tant il considérait, comme on vient de
l’entendre dire, que symbolisme et poésie étaient synonyme. Ainsi, «sa réponse, en 1891, à l’enquête de Jules
Huret sur le “Symbolisme” est, sous ce jour, significative : “Symbolisme?
affirma-t-il. Comprends pas. Ça doit être un mot allemand, hein? Qu’est-ce que
cela peut bien vouloir dire? Moi, d’ailleurs, je m’en fiche. Quand je souffre,
quand je jouis et quand je pleure, je sais bien que ça n’est pas du symbole”».
Rimbaud aurait été tout aussi révolté de voir son œuvre embrigadée au service
d’une école. Toutefois, si être
symboliste signifiait éprouver des sensations poussées à leur extrême limite, or, «au moment où Rimbaud souhaitait
se dérégler la sensibilité, il exigeait de soi que ce fût raisonnablement. Ils parlent tous du “dérèglement des
sens”. Tous, ils oublient le “raisonné” qui précède “dérèglement”». Qu'est-ce que l'originalité de Rimbaud, sinon qu'il voulait que la poésie ne soit que cette préparation raisonnée au souffrir, au jouir et aux larmes. En cette simple distinction, c'est toute la différence irréconciliable entre l'époux infernal et la vierge folle, entre Rimbaud et Verlaine. Le symbolisme en venait à signifier «le drame de l’homme pris entre la nécessité de vivre et la volonté de
se protéger contre la vie. Le symbole est ici synthèse et la poésie du moi
se mue en une poésie de l’esprit».
 |
| Édouard Manet. Stéphane Mallarmé. |
Le poète symboliste le plus structuré
méthodiquement demeure Stéphane Mallarmé (1842-1898). Ce professeur, que ses
élèves chahutaient, était un être clair et lucide. «Paul Claudel nous dit que Mallarmé devant les choses se posait une
seule question : “Qu’est-ce que cela veut dire?” Il s’agit toujours de favoriser
la genèse des images, de remonter le cours des analogies jusqu’au plus lointain
clair-obscur, comme si, dans ces arcanes, la vraie figure de l’univers risquait
de s’apparaître à elle-même».
Mallarmé appartenait à la même génération que Verlaine et subissait la tyrannie
de «l’un des plus grands despotes
intellectuels qui soient»,
c’est-à-dire Richard Wagner : «…les
jeunes poètes de la génération montante, fascinés par la révélation de l’art
synthétique de Wagner,  impatients de parvenir à une fusion plus intime du vers
et du son, cherchant des images suggestives et un vocabulaire revivifié,
trouvaient exemple et inspiration dans l’œuvre de ces aînés. “Charles
Baudelaire doit être considéré comme le véritable précurseur du présent
mouvement, proclamait Moréas; Stéphane Mallarmé le lotit du sens du mystère et
de l’ineffable; Paul Verlaine brisa en son honneur les cruelles entraves du
vers que les doigts prestigieux de Théodore de Banville avaient assoupli
auparavant”».
Édouard Dujardin, éditeur de la Revue
Wagnérienne, «croit pouvoir dire que
le modèle symphoniste et totalitaire offert par Wagner est à l’origine du
“mouvement symboliste”. Kaléidoscope héraldique : où le son prétend clamer la
couleur de l’espace, la forêt mimer l’onde, le monstre siffler la chevauchée,
la sirène tracer une rumeur. Le wagnérisme comme phénomène d’extase
individuelle et collective est, pour les évadés du siècle, lyrisme tonique,
abîme du rêve, dérive romantique, réceptacle de fantasmes»,
il semblerait que pour «Mallarmé, le
théâtre symboliste suppose l’éclatement de la figure, la dissolution de toute
impatients de parvenir à une fusion plus intime du vers
et du son, cherchant des images suggestives et un vocabulaire revivifié,
trouvaient exemple et inspiration dans l’œuvre de ces aînés. “Charles
Baudelaire doit être considéré comme le véritable précurseur du présent
mouvement, proclamait Moréas; Stéphane Mallarmé le lotit du sens du mystère et
de l’ineffable; Paul Verlaine brisa en son honneur les cruelles entraves du
vers que les doigts prestigieux de Théodore de Banville avaient assoupli
auparavant”».
Édouard Dujardin, éditeur de la Revue
Wagnérienne, «croit pouvoir dire que
le modèle symphoniste et totalitaire offert par Wagner est à l’origine du
“mouvement symboliste”. Kaléidoscope héraldique : où le son prétend clamer la
couleur de l’espace, la forêt mimer l’onde, le monstre siffler la chevauchée,
la sirène tracer une rumeur. Le wagnérisme comme phénomène d’extase
individuelle et collective est, pour les évadés du siècle, lyrisme tonique,
abîme du rêve, dérive romantique, réceptacle de fantasmes»,
il semblerait que pour «Mallarmé, le
théâtre symboliste suppose l’éclatement de la figure, la dissolution de toute
 personnification, il est un théâtre de l’Idée, du son, de la voix. “Est-ce qu’un
fait spirituel - se demande-t-il -, l’épanouissement de symboles ou leur
préparation, nécessite un lieu, pour s’y développer, autre que le fictif foyer
de vision dardé par le regard d’une foule! Saint des Saints, mais mental. Alors
y aboutissent, dans quelque éclair suprême, d’où s’éveille la Figure que Nul
n’est, chaque attitude mimique prise par elle à un rythme inclus dans la
symphonie, et le délivrant! alors viennent expirer comme aux pieds de cette
incarnation, non sans qu’un lien certain les apparente ainsi à son humanité,
ces raréfactions et ces sommités naturelles que la Musique rend…”».
Et Wyzeva de la revue Art moderne (1889)
de conclure : «C’est ainsi que M.
Mallarmé a été conduit à voir dans la poésie l’expression des symboles,
c’est-à-dire des correspondances mystérieuses et profondes qui existent entre
toutes chosesI».
Par contre, dans son Journal, François Coppée écrivait, dès 1871 : «Mallarmé
devient plus fou que jamais. Je reparlerai de lui et longuement. Cet exquis
insensé en vaut la peine. Mais je note ici la meilleure folie d’hier soir. La
lune le gêne. Il explique le symbolisme des étoiles, dont le désordre dans le
firmament lui paraît l’image du hasard. Mais la lune, qu’il appelle avec mépris
“ce fromage”, lui semble inutile. Il
personnification, il est un théâtre de l’Idée, du son, de la voix. “Est-ce qu’un
fait spirituel - se demande-t-il -, l’épanouissement de symboles ou leur
préparation, nécessite un lieu, pour s’y développer, autre que le fictif foyer
de vision dardé par le regard d’une foule! Saint des Saints, mais mental. Alors
y aboutissent, dans quelque éclair suprême, d’où s’éveille la Figure que Nul
n’est, chaque attitude mimique prise par elle à un rythme inclus dans la
symphonie, et le délivrant! alors viennent expirer comme aux pieds de cette
incarnation, non sans qu’un lien certain les apparente ainsi à son humanité,
ces raréfactions et ces sommités naturelles que la Musique rend…”».
Et Wyzeva de la revue Art moderne (1889)
de conclure : «C’est ainsi que M.
Mallarmé a été conduit à voir dans la poésie l’expression des symboles,
c’est-à-dire des correspondances mystérieuses et profondes qui existent entre
toutes chosesI».
Par contre, dans son Journal, François Coppée écrivait, dès 1871 : «Mallarmé
devient plus fou que jamais. Je reparlerai de lui et longuement. Cet exquis
insensé en vaut la peine. Mais je note ici la meilleure folie d’hier soir. La
lune le gêne. Il explique le symbolisme des étoiles, dont le désordre dans le
firmament lui paraît l’image du hasard. Mais la lune, qu’il appelle avec mépris
“ce fromage”, lui semble inutile. Il  rêve sérieusement un âge plus savant de
l’humanité où on la dissoudra très facilement par des moyens chimiques. Un seul
point l’inquiète: la cessation des marées, et ce bouleversement rythmique de la
mer est nécessaire à sa théorie du symbolisme du décor humain. Hélas! hélas!
pauvre raison humaine…».
Mais Mallarmé ne s’en inquiétait pas pour autant, «Alors (de l’Absolu) son esprit se formant par le hasard absolu de
ce fait) il dit à tout ce vacarme :
certainement il y a là un acte - c’est mon devoir de le proclamer : cette folie
existe». Bientôt, la critique
commença à s’opposer à certaines de ses œuvres, en particulier son poème
musical. L’après-midi d’un faune, après
que le Théâtre-Français le refusa en 1865 : «L’injure faite à Mallarmé […]
lui donne peut-être la tentation de s’en remettre à d’autres que ses
compatriotes du soin de goûter ses vers; ou bien les trésors poétiques
étrangers lui semblent pouvoir apporter au lyrisme français de précieux
enrichissements. Peut-être trouve-t-il à ces étranges artistes de Londres de la
fin du XIXe siècle, venus après George Eliot, et aux préraphaélites, un charme
irrésistible. Le voici, pour quelque temps, en étroite liaison avec les
écrivains anglais. Il expédie régulièrement à l’Athenæum ses courtes et claires notes et donne à O’
Shaughnessy des nouvelles de ses livres et des éditeurs lambins : “le Faune
dont l’après-midi menace d’aboutir en la nuit éternelle; et Vathek plus oublié par l’imprimeur que le rituel
ancien d’une momie”…».
Il faudra attendre la mise en musique par Debussy pour que ce poème trouve
finalement son publique.
rêve sérieusement un âge plus savant de
l’humanité où on la dissoudra très facilement par des moyens chimiques. Un seul
point l’inquiète: la cessation des marées, et ce bouleversement rythmique de la
mer est nécessaire à sa théorie du symbolisme du décor humain. Hélas! hélas!
pauvre raison humaine…».
Mais Mallarmé ne s’en inquiétait pas pour autant, «Alors (de l’Absolu) son esprit se formant par le hasard absolu de
ce fait) il dit à tout ce vacarme :
certainement il y a là un acte - c’est mon devoir de le proclamer : cette folie
existe». Bientôt, la critique
commença à s’opposer à certaines de ses œuvres, en particulier son poème
musical. L’après-midi d’un faune, après
que le Théâtre-Français le refusa en 1865 : «L’injure faite à Mallarmé […]
lui donne peut-être la tentation de s’en remettre à d’autres que ses
compatriotes du soin de goûter ses vers; ou bien les trésors poétiques
étrangers lui semblent pouvoir apporter au lyrisme français de précieux
enrichissements. Peut-être trouve-t-il à ces étranges artistes de Londres de la
fin du XIXe siècle, venus après George Eliot, et aux préraphaélites, un charme
irrésistible. Le voici, pour quelque temps, en étroite liaison avec les
écrivains anglais. Il expédie régulièrement à l’Athenæum ses courtes et claires notes et donne à O’
Shaughnessy des nouvelles de ses livres et des éditeurs lambins : “le Faune
dont l’après-midi menace d’aboutir en la nuit éternelle; et Vathek plus oublié par l’imprimeur que le rituel
ancien d’une momie”…».
Il faudra attendre la mise en musique par Debussy pour que ce poème trouve
finalement son publique.
 L’influence du symbolisme français fraya son
chemin en Allemagne, avec le poète Stefan George (1868-1933) dont nous avons
déjà parlé. Avant qu’il ne devienne le chantre du nationalisme dans son pays, «lorsqu’il était jeune, il se promena pas mal
à l’étranger, à Paris où il fréquenta les poètes symbolistes, et à Londres où
il fut en contact avec les préraphaélites. Ces deux mouvements restèrent les
influences principales d’une vie entièrement consacrée à la poésie. De retour
en Allemagne, il rassembla autour de lui une école dont l’esthétique nouvelle
voulait ressusciter les modèles de la beauté pure en art et en poésie, à
l’encontre du réalisme populaire, et du dominant et fruste réalisme représenté
par exemple par Gerhardt Hauptmann. George recherchait à la fois une perfection
classique, des effets musicaux et les images du symbolisme. […] En 1892, il fond le Blätter für die kunst dont la publication se poursuivit
L’influence du symbolisme français fraya son
chemin en Allemagne, avec le poète Stefan George (1868-1933) dont nous avons
déjà parlé. Avant qu’il ne devienne le chantre du nationalisme dans son pays, «lorsqu’il était jeune, il se promena pas mal
à l’étranger, à Paris où il fréquenta les poètes symbolistes, et à Londres où
il fut en contact avec les préraphaélites. Ces deux mouvements restèrent les
influences principales d’une vie entièrement consacrée à la poésie. De retour
en Allemagne, il rassembla autour de lui une école dont l’esthétique nouvelle
voulait ressusciter les modèles de la beauté pure en art et en poésie, à
l’encontre du réalisme populaire, et du dominant et fruste réalisme représenté
par exemple par Gerhardt Hauptmann. George recherchait à la fois une perfection
classique, des effets musicaux et les images du symbolisme. […] En 1892, il fond le Blätter für die kunst dont la publication se poursuivit
 jusqu’en 1919. Ce journal prêchait le culte de la beauté dans la vie comme dans
l’art, le goût de la perfection, et un humanisme qui tenait du mysticisme
religieux. Ce culte était ésotérique et n’eut qu’un petit nombre d’élus,
fortement réfractaires aux tendances populaires démocratiques. George se
considérait comme une sorte de prêtre et de prophète, ce qu’il était; après la
guerre 1914-1918, il affirmait qu’il avait trop souffert de la véritable
laideur, du matérialisme et de la brutalité de l’époque pour ne pas avoir prévu
la catastrophe».
En Belgique, c’est en Émile Verhaeren (1855-1916) qu’«il faut voir le poète qui a passé, sur le plan moral, du pour au contre
et dont la tâche, du jour où il repoussa la tentation de la neurasténie, fut de
s’apprivoiser peu à peu au milieu de ce monde moderne qu’il haïssait depuis
qu’il ne reconnaissait plus en lui l’œuvre de Dieu. Il y a peu d’exemples d’un
semblable essai de “transmutation des valeurs”, d’une volonté si peu déguisée
de faire jaillir la joie de la souffrance. Si Verhaeren se refuse désormais à
rejeter quoi que ce soit qui existe, c’est pour mieux s’avancer au delà et
embrasser “la vie ardente et contradictoire”. Mais ce qu’il importe de noter,
c’est que ce vaste mouvement d’extraversion correspond à l’évolution générale
des esprits, de l’époque symboliste à la guerre”. “Ce que tous subissent en
Verhaeren, disait, en 1904, M. Marius-Ary Leblond, c’est la passion.” Une
audience si large, en effet, tant d’échos éveillés de proche
jusqu’en 1919. Ce journal prêchait le culte de la beauté dans la vie comme dans
l’art, le goût de la perfection, et un humanisme qui tenait du mysticisme
religieux. Ce culte était ésotérique et n’eut qu’un petit nombre d’élus,
fortement réfractaires aux tendances populaires démocratiques. George se
considérait comme une sorte de prêtre et de prophète, ce qu’il était; après la
guerre 1914-1918, il affirmait qu’il avait trop souffert de la véritable
laideur, du matérialisme et de la brutalité de l’époque pour ne pas avoir prévu
la catastrophe».
En Belgique, c’est en Émile Verhaeren (1855-1916) qu’«il faut voir le poète qui a passé, sur le plan moral, du pour au contre
et dont la tâche, du jour où il repoussa la tentation de la neurasténie, fut de
s’apprivoiser peu à peu au milieu de ce monde moderne qu’il haïssait depuis
qu’il ne reconnaissait plus en lui l’œuvre de Dieu. Il y a peu d’exemples d’un
semblable essai de “transmutation des valeurs”, d’une volonté si peu déguisée
de faire jaillir la joie de la souffrance. Si Verhaeren se refuse désormais à
rejeter quoi que ce soit qui existe, c’est pour mieux s’avancer au delà et
embrasser “la vie ardente et contradictoire”. Mais ce qu’il importe de noter,
c’est que ce vaste mouvement d’extraversion correspond à l’évolution générale
des esprits, de l’époque symboliste à la guerre”. “Ce que tous subissent en
Verhaeren, disait, en 1904, M. Marius-Ary Leblond, c’est la passion.” Une
audience si large, en effet, tant d’échos éveillés de proche
 |
| Théo van Rysselberghe. Emile Verhaeren |
en proche, en
France et hors de France, par l’auteur des Forces tumultueuses et de la Multiple Splendeur, s’expliqueraient mal si l’on tenait compte
seulement des mérites esthétiques de son œuvre. La griserie orgueilleuse des
Européens du XXe siècle, à la veille de la catastrophe, la gloire de l’homme et
son pacte d’alliance avec la matière, voilà ce que proclamait par-dessus tout
Verhaeren».
Verhaeren dressa une auto-critique des plus pertinentes de la mouvance
symboliste : «Un recul formidable de
l’imagination moderne vers le passé, une enquête scientifique énorme et des
passions inédites vers un surnaturel vague et encore indéfini nous ont poussés
à incarner dans un symbolisme étrange qui traduit l’âme contemporaine comme le
symbolisme antique interprétait l’âme d’autrefois. Seulement nous n’y mettons
point notre foi et nos croyances, nous y mettons, au contraire, nos doutes, nos
affres, nos ennuis, nos vices, nos désespoirs et probablement nos agonies».
Lorsque son pays fut envahi par les troupes allemandes, en 1914, Verhaeren composa des poèmes pacifistes. Invité, le 27 novembre 1916, à donner une conférence à Rouen, il fut poussé par la foule nombreuse sur le quai de la gare et glissa sous les roues d'un train qui partait. Bref, les symbolistes retenaient essentiellement que l’aspect négatif du monde.
Sans doute qu’il y aurait beaucoup plus à
reprocher à la mouvance symboliste : son égoïsme, son élitisme, son parti pris
pour la rêverie qui l’a conduite vers la morosité, les cauchemars et la
dissonance entre la  pensée et l’imagination. «Dans ses études d’inspiration bergsonienne sur l’Attitude du
lyrisme contemporain, Tancrède de Visan
fut conduit à faire de la poésie une sorte de métaphysique irrégulière et à
définir le rôle essentiel de l’image, qui tend à symboliser de manière
concrète, à incarner, un “état d’âme” se développant dans la durée. Il ne faut
pas que le poète ait le dessein de décorer un voile linguistique qui le
séparerait de la réalité véritable qui réside en lui-même. Sa seule intention
légitime doit être de pénétrer jusqu’au cœur de cette réalité. S’il échoue
fatalement malgré ses efforts, si les images qui s’offrent à lui ne peuvent
être en définitive que des symboles - non pas l’être même, mais quelque chose
qui est cependant plus qu’un indice, qu’un signe, et auquel l’être participe -
il n’en doit pas moins se vouer à l’expression aussi directe que possible de
cet ineffable. L’esthétique symboliste, conclut T. de Visan, avec les
apparences du paradoxe, “est celle qui prétend se passer de symboles”; entendez
qu’elle répudie le symbole indirect, volontairement élaboré, pour inviter le
poète à s’approcher de la nature nue et à l’attirer dans le flux des images. Il
affirme que le langage concret du poème, en nous donnant le sentiment intense
du réel, nous apporte en définitive une connaissance de ce réel qui dépasse en
authenticité celle qui pourrait naître en nous de n’importe quel agencement de
concepts».
Il est vrai qu’en
pensée et l’imagination. «Dans ses études d’inspiration bergsonienne sur l’Attitude du
lyrisme contemporain, Tancrède de Visan
fut conduit à faire de la poésie une sorte de métaphysique irrégulière et à
définir le rôle essentiel de l’image, qui tend à symboliser de manière
concrète, à incarner, un “état d’âme” se développant dans la durée. Il ne faut
pas que le poète ait le dessein de décorer un voile linguistique qui le
séparerait de la réalité véritable qui réside en lui-même. Sa seule intention
légitime doit être de pénétrer jusqu’au cœur de cette réalité. S’il échoue
fatalement malgré ses efforts, si les images qui s’offrent à lui ne peuvent
être en définitive que des symboles - non pas l’être même, mais quelque chose
qui est cependant plus qu’un indice, qu’un signe, et auquel l’être participe -
il n’en doit pas moins se vouer à l’expression aussi directe que possible de
cet ineffable. L’esthétique symboliste, conclut T. de Visan, avec les
apparences du paradoxe, “est celle qui prétend se passer de symboles”; entendez
qu’elle répudie le symbole indirect, volontairement élaboré, pour inviter le
poète à s’approcher de la nature nue et à l’attirer dans le flux des images. Il
affirme que le langage concret du poème, en nous donnant le sentiment intense
du réel, nous apporte en définitive une connaissance de ce réel qui dépasse en
authenticité celle qui pourrait naître en nous de n’importe quel agencement de
concepts».
Il est vrai qu’en  cette époque qui se rapprochait de la Grande Guerre, «outre le néo-mallarmisme et le
néo-impressionnisme de la Phalange,
le goût se maintenait de la vie “maudite”, du non-conformisme moral et
intellectuel, du bizarre et de l’exceptionnel. On a pu rattacher à cette
tradition post-romantique et décadente la sensibilité de plus d’un poète
fantaisiste; or, c’est à l’aile avancée du “fantaisisme” que se placent les
trois hommes qui ont contribué plus que personne sans doute à donner à la
poésie des années de guerre et d’après-guerre son orientation : André Salmon, Max
Jacob, Guillaume Apollinaire»..Était-il
donc possible pour le symbolisme de s’écarter de cette veine pessimiste qui la
conduisait au décadentisme? Pour les principaux théoriciens, le décadentisme
trahissait l’esprit du symbolisme pour qui tout rêve n’est pas condamné à virer
au cauchemar. Moréas mettait déjà en garde, dès 1886, en soulignant combien la mouvance
était «ennemie de l’enseignement, de la
déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie
symboliste cherche : à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins, ne
serait pas son but à elle-même, mais qui tout en servant à exprimer l’Idée
demeurerait sujette. L’Idée à son tour ne doit pas se laisser voir priver des
somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel de
l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée en
soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains,
tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont là
des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques
avec des Idées primordiales…».
Il en alla tout autrement.
cette époque qui se rapprochait de la Grande Guerre, «outre le néo-mallarmisme et le
néo-impressionnisme de la Phalange,
le goût se maintenait de la vie “maudite”, du non-conformisme moral et
intellectuel, du bizarre et de l’exceptionnel. On a pu rattacher à cette
tradition post-romantique et décadente la sensibilité de plus d’un poète
fantaisiste; or, c’est à l’aile avancée du “fantaisisme” que se placent les
trois hommes qui ont contribué plus que personne sans doute à donner à la
poésie des années de guerre et d’après-guerre son orientation : André Salmon, Max
Jacob, Guillaume Apollinaire»..Était-il
donc possible pour le symbolisme de s’écarter de cette veine pessimiste qui la
conduisait au décadentisme? Pour les principaux théoriciens, le décadentisme
trahissait l’esprit du symbolisme pour qui tout rêve n’est pas condamné à virer
au cauchemar. Moréas mettait déjà en garde, dès 1886, en soulignant combien la mouvance
était «ennemie de l’enseignement, de la
déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie
symboliste cherche : à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins, ne
serait pas son but à elle-même, mais qui tout en servant à exprimer l’Idée
demeurerait sujette. L’Idée à son tour ne doit pas se laisser voir priver des
somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel de
l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée en
soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains,
tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont là
des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques
avec des Idées primordiales…».
Il en alla tout autrement.
La dernière phase de l’art symboliste se réalisa
davantage que dans la peinture dans les arts décoratifs. L’apparition du Modern Style au cours de la dernière
décennie du XIXe siècle résonnait comme en écho aux grands principes
idéologiques des premiers symbolistes. Si l’art symboliste avait une portée
révolutionnaire, ce n’était pas en en appelant à la révolte populaire, mais aux
réformes auxquelles l’art, par sa  puissance suggestive, pouvait
contribuer : «La grande voix qui
lancera pendant des années l’anathème contre les riches, va bientôt commencer à
se faire entendre : elle portera loin la renommée de John Ruskin (1819-1900),
le premier propagandiste de la Beauté qu’ait connu l’Angleterre. Non sans avoir
dénoncé au préalable ce qui la rend impossible, la misère. La pourriture des
slums de Londres, de Liverpool, de Manchester, de Birmingham, l’esclavage des
ouvriers de l’âge d’or du libéralisme, seront toujours présents aux yeux de
celui qui fut, non seulement un historien d’art et un esthète mais aussi un
réformateur social et un moment de la conscience de son époque: “Tant de tonnes
de minerai ont été fondues, tant de balles de coton changées en tissus, mais
combien de vigoureuses mains paralysées, combien de jeunes volontés atteintes,
combien d’enfants frappés dans leur croissance?” Dans une telle situation, pas
d’art possible».
Il fallait donc réformer la société industrielle et capitaliste non pas
seulement pour équilibrer les richesses, mais afin de sauver l’art lui-même.
C’est ainsi que «l’évangile ruskinien
prône la charité plutôt que la justice. Tout l’effort de ce “tory socialiste”
que fut Ruskin tendait en effet à essayer d’adapter les relations morales
unissant le squire à son groupe campagnard du temps de la “joyeuse Angleterre”,
aux foules urbaines. Dans cette perspective, les “capitaines d’industrie”
devaient être des suzerains accordant protection à leurs
puissance suggestive, pouvait
contribuer : «La grande voix qui
lancera pendant des années l’anathème contre les riches, va bientôt commencer à
se faire entendre : elle portera loin la renommée de John Ruskin (1819-1900),
le premier propagandiste de la Beauté qu’ait connu l’Angleterre. Non sans avoir
dénoncé au préalable ce qui la rend impossible, la misère. La pourriture des
slums de Londres, de Liverpool, de Manchester, de Birmingham, l’esclavage des
ouvriers de l’âge d’or du libéralisme, seront toujours présents aux yeux de
celui qui fut, non seulement un historien d’art et un esthète mais aussi un
réformateur social et un moment de la conscience de son époque: “Tant de tonnes
de minerai ont été fondues, tant de balles de coton changées en tissus, mais
combien de vigoureuses mains paralysées, combien de jeunes volontés atteintes,
combien d’enfants frappés dans leur croissance?” Dans une telle situation, pas
d’art possible».
Il fallait donc réformer la société industrielle et capitaliste non pas
seulement pour équilibrer les richesses, mais afin de sauver l’art lui-même.
C’est ainsi que «l’évangile ruskinien
prône la charité plutôt que la justice. Tout l’effort de ce “tory socialiste”
que fut Ruskin tendait en effet à essayer d’adapter les relations morales
unissant le squire à son groupe campagnard du temps de la “joyeuse Angleterre”,
aux foules urbaines. Dans cette perspective, les “capitaines d’industrie”
devaient être des suzerains accordant protection à leurs  ouvriers chargés de
jouer le rôle de vassaux fidèles».
Ce socialisme chrétien, qui idéalisait d’une façon fantaisites les liens féodaux, avait de quoi plaire aux capitaines d’industrie, mais il apparut très
vite insuffisant malgré l’amélioration des conditions des prolétaires anglais
dans le dernier tiers du XIXe siècle. William Morris (1834-1896) voulait que
cet art pénètre dans la quotidienneté. Ruskin pensait encore aux grands
édifices, aux usines, aux bureaux administratifs, il s’adressait donc
essentiellement aux architectes : «L’appel
lancé par Ruskin aux architectes pour qu’ils s’inspirent des leçons de la
Nature ne va être que trop entendu. […]
Faire passer la nature dans l’édifice? C’est le but que vont se proposer Horta
à Bruxelles, Guimard à Paris, Gaudi à Barcelone. Dans cette voie périlleuse,
n’y a-t-il pas danger de se perdre dans l’ornement? Certes oui et pour une
bonne raison: “La fonction de l’ornement est de nous rendre
ouvriers chargés de
jouer le rôle de vassaux fidèles».
Ce socialisme chrétien, qui idéalisait d’une façon fantaisites les liens féodaux, avait de quoi plaire aux capitaines d’industrie, mais il apparut très
vite insuffisant malgré l’amélioration des conditions des prolétaires anglais
dans le dernier tiers du XIXe siècle. William Morris (1834-1896) voulait que
cet art pénètre dans la quotidienneté. Ruskin pensait encore aux grands
édifices, aux usines, aux bureaux administratifs, il s’adressait donc
essentiellement aux architectes : «L’appel
lancé par Ruskin aux architectes pour qu’ils s’inspirent des leçons de la
Nature ne va être que trop entendu. […]
Faire passer la nature dans l’édifice? C’est le but que vont se proposer Horta
à Bruxelles, Guimard à Paris, Gaudi à Barcelone. Dans cette voie périlleuse,
n’y a-t-il pas danger de se perdre dans l’ornement? Certes oui et pour une
bonne raison: “La fonction de l’ornement est de nous rendre  heureux.” Ruskin
voulait que l’art soit générateur de joie et tous les hommes de l’Art Nouveau
lutteront aussi pour qu’il soit un art du bonheur».
Avec Morris, les thèmes symbolistes s’incarnèrent essentiellement dans l’art
décoratif, qui finit par s'émanciper pour devenir tout simplement
heureux.” Ruskin
voulait que l’art soit générateur de joie et tous les hommes de l’Art Nouveau
lutteront aussi pour qu’il soit un art du bonheur».
Avec Morris, les thèmes symbolistes s’incarnèrent essentiellement dans l’art
décoratif, qui finit par s'émanciper pour devenir tout simplement le style
Art déco avec l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925.
L’illustration, bien sûr, mais aussi les motifs de tapisseries, les
dessins sur verre (potiches, vases, vaisselles, poteries) qui répandront les
images végétales qui deviendront l’emblème du Modern Style : «L’adhésion
de Morris au socialisme date de 1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste
et en poète, d’abord soucieux de son œuvre. Il a cependant protesté contre les
massacres de populations chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur
des Irlandais affamés. Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier
parti socialiste organisé en Angleterre - est un pas décisif que les
Conservateurs ne pardonneront pas au tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans
la presse. Morris ne s’entendra d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de
parti: il fondera son propre mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera
les conférences pour prouver à ses auditeurs que l’organisation industrielle
qu’ils subissent est incompatible avec toute idée de bonheur et de beauté». C’est
ainsi que William Morris devint sans doute l’artiste symboliste le plus engagé
politiquement, même si son socialisme appartenait non pas à l’espèce des luttes
de classes mais plutôt à celle des accommodements.
Ce qui ne fait pas pour autant de Morris un être superficiel face
à la question sociale. Son socialisme était aussi sincère dans ses buts que celui
de ses adversaires : «Qui a été l’un
des premiers artistes “engagés”, sinon celui qui osait écrire : “Bien que j’aime
chèrement l’art, je l’apprécie surtout comme un indice du bonheur du peuple et
j’aimerais mieux qu’il disparût du monde que de voir la masse du peuple en  être
opprimé”. Ils ont été ses véritables successeurs, le Belge Van de Velde,
professeur à l’Université populaire de Bruxelles, le Français Gallé, membre de
la Ligue des Droits de l’Homme, les Sécessionnistes de Munich groupés autour de
Jugend, la revue de
“l’Anti-Allemagne”. “L’Art Social” sera l’une des composantes de l’Art Nouveau,
ce fait essentiel ne doit jamais être oublié. Pour W. Morris comme pour ses
continuateurs, le souci de la beauté du home fut la pièce maîtresse d’un art au service du peuple». Jusqu’à la fin de
sa vie, il maintint une pareille ardeur à promouvoir le nouveau style décoratif
inspiré des thèmes symbolistes avec la volonté que la condition humaine
s’améliore pour le bénéfice de tous. C’est encore suite à l’un de ces
affrontements rendus coutumiers qu’il fit une dernière intervention sur le
sujet : «La dernière prise de
position publique de Morris avait été une lettre envoyée au Daily Chronicle, le 9 novembre 1893, à propos d’un lock-out
minier. Il y renouvelait sa croyance en l’apparition d’un art qui serait
l’expression d’une société régénérée par le socialisme: “On verra bientôt,
écrivait Morris, naître cet art nouveau qui sera l’expression du plaisir de la
vie et sera fondé sur le bien-être du peuple. Le premier pas à faire vers la
renaissance de l’art doit être l’amélioration de la condition des ouvriers.
Leur existence doit être moins précaire et moins sujette aux privations, leurs
heures de travail doivent être moins nombreuses, leur condition assurée contre
tous les hasards du commerce par des lois. Mais encore une fois cette
amélioration ne pourra être réalisée que par les efforts des travailleurs
eux-mêmes. Par nous et non pour nous doit être leur devise”».
Morris mourut avec la satisfaction de constater que son appel avait été entendu
et que le Modern Style attirait des
artisans en art décoratif soucieux d’une large diffusion des motifs
symbolistes.
être
opprimé”. Ils ont été ses véritables successeurs, le Belge Van de Velde,
professeur à l’Université populaire de Bruxelles, le Français Gallé, membre de
la Ligue des Droits de l’Homme, les Sécessionnistes de Munich groupés autour de
Jugend, la revue de
“l’Anti-Allemagne”. “L’Art Social” sera l’une des composantes de l’Art Nouveau,
ce fait essentiel ne doit jamais être oublié. Pour W. Morris comme pour ses
continuateurs, le souci de la beauté du home fut la pièce maîtresse d’un art au service du peuple». Jusqu’à la fin de
sa vie, il maintint une pareille ardeur à promouvoir le nouveau style décoratif
inspiré des thèmes symbolistes avec la volonté que la condition humaine
s’améliore pour le bénéfice de tous. C’est encore suite à l’un de ces
affrontements rendus coutumiers qu’il fit une dernière intervention sur le
sujet : «La dernière prise de
position publique de Morris avait été une lettre envoyée au Daily Chronicle, le 9 novembre 1893, à propos d’un lock-out
minier. Il y renouvelait sa croyance en l’apparition d’un art qui serait
l’expression d’une société régénérée par le socialisme: “On verra bientôt,
écrivait Morris, naître cet art nouveau qui sera l’expression du plaisir de la
vie et sera fondé sur le bien-être du peuple. Le premier pas à faire vers la
renaissance de l’art doit être l’amélioration de la condition des ouvriers.
Leur existence doit être moins précaire et moins sujette aux privations, leurs
heures de travail doivent être moins nombreuses, leur condition assurée contre
tous les hasards du commerce par des lois. Mais encore une fois cette
amélioration ne pourra être réalisée que par les efforts des travailleurs
eux-mêmes. Par nous et non pour nous doit être leur devise”».
Morris mourut avec la satisfaction de constater que son appel avait été entendu
et que le Modern Style attirait des
artisans en art décoratif soucieux d’une large diffusion des motifs
symbolistes.
 |
| William Morris. Tapisserie. |
Le Modern
Style est apparu au moment où l’art symboliste se mourrait. Il lui assura
une longévité prolongée jusqu’à la veille de la Grande Guerre. Jamais il ne
dérogea à sa croisade contre le réalisme et le naturalisme : «Les idées symbolistes de la littérature se
reflètent dans les beaux-arts. Le but n’était plus de rendre une image fidèle
au motif. La peinture objective fait place à la peinture subjective; ce que
l’on recherche, c’est de rendre une image de la perception, une synthèse des
sensations. Sans doute Schopenhauer a-t-il aussi joué un certain rôle dans
cette conception de la nature. Le symboliste Émile Bernard portait toujours sur
lui un volume des œuvres du philosophe, pendant ses promenades en Bretagne, et
il était fiévreusement discuté à Pont-Aven, par le groupe rassemblé autour de
Gauguin. Justement cette réaction contre le naturalisme, et cette aspiration
consciente vers une synthèse, exprimée en peinture par une ligne de contour
ferme et enveloppante, furent d’une certaine importance pour l’Art Nouveau. Les
courants littéraires contribuent à expliquer le goût du symbole dans le style
art nouveau. Aucun style ensuite n’a été aussi musical, et n’a eu une telle
foison de symboles dans sa forme ornementale».
Cette musicalité allait se retrouver dans les aménagements décoratifs du Modern Style. Déjà, «dans le pastel de Burne-Jones The Pelican, 1881, se trouvent plusieurs des
traits caractéristiques de l’école, par exemple une prédilection très marquée
pour un format haut et étroit, combiné avec un linéarisme vertical. En plus, il
fait usage de la ligne serpentine et ondulante. Nous retrouvons les mêmes
tendances chez Walter Crane, surtout dans ses cartons de 1886-1887 pour une
mosaïque».
Le disciple le plus important de Morris fut, en effet, Walter Crane
(1845-1915), qui devint l’un des animateurs principaux du mouvement artistique
des Arts & Crafts : «La réputation européenne de Walter Crane
fut, en son temps, au moins aussi étendue que celle de son maître. Elle tint à
ses ouvrages pour enfants, unanimement appréciés et imités, et surtout à ses
papiers peints. Toutes les revues d’art de la fin du XIXe siècle leur ont
consacré des articles enthousiastes. L’un des plus significatifs, par son
écriture artiste, est celui qu’Henry Van de Velde publia dans L’Art Moderne de Bruxelles en juin 1893 : “Ce fut
l’émigration spontanée vers les murs de tout son peuple de filles-fleurs et
d’êtres sylvains et tous les animaux partis également des albums légendaires se
mirent à les suivre à travers de très rythmiques végétations. Car c’est sur une
architecture d’assez identiques volutes que se déroulent la plupart de ces
épisodes; les lignes de très spéciale souplesse partent en fusées
tirebouchonnantes et se résument en les frises que la tradition anglaise veut
larges excessivement; là, sans heurt trop évident dévie le motif dans le sens
horizontal de la cimaise qu’il se met à longer”. L’art de Walter Crane est un
mélange d’inspirations diverses propre à la période dans laquelle il s’est
épanoui. Un critique belge l’avait bien vu dès 1891 lorsqu’il écrivait : “Aux
influences préraphaélites, à des souvenirs de graveurs allemands et de la
première renaissance italienne, les influences combinées de l’art grec et de
l’art japonais s’ajoutèrent, déterminant une des plus incontestables
personnalités contemporaines”».
Mais Crane n’était pas seul à poursuivre l’évangile de Ruskin et de Morris; «d’une plus vaste envergure fut Arthur H.
Mackmurdo (1851-1942), en qui certains voudraient voir le véritable inventeur
des ornements de flamme qui allaient embraser l’Europe».
 |
| Walter Crane. Beauty and the Beast. |
En France également l’art décoratif suivit la
vague venue des îles britanniques. Eugène Grasset (1845-1917) reprenait le
vieux thème, souvent abandonné, du retour à la décoration médiévale. «Au cours de la visite que lui fait Henry
Nocq, en 1896, pour les besoins de sa fameuse enquête sur l’évolution des
industries d’art, Grasset - qui n’en est pas, comme tous ses pareils, à une
contradiction près - condamne formellement le mal suprême, l’archéologie. Il
faut revenir au Moyen Âge, non pour le copier, mais pour reprendre le mouvement
là où la Renaissance l’a interrompu. Comme les imagiers de l’époque médiévale,
on doit trouver dans la nature tous les éléments de décoration désirables. La
nature, voilà le grand livre d’art ornemental à consulter sans cesse».
Évidemment, comme les restaurations de Viollet-le-Duc, le Moyen Âge de Grousset
avait, lui aussi, sa part de fantaisies proprement de son  époque. Un autre
artisan symboliste, de Nancy, Émile Gallé (1846-1904) fut connu pour ses vases
dessinés aux motifs floraux ou aquatiques : «Gallé mérite d’être classé parmi les Symbolistes. Il avait d’ailleurs une remarquable connaissance, non seulement de Hugo et de Baudelaire, mais
aussi de tous les poètes de son temps qu’il cite sans cesse. Quelquefois,
également, il fait penser à un Des Esseintes envoûté par la nature : “L’artiste
du décor a des missions à remplir, plus hautes peut-être que semer de la joie.
Il tient dans ses mains l’illusion, mais aussi des réalités, les promesses et
la consolation, le mirage et le baume. Je veux que le peintre des murailles qui
m’enserrent soit poète, qu’il soit magicien, qu’il fasse de ces boiseries des
bosquets lointains, de ces tapis des prairies, de ces tentures l’éther où,
captif, j’aspire”».
C’est ici que se confirme combien le Zeitgeist
propre au symbolisme caractérisa l’ensemble des œuvres aussi bien
littéraires qu’artistiques dans l’ensemble de l’Occident. Plus que Morris
encore, Gallé pensait aux décorations d’intérieur des foyers populaires :
«Ce rôle magnifique de décorateur, Gallé,
prêtre de l’art social, ne le pensait pas réservé au service d’une élite. Son
généreux idéalisme a marqué d’un accent particulier l’art nouveau nancéien,
l’art de la fleur dans tout et pour tous : “Certes, écrivait Gallé, je déteste
les idiotes batailles de fleurs; j’hésite même à sacrifier la fleur à
l’agrément, à l’étude. Aujourd’hui, il faut les jeter sous les pieds des
barbares et des païens! Il faut répandre la grâce touchante de leur mort sur
les objets les plus modestes. Qu’importe si des centaines de jolis brins de vie
agonisent dans la poussière sous les bêtes et les fauves pourvu qu’un unique
passant, dans ces foules déshéritées des sentiers fleuris, rapporte
époque. Un autre
artisan symboliste, de Nancy, Émile Gallé (1846-1904) fut connu pour ses vases
dessinés aux motifs floraux ou aquatiques : «Gallé mérite d’être classé parmi les Symbolistes. Il avait d’ailleurs une remarquable connaissance, non seulement de Hugo et de Baudelaire, mais
aussi de tous les poètes de son temps qu’il cite sans cesse. Quelquefois,
également, il fait penser à un Des Esseintes envoûté par la nature : “L’artiste
du décor a des missions à remplir, plus hautes peut-être que semer de la joie.
Il tient dans ses mains l’illusion, mais aussi des réalités, les promesses et
la consolation, le mirage et le baume. Je veux que le peintre des murailles qui
m’enserrent soit poète, qu’il soit magicien, qu’il fasse de ces boiseries des
bosquets lointains, de ces tapis des prairies, de ces tentures l’éther où,
captif, j’aspire”».
C’est ici que se confirme combien le Zeitgeist
propre au symbolisme caractérisa l’ensemble des œuvres aussi bien
littéraires qu’artistiques dans l’ensemble de l’Occident. Plus que Morris
encore, Gallé pensait aux décorations d’intérieur des foyers populaires :
«Ce rôle magnifique de décorateur, Gallé,
prêtre de l’art social, ne le pensait pas réservé au service d’une élite. Son
généreux idéalisme a marqué d’un accent particulier l’art nouveau nancéien,
l’art de la fleur dans tout et pour tous : “Certes, écrivait Gallé, je déteste
les idiotes batailles de fleurs; j’hésite même à sacrifier la fleur à
l’agrément, à l’étude. Aujourd’hui, il faut les jeter sous les pieds des
barbares et des païens! Il faut répandre la grâce touchante de leur mort sur
les objets les plus modestes. Qu’importe si des centaines de jolis brins de vie
agonisent dans la poussière sous les bêtes et les fauves pourvu qu’un unique
passant, dans ces foules déshéritées des sentiers fleuris, rapporte  une fleur à
la maison!”».
Jusqu’à la fin, le Modern Style restera
imbu du socialisme utopique de ses origines. Le docteur Henry Cazalis
(1840-1909), alias Jean Lahor, renouvellera la profession de foi en une amélioration du sort de l’humanité par les arts : «Étudiant en 1901, l’Art Nouveau au point de vue social, Jean Lahor
réclamera, lui aussi, “l’art dans tout” : “Car nous voulons, écrit-il, et c’est
vraiment l’une des tendances encore de l’Art Nouveau, nous voulons donc que
l’art soit distribué à tous, comme l’air et la lumière, et nous voulons qu’il
soit partout, dans la maison de l’artisan comme en la nôtre, et à l’école comme
au collège,
une fleur à
la maison!”».
Jusqu’à la fin, le Modern Style restera
imbu du socialisme utopique de ses origines. Le docteur Henry Cazalis
(1840-1909), alias Jean Lahor, renouvellera la profession de foi en une amélioration du sort de l’humanité par les arts : «Étudiant en 1901, l’Art Nouveau au point de vue social, Jean Lahor
réclamera, lui aussi, “l’art dans tout” : “Car nous voulons, écrit-il, et c’est
vraiment l’une des tendances encore de l’Art Nouveau, nous voulons donc que
l’art soit distribué à tous, comme l’air et la lumière, et nous voulons qu’il
soit partout, dans la maison de l’artisan comme en la nôtre, et à l’école comme
au collège,  comme en toutes ces casernes universitaires, généralement si laides
et lugubres toujours, comme à l’hôpital même, et dans nos gares, partout enfin
où s’assemble une foule humaine, et surtout peut-être une foule populaire”».
À l’ère généralisée du grand
renfermement, les socialistes symbolistes ne voulaient pas que l’humanité
oublie le souffle de la nature, la beauté des astres, la vitalité des oiseaux,
des bêtes et des poissons. Il fallait permettre à la nature, et surtout aux
mystères qu’elle renferme, de pénétrer à nouveau, ne serait-ce que sous la
forme artistique (même mensongère selon Wilde), dans les demeures : peinte
sur les vases, fabriquée dans de la porcelaine, illustrée sur les vitraux
d’abat-jour, gravée en relief sur les tapisseries murale et les tapis de
plancher, tissée dans les rideaux et les tentures. L’ornementation pour ne pas
perdre son humanité, comme un rappel d’un monde ancien, ce que le titre du beau
livre de Peter Laslett rappelait : ce
monde que nous avons perdu.
comme en toutes ces casernes universitaires, généralement si laides
et lugubres toujours, comme à l’hôpital même, et dans nos gares, partout enfin
où s’assemble une foule humaine, et surtout peut-être une foule populaire”».
À l’ère généralisée du grand
renfermement, les socialistes symbolistes ne voulaient pas que l’humanité
oublie le souffle de la nature, la beauté des astres, la vitalité des oiseaux,
des bêtes et des poissons. Il fallait permettre à la nature, et surtout aux
mystères qu’elle renferme, de pénétrer à nouveau, ne serait-ce que sous la
forme artistique (même mensongère selon Wilde), dans les demeures : peinte
sur les vases, fabriquée dans de la porcelaine, illustrée sur les vitraux
d’abat-jour, gravée en relief sur les tapisseries murale et les tapis de
plancher, tissée dans les rideaux et les tentures. L’ornementation pour ne pas
perdre son humanité, comme un rappel d’un monde ancien, ce que le titre du beau
livre de Peter Laslett rappelait : ce
monde que nous avons perdu.
Comme nous l’avons vu, il ne s’agissait pas
seulement d’un socialisme au service du bien-être des plus pauvres, mais aussi
un socialisme à la défense du principe même de l’art pour l’art. En faisant
passer le  symbolisme des œuvres d’élite à la production d’objets décoratifs de
masse, le symbolisme subissait une modification profonde dans la façon
d’aborder ses principes. «On ne peut
s’empêcher de penser aux paroles du Nabi hollandais Jan Verkade : “Il n’existe
pas de tableaux, seulement un décor”».
C’est en ce sens que le Modern Style contribua,
à sa façon, à la dissolution du symbolisme au tournant du XXe siècle. Ainsi, «au moment où le symbolisme se meurt,
l’aspect symbolique de l’Art Nouveau perd également son sens. Il est vrai aussi
que dans la mesure où l’Art Nouveau représente un contre-mouvement, une
réaction contre le passé, il perd sa signification quand on s’est débarrassé du
chaos stylistique du XIXe siècle. Il a montré assez d’énergie pour couper les
ponts avec le passé, mais pas assez cependant pour bâtir l’avenir. Il arrive
alors ce qui est arrivé maintes fois auparavant dans l’histoire du style en
Europe, on se retourne vers les normes bien connues et sans surprises du
classicisme».
Cette époque trouva aussi la fin du symbolisme en littérature où les effets
commencèrent à tenir une place plus importante. On imagine mal la pataphysique
de Jarry sans les costumes de Père Ubu et de sa femme. Ce théâtre de
symbolisme des œuvres d’élite à la production d’objets décoratifs de
masse, le symbolisme subissait une modification profonde dans la façon
d’aborder ses principes. «On ne peut
s’empêcher de penser aux paroles du Nabi hollandais Jan Verkade : “Il n’existe
pas de tableaux, seulement un décor”».
C’est en ce sens que le Modern Style contribua,
à sa façon, à la dissolution du symbolisme au tournant du XXe siècle. Ainsi, «au moment où le symbolisme se meurt,
l’aspect symbolique de l’Art Nouveau perd également son sens. Il est vrai aussi
que dans la mesure où l’Art Nouveau représente un contre-mouvement, une
réaction contre le passé, il perd sa signification quand on s’est débarrassé du
chaos stylistique du XIXe siècle. Il a montré assez d’énergie pour couper les
ponts avec le passé, mais pas assez cependant pour bâtir l’avenir. Il arrive
alors ce qui est arrivé maintes fois auparavant dans l’histoire du style en
Europe, on se retourne vers les normes bien connues et sans surprises du
classicisme».
Cette époque trouva aussi la fin du symbolisme en littérature où les effets
commencèrent à tenir une place plus importante. On imagine mal la pataphysique
de Jarry sans les costumes de Père Ubu et de sa femme. Ce théâtre de  marionnettes
hissé à hauteur d’hommes émanait tout droit de l’esprit symboliste et même
mallarméen : «La “tête de cheval en
carton qu’il se pendrait au cou” pouvait rappeler que la vision du spectateur
se contenterait sans peine d’un détail qui éveille l’attention pour la fixer,
ainsi évoquée, sur une réalité plus ample. Un vrai cheval sur la scène aurait
brisé au contraire cette attention
exigée du public : un réalisme propre aux pièces du théâtre du Boulevard aurait
apporté une possibilité de succès dû à des raisons différentes de celles
désirées par Jarry et que celui-ci ne voulait devoir qu’à une certaine
conception personnelle de l’Art. Par cette “tête de cheval en carton qu’il se
pendrait au cou” Jarry affirmait les principes de recherche de l’absolu qui,
après Mallarmé et Laforgue, menaient les poètes symbolistes à échapper au
mécanisme des routines verbales et visuelles : il fallait saisir la signification à son point d’existence le plus réduit et,
donc, abandonner les accessoires qui flattent la vue mais égarent la vision».
Alfred Jarry (1873-1907), fondateur de la Pataphysique dont il reconnaissait en
Lautréamont un précurseur, était définie par l’un de ses personnages, le
docteur Faustroll, comme étant une
science des solutions
marionnettes
hissé à hauteur d’hommes émanait tout droit de l’esprit symboliste et même
mallarméen : «La “tête de cheval en
carton qu’il se pendrait au cou” pouvait rappeler que la vision du spectateur
se contenterait sans peine d’un détail qui éveille l’attention pour la fixer,
ainsi évoquée, sur une réalité plus ample. Un vrai cheval sur la scène aurait
brisé au contraire cette attention
exigée du public : un réalisme propre aux pièces du théâtre du Boulevard aurait
apporté une possibilité de succès dû à des raisons différentes de celles
désirées par Jarry et que celui-ci ne voulait devoir qu’à une certaine
conception personnelle de l’Art. Par cette “tête de cheval en carton qu’il se
pendrait au cou” Jarry affirmait les principes de recherche de l’absolu qui,
après Mallarmé et Laforgue, menaient les poètes symbolistes à échapper au
mécanisme des routines verbales et visuelles : il fallait saisir la signification à son point d’existence le plus réduit et,
donc, abandonner les accessoires qui flattent la vue mais égarent la vision».
Alfred Jarry (1873-1907), fondateur de la Pataphysique dont il reconnaissait en
Lautréamont un précurseur, était définie par l’un de ses personnages, le
docteur Faustroll, comme étant une
science des solutions
 |
| Alfred Jarry peint par Eduard Vacek |
imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les
propriétés des objets décrits par leur virtualité». L’œuvre théâtral,
poétique et philosophique de Jarry appartient tout autant que le Modern Style aux dernières lueurs du
symbolisme : «“Parmi la foule qui se
pressait comme à un rendez-vous de foire au théâtre de l’Œuvre, se trouvaient
deux poètes anglais, Arthur Symons et W. B. Yeats. Le premier s’est souvenu
avec émotion des “personnages bruyants et sanguinaires” de la pièce. Le second,
prenant le parti d’un art dans lequel il voyait d’abord un refus des
conventions, nous a laissé le témoignage de son approbation et aussi de son
inquiétude: “Nous sentant tenus à soutenir le groupe le plus animé, nous avons
crié en faveur de la pièce, mais cette nuit, à l’Hôtel Corneille, je suis très
triste… Je dis… après Stéphane Mallarmé, après Paul Verlaine, après Gustave
Moreau, après Puvis de Chavannes, après notre poésie, après toute notre
subtilité de couleur, notre sensibilité de rythme, après la douceur des
tonalités de Condor, qu’y a-t-il encore de possible? Après nous le dieu
sauvage”. Il y avait aussi un spectateur qui devait ensuite approuver Jarry :
“Vous avez mis debout, avec une glaise rare et durable au doigt, un personnage
prodigieux et les siens, cela, en sobre et sûr sculpteur dramatique. Il entre
dans le répertoire de haut goût et me hante.” Ce spectateur-là, c’était
Mallarmé».
C’était ainsi que l’œuvre de Jarry leur apparaissait comme le requiem de la
tendance symboliste.
Il ne serait pas faux de dire que le
décadentisme, tout en attirant le regard sur le mouvement symboliste, fut en
même temps et par là-même, son fossoyeur. Autant le naturalisme s’abîmait dans
la contemplation de la dégénérescence héréditaire, autant le symbolisme se vautrait
dans les considérations sordides d’artistes névropathes. Le germe qui devait
conduire le symbolisme au décadentisme était contenu dans sa thèse de l’art
pour l’art. L’esthétisme, comme comportement approprié aux dandies, était repris par les principaux représentants de la
mouvance, à commencer par Oscar Wilde (1854-1900) : «C’est à Oxford…, que l’esthétisme lui fut révélé. L’esthétisme n’était
pas une théorie, et encore moins une doctrine. C’était  une attitude envers la
vie, et qui comportait bien des nuances. Historiquement, elle correspondait au
désir de tailler une place à la beauté dans le dur et matérialiste univers des
Victoriens. Chez les Préraphaélites et chez Ruskin, ce désir s’accompagnait de
justifications morales et religieuses. Chez Walter Pater, dont Wilde, dès
Oxford, se proclama le disciple, ces justifications apparaissaient beaucoup
moins, et le culte de la beauté trouvait davantage en lui-même sa fin, Wilde
devait aller plus loin. Sa religion du beau devint, à la longue, si fanatique qu’elle
se refusait à reconnaître, ou même à prendre au sérieux, d’autres valeurs.
Wilde fut l’esthète pur, intransigeant. Et son esthétisme se nuança presque dès
le début d’immoralisme et de tendances antisociales».
Wilde cultiva très jeune cet esthétisme de lui-même, par son habillement
excentrique, ses réparties flamboyantes et ce qui allait devenir son vice qui ne l’empêcha pas de contracter
mariage et de se montrer bon père de famille. Appartenir aux uraniens, porter l’œillet vert, symbole
de reconnaissance entre homosexuels à une époque où le code criminel pouvait
s’appliquer en toute rigueur à leur pratique, semblait devenir une attitude
proprement préraphaélique. Mais Wilde n’avait pas été le seul à passer par
Oxford et adopter la marginalité sexuelle.
une attitude envers la
vie, et qui comportait bien des nuances. Historiquement, elle correspondait au
désir de tailler une place à la beauté dans le dur et matérialiste univers des
Victoriens. Chez les Préraphaélites et chez Ruskin, ce désir s’accompagnait de
justifications morales et religieuses. Chez Walter Pater, dont Wilde, dès
Oxford, se proclama le disciple, ces justifications apparaissaient beaucoup
moins, et le culte de la beauté trouvait davantage en lui-même sa fin, Wilde
devait aller plus loin. Sa religion du beau devint, à la longue, si fanatique qu’elle
se refusait à reconnaître, ou même à prendre au sérieux, d’autres valeurs.
Wilde fut l’esthète pur, intransigeant. Et son esthétisme se nuança presque dès
le début d’immoralisme et de tendances antisociales».
Wilde cultiva très jeune cet esthétisme de lui-même, par son habillement
excentrique, ses réparties flamboyantes et ce qui allait devenir son vice qui ne l’empêcha pas de contracter
mariage et de se montrer bon père de famille. Appartenir aux uraniens, porter l’œillet vert, symbole
de reconnaissance entre homosexuels à une époque où le code criminel pouvait
s’appliquer en toute rigueur à leur pratique, semblait devenir une attitude
proprement préraphaélique. Mais Wilde n’avait pas été le seul à passer par
Oxford et adopter la marginalité sexuelle.
 |
| Ben Barnes dans le rôle de Dorian Gray, de Oliver Parker, 2009. |
Un autre cas célèbre concerne le poète Charles Algernon Swinburne (1837-1909) dont la poésie était truffée de références au
sado-masochisme, au lesbianisme et au suicide. Lui aussi élève de Rossetti,
Morris et Burne-Jones qui en traça le portrait, il épousait les éléments
essentiels de l’art symboliste. Swinburne étalait - et sans doute se vantait-il
plus que tout autre chose -, son homosexualité et son goût pour la
flagellation. Épileptique, alcoolique, son tempérament était hautement
excitable, et lorsqu’on sait la part que la sensibilité tenait dans
l’Imaginaire symboliste, on devine tout de suite la nature de sa poésie, entre
autres ses Ballade de vie et ballade de
mort, car «pour ce qui est du
sadomasochisme, aucun poète britannique n’égale Charles Algernon Swinburne,
dont la poésie à la fois belle, forte, hardie, peu conventionnelle, et même
provocatrice dans une nation puritaine et - qui plus est - à l’ère victorienne,
a en même temps la candeur vigoureuse et torturée du vécu, “Nous notons, écrit
à son sujet Georges Lafourcade, non sans une certaine surprise, ce désir de
servir et d’obéir, ce besoin de s’humilier vis-à-vis de ceux qu’on aime, doublé
d’une tendance tout aussi forte à se dresser contre une autorité quelconque
avec une violence et une combativité incroyables… ce qui l’attire, c’est la
sensualité profonde des tableaux et des légendes préraphaélites, avec cet
élément de mystère et de suggestion symbolique qui empêche cette sensualité
d’être franche et joyeuse, qui la rend au contraire douloureuse et cruelle;
c’est cette alliance subtile de la douleur et du plaisir qu’il saisit avec
promptitude et réalise aussitôt pour son propre compte…” “Impuissant à réagir
aux stimulants ordinaires de l’instinct, Swinburne sent au contraire s’éveiller
sa sensibilité sexuelle à certains spectacles ou représentations sadiques d’un
ordre tout particulier. D’après les lois de la nature, le développement de
l’instinct ne pouvait être, chez lui, normal.” Ainsi, “l’homme, dans l’œuvre du
poète, aspire à être ‘the powerless victim of the furious rage of a
beautiful woman’ : l’impuissante victime
de la rage furieuse d’une femme très belle : son attitude est passive, son
amour est martyre, son plaisir est douleur. Quant à la femme, qu’elle soit
Frédégonde, ou Lucrèce Borgia, Rosamond ou Marie Stuart, c’est toujours le même
genre de beauté licencieuse, impérieuse et cruelle… En outre, étant donné
l’expérience très limitée que Swinburne eut de l’autre sexe, il est naturel que
les femmes qu’il décrit doivent être toutes conformes à un type, qui est une
simple projection de la trouble sensualité du poète : elles tiennent beaucoup
de l’idole qui est justement , fantôme, plutôt que créature réelle”».
 Un autre esprit de la même famille fut
l’illustrateur et graveur Aubrey Beardsley (1872-1898), qui, comme Lautréamont
et Rimbaud, passa pour un génie précoce. Il est vrai que, comme le premier, son
décès prématuré jeta une ombre maudite sur son œuvre. Grand lecteur d’Edgar
Poe, dont il illustra les contes, Beardsley fut très tôt atteint de tuberculose
qui devait l’emporter à 26 ans. Sa carrière ne dura elle, que cinq années
(1893-97) et fit ses débuts en exécutant les cinq cents vignettes et
illustrations pour La Morte d’Arthur de
Sir Thomas Malory : «Aubrey
Beardsley était né à Brighton le 21 août 1872. Sa mère dessinait des
silhouettes dans le goût du XVIIIe siècle : l’artiste aura toujours un goût
très vif pour cette époque où il puisera de nombreux thèmes. Aubrey arrive à
Londres en 1888; il travaille d’abord dans une compagnie d’assurances tout en
dessinant et un libraire s’intéresse à lui. […] Les critiques avaient commencé à voir en ce garçon prodige le
successeur de W. Morris, mais ils pensent maintenant de plus en plus se trouver
en face du décadent type. Car Beardsley se crée
Un autre esprit de la même famille fut
l’illustrateur et graveur Aubrey Beardsley (1872-1898), qui, comme Lautréamont
et Rimbaud, passa pour un génie précoce. Il est vrai que, comme le premier, son
décès prématuré jeta une ombre maudite sur son œuvre. Grand lecteur d’Edgar
Poe, dont il illustra les contes, Beardsley fut très tôt atteint de tuberculose
qui devait l’emporter à 26 ans. Sa carrière ne dura elle, que cinq années
(1893-97) et fit ses débuts en exécutant les cinq cents vignettes et
illustrations pour La Morte d’Arthur de
Sir Thomas Malory : «Aubrey
Beardsley était né à Brighton le 21 août 1872. Sa mère dessinait des
silhouettes dans le goût du XVIIIe siècle : l’artiste aura toujours un goût
très vif pour cette époque où il puisera de nombreux thèmes. Aubrey arrive à
Londres en 1888; il travaille d’abord dans une compagnie d’assurances tout en
dessinant et un libraire s’intéresse à lui. […] Les critiques avaient commencé à voir en ce garçon prodige le
successeur de W. Morris, mais ils pensent maintenant de plus en plus se trouver
en face du décadent type. Car Beardsley se crée  systématiquement une réputation
de dépravé et de blasphémateur : il pose au cynique qui aime jouer du piano
avec un squelette installé à côté de lui. Beardsley participe au mouvement qui
transforme l’affiche anglaise à partir de 1894, quand une équipe de jeunes
artistes revient de Paris. On retient surtout celle, de petit format, qui a été
conçue pour les murs des stations du métro londonien, le “Tube”. Il s’agit
d’une affiche pour l’Avenue Theatre qui présente Une comédie de soupirs. Deux tons insolites, pourpre et vert. Une
femme aux sourcils épais et aux lèvres sensuelles attend, énigmatique, derrière
un rideau de gaze. C’est déjà la “Beardsley woman”, l’archétype de la
femme-goule, en loup et gants noirs, que l’artiste va bientôt multiplier avec
un goût pervers. Mêlées à des nudités androgynes, ces créatures infernales vont
épouvanter les imprudents lecteurs du Yellow Book. Il n’est pas possible de tolérer plus longtemps que les hommes
ressemblent à des
systématiquement une réputation
de dépravé et de blasphémateur : il pose au cynique qui aime jouer du piano
avec un squelette installé à côté de lui. Beardsley participe au mouvement qui
transforme l’affiche anglaise à partir de 1894, quand une équipe de jeunes
artistes revient de Paris. On retient surtout celle, de petit format, qui a été
conçue pour les murs des stations du métro londonien, le “Tube”. Il s’agit
d’une affiche pour l’Avenue Theatre qui présente Une comédie de soupirs. Deux tons insolites, pourpre et vert. Une
femme aux sourcils épais et aux lèvres sensuelles attend, énigmatique, derrière
un rideau de gaze. C’est déjà la “Beardsley woman”, l’archétype de la
femme-goule, en loup et gants noirs, que l’artiste va bientôt multiplier avec
un goût pervers. Mêlées à des nudités androgynes, ces créatures infernales vont
épouvanter les imprudents lecteurs du Yellow Book. Il n’est pas possible de tolérer plus longtemps que les hommes
ressemblent à des  femmes et que celles-ci affectent des allures viriles et
surtout une physionomie constamment équivoque».
L'univers de Beardsley, comme celui de Poe ou de Wilde, était hanté par les femmes corpulentes ou vénéneuses, les morts incertaines, l'angoisse de la castration (Salomé). Les allusions médiévales qu'il avait apprises à créer pour La Morte d'Arthur, l'accompagnèrent dans toutes ses compositions ultérieures. Comme dans sa personne, la mort faisait son œuvre. De plus, comme Wilde et Swinburne, Beardsley portait l’œillet vert, et comme l’on était
en plein scandale du procès Wilde, il décida d’aller soigner sa tuberculose en
France : «Pendant les mois qui
suivirent la condamnation de Wilde, les Décadents se turent. En janvier 1896,
un éditeur de livres érotiques, Léonard Smithers, lance un nouveau brulôt, The
Savoy : Beardley fait partie de l’équipe de rédaction. Mais, rongé par la
tuberculose, il est de plus en plus malade. Il se jette dans le catholicisme et
demande à un ami de détruire tous ses dessins obscènes avant de mourir à Menton
le 16 mars 1898. Il avait vingt-six ans».
Non seulement les œuvres de ces auteurs symbolistes encourageaient les
expériences corruptrices des mœurs et attisaient un certain
femmes et que celles-ci affectent des allures viriles et
surtout une physionomie constamment équivoque».
L'univers de Beardsley, comme celui de Poe ou de Wilde, était hanté par les femmes corpulentes ou vénéneuses, les morts incertaines, l'angoisse de la castration (Salomé). Les allusions médiévales qu'il avait apprises à créer pour La Morte d'Arthur, l'accompagnèrent dans toutes ses compositions ultérieures. Comme dans sa personne, la mort faisait son œuvre. De plus, comme Wilde et Swinburne, Beardsley portait l’œillet vert, et comme l’on était
en plein scandale du procès Wilde, il décida d’aller soigner sa tuberculose en
France : «Pendant les mois qui
suivirent la condamnation de Wilde, les Décadents se turent. En janvier 1896,
un éditeur de livres érotiques, Léonard Smithers, lance un nouveau brulôt, The
Savoy : Beardley fait partie de l’équipe de rédaction. Mais, rongé par la
tuberculose, il est de plus en plus malade. Il se jette dans le catholicisme et
demande à un ami de détruire tous ses dessins obscènes avant de mourir à Menton
le 16 mars 1898. Il avait vingt-six ans».
Non seulement les œuvres de ces auteurs symbolistes encourageaient les
expériences corruptrices des mœurs et attisaient un certain  goût pour les
perversions qui brûlaient de braise recouverte par la morale victorienne, mais
elles faisaient de ces goûts le nouveau vice
anglais au regard du continent, comme en témoigne ce qui se passa à Paris après
l’exposition de joaillerie au magasin S. Bing et que commenta Arsène Alexandre,
dans le Figaro du 28 décembre
1895 : «De prime abord, A. Alexandre
déclarait qu’il jugeait la tentative de Bing avec “une sympathie totalement
dépourvue de bienveillance” et manifestait une allergie totale aux pièces
modernes rassemblées par l’un des premiers introducteurs en France de l’art
japonais et chinois. Le critique était sorti du magasin “fatigué, malade,
exaspéré, avec les nerfs à vif et la tête pleine de cauchemars dansants”. Sa
conclusion reflétait la xénophobie et le racisme habituels des milieux de
droite: “Tout cela sent l’Anglais vicieux, la Juive morphinomane ou le Belge
roublards, ou une agréable salade de ces trois poisons”».
Il est vrai que le procès Wilde se déroulait à peu près au même moment où
éclata l’affaire Dreyfus. Le procès Wilde révélait au grand public, comme s’il semblait
l’ignorer, que ces choses dont
parlaient une certaine poésie s’accomplissait pour de vrai dans bien des
comportements. Le décadentisme, pour le reste de l’Europe, serait apparu comme ce
vice anglais si chaque nation n’avait
eu, et souvent en de hauts lieux de la société, ses propres scandales de
perversions sexuelles.
goût pour les
perversions qui brûlaient de braise recouverte par la morale victorienne, mais
elles faisaient de ces goûts le nouveau vice
anglais au regard du continent, comme en témoigne ce qui se passa à Paris après
l’exposition de joaillerie au magasin S. Bing et que commenta Arsène Alexandre,
dans le Figaro du 28 décembre
1895 : «De prime abord, A. Alexandre
déclarait qu’il jugeait la tentative de Bing avec “une sympathie totalement
dépourvue de bienveillance” et manifestait une allergie totale aux pièces
modernes rassemblées par l’un des premiers introducteurs en France de l’art
japonais et chinois. Le critique était sorti du magasin “fatigué, malade,
exaspéré, avec les nerfs à vif et la tête pleine de cauchemars dansants”. Sa
conclusion reflétait la xénophobie et le racisme habituels des milieux de
droite: “Tout cela sent l’Anglais vicieux, la Juive morphinomane ou le Belge
roublards, ou une agréable salade de ces trois poisons”».
Il est vrai que le procès Wilde se déroulait à peu près au même moment où
éclata l’affaire Dreyfus. Le procès Wilde révélait au grand public, comme s’il semblait
l’ignorer, que ces choses dont
parlaient une certaine poésie s’accomplissait pour de vrai dans bien des
comportements. Le décadentisme, pour le reste de l’Europe, serait apparu comme ce
vice anglais si chaque nation n’avait
eu, et souvent en de hauts lieux de la société, ses propres scandales de
perversions sexuelles.

Voilà pourquoi la bourgeoisie conservatrice
française commença à se dégager du mouvement qui jusqu’alors prêchait le
socialisme chrétien qui satisfaisait sa politique sociale et surtout sa haine
de la République. La guerre franco-prussienne et la Commune de Paris marquèrent
une séparation qui n’eut pas son équivalent en Angleterre. Il semblerait même
que le jeune Rimbaud ait été fouiné dans le Paris occupé alors par les
communards et qu’après, il aurait été violé par les Versaillais. Ainsi, «le symbolisme et le “dérèglement” des sens
auquel avait appelé Rimbaud cultivaient la même veine. Aux yeux des ennemis du
régime, ces évolutions esthétiques étaient à l’origine d’une corruption
généralisée. La République  opportuniste était à la source de la pornographie,
de l’immoralisme, du galimatias et des barbouillages déments qui prétendaient
succéder à la noble tradition de l’art français. […] Plus grave, elle avait dévitalisé le corps social».
Si «le nationalisme bourgeois s’accorde
fort bien du cosmopolitisme des “citoyens sans patrie, traversant les
frontières et les cultures”: Mucha, Rops, Masek, Schwabe à Paris, Böcklin à
Florence, Burne-Jones à Rome, Linger et Toorop à Bruxelles, Von Marées à
Naples, Villiers de l’Isle-Adam à Lucerne…»,
la bourgeoisie française commença à éprouver des doutes lorsqu’en 1886, on vit
les symbolistes recevoir la dangereuse communarde revenue de son long exil de
la Nouvelle-Calédonie, Louise Michel : «…la “Vierge rouge”, la “Velléda de l’anarchie” que Baju appelle à la
tribune du Décadent, le 20 novembre
de cette même année, pour parler littérature devant Mallarmé, Moréas, Ghil, de
Gourmont, Morice, etc.: “Nos sens sont encore imparfaits, avance Louise Michel,
mais la pensée de l’homme pourra prendre tous les sons, toutes les harmonies,
toutes les formes… Les anarchistes, comme les décadents, veulent
l’anéantissement du vieux monde. Les décadents créent l’anarchie du style.”
Qu’une ligne de démarcation ne puisse être tracée entre décadent et
anarchistes, anarchistes et symbolistes, décadents et symbolistes est d’autant
plus évident que dans le milieu littéraire la confusion règne entre les uns et
les autres : une confusion qui ne passe pas nécessairement par le territoire de
la révolte politique, puisque aussi bien “l’âme bariolée tachetée d’anarchisme”
ne semble pouvoir recouvrir le symbolisme que dans la mesure où, par opposition
à toute tradition, celui-ci prône l’innovation radicale et la levée de tout
interdit : pour se révéler comme riposte à toutes les clôtures».
Se pouvait-il que le symbolisme portât en lui autant de menaces que le réalisme,
allant jusqu’à s’associer avec l’anarchisme comme le second s’associait avec le
marxisme?
opportuniste était à la source de la pornographie,
de l’immoralisme, du galimatias et des barbouillages déments qui prétendaient
succéder à la noble tradition de l’art français. […] Plus grave, elle avait dévitalisé le corps social».
Si «le nationalisme bourgeois s’accorde
fort bien du cosmopolitisme des “citoyens sans patrie, traversant les
frontières et les cultures”: Mucha, Rops, Masek, Schwabe à Paris, Böcklin à
Florence, Burne-Jones à Rome, Linger et Toorop à Bruxelles, Von Marées à
Naples, Villiers de l’Isle-Adam à Lucerne…»,
la bourgeoisie française commença à éprouver des doutes lorsqu’en 1886, on vit
les symbolistes recevoir la dangereuse communarde revenue de son long exil de
la Nouvelle-Calédonie, Louise Michel : «…la “Vierge rouge”, la “Velléda de l’anarchie” que Baju appelle à la
tribune du Décadent, le 20 novembre
de cette même année, pour parler littérature devant Mallarmé, Moréas, Ghil, de
Gourmont, Morice, etc.: “Nos sens sont encore imparfaits, avance Louise Michel,
mais la pensée de l’homme pourra prendre tous les sons, toutes les harmonies,
toutes les formes… Les anarchistes, comme les décadents, veulent
l’anéantissement du vieux monde. Les décadents créent l’anarchie du style.”
Qu’une ligne de démarcation ne puisse être tracée entre décadent et
anarchistes, anarchistes et symbolistes, décadents et symbolistes est d’autant
plus évident que dans le milieu littéraire la confusion règne entre les uns et
les autres : une confusion qui ne passe pas nécessairement par le territoire de
la révolte politique, puisque aussi bien “l’âme bariolée tachetée d’anarchisme”
ne semble pouvoir recouvrir le symbolisme que dans la mesure où, par opposition
à toute tradition, celui-ci prône l’innovation radicale et la levée de tout
interdit : pour se révéler comme riposte à toutes les clôtures».
Se pouvait-il que le symbolisme portât en lui autant de menaces que le réalisme,
allant jusqu’à s’associer avec l’anarchisme comme le second s’associait avec le
marxisme?
 |
| Félicien Rops. Satan répandant sa semence sur le monde,.1878 |
 Pourtant rien n’indique, comme on l’a dit, que
le symbolisme eût changé foncièrement la vision de son engagement social. Les
symbolistes restaient des isolés, des affranchis qui ne travaillaient que pour
le petit nombre. Ainsi Puvis de Chavannes – que ses élèves, dont plusieurs
parmi eux se retrouveront parmi les impressionnistes, appelaient Pubis de
Cheval -, «s’était, en 1869 déjà, donné à
cette “volupté aristocratique” qui consiste “à ne penser qu’au très petit
nombre”, à se tenir loin de la “foule versatile et indifférente” pour lui
opposer “l’amour-refuge du beau et du vrai”. Re-tranchement idéaliste.
Détachement apparent. Pour mieux faire de l’image le lieu où se rassemble
l’idéologie dominante».
Ce qui avait changé depuis ce temps, c’était l’ouverture même du symbolisme à
dialoguer avec toutes les formes d’art, y compris l’impressionnisme, rejeton
pourtant du réalisme honni. Madsen remarque ce «trait intéressant du symbolisme [qu']est le lien intime qui existe entre les
écrivains et les autres artistes. Valloton, Maillol, Bonnard, Denis et
Toulouse-Lautrec écrivaient dans les toutes nouvelles revues symbolistes comme La
Plume (1889), Le Mercure de France (1890), et La Revue Blanche (1891). Prouvé et Gallé, eux, travaillaient
en collaboration. Tous les artistes de ce milieu étaient liés les uns aux
autres, et imprégnés des mêmes idées. Nous retrouvons le même phénomène en
Angleterre où Algernon Swinburne, prince des poètes esthétiques, était
intimement lié aux préraphaélites. Il dédie son drame The Queen Mother au poète et peintre Rossetti, et Laus Veneris à Burne Jones, qui, en retour, donna le même titre à l’un de ses
tableaux».
La dernière décennie du siècle marqua pourtant la dernière poussée d’une flamme
mourante avec l’épuisement du roman gothique qui, de la fin du XVIIIe siècle,
en passant par le romantisme, puis le symbolisme, produisit ses dernières
œuvres mémorables. Comme le rappelle Leatherdale : «Les dernières années du XIXe siècle pourraient s’appeler l’été indien
du roman gothique. Docteur Jekyll et Mr Hyde, de R. L. Stevenson (1886), Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde (1891), représentent, avec Dracula, les exemples les plus percutants de cette
explosion inattendue d’énergie symbolique. Une fois de plus, le thème
vampirique se mit à bourgeonner dans des directions inattendues. L’étrange
orchidée, d’H. G. Wells présente des
plantes vampires; Le parasite, d’A.
Conan Doyle se ramène à des éponges psychiques; quant au Château des
Carpathes, de Jules Vernes, il met en
scène d’infâmes scientifiques qui se font passer pour vampires. Le Horla, de Guy de Maupassant, décrit avec brio une
attaque vampirique narrée selon la perspective angoissée de la victime qui
tient un journal intime».
C’était tout de même une belle brochette d’œuvres qui devaient inspirer tout le
siècle à venir, surtout lorsqu’elles se rencontrèrent sur les plateaux de
tournage de cinéma.
Pourtant rien n’indique, comme on l’a dit, que
le symbolisme eût changé foncièrement la vision de son engagement social. Les
symbolistes restaient des isolés, des affranchis qui ne travaillaient que pour
le petit nombre. Ainsi Puvis de Chavannes – que ses élèves, dont plusieurs
parmi eux se retrouveront parmi les impressionnistes, appelaient Pubis de
Cheval -, «s’était, en 1869 déjà, donné à
cette “volupté aristocratique” qui consiste “à ne penser qu’au très petit
nombre”, à se tenir loin de la “foule versatile et indifférente” pour lui
opposer “l’amour-refuge du beau et du vrai”. Re-tranchement idéaliste.
Détachement apparent. Pour mieux faire de l’image le lieu où se rassemble
l’idéologie dominante».
Ce qui avait changé depuis ce temps, c’était l’ouverture même du symbolisme à
dialoguer avec toutes les formes d’art, y compris l’impressionnisme, rejeton
pourtant du réalisme honni. Madsen remarque ce «trait intéressant du symbolisme [qu']est le lien intime qui existe entre les
écrivains et les autres artistes. Valloton, Maillol, Bonnard, Denis et
Toulouse-Lautrec écrivaient dans les toutes nouvelles revues symbolistes comme La
Plume (1889), Le Mercure de France (1890), et La Revue Blanche (1891). Prouvé et Gallé, eux, travaillaient
en collaboration. Tous les artistes de ce milieu étaient liés les uns aux
autres, et imprégnés des mêmes idées. Nous retrouvons le même phénomène en
Angleterre où Algernon Swinburne, prince des poètes esthétiques, était
intimement lié aux préraphaélites. Il dédie son drame The Queen Mother au poète et peintre Rossetti, et Laus Veneris à Burne Jones, qui, en retour, donna le même titre à l’un de ses
tableaux».
La dernière décennie du siècle marqua pourtant la dernière poussée d’une flamme
mourante avec l’épuisement du roman gothique qui, de la fin du XVIIIe siècle,
en passant par le romantisme, puis le symbolisme, produisit ses dernières
œuvres mémorables. Comme le rappelle Leatherdale : «Les dernières années du XIXe siècle pourraient s’appeler l’été indien
du roman gothique. Docteur Jekyll et Mr Hyde, de R. L. Stevenson (1886), Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde (1891), représentent, avec Dracula, les exemples les plus percutants de cette
explosion inattendue d’énergie symbolique. Une fois de plus, le thème
vampirique se mit à bourgeonner dans des directions inattendues. L’étrange
orchidée, d’H. G. Wells présente des
plantes vampires; Le parasite, d’A.
Conan Doyle se ramène à des éponges psychiques; quant au Château des
Carpathes, de Jules Vernes, il met en
scène d’infâmes scientifiques qui se font passer pour vampires. Le Horla, de Guy de Maupassant, décrit avec brio une
attaque vampirique narrée selon la perspective angoissée de la victime qui
tient un journal intime».
C’était tout de même une belle brochette d’œuvres qui devaient inspirer tout le
siècle à venir, surtout lorsqu’elles se rencontrèrent sur les plateaux de
tournage de cinéma.
 |
| Edward Burne-Jones. Laus Veneris, 1875. |
Le romancier qui fit faire le plus grand bond au
symbolisme vers un classicisme fut Joris-Karl Huysmans (1848-1907). À sa
manière, il mit fin au rayonnement du symbolisme en portant à l’excès son goût
pour le morbide, le satanisme et les perversions les plus obscènes pour finir
en se convertissant, destin inusité! au catholicisme. Huysmans était un
rebelle dans l’âme. Le romancier décadent commença sa carrière en rompant avec
le naturalisme putride de Zola :
«En 1884, Huysmans (né en 1848), publiant
À rebours, quitta soudainement
l’entourage de Zola. Le héros de son livre, le décadent des Esseintes, annonce
qu’une nouvelle poésie est en train de naître, quoique encore peu comprise, et
proclame son admiration pour Verlaine et Mallarmé. Il dit au sujet de ce
dernier : “Percevant les analogies les plus lointaines, il désignait souvent
d’un terme donnant à la fois, par un effet de similitude, la forme, le parfum,
la couleur, la qualité, l’éclat, l’objet ou l’être auquel il eût fallu accoler
de nombreuses et différentes épithètes pour en dégager toutes les faces, toutes
les nuances s’il avait été simplement indiqué par son nom technique”».
Ce roman philosophique présentait le stéréotype de l’esthète issu d’Oxford et
du symbolisme. Jean des Esseintes, maladif, excentrique, opiomane y passe en
revue ses goûts et ses dégoûts. Fidèle en cela au credo du mouvement, il cherche
la vérité par-delà la réalité
manifeste du monde. Sa vie est meublée par l’oisiveté, les études stériles, la
recherche de parfums raffinés à partir d’un jardin de fleurs vénéneuses. Cette
non-existence se déroule dans une atmosphère décorée des tableaux de Gustave
Moreau et des œuvres de Odilon Redon qui influencèrent l’esthétisme de
Huysmans : «Henri de Régnier affirma
plus tard qu’il était convaincu que les relations personnelles que Huysmans avait
eues avec Moreau et Redon avaient ranimé chez lui “une propension au rêve pur,
une tendance aux exils évasifs hors du présent”. Ainsi que Huysmans l’écrivait
lui-même : “Le tout est […] de savoir
s’abstraire suffisamment pour amener l’hallucination et pouvoir substituer le
rêve de la réalité à la réalité même.” Pour le héros de Huysmans, des
Esseintes, “l’artifice paraissait la marque distinctive du génie de l’homme.
Comme il le disait, la nature a fait son temps; elle a définitivement lassé,
par la dégoûtante uniformité de ces paysages et de ses ciels, l’attentive
patience des raffinés… À n’en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a
maintenant la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu
où il s’agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l’artifice”».
Des Esseintes apparaît comme le parfait représentant de cette forme de vie
prêchée par Puvis de Chavannes, une sorte de taedium vitæ centrée sur l’exploration de ses propres sensations.
Même si on n’y retrouve pas le masochisme de Swinburne, l’atmosphère baigne dans
l’odeur de varech : «Alors “sous le ciel
bas, dans l’air mou, les murs des maisons ont des sueurs noires et leurs
soupiraux fétident; la dégoûtation de l’existence s’accentue et le spleen
écrase; les semailles d’ordures que chacun a dans l’âme éclosent; des besoins
de sales ribotes agitent les gens austères et, dans le cerveau des gens
considérés, des désirs de forçats vont naître”. Chimie des sensations. Énergie
de la sensualité. Le naturalisme est mis en échec».
Ce qui place essentiellement Huysmans dans le cercle des symbolistes, c’est son
mépris des masses démocratiques, son goût pour l’élitisme et surtout la fuite
de la modernité telle que présentée par le réalisme et le naturalisme : «Pour changer d’air (“Je cherchais vaguement
à m’évader d’un cul-de-sac où je suffoquais”), il imagine alors un personnage
tout aussi dégoûté de la vie que ses précédentes marionnettes mais qui, par la
culture et la richesse mises au service d’une imagination exubérante, va, après
des tribulations communes, tenter de fuir toutes les platitudes de l’existence
en vivant la plus extravagante des aventures closes. C’est, en effet, en ne
bougeant pratiquement pas de la villa de banlieue où il a fait retraite que le
duc Jean des Esseintes pousse au paroxysme de l’artifice son goût démesuré du
rare, de l’étrange, du non-pareil en tout genre. Fuyant la vulgarité du siècle,
il fait de ses jours une rhapsodie de sensations exceptionnelles et de sa
maison un kaléidoscope de correspondances “baudelairiennes où les sons, les
couleurs, les parfums, les saveurs et les émotions se répondent dans une
luxueuse harmonie”».
Le second roman de Huysmans, Là-bas paru en 1891, passait de
l’esthétisme au satanisme. Durtal, doublure de Huysmans, médiocre écrivain, se
passionne pour Gilles de Rais, les messes noires, l’occultisme  et la magie.
Comme le premier roman, À rebours, Là-bas
est avant tout un roman philosophique sur la nature du Mal. Les
préoccupations métaphysiques de Huysmans y sont de plus en plus présentes, mais
il en est encore au merveilleux spirite, aux êtres femelles mi-humains,
mi-démons qui seraient à la source des érotismes pathologiques : «Pour qu’elles deviennent des individualités,
il leur faut s’objectiver. Et, pour cela, les humains leur sont nécessaires.
Ils le sont de deux manières bien différentes l’une de l’autre. La première est
caractérisée par une totale absence de volonté. L’esprit de l’homme, engourdi
et incapable de s’opposer aux vibrations de la vie cosmique, entre en quelque
sorte en communion avec la nature tout entière. “Tout s’anime, écrit
et la magie.
Comme le premier roman, À rebours, Là-bas
est avant tout un roman philosophique sur la nature du Mal. Les
préoccupations métaphysiques de Huysmans y sont de plus en plus présentes, mais
il en est encore au merveilleux spirite, aux êtres femelles mi-humains,
mi-démons qui seraient à la source des érotismes pathologiques : «Pour qu’elles deviennent des individualités,
il leur faut s’objectiver. Et, pour cela, les humains leur sont nécessaires.
Ils le sont de deux manières bien différentes l’une de l’autre. La première est
caractérisée par une totale absence de volonté. L’esprit de l’homme, engourdi
et incapable de s’opposer aux vibrations de la vie cosmique, entre en quelque
sorte en communion avec la nature tout entière. “Tout s’anime, écrit  notre
auteur, le minéral lui aussi, et une sympathie puissante semble entraîner les
règnes les uns vers les autres.” Cette
sympathie semble uniquement d’ordre érotique. Ce qui attire ainsi les incubes
et fait soupirer les humains, c’est l’instinct sexuel. L’auteur retrouve ainsi
cette image chère à une partie du XIXe siècle finissant, laquelle fait de
l’homme la victime d’une sexualité avilissante et dégradante. La dépendance
passe ici par l’intermonde et sa population de larves. Ceux que les incubes
atteignent ainsi, ce sont “les organismes maladifs, énervés par un célibat
prolongé ou par toute autre cause. Chez eux, la résistance morale est presque
nulle, la volonté atrophiée. Ils sont en quelque sorte
notre
auteur, le minéral lui aussi, et une sympathie puissante semble entraîner les
règnes les uns vers les autres.” Cette
sympathie semble uniquement d’ordre érotique. Ce qui attire ainsi les incubes
et fait soupirer les humains, c’est l’instinct sexuel. L’auteur retrouve ainsi
cette image chère à une partie du XIXe siècle finissant, laquelle fait de
l’homme la victime d’une sexualité avilissante et dégradante. La dépendance
passe ici par l’intermonde et sa population de larves. Ceux que les incubes
atteignent ainsi, ce sont “les organismes maladifs, énervés par un célibat
prolongé ou par toute autre cause. Chez eux, la résistance morale est presque
nulle, la volonté atrophiée. Ils sont en quelque sorte  le réceptacle de toutes
les impressions de l’extérieur. C’est pourquoi l’incubat s’observe surtout dans
les cloîtres. Ces phénomènes étant d’ordre astral, avec violente répercussion
sur le corps physique, avant d’agir sur les parties génitales, affectent
d’abord les organes qui sont le plus en rapport avec le corps astral, les
poumons et les viscères de la poitrine. Une angoisse immense étreint l’être qui
sent l’approche de l’incube ou du succube. La gorge se serre; un commencement
de suffocation se produit, en même temps toutes les muqueuses sont caressées
par des titillements voluptueux. Il semble qu’un amant extraordinairement
expert vous enveloppe, vous pénètre, se fond en vous. La jouissance est alors
insensée, la dépense nerveuse terrible. L’imagination s’exalte, la clairvoyance
somnambulique arrive. Vous voyez distinctement l’âme fantastique et glauque qui
vous travaille, qui vous fait grincer les dents dans les spasmes. Puis soudain,
il s’évanouit. Mais lorsqu’on a supporté une fois cette accointance, l’esprit
reste fortement affecté”».
Il peut paraître paradoxale que Là-bas prépare
la conversion de Huysmans au catholicisme. Comme Léon Bloy, son contemporain,
Huysmans navigait entre son vieux fond
de réalisme et l’aspiration à une spiritualité déficiente dans ce monde
matérialiste et uniquement préoccupé de progrès techniques et d’enrichissements
financiers.
le réceptacle de toutes
les impressions de l’extérieur. C’est pourquoi l’incubat s’observe surtout dans
les cloîtres. Ces phénomènes étant d’ordre astral, avec violente répercussion
sur le corps physique, avant d’agir sur les parties génitales, affectent
d’abord les organes qui sont le plus en rapport avec le corps astral, les
poumons et les viscères de la poitrine. Une angoisse immense étreint l’être qui
sent l’approche de l’incube ou du succube. La gorge se serre; un commencement
de suffocation se produit, en même temps toutes les muqueuses sont caressées
par des titillements voluptueux. Il semble qu’un amant extraordinairement
expert vous enveloppe, vous pénètre, se fond en vous. La jouissance est alors
insensée, la dépense nerveuse terrible. L’imagination s’exalte, la clairvoyance
somnambulique arrive. Vous voyez distinctement l’âme fantastique et glauque qui
vous travaille, qui vous fait grincer les dents dans les spasmes. Puis soudain,
il s’évanouit. Mais lorsqu’on a supporté une fois cette accointance, l’esprit
reste fortement affecté”».
Il peut paraître paradoxale que Là-bas prépare
la conversion de Huysmans au catholicisme. Comme Léon Bloy, son contemporain,
Huysmans navigait entre son vieux fond
de réalisme et l’aspiration à une spiritualité déficiente dans ce monde
matérialiste et uniquement préoccupé de progrès techniques et d’enrichissements
financiers.
 En cela, même en se convertissant au
catholicisme, les vieilles obsessions de Huysmans demeurèrent. Son Moyen Âge,
comme celui des Préraphaélites, restait une reconstitution purement imaginaire :
«Ce Moyen Âge de Huysmans ne sera pas
celui des universités et de leurs sommes théologiques, - mais celui des
cathédrales, de leur symbolique, de leurs “symbologistes” (pour employer ce mot
si précis qui donne son titre à l’un des chapitres du livre de M. Baldick);
celui des béguinages, et de leurs béates stigmatisées et visionnaires; celui
des monastères et de leur liturgie. Huysmans en cela était bien de son temps…».
Il y avait plus de thèmes ésotériques dans ce catholicisme que de véritables
épreuves spirituelles, comme le souligne Henri Mondor, «Huysmans est tout au Symbolisme catholique, de source divine. Il
préfère, à celle de Littré, la définition de Hugues de Saint-Victor. “Le symbole
est la représentation allégorique d’un principe chrétien sous une forme
sensible”».
Fulcanelli et son mystère des cathédrales n’était plus très loin.
En cela, même en se convertissant au
catholicisme, les vieilles obsessions de Huysmans demeurèrent. Son Moyen Âge,
comme celui des Préraphaélites, restait une reconstitution purement imaginaire :
«Ce Moyen Âge de Huysmans ne sera pas
celui des universités et de leurs sommes théologiques, - mais celui des
cathédrales, de leur symbolique, de leurs “symbologistes” (pour employer ce mot
si précis qui donne son titre à l’un des chapitres du livre de M. Baldick);
celui des béguinages, et de leurs béates stigmatisées et visionnaires; celui
des monastères et de leur liturgie. Huysmans en cela était bien de son temps…».
Il y avait plus de thèmes ésotériques dans ce catholicisme que de véritables
épreuves spirituelles, comme le souligne Henri Mondor, «Huysmans est tout au Symbolisme catholique, de source divine. Il
préfère, à celle de Littré, la définition de Hugues de Saint-Victor. “Le symbole
est la représentation allégorique d’un principe chrétien sous une forme
sensible”».
Fulcanelli et son mystère des cathédrales n’était plus très loin.
 |
| Dante Gabriel Rossetti. Beata Beatrix, 1864-1870. |
L’importance de Huysmans réside dans le fait
qu’il continua à sauvegarder une certaine approche du mystère et du mystérieux
qui faisait l’intérêt du symbolisme. Dépouillés de ses atours élitistes, les
thèmes symbolistes  ressurgiront dans différents courants artistiques ou
idéologiques tout au long du XXe siècle. Voilà pourquoi son biographe, Duployé,
reconnaît qu’«“À Rebours a eu le mérite
de faire prendre conscience aux jeunes d’alors qu’une nouvelle forme de
sensibilité s’était esquissée, …Jean des Esseintes décide de se réfugier loin
de l’incessant déluge de la sottise humaine : anywhere out of the world. Ses nerfs malades exigent un raffinement
extrême : il substitue le rêve à la réalité, et ne supporte le réel que s’il
paraît factice… Ainsi naquit l’âme collective d’une génération dégoûtée de
vivre la vie quotidienne, épuisée de sensations rares et d’irréel… (Hommes pour
qui) leurs accessoires de prédilection jouent le rôle de mots de passe. Ce
langage chiffré permet aux initiés de se reconnaître car il ne cesse de faire
appel aux idoles qu’on vénère : Baudelaire, et par conséquent Edgar Poe, Puvis
de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon, Bresdin, les préraphaélites anglais
qui peignent l’allégorie et le mystère, Richard Wagner, enfin. Les amateurs
d’art possèdent chez eux des reproductions de Beata Beatrix, sainte Cécile,
Salomé : ‘Telle tête de Burne-Jones…, la
jeune fille d’Orphée de Gustave Moreau
nous fera sangloter’ (J. Laforgue). Ils se délectent comme des Esseintes à la
lecture de Villiers de l’Isle-Adam, Verlaine,
ressurgiront dans différents courants artistiques ou
idéologiques tout au long du XXe siècle. Voilà pourquoi son biographe, Duployé,
reconnaît qu’«“À Rebours a eu le mérite
de faire prendre conscience aux jeunes d’alors qu’une nouvelle forme de
sensibilité s’était esquissée, …Jean des Esseintes décide de se réfugier loin
de l’incessant déluge de la sottise humaine : anywhere out of the world. Ses nerfs malades exigent un raffinement
extrême : il substitue le rêve à la réalité, et ne supporte le réel que s’il
paraît factice… Ainsi naquit l’âme collective d’une génération dégoûtée de
vivre la vie quotidienne, épuisée de sensations rares et d’irréel… (Hommes pour
qui) leurs accessoires de prédilection jouent le rôle de mots de passe. Ce
langage chiffré permet aux initiés de se reconnaître car il ne cesse de faire
appel aux idoles qu’on vénère : Baudelaire, et par conséquent Edgar Poe, Puvis
de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon, Bresdin, les préraphaélites anglais
qui peignent l’allégorie et le mystère, Richard Wagner, enfin. Les amateurs
d’art possèdent chez eux des reproductions de Beata Beatrix, sainte Cécile,
Salomé : ‘Telle tête de Burne-Jones…, la
jeune fille d’Orphée de Gustave Moreau
nous fera sangloter’ (J. Laforgue). Ils se délectent comme des Esseintes à la
lecture de Villiers de l’Isle-Adam, Verlaine,  Mallarmé. Ils se rendent en
pèlerinage à Bayreuth, car Wagner a dominé l’épo-
que…”».
En effet, à travers l’expressionnisme, le surréalisme, la contre-culture des
années 1960 et jusqu’aux films d’horreur gore
du second XXe siècle, le symbolisme a apporté une contribution inestimable
– tout aussi inestimable que le réalisme et le naturalisme – à la
représentation sociale occidentale du tournant du XXe siècle. Mais il en a
également cultivé les éléments morbides, mortifères et pathologiques que le Zeitgest de l’Anus mundi finira par condenser avec le naturalisme putride d’un Zola. Ici, alors que la
dégénérescence des familles est le produit d’une fatalité de la nécessité liée
à l’hérédité, là, c’est une sensibilité exacerbée jusqu’à la perversité qui
associe tous les symboles à des expériences morbides ou macabres ; des
rêves obscènes dont le jeune Sigmund Freud tentait déjà de retrouver la clef.
Pendant ce temps, le réalisme se refaisait une forme nouvelle apte à pousser
l’observation jusque dans ses derniers retranchements avec le groupe des refusés, celui dit des impressionnistes⌛
Mallarmé. Ils se rendent en
pèlerinage à Bayreuth, car Wagner a dominé l’épo-
que…”».
En effet, à travers l’expressionnisme, le surréalisme, la contre-culture des
années 1960 et jusqu’aux films d’horreur gore
du second XXe siècle, le symbolisme a apporté une contribution inestimable
– tout aussi inestimable que le réalisme et le naturalisme – à la
représentation sociale occidentale du tournant du XXe siècle. Mais il en a
également cultivé les éléments morbides, mortifères et pathologiques que le Zeitgest de l’Anus mundi finira par condenser avec le naturalisme putride d’un Zola. Ici, alors que la
dégénérescence des familles est le produit d’une fatalité de la nécessité liée
à l’hérédité, là, c’est une sensibilité exacerbée jusqu’à la perversité qui
associe tous les symboles à des expériences morbides ou macabres ; des
rêves obscènes dont le jeune Sigmund Freud tentait déjà de retrouver la clef.
Pendant ce temps, le réalisme se refaisait une forme nouvelle apte à pousser
l’observation jusque dans ses derniers retranchements avec le groupe des refusés, celui dit des impressionnistes⌛
 |
| John William Waterhouse. Sainte Cécile, 1895. |


 Angleterre avec le courant
dit des Préraphaélites. Ce courant
artistique avait ses théoriciens et ses praticiens. Comme les réalistes et les
naturalistes, préraphaélites et symbolistes réagissaient contre la seconde
Révolution industrielle du milieu du XIXe siècle. Ils réagissaient, mais en faisant
la promotion d’autres valeurs et références stylistiques que les premiers.
L’esprit symboliste combattit contre ce «caractère
presque exclusivement utilitaire et pratique de la nouvelle civilisation
industrielle, qui n’avait pas eu de précédent, [et commençait] vers la fin du XIXe siècle à inquiéter
sérieusement quelques réformateurs. Ces hommes, John Ruskin (1819-1900),
Matthew Arnold (1822-1888) et William Morris (1834-1896) apparurent tous en
Grande-Bretagne, le premier pays qui ait vu le triomphe de l’industrialisme.
Ils virent que la nouvelle abondance et le nouveau confort pourvoyaient de plus
en plus aux besoins prosaïques, pratiques et terre-à-terre des hommes et des
femmes, dépouillaient la vie en ce monde de quelque chose de sa saveur, au
moment même où de plus en plus de gens mettaient tous leurs espoirs dans cette
existence temporelle. Ces espoirs mêmes séchaient sur pied. Avec le
développement du machinisme et la multiplication des produits et des services,
le travail, pour l’homme et la femme du commun, devenait moins intéressant et
moins attrayant. L’amour du travail pour le travail, pour ses produits directs,
diminuait en même temps que la capacité pour les spectateurs de contempler avec
joie les résultats d’un bon travail».[3]
Ruskin et Morris étaient peintres, poètes, esthètes, critiques d’art,
philosophes sociaux. Ils n’étaient pas moins critiques de la société
industrielle et capitaliste que Courbet ou Zola, mais au lieu de regarder le présent
en pleine figure, ils détournaient le regard vers le passé. Ils idéalisaient un
Moyen Âge qui avait peu à voir avec la société féodale. Plus précisément, ils
pensaient rajouter un peu de vie dans un monde déshydraté en insérant des
valeurs nobles dans une société bourgeoise, «car lancer l’anathème contre la civilisation des machines, contre le
capitalisme industriel, contre les structures fondées sur la concurrence et la
compétition - outils majeurs de la “grande
Angleterre avec le courant
dit des Préraphaélites. Ce courant
artistique avait ses théoriciens et ses praticiens. Comme les réalistes et les
naturalistes, préraphaélites et symbolistes réagissaient contre la seconde
Révolution industrielle du milieu du XIXe siècle. Ils réagissaient, mais en faisant
la promotion d’autres valeurs et références stylistiques que les premiers.
L’esprit symboliste combattit contre ce «caractère
presque exclusivement utilitaire et pratique de la nouvelle civilisation
industrielle, qui n’avait pas eu de précédent, [et commençait] vers la fin du XIXe siècle à inquiéter
sérieusement quelques réformateurs. Ces hommes, John Ruskin (1819-1900),
Matthew Arnold (1822-1888) et William Morris (1834-1896) apparurent tous en
Grande-Bretagne, le premier pays qui ait vu le triomphe de l’industrialisme.
Ils virent que la nouvelle abondance et le nouveau confort pourvoyaient de plus
en plus aux besoins prosaïques, pratiques et terre-à-terre des hommes et des
femmes, dépouillaient la vie en ce monde de quelque chose de sa saveur, au
moment même où de plus en plus de gens mettaient tous leurs espoirs dans cette
existence temporelle. Ces espoirs mêmes séchaient sur pied. Avec le
développement du machinisme et la multiplication des produits et des services,
le travail, pour l’homme et la femme du commun, devenait moins intéressant et
moins attrayant. L’amour du travail pour le travail, pour ses produits directs,
diminuait en même temps que la capacité pour les spectateurs de contempler avec
joie les résultats d’un bon travail».[3]
Ruskin et Morris étaient peintres, poètes, esthètes, critiques d’art,
philosophes sociaux. Ils n’étaient pas moins critiques de la société
industrielle et capitaliste que Courbet ou Zola, mais au lieu de regarder le présent
en pleine figure, ils détournaient le regard vers le passé. Ils idéalisaient un
Moyen Âge qui avait peu à voir avec la société féodale. Plus précisément, ils
pensaient rajouter un peu de vie dans un monde déshydraté en insérant des
valeurs nobles dans une société bourgeoise, «car lancer l’anathème contre la civilisation des machines, contre le
capitalisme industriel, contre les structures fondées sur la concurrence et la
compétition - outils majeurs de la “grande  puissance de l’Europe moderne”
disait W. Morris - ce sera toujours “aller à contre-courant”. Tout ceci est
vrai - Barthes, transparent, accuse : “Il est aucun discours avec lequel
l’argent soit compatible.” Il est d’autant plus absurde de voir les livres de
Ruskin se vendre très chers. Car leur imprimeur G. Allen les fait exécuter
“loin des usines inesthétiques, au milieu des champs de fleurs”. On dit même
que ces précieux livres n’étaient jamais expédiés par chemin de fer, aucun
“objet de laideur” ne devant “participer à leur diffusion”. Il y a néanmoins,
entre le programme des esthéticiens et celui des esthètes, des rencontres
imprévues, sinon, des uns sur les autres, des effets inattendus. Ruskin et
William Morris, pour avoir recommandé l’insertion de l’art à tous les paliers
de la vie en arrivèrent à voir se promener en plein jour et au plein cœur de
Londres “des jeunes filles vêtues de costumes du Moyen Âge” et, au cours de
certaines soirées, “ces mêmes femmes apparaître dans des robes copiées d’après
d’anciens tableaux, avec des lys dans les cheveux”».[4]
Ce retour au symboles médiévaux occupait une place importante dans leur
réformisme socialiste, la question demeurant comment opérer cette synthèse
impossible. «Comment donc [ce] socialisme esthétique va-t-il concilier sa
“haine de la civilisation moderne” et le projet “d’offrir au travailleur une
vie à laquelle la perception de la beauté, c’est-à-dire la jouissance du
plaisir véritable, apparaîtra aussi nécessaire que le pain quotidien”? Comment
va-t-il concilier une opération de rénovation, sa foi dans le Moyen Âge et son
hostilité à la machine? Il est des contradictions qu’il faut pouvoir assumer.
Lorsqu’on l’on ose penser. Et créer. À la fois. Simultanément. L’un dans
l’autre».[5]
puissance de l’Europe moderne”
disait W. Morris - ce sera toujours “aller à contre-courant”. Tout ceci est
vrai - Barthes, transparent, accuse : “Il est aucun discours avec lequel
l’argent soit compatible.” Il est d’autant plus absurde de voir les livres de
Ruskin se vendre très chers. Car leur imprimeur G. Allen les fait exécuter
“loin des usines inesthétiques, au milieu des champs de fleurs”. On dit même
que ces précieux livres n’étaient jamais expédiés par chemin de fer, aucun
“objet de laideur” ne devant “participer à leur diffusion”. Il y a néanmoins,
entre le programme des esthéticiens et celui des esthètes, des rencontres
imprévues, sinon, des uns sur les autres, des effets inattendus. Ruskin et
William Morris, pour avoir recommandé l’insertion de l’art à tous les paliers
de la vie en arrivèrent à voir se promener en plein jour et au plein cœur de
Londres “des jeunes filles vêtues de costumes du Moyen Âge” et, au cours de
certaines soirées, “ces mêmes femmes apparaître dans des robes copiées d’après
d’anciens tableaux, avec des lys dans les cheveux”».[4]
Ce retour au symboles médiévaux occupait une place importante dans leur
réformisme socialiste, la question demeurant comment opérer cette synthèse
impossible. «Comment donc [ce] socialisme esthétique va-t-il concilier sa
“haine de la civilisation moderne” et le projet “d’offrir au travailleur une
vie à laquelle la perception de la beauté, c’est-à-dire la jouissance du
plaisir véritable, apparaîtra aussi nécessaire que le pain quotidien”? Comment
va-t-il concilier une opération de rénovation, sa foi dans le Moyen Âge et son
hostilité à la machine? Il est des contradictions qu’il faut pouvoir assumer.
Lorsqu’on l’on ose penser. Et créer. À la fois. Simultanément. L’un dans
l’autre».[5]
 Encore ici, c’est dans le contexte du Printemps des peuples que le premier
cercle préraphaélite apparut : «La Preraphaelite
Brotherhood fut fondée en 1848 par
William Dyce, Ford Madox Brown et Dante Gabriel Rossetti. Les deux premiers
avaient été en contact avec les nazaréens de Rome, et le point de départ des
préraphaélites est à peu de chose près le même. L’art, la religion et l’éthique
étaient étroitement liés; l’étude de la nature prit une place centrale, et
naturellement l’étude de l’art avant Raphaël. Les artistes anglais
s’intéressaient cependant tout spécialement à l’art décoratif. Holman Hunt,
Edward Burne-Jones, John E. Everett Millais et le jeune William Morris se
joignent bientôt au groupe. Leurs œuvres allaient du naturalisme le plus cru
jusqu’au romantisme médiéval le plus sentimental et le plus mystique. C’est
cependant chez les derniers artistes de cette école que nous pouvons trouver
des tendances menant droit à l’Art Nouveau…».[8]
Encore ici, c’est dans le contexte du Printemps des peuples que le premier
cercle préraphaélite apparut : «La Preraphaelite
Brotherhood fut fondée en 1848 par
William Dyce, Ford Madox Brown et Dante Gabriel Rossetti. Les deux premiers
avaient été en contact avec les nazaréens de Rome, et le point de départ des
préraphaélites est à peu de chose près le même. L’art, la religion et l’éthique
étaient étroitement liés; l’étude de la nature prit une place centrale, et
naturellement l’étude de l’art avant Raphaël. Les artistes anglais
s’intéressaient cependant tout spécialement à l’art décoratif. Holman Hunt,
Edward Burne-Jones, John E. Everett Millais et le jeune William Morris se
joignent bientôt au groupe. Leurs œuvres allaient du naturalisme le plus cru
jusqu’au romantisme médiéval le plus sentimental et le plus mystique. C’est
cependant chez les derniers artistes de cette école que nous pouvons trouver
des tendances menant droit à l’Art Nouveau…».[8]


 pour constituer le PreRaphaelite
Brotherhood, dont les initiales P.R.B.
devaient apparaître sous leurs œuvres comme signature et signe communautaire.
Dante Gabriel Rossetti, dont on vante volontiers l’imagination, l’enthousiasme,
les curiosités spirites, la “vocation de fils de carbonaro à créer les sociétés
plus ou moins secrètes” semble bien avoir eu l’idée de cette pseudo-confrérie
et celle d’un house-organe qui exposerait les idées du groupe».[12]
Cette volonté organisationnelle contrasta avec leurs vis-à-vis du continent qui
restaient des groupes non formalisés, partageant certains thèmes ou certaines
façons d’interpréter l’art mais sans la volonté manifeste de créer une société
particulière. Le groupe britannique opposait l’artisanat traditionnel à la
modernité industrielle : «La contribution
personnelle la plus importante fut cependant celle de William Morris;
nouvellement marié et plein d’optimisme, il déménage à Red House en 1860, et
l’année suivante sa firme prend forme, avec ses bureaux installés au 8, LionSquare […]. C’est là, dans un décor
presque bucolique, que travaillaient William Morris, Philippe Webb, les
préraphaélites Ford Madox Brown et Edward Burne Jones, ainsi que parfois Dante
Gabriel Rossetti et le curieux mathématicien Ch. J. Faulkner. Le septième
membre de la firme était Peter Marshall, un ami de Madox Brown, ingénieur de
son métier, mais comme les autres, passionné par les arts décoratifs. À partir
de 1870, on peut noter l’influence exercée sur le goût de l’époque par Morris
et son mouvement, la firme participe à des expositions internationales et sa
production pratiquement couvre toutes les branches des arts appliqués».[13]
pour constituer le PreRaphaelite
Brotherhood, dont les initiales P.R.B.
devaient apparaître sous leurs œuvres comme signature et signe communautaire.
Dante Gabriel Rossetti, dont on vante volontiers l’imagination, l’enthousiasme,
les curiosités spirites, la “vocation de fils de carbonaro à créer les sociétés
plus ou moins secrètes” semble bien avoir eu l’idée de cette pseudo-confrérie
et celle d’un house-organe qui exposerait les idées du groupe».[12]
Cette volonté organisationnelle contrasta avec leurs vis-à-vis du continent qui
restaient des groupes non formalisés, partageant certains thèmes ou certaines
façons d’interpréter l’art mais sans la volonté manifeste de créer une société
particulière. Le groupe britannique opposait l’artisanat traditionnel à la
modernité industrielle : «La contribution
personnelle la plus importante fut cependant celle de William Morris;
nouvellement marié et plein d’optimisme, il déménage à Red House en 1860, et
l’année suivante sa firme prend forme, avec ses bureaux installés au 8, LionSquare […]. C’est là, dans un décor
presque bucolique, que travaillaient William Morris, Philippe Webb, les
préraphaélites Ford Madox Brown et Edward Burne Jones, ainsi que parfois Dante
Gabriel Rossetti et le curieux mathématicien Ch. J. Faulkner. Le septième
membre de la firme était Peter Marshall, un ami de Madox Brown, ingénieur de
son métier, mais comme les autres, passionné par les arts décoratifs. À partir
de 1870, on peut noter l’influence exercée sur le goût de l’époque par Morris
et son mouvement, la firme participe à des expositions internationales et sa
production pratiquement couvre toutes les branches des arts appliqués».[13]



 n’allait pas sans évoquer l’hymne à la nature de Walt Whitman. La
nature, ici, contrairement au réaliste, n’étant pas vue sous son angle de
réalité absolue opposée à l’artificiel de l’industrie humaine. C’est la
sensibilité féminine à fleur de peau chez cet homme quand même rude et
volontaire qu’était Whitman, qui toucha poètes et artistes préraphaélites. Une
correspondance entre le poète américain et le cercle s’engagea : «Les premières éditions des Feuilles
d’herbe ont assez vivement impressionné
les entourages de Carlyle, de Ruskin, des deux Rossetti et de Swinburne pour
que l’édition de 1860 ait rencontré une audience sensiblement plus large. […] À ce propos une correspondance s’engage
entre Rossetti et Whitman, dont la première conséquence est de sceller entre
n’allait pas sans évoquer l’hymne à la nature de Walt Whitman. La
nature, ici, contrairement au réaliste, n’étant pas vue sous son angle de
réalité absolue opposée à l’artificiel de l’industrie humaine. C’est la
sensibilité féminine à fleur de peau chez cet homme quand même rude et
volontaire qu’était Whitman, qui toucha poètes et artistes préraphaélites. Une
correspondance entre le poète américain et le cercle s’engagea : «Les premières éditions des Feuilles
d’herbe ont assez vivement impressionné
les entourages de Carlyle, de Ruskin, des deux Rossetti et de Swinburne pour
que l’édition de 1860 ait rencontré une audience sensiblement plus large. […] À ce propos une correspondance s’engage
entre Rossetti et Whitman, dont la première conséquence est de sceller entre
 les deux hommes une ferme amitié et la seconde de dissuader le poète
d’envisager la publication intégrale de son œuvre en Angleterre. […] dans une introduction, W.-M. Rossetti
déclare que l’auteur des Feuilles d’herbe “a réalisé l’œuvre la plus grande de notre période en poésie”.[20]
C’est le triomphe en Europe – sauf un bémol de la part de la critique
française - : «les témoignages venus
d’Europe ne cessent d’affluer. Tandis qu’à l’envoi des Feuilles d’herbe Tennyson répond par une invitation,
Swinburne publie son poème À Walt Whitman en Amérique et Edward Dowdes
son essai Poésie de la démocratie. En
1868 Ferdinand Freiligrath a révélé Whitman à l’Allemagne. Trois ans plus tard
Rudolf Schmidt traduit en danois Perspectives démocratiques. En France, hélas, la Revue des deux
mondes accorde avec condescendance au
poète américain des dons estimables en dépit de son “répugnant matérialisme”.
Par bonheur un article d’Émile Blémont, dans la Renaissance artistique et
littéraire, contient une apostrophe qui
sauve l’honneur…».[21]
La réception britannique fut un succès tant le terrain avait été préparé
puisque «cette vision de la nature est en
partie héritée des théoriciens du mouvement préraphaélite. John Ruskin et
William Morris considéraient la nature comme une source d’inspiration, et
reviennent continuellement sur ce sujet. John Sedding, élève enthousiaste de
Morris, le formule ainsi : “Laissez tomber cette ennuyeuse traduction des vieux
styles, et traduisez plutôt la nature!” L’évolution en cours pendant la période
de l’Art Nouveau a des racines dans le naturalisme».[22]
Un naturalisme qui va retrouver celui de Zola sous un aspect fort différent, mais
nous y reviendrons.
les deux hommes une ferme amitié et la seconde de dissuader le poète
d’envisager la publication intégrale de son œuvre en Angleterre. […] dans une introduction, W.-M. Rossetti
déclare que l’auteur des Feuilles d’herbe “a réalisé l’œuvre la plus grande de notre période en poésie”.[20]
C’est le triomphe en Europe – sauf un bémol de la part de la critique
française - : «les témoignages venus
d’Europe ne cessent d’affluer. Tandis qu’à l’envoi des Feuilles d’herbe Tennyson répond par une invitation,
Swinburne publie son poème À Walt Whitman en Amérique et Edward Dowdes
son essai Poésie de la démocratie. En
1868 Ferdinand Freiligrath a révélé Whitman à l’Allemagne. Trois ans plus tard
Rudolf Schmidt traduit en danois Perspectives démocratiques. En France, hélas, la Revue des deux
mondes accorde avec condescendance au
poète américain des dons estimables en dépit de son “répugnant matérialisme”.
Par bonheur un article d’Émile Blémont, dans la Renaissance artistique et
littéraire, contient une apostrophe qui
sauve l’honneur…».[21]
La réception britannique fut un succès tant le terrain avait été préparé
puisque «cette vision de la nature est en
partie héritée des théoriciens du mouvement préraphaélite. John Ruskin et
William Morris considéraient la nature comme une source d’inspiration, et
reviennent continuellement sur ce sujet. John Sedding, élève enthousiaste de
Morris, le formule ainsi : “Laissez tomber cette ennuyeuse traduction des vieux
styles, et traduisez plutôt la nature!” L’évolution en cours pendant la période
de l’Art Nouveau a des racines dans le naturalisme».[22]
Un naturalisme qui va retrouver celui de Zola sous un aspect fort différent, mais
nous y reviendrons. déjà des préoccupations d’ordre social l’animent, l’inquiètent, le sollicitent.
L’art devrait avoir, ou retrouver, un sens, une fonction communautaires. Il
devrait s’intégrer à la vie quotidienne du plus grand nombre. Ce sont les idées
défendues par Ruskin et Carlyle. Lui entend leur donner substance en réalité.
Il fonde en 1861, avec Brown, Rossetti, Arthur Hughes, un atelier collectif
d’artistes-artisans, point de départ du mouvement Arts and Crafts où l’on trouve quelques-uns des arguments
fondamentaux de l’Art Nouveau. L’essentiel de sa doctrine est réuni dans un
texte qu’il expose le 13 novembre 1887 à la section de Hammersmith de la Socialist League. Il est intitulé : la Société du futur : “Il s’agit d’une société qui ne connaît
pas la signification des vocables riche et pauvre, ni les droits de la
propriété, ni la loi ni la légalité, pas plus que la nationalité, une société
qui n’a pas conscience d’être gouvernée, où l’égalité de condition est une
évidence, et où personne n’est récompensé pour avoir servi la communauté en
ayant reçu le pouvoir de lui porter atteinte. Il s’agit d’une société qui a
conscience de conserver à la vie sa simplicité, de renoncer à certaines victoires
sur la nature, remportées autrefois, afin d’être plus
déjà des préoccupations d’ordre social l’animent, l’inquiètent, le sollicitent.
L’art devrait avoir, ou retrouver, un sens, une fonction communautaires. Il
devrait s’intégrer à la vie quotidienne du plus grand nombre. Ce sont les idées
défendues par Ruskin et Carlyle. Lui entend leur donner substance en réalité.
Il fonde en 1861, avec Brown, Rossetti, Arthur Hughes, un atelier collectif
d’artistes-artisans, point de départ du mouvement Arts and Crafts où l’on trouve quelques-uns des arguments
fondamentaux de l’Art Nouveau. L’essentiel de sa doctrine est réuni dans un
texte qu’il expose le 13 novembre 1887 à la section de Hammersmith de la Socialist League. Il est intitulé : la Société du futur : “Il s’agit d’une société qui ne connaît
pas la signification des vocables riche et pauvre, ni les droits de la
propriété, ni la loi ni la légalité, pas plus que la nationalité, une société
qui n’a pas conscience d’être gouvernée, où l’égalité de condition est une
évidence, et où personne n’est récompensé pour avoir servi la communauté en
ayant reçu le pouvoir de lui porter atteinte. Il s’agit d’une société qui a
conscience de conserver à la vie sa simplicité, de renoncer à certaines victoires
sur la nature, remportées autrefois, afin d’être plus  humaine et moins
mécanique, et qui désire sacrifier quelque chose à cette fin. Elle serait
divisée en petites communautés variant beaucoup dans les limites autorisées par
l’éthique sociale et qui ne rivalisent pas entre elles, regardant avec aversion
l’idée d’une race élue».[23]
Cette adhésion arrivait bien tardivement pour un militant qui, depuis 30 ans,
parlait de la rupture avec la tradition issue de la Renaissance : «L’adhésion de Morris au socialisme date de
1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste et en poète, d’abord soucieux de
son œuvre. Il a cependant protesté contre les massacres de populations
chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur des Irlandais affamés.
Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier parti socialiste organisé
en Angleterre - est un pas décisif que les Conservateurs ne pardonneront pas au
tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans la presse. Morris ne s’entendra
d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de parti : il fondera son propre
mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera les conférences pour prouver à
ses auditeurs que l’organisation industrielle qu’ils subissent est incompatible
avec toute idée de bonheur et de beauté».[24]
Socialisme utopique, moins enrégimenté que dans le phalanstère de Fourier ou
l’embrigadement partisan des marxistes-léninistes, la logique du mouvement
social s’inscrivait davantage dans la mouvance artistique plutôt que dans la
lutte violente contre les injustices issues de l’organisation du travail et la
séparation du Capital et du Travail. Socialisme rétrograde, qui regardait en
arrière vers la société pré-industrielle comme modèle de valeurs et de morales,
la tendance préraphaélite ne s’assimilait pas au mouvement des travailleurs.
humaine et moins
mécanique, et qui désire sacrifier quelque chose à cette fin. Elle serait
divisée en petites communautés variant beaucoup dans les limites autorisées par
l’éthique sociale et qui ne rivalisent pas entre elles, regardant avec aversion
l’idée d’une race élue».[23]
Cette adhésion arrivait bien tardivement pour un militant qui, depuis 30 ans,
parlait de la rupture avec la tradition issue de la Renaissance : «L’adhésion de Morris au socialisme date de
1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste et en poète, d’abord soucieux de
son œuvre. Il a cependant protesté contre les massacres de populations
chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur des Irlandais affamés.
Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier parti socialiste organisé
en Angleterre - est un pas décisif que les Conservateurs ne pardonneront pas au
tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans la presse. Morris ne s’entendra
d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de parti : il fondera son propre
mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera les conférences pour prouver à
ses auditeurs que l’organisation industrielle qu’ils subissent est incompatible
avec toute idée de bonheur et de beauté».[24]
Socialisme utopique, moins enrégimenté que dans le phalanstère de Fourier ou
l’embrigadement partisan des marxistes-léninistes, la logique du mouvement
social s’inscrivait davantage dans la mouvance artistique plutôt que dans la
lutte violente contre les injustices issues de l’organisation du travail et la
séparation du Capital et du Travail. Socialisme rétrograde, qui regardait en
arrière vers la société pré-industrielle comme modèle de valeurs et de morales,
la tendance préraphaélite ne s’assimilait pas au mouvement des travailleurs. prenait de front les tendances réalistes et
naturalistes dans lesquelles il ne voyait qu’une poursuite des valeurs de la
société industrielle : «De là encore
une volonté de se démarquer face au Réalisme régnant, par crainte de voir les
Naturalistes “monter à l’assaut de l’avenir” (Castagnary), cette attitude se
confondant avec une hostilité profonde à l’égard de l’émancipation sociale
(hors celle de William Morris) et la crainte, conséquente, de voir la gauche
s’attaquer aux privilèges de la classe dominante. Dans cette perspective le
sous-ensemble symboliste des années 1870-1900 peut être simultanément
appréhendé comme structure idéologique qui incorporerait les informations d’un
milieu (circonscription physique et sociale) et de l’histoire des paradigmes préexistants, comme engagement
politique qui marquerait l’opposition au positivisme et au matérialisme
historique (opposition qui coïnciderait avec l’“avènement de la science” et
l’épanouissement du mythe du progrès), comme champ sémantique orienté vers
l’anéantissement de l’art à partir de l’angoisse, de la détresse, de la déroute
suscitée par les bouleversements de l’environnement, l’inflation urbaine, les
transformations techniques et économiques, comme manifestation d’une opposition
plus ou moins prononcée au stade de la thermodynamique, producteur massif de la
vapeur qui “siffle et fume pour marcher vers un but auquel on ne croit pas”
(Villiers de l’Isle-Adam)».[26]
À la réalité, le symbolisme opposa la
vérité. Ce fut d’ailleurs le paradoxe
d’Oscar Wilde concernant l’axiome de l’art pour l’art, entendu que «l’art n’exprime pas les siècles. Il
n’exprime jamais rien que lui-même. Une noble passion, un grand moment de la
pensée humaine ont moins d’importance pour l’art qu’une forme inédite ou un
procédé
prenait de front les tendances réalistes et
naturalistes dans lesquelles il ne voyait qu’une poursuite des valeurs de la
société industrielle : «De là encore
une volonté de se démarquer face au Réalisme régnant, par crainte de voir les
Naturalistes “monter à l’assaut de l’avenir” (Castagnary), cette attitude se
confondant avec une hostilité profonde à l’égard de l’émancipation sociale
(hors celle de William Morris) et la crainte, conséquente, de voir la gauche
s’attaquer aux privilèges de la classe dominante. Dans cette perspective le
sous-ensemble symboliste des années 1870-1900 peut être simultanément
appréhendé comme structure idéologique qui incorporerait les informations d’un
milieu (circonscription physique et sociale) et de l’histoire des paradigmes préexistants, comme engagement
politique qui marquerait l’opposition au positivisme et au matérialisme
historique (opposition qui coïnciderait avec l’“avènement de la science” et
l’épanouissement du mythe du progrès), comme champ sémantique orienté vers
l’anéantissement de l’art à partir de l’angoisse, de la détresse, de la déroute
suscitée par les bouleversements de l’environnement, l’inflation urbaine, les
transformations techniques et économiques, comme manifestation d’une opposition
plus ou moins prononcée au stade de la thermodynamique, producteur massif de la
vapeur qui “siffle et fume pour marcher vers un but auquel on ne croit pas”
(Villiers de l’Isle-Adam)».[26]
À la réalité, le symbolisme opposa la
vérité. Ce fut d’ailleurs le paradoxe
d’Oscar Wilde concernant l’axiome de l’art pour l’art, entendu que «l’art n’exprime pas les siècles. Il
n’exprime jamais rien que lui-même. Une noble passion, un grand moment de la
pensée humaine ont moins d’importance pour l’art qu’une forme inédite ou un
procédé  nouveau. L’art “détourne les yeux” du réel. Il développe et dévoile solitairement sa propre perfection.
Il ne prend dans la réalité qu’un point de départ, et c’est pour le dépasser
aussitôt en exprimant de “belles
choses fausses”. L’artiste, de ce point
de vue, est le menteur superbement doué, et le style - rituel plus important
que le contenu du culte - est l’ensemble des savants moyens qui nous font
accepter et chérir comme vraies ces chimères».[27]
Le même Wilde affirmait, a contrario,
«dans La Décadence du Mensonge […], que la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, il supprime
très consciemment la partie la plus évidente de la vérité pour n’en retenir que
la partie la moins connue. Et le bien
plus est, ici, le petit coup de pouce
qui achève de créer le paradoxe».[28]
Si l’art n’est qu’une interprétation faussée de la réalité, mais que le réel
lui-même imite l’art, alors le mensonge ne peut être que partout, dans le réel
comme dans l’art, et l’artiste perd ce privilège d’être le menteur superbement doué, d’où une vacuité du travail de l’artiste.
La seule façon d’échapper au paradoxe imposait de franchir le seuil de la
métaphysique.
nouveau. L’art “détourne les yeux” du réel. Il développe et dévoile solitairement sa propre perfection.
Il ne prend dans la réalité qu’un point de départ, et c’est pour le dépasser
aussitôt en exprimant de “belles
choses fausses”. L’artiste, de ce point
de vue, est le menteur superbement doué, et le style - rituel plus important
que le contenu du culte - est l’ensemble des savants moyens qui nous font
accepter et chérir comme vraies ces chimères».[27]
Le même Wilde affirmait, a contrario,
«dans La Décadence du Mensonge […], que la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, il supprime
très consciemment la partie la plus évidente de la vérité pour n’en retenir que
la partie la moins connue. Et le bien
plus est, ici, le petit coup de pouce
qui achève de créer le paradoxe».[28]
Si l’art n’est qu’une interprétation faussée de la réalité, mais que le réel
lui-même imite l’art, alors le mensonge ne peut être que partout, dans le réel
comme dans l’art, et l’artiste perd ce privilège d’être le menteur superbement doué, d’où une vacuité du travail de l’artiste.
La seule façon d’échapper au paradoxe imposait de franchir le seuil de la
métaphysique.
 alors se rallier au mysticisme des
Rossetti et des Moreau, où la vérité transcende
la réalité, tant le réalisme et le
naturalisme s’abîmaient dans ce projet (stérile) de reproduire
une réalité que tout le monde connaissait, comme le rappelait Renan. «La vie, en effet, passe. L’art demeure. Il
sauve de la mort non seulement le nom de l’artiste, mais les fragments du réel
que sa magie a transfigurés. L’art, au surplus, manifeste la seule liberté qui
reste en notre pouvoir. Car l’action non seulement meurt au moment de son
énergie, mais étroitement soumise aux circonstances du temps et de l’espace,
elle ne connaît ni sa propre origine, ni ses propres conséquences. Dans
l’individu même où elle apparaît, elle est toujours nécessaire. Car elle est déterminée par ce principe d’hérédité où Wilde, avec une satisfaction qui
paraîtra quelque peu hâtive, voit la négation de toute responsabilité morale.
Plus légitimement, il y trouve une autorisation de s’abandonner à la vie
contemplative. Cette contemplation,
cependant, ne prendra pas pour objet le monde de la pensée abstraite. […] Seule la contemplation artistique peut nous
satisfaire pleinement, car même dans ses plus humbles manifestations, elle
parle à la fois aux sens et à l’âme».[31]
Wilde, théoricien de l’esthétisme, transposait la sensibilité des préraphaélites
dans l’œuvre romanesque et en particulier dans Le portrait de Dorian Gray, dans lequel temps, mystère, beauté,
vieillissement, épuisement et mort se donnaient rendez-vous.
alors se rallier au mysticisme des
Rossetti et des Moreau, où la vérité transcende
la réalité, tant le réalisme et le
naturalisme s’abîmaient dans ce projet (stérile) de reproduire
une réalité que tout le monde connaissait, comme le rappelait Renan. «La vie, en effet, passe. L’art demeure. Il
sauve de la mort non seulement le nom de l’artiste, mais les fragments du réel
que sa magie a transfigurés. L’art, au surplus, manifeste la seule liberté qui
reste en notre pouvoir. Car l’action non seulement meurt au moment de son
énergie, mais étroitement soumise aux circonstances du temps et de l’espace,
elle ne connaît ni sa propre origine, ni ses propres conséquences. Dans
l’individu même où elle apparaît, elle est toujours nécessaire. Car elle est déterminée par ce principe d’hérédité où Wilde, avec une satisfaction qui
paraîtra quelque peu hâtive, voit la négation de toute responsabilité morale.
Plus légitimement, il y trouve une autorisation de s’abandonner à la vie
contemplative. Cette contemplation,
cependant, ne prendra pas pour objet le monde de la pensée abstraite. […] Seule la contemplation artistique peut nous
satisfaire pleinement, car même dans ses plus humbles manifestations, elle
parle à la fois aux sens et à l’âme».[31]
Wilde, théoricien de l’esthétisme, transposait la sensibilité des préraphaélites
dans l’œuvre romanesque et en particulier dans Le portrait de Dorian Gray, dans lequel temps, mystère, beauté,
vieillissement, épuisement et mort se donnaient rendez-vous.
 surtout, bien sûr, en Angleterre et aux
États-Unis. […] Pendant toute cette
période, surtout dans la seconde moitié, on cultive volontiers dans les arts en
général un climat d’étrangeté, qui s’accorde assez bien avec le numineux que
sécrètent les récits fantastiques. Un autre élément littéraire favorable est le
roman policier…».[32]
Les conversions de Wilde et de Verlaine lors de leur période de détention après
les scandales qui les mirent en valeur provenaient possiblement de cette
intrusion dans le domaine métaphysique. Mais leur religiosité relevait peu du
catholicisme authentique : «Sans être
religieux, le symbolisme offre d’autres perspectives sur les richesses de la
personne humaine. Le Roman Russe
d’Eugène-Melchior de Vogüé qui fait appel aux “puissances invincibles du désir
et du rêve”, lui ouvre en 1885 les horizons nostalgiques de l’âme slave, et le
drame ibsenien lui apporte l’affirmation de la dignité de l’âme. Est-il besoin
de le rappeler? plusieurs de ses plus grands poètes ont des accents chrétiens :
le remords arrache des prières à Verlaine et les vers de Rimbaud évoquent une
charité qui est amour».[33]
Était-ce parce que ces importations ne trouvaient pas racines dans leurs âmes
que ces conversions durèrent le temps
de la persécution et s’évanouirent une fois les forçats retournés à la liberté?
L’avenir de la tendance symboliste lui-même en sera hypothéqué, tant, selon
l’anthropologue Gilbert Durand, «le
mouvement symboliste est bien le signe d’une saturation des visions du monde
trop contingentées par l’idéologie du progressisme scientifique dont le
néo-impressionnisme fut l’un des paradigmes».[34]
Si le réalisme s’associait à la foi religieuse du scientisme, le symbolisme chercha
plutôt du côté de l’occulte, allant jusqu’à inverser, chez un Félicien Rops, le
culte catholique pour la démonolâtrie. Le diable de Baudelaire donnait à se
manifester dans les arts alors que son adversaire venait d’être proclamé mort
par Nietzsche. Mais, faut-il le préciser? le symbolisme n’a pas été créé pour
servir les sciences occultes, mais son
approche de l’art et de la littérature, à elles aussi, entrouvrait ses
portes.
surtout, bien sûr, en Angleterre et aux
États-Unis. […] Pendant toute cette
période, surtout dans la seconde moitié, on cultive volontiers dans les arts en
général un climat d’étrangeté, qui s’accorde assez bien avec le numineux que
sécrètent les récits fantastiques. Un autre élément littéraire favorable est le
roman policier…».[32]
Les conversions de Wilde et de Verlaine lors de leur période de détention après
les scandales qui les mirent en valeur provenaient possiblement de cette
intrusion dans le domaine métaphysique. Mais leur religiosité relevait peu du
catholicisme authentique : «Sans être
religieux, le symbolisme offre d’autres perspectives sur les richesses de la
personne humaine. Le Roman Russe
d’Eugène-Melchior de Vogüé qui fait appel aux “puissances invincibles du désir
et du rêve”, lui ouvre en 1885 les horizons nostalgiques de l’âme slave, et le
drame ibsenien lui apporte l’affirmation de la dignité de l’âme. Est-il besoin
de le rappeler? plusieurs de ses plus grands poètes ont des accents chrétiens :
le remords arrache des prières à Verlaine et les vers de Rimbaud évoquent une
charité qui est amour».[33]
Était-ce parce que ces importations ne trouvaient pas racines dans leurs âmes
que ces conversions durèrent le temps
de la persécution et s’évanouirent une fois les forçats retournés à la liberté?
L’avenir de la tendance symboliste lui-même en sera hypothéqué, tant, selon
l’anthropologue Gilbert Durand, «le
mouvement symboliste est bien le signe d’une saturation des visions du monde
trop contingentées par l’idéologie du progressisme scientifique dont le
néo-impressionnisme fut l’un des paradigmes».[34]
Si le réalisme s’associait à la foi religieuse du scientisme, le symbolisme chercha
plutôt du côté de l’occulte, allant jusqu’à inverser, chez un Félicien Rops, le
culte catholique pour la démonolâtrie. Le diable de Baudelaire donnait à se
manifester dans les arts alors que son adversaire venait d’être proclamé mort
par Nietzsche. Mais, faut-il le préciser? le symbolisme n’a pas été créé pour
servir les sciences occultes, mais son
approche de l’art et de la littérature, à elles aussi, entrouvrait ses
portes.




 “officiel”
tout en portant délibérément leur démarche sur le front idéaliste. De là les
points d’appui qu’ils prennent dans la légende grecque, celtique,
judéo-chrétienne : pour culturaliser leur production et la rendre accessible
seulement à une classe».[38]
Car tout cela ne s’adresse pas au commun des mortels, contrairement aux
tableaux historiques de Courbet. Le Manifeste symbolique rédigé par le critique
d’art G. Albert Aurier, en 1891, se termine par ces cinq points qui entendent
résumer l’essentiel du mouvement : «Donc,
pour enfin se résumer et conclure, l’œuvre d’art telle qu’il m’a plu de la
logiquement évoquer sera : 1° idéiste, puisque son idéal unique sera l’expression
de l’Idée; 2° symboliste, puisqu’elle
exprimera cette Idée par des formes; 3° synthétique, puisqu’elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de
compréhension générale; 4° subjective,
puisque l’objet n’y sera jamais considéré en tant qu’objet, mais en tant que
signe d’idée perçue par le sujet; 5° (c’est une conséquence) décorative, car la peinture décorative proprement
dite, telle que l’ont comprise les Égyptiens, très probablement les Grecs et
les Primitifs, n’est rien autre chose qu’une manifestation d’art à la fois
subjective, synthétique, symboliste et idéiste».[39]
On ne pouvait guère mieux résumer ce qu’on retrouvait dans les tableaux
symbolistes. Quelques années plus tard, en 1895, un second manifeste, celui de
Maurice Denis, préciserait qu’il faut «se
rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de bataille, une
“officiel”
tout en portant délibérément leur démarche sur le front idéaliste. De là les
points d’appui qu’ils prennent dans la légende grecque, celtique,
judéo-chrétienne : pour culturaliser leur production et la rendre accessible
seulement à une classe».[38]
Car tout cela ne s’adresse pas au commun des mortels, contrairement aux
tableaux historiques de Courbet. Le Manifeste symbolique rédigé par le critique
d’art G. Albert Aurier, en 1891, se termine par ces cinq points qui entendent
résumer l’essentiel du mouvement : «Donc,
pour enfin se résumer et conclure, l’œuvre d’art telle qu’il m’a plu de la
logiquement évoquer sera : 1° idéiste, puisque son idéal unique sera l’expression
de l’Idée; 2° symboliste, puisqu’elle
exprimera cette Idée par des formes; 3° synthétique, puisqu’elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de
compréhension générale; 4° subjective,
puisque l’objet n’y sera jamais considéré en tant qu’objet, mais en tant que
signe d’idée perçue par le sujet; 5° (c’est une conséquence) décorative, car la peinture décorative proprement
dite, telle que l’ont comprise les Égyptiens, très probablement les Grecs et
les Primitifs, n’est rien autre chose qu’une manifestation d’art à la fois
subjective, synthétique, symboliste et idéiste».[39]
On ne pouvait guère mieux résumer ce qu’on retrouvait dans les tableaux
symbolistes. Quelques années plus tard, en 1895, un second manifeste, celui de
Maurice Denis, préciserait qu’il faut «se
rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de bataille, une  femme nue ou
une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées.” [L’auteur ajoute, en 1895 : “et
pour le plaisir des yeux”]. «Sur ce
document s’articule, en 1892, l’article-manifeste qu’Albert Aurier donne à la Revue
Encyclopédique quelques mois avant sa
mort : “De toute part, précise le poète, on revendique le droit au rêve, le
droit aux pâturages de l’azur, le droit à l’envolement vers les étoiles niées
de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, l’imitation
imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la
gloire d’être aussi fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne
contente plus aucun peintre, aucun sculpteur digne de ce nom”. Ici apparaît
l’une des alternatives du symbolisme : celle qui opte pour “l’expression par le
décor, par l’harmonie des formes et des couleurs”. À ce niveau l’œuvre prétend
être un “équivalent décoratif” à “toute émotion humaine”. Pour Maurice Denis le
symbolisme est “l’expression des émotions et des pensées humaines par des
correspondants esthétiques”. La tendance ramène le symbolisme à une structure
de surface, celle qui va soutenir le développement du Modern Style, vu comme
phénomène formel et visuel “ornemental”, “décoratif”; moyen apparemment
innocent de mettre entre parenthèses les réalités socio-politiques
environnantes tout en incorporant un comportement viscéral à la pratique signifiante
: contradictoirement les conduites du corps vont, dans l’Art Nouveau des années
1890-1900, recouvrir l’hypo-symbolisme
tel qu’il est circonscrit par M. Denis à partir d’une conscience religieuse
très prononcée (sans jamais atteindre l’acuité du sens du sacré inhérent à la
démarche de Gauguin)».[40]
Le symbolisme semblait mener aussi directement au post-impressionnisme que
l’impressionnisme était sorti du réalisme, le tout allant se fondre dans
l’expressionnisme. La convergence de
tendances aussi opposées dans leur trajectoire semblait attirer les artistes
depuis l’affrontement de 1870.
femme nue ou
une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées.” [L’auteur ajoute, en 1895 : “et
pour le plaisir des yeux”]. «Sur ce
document s’articule, en 1892, l’article-manifeste qu’Albert Aurier donne à la Revue
Encyclopédique quelques mois avant sa
mort : “De toute part, précise le poète, on revendique le droit au rêve, le
droit aux pâturages de l’azur, le droit à l’envolement vers les étoiles niées
de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, l’imitation
imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la
gloire d’être aussi fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne
contente plus aucun peintre, aucun sculpteur digne de ce nom”. Ici apparaît
l’une des alternatives du symbolisme : celle qui opte pour “l’expression par le
décor, par l’harmonie des formes et des couleurs”. À ce niveau l’œuvre prétend
être un “équivalent décoratif” à “toute émotion humaine”. Pour Maurice Denis le
symbolisme est “l’expression des émotions et des pensées humaines par des
correspondants esthétiques”. La tendance ramène le symbolisme à une structure
de surface, celle qui va soutenir le développement du Modern Style, vu comme
phénomène formel et visuel “ornemental”, “décoratif”; moyen apparemment
innocent de mettre entre parenthèses les réalités socio-politiques
environnantes tout en incorporant un comportement viscéral à la pratique signifiante
: contradictoirement les conduites du corps vont, dans l’Art Nouveau des années
1890-1900, recouvrir l’hypo-symbolisme
tel qu’il est circonscrit par M. Denis à partir d’une conscience religieuse
très prononcée (sans jamais atteindre l’acuité du sens du sacré inhérent à la
démarche de Gauguin)».[40]
Le symbolisme semblait mener aussi directement au post-impressionnisme que
l’impressionnisme était sorti du réalisme, le tout allant se fondre dans
l’expressionnisme. La convergence de
tendances aussi opposées dans leur trajectoire semblait attirer les artistes
depuis l’affrontement de 1870.
 années, s’adressant toutes plus ou moins au même cercle restreint de lecteurs,
semble refléter les querelles intestines dont souffrait le symbolisme. Chaque
dissident paraît avoir publié presque automatiquement un autre périodique. Il y
eut également de fréquentes et contradictoires déclarations quant à savoir
quels étaient, sur le nouveau mouvement, les exposés autorisés».[42]
L’ésotérisme du genre contribuait sans doute beaucoup à cette difficulté de
trouver une tonalité commune. Les peintres, eux, se distribuèrent selon les
écoles de poésie symboliste : «Quelquefois,
Seurat, avec Signac, Dubois-Pillet et Charles Henry, se joignait à un groupe de
poètes et d’écrivains à la Brasserie Gambrinus où, de 1884 à 1886, se réunissaient presque tous les soirs Jean
Moréas, Gustave Kahn, Félix Fénéon, Paul Adam, Édouard Dujardin, éditeur de La
Revue wagnérienne, Teodor de Wyzewa,
critique hostile aux théories de Seurat, Jean Ajalbert, Maurice Barrès, Jules
Laforgue et leurs amis. C’est dans cette brasserie qu’avaient été fondées La
Revue indépendante et l’éphémère revue La
Vogue; c’est là que, selon Jules
Christophe, “naquit du dégoût des grossières, toutes extérieures et déjà
vieilles formules naturalistes, le symbolisme, enquêteur d’âmes, de nuances
fragiles, de commas sensationnels, de fugitives et combien - quelquefois - douloureuses ou intensives impressions, donc art ésotérique, forcément
aristocratique, un peu
années, s’adressant toutes plus ou moins au même cercle restreint de lecteurs,
semble refléter les querelles intestines dont souffrait le symbolisme. Chaque
dissident paraît avoir publié presque automatiquement un autre périodique. Il y
eut également de fréquentes et contradictoires déclarations quant à savoir
quels étaient, sur le nouveau mouvement, les exposés autorisés».[42]
L’ésotérisme du genre contribuait sans doute beaucoup à cette difficulté de
trouver une tonalité commune. Les peintres, eux, se distribuèrent selon les
écoles de poésie symboliste : «Quelquefois,
Seurat, avec Signac, Dubois-Pillet et Charles Henry, se joignait à un groupe de
poètes et d’écrivains à la Brasserie Gambrinus où, de 1884 à 1886, se réunissaient presque tous les soirs Jean
Moréas, Gustave Kahn, Félix Fénéon, Paul Adam, Édouard Dujardin, éditeur de La
Revue wagnérienne, Teodor de Wyzewa,
critique hostile aux théories de Seurat, Jean Ajalbert, Maurice Barrès, Jules
Laforgue et leurs amis. C’est dans cette brasserie qu’avaient été fondées La
Revue indépendante et l’éphémère revue La
Vogue; c’est là que, selon Jules
Christophe, “naquit du dégoût des grossières, toutes extérieures et déjà
vieilles formules naturalistes, le symbolisme, enquêteur d’âmes, de nuances
fragiles, de commas sensationnels, de fugitives et combien - quelquefois - douloureuses ou intensives impressions, donc art ésotérique, forcément
aristocratique, un peu  “fumiste”, si l’on veut, où se trouve comme un désir de
mystification qui se venge de l’universelle sottise, art qui se réclame de la
science et du rêve, évocateur de schémas, c’est-à-dire de toute forme existante
dans l’entendement et en dehors de la matière même, art spiritualiste et
pyrrhonien, nihiliste, religieux et athée, même wagnérien”».[43]
Encore une fois, c’était une commune haine du réalisme et du naturalisme qui réunissaient
ceux que l’on rassembla sous l’étiquette symboliste
plutôt qu’un projet artistique ou littéraire commun Alors que les écrivains, Aurier ou Denis, donnaient leur
définition du symbolisme, ce furent le post-impressionniste «Gauguin et les synthétistes» (Pont Aven) qui exprimèrent «une thèse […] à laquelle nous donnons le nom de Symbolisme
: l’œuvre d’art n’est pas expressive mais représentative, elle est un
corrélatif du sentiment et non pas une expression du sentiment».[44]
Malgré les dissensions, la caractéristique de l’équivalent demeurait le sens commun du mouvement symboliste.
“fumiste”, si l’on veut, où se trouve comme un désir de
mystification qui se venge de l’universelle sottise, art qui se réclame de la
science et du rêve, évocateur de schémas, c’est-à-dire de toute forme existante
dans l’entendement et en dehors de la matière même, art spiritualiste et
pyrrhonien, nihiliste, religieux et athée, même wagnérien”».[43]
Encore une fois, c’était une commune haine du réalisme et du naturalisme qui réunissaient
ceux que l’on rassembla sous l’étiquette symboliste
plutôt qu’un projet artistique ou littéraire commun Alors que les écrivains, Aurier ou Denis, donnaient leur
définition du symbolisme, ce furent le post-impressionniste «Gauguin et les synthétistes» (Pont Aven) qui exprimèrent «une thèse […] à laquelle nous donnons le nom de Symbolisme
: l’œuvre d’art n’est pas expressive mais représentative, elle est un
corrélatif du sentiment et non pas une expression du sentiment».[44]
Malgré les dissensions, la caractéristique de l’équivalent demeurait le sens commun du mouvement symboliste. équivalents. Il y avait donc étroite correspondance
entre des formes et des émotions. Les phénomènes signifient des états d’âme, et
c’est le symbolisme. La matière est devenue expressive et la chair s’est faite
le verbe. […] Le symbolisme s’appuie
donc tout entier sur une de ces vérités très simples que confirment à la fois,
depuis les temps les plus reculés, la tradition et l’expérience. […] En fait, et c’est ici que le symbolisme
historique des années 1870-1900 trouve sa véritable dimension, la “conscience
du symbole”, pour mettre en échec le réalisme positiviste ou le “naturalisme”
a, contradictoirement, marqué un retour à l’état de nature, à l’homme en qui
l’expérience primordiale survit dans l’expérience individuelle».[45]
Pour illustrer le type de penser auquel conduisait le symbolisme, il suffit de
mentionner le nom, en photographie, d’«Émile
Joachim Constant Puyo (1857-1933) [qui]
a laissé une description de l’éclairage compliqué auquel il a eu recours pour
réaliser sa “Tête de Gorgone”; “…je dirais que je voulais plonger les orbites
dans l’ombre, mettre le front et le nez en lumière, et faire ressortir les
contours qui forment le cadre osseux du visage. Pour produire cet effet, j’ai
enveloppé une lampe dans un tissu et je l’ai placée à une distance de 50
centimètres au-dessus du front; la lumière frappe directement l’os frontal et
l’arête du nez…” Pour le choix de ses sujets, il s’inscrivait comme nombre
d’artistes des années 1890 dans le courant de “l’imagination décadente”».[46]
Le plus honorable que l’on puisse dire de la recherche symboliste, c’est
qu’elle consistait à «découvrir par le
langage un monde transcendant [et que ce fut là] la préoccupation de bien des artistes. Par là se rénovait dans tous
les pays, depuis le symbolisme, une langue que le naturalisme avait réduite à
la banalité de la vie quotidienne».[47]
Cela, les écrivains furent les mieux placés pour le formuler.
équivalents. Il y avait donc étroite correspondance
entre des formes et des émotions. Les phénomènes signifient des états d’âme, et
c’est le symbolisme. La matière est devenue expressive et la chair s’est faite
le verbe. […] Le symbolisme s’appuie
donc tout entier sur une de ces vérités très simples que confirment à la fois,
depuis les temps les plus reculés, la tradition et l’expérience. […] En fait, et c’est ici que le symbolisme
historique des années 1870-1900 trouve sa véritable dimension, la “conscience
du symbole”, pour mettre en échec le réalisme positiviste ou le “naturalisme”
a, contradictoirement, marqué un retour à l’état de nature, à l’homme en qui
l’expérience primordiale survit dans l’expérience individuelle».[45]
Pour illustrer le type de penser auquel conduisait le symbolisme, il suffit de
mentionner le nom, en photographie, d’«Émile
Joachim Constant Puyo (1857-1933) [qui]
a laissé une description de l’éclairage compliqué auquel il a eu recours pour
réaliser sa “Tête de Gorgone”; “…je dirais que je voulais plonger les orbites
dans l’ombre, mettre le front et le nez en lumière, et faire ressortir les
contours qui forment le cadre osseux du visage. Pour produire cet effet, j’ai
enveloppé une lampe dans un tissu et je l’ai placée à une distance de 50
centimètres au-dessus du front; la lumière frappe directement l’os frontal et
l’arête du nez…” Pour le choix de ses sujets, il s’inscrivait comme nombre
d’artistes des années 1890 dans le courant de “l’imagination décadente”».[46]
Le plus honorable que l’on puisse dire de la recherche symboliste, c’est
qu’elle consistait à «découvrir par le
langage un monde transcendant [et que ce fut là] la préoccupation de bien des artistes. Par là se rénovait dans tous
les pays, depuis le symbolisme, une langue que le naturalisme avait réduite à
la banalité de la vie quotidienne».[47]
Cela, les écrivains furent les mieux placés pour le formuler.  l’essentiel, ils ne disent
rien. On croit davantage à la poésie parce que, même évanescente - et à vrai
dire cette époque ne donna aucun chef-d’œuvre poétique -, la poésie joue entre
plusieurs épaisseurs de la réalité, suggère toujours ce que l’on ne dit pas, et
ne prétend pas “expliquer”, comme le roman, tout ce qui se passe…».[48]
Ce furent donc les poètes qui se chargèrent de représenter la tendance
symboliste en littérature. Le poète français le plus retenu, en tant que
théoricien du mouvement plutôt que par ses œuvres elles-mêmes, maintenant oubliées,
c’est Jean Moréas poète français d’origine grecque (1856-1910). Il appartenait
à cette nouvelle génération en réaction «contre
le naturalisme littéraire et son “manque de mystère”, ses descriptions
soigneuses plutôt que la suggestion et l’évocation de “climats”. Ainsi, en
automne 1886, Jean Moréas publia son Manifeste du symbolisme fort discuté, annonçant les principes d’une
nouvelle conception littéraire. Moréas était vaillamment soutenu par Gustave Kahn qui venait précisément de mettre le point final à un volume de poésies,
écrites en ce qu’il appelait “vers libres”, dont le dédain pour la syntaxe
traditionnelle
l’essentiel, ils ne disent
rien. On croit davantage à la poésie parce que, même évanescente - et à vrai
dire cette époque ne donna aucun chef-d’œuvre poétique -, la poésie joue entre
plusieurs épaisseurs de la réalité, suggère toujours ce que l’on ne dit pas, et
ne prétend pas “expliquer”, comme le roman, tout ce qui se passe…».[48]
Ce furent donc les poètes qui se chargèrent de représenter la tendance
symboliste en littérature. Le poète français le plus retenu, en tant que
théoricien du mouvement plutôt que par ses œuvres elles-mêmes, maintenant oubliées,
c’est Jean Moréas poète français d’origine grecque (1856-1910). Il appartenait
à cette nouvelle génération en réaction «contre
le naturalisme littéraire et son “manque de mystère”, ses descriptions
soigneuses plutôt que la suggestion et l’évocation de “climats”. Ainsi, en
automne 1886, Jean Moréas publia son Manifeste du symbolisme fort discuté, annonçant les principes d’une
nouvelle conception littéraire. Moréas était vaillamment soutenu par Gustave Kahn qui venait précisément de mettre le point final à un volume de poésies,
écrites en ce qu’il appelait “vers libres”, dont le dédain pour la syntaxe
traditionnelle  inquiéta Mallarmé».[49]
Comme Zola dans son Roman naturaliste, Moréas
annonçait une nouvelle ère artistique et poétique : «Buts et moyens étaient définis par Moréas dans son manifeste : “La
poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins,
ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l’Idée,
demeurerait sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée
des somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel
de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée
en soi… “Pour la traduction exacte de sa synthèse, il faut au symbolisme un
style archétype et complexe: d’impollués vocables, la période qui s’arc-boute,
alternant avec la période aux défaillances ondulées, les pléonasmes
significatifs, les mystérieuses ellipses, l’anacoluthe en suspens, tout trope
hardi et multiforme : enfin, la bonne langue.” Et Moréas continuait en répétant
: “L’art ne saurait chercher en l’objectif qu’un simple point de départ
extrêmement succint”».[50]
Il se trouvait que «dans sa théorie de la
poésie, Kahn explique l’utilisation d’impulsions dynamogéniques ou inhibitoires
dans le vers, l’assonance, la continuité et d’autres éléments de rythme et de
structure qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’il était influencé par le Cercle
chromatique (1888) de son ami. En cet
ouvrage, Henry analyse la langue et la musique d’une manière analogue à son
analyse des couleurs, sa théorie de la psychologie perceptuelle étant à base de
ses études sur les trois branches de l’art : peinture, poésie et musique. Kahn
établit des rapports entre émotions et sons et rythme comme le fait Henyi».[51]
inquiéta Mallarmé».[49]
Comme Zola dans son Roman naturaliste, Moréas
annonçait une nouvelle ère artistique et poétique : «Buts et moyens étaient définis par Moréas dans son manifeste : “La
poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins,
ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l’Idée,
demeurerait sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée
des somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel
de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée
en soi… “Pour la traduction exacte de sa synthèse, il faut au symbolisme un
style archétype et complexe: d’impollués vocables, la période qui s’arc-boute,
alternant avec la période aux défaillances ondulées, les pléonasmes
significatifs, les mystérieuses ellipses, l’anacoluthe en suspens, tout trope
hardi et multiforme : enfin, la bonne langue.” Et Moréas continuait en répétant
: “L’art ne saurait chercher en l’objectif qu’un simple point de départ
extrêmement succint”».[50]
Il se trouvait que «dans sa théorie de la
poésie, Kahn explique l’utilisation d’impulsions dynamogéniques ou inhibitoires
dans le vers, l’assonance, la continuité et d’autres éléments de rythme et de
structure qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’il était influencé par le Cercle
chromatique (1888) de son ami. En cet
ouvrage, Henry analyse la langue et la musique d’une manière analogue à son
analyse des couleurs, sa théorie de la psychologie perceptuelle étant à base de
ses études sur les trois branches de l’art : peinture, poésie et musique. Kahn
établit des rapports entre émotions et sons et rythme comme le fait Henyi».[51]
 Charles Henry (1859-1926), en effet, avait publié ses études sur le cercle chromatique qui représentait l’ordonnancement des couleurs (primaires et
secondaires) et n’en était pas moins un positiviste. Autant que les
impressionnistes, les symbolistes allaient puiser dans ce cercle chromatique les
éléments pour construire leurs peintures. Pour les poètes, le principe
similaire devait être trouvé dans la sonorité des rythmes, des vers, des
compositions. Comme le reconnaît Marcel Raymond : «Un des plus grands mérites des symbolistes est d’avoir pris conscience
de ces phénomènes complexes. “En écriture, de par l’abondance, je procède
musiciennement, perchant les mots sur les portées d’orchestration : voici les
cordes et les bois, voilà les cuivres et la batterie…” Ces affirmations
pittoresques, qui sont de Saint-Pol-Roux, nous laissent voir comment une vertu,
poussée à l’extrême, peut se retourner contre elle-même. L’usage systématique a
conduit à une nouvelle servitude et à deux erreurs principales, semble-t-il :
D’abord, les symbolistes ont trop souvent sacrifié la musicalité intérieure aux
simples jeux de
Charles Henry (1859-1926), en effet, avait publié ses études sur le cercle chromatique qui représentait l’ordonnancement des couleurs (primaires et
secondaires) et n’en était pas moins un positiviste. Autant que les
impressionnistes, les symbolistes allaient puiser dans ce cercle chromatique les
éléments pour construire leurs peintures. Pour les poètes, le principe
similaire devait être trouvé dans la sonorité des rythmes, des vers, des
compositions. Comme le reconnaît Marcel Raymond : «Un des plus grands mérites des symbolistes est d’avoir pris conscience
de ces phénomènes complexes. “En écriture, de par l’abondance, je procède
musiciennement, perchant les mots sur les portées d’orchestration : voici les
cordes et les bois, voilà les cuivres et la batterie…” Ces affirmations
pittoresques, qui sont de Saint-Pol-Roux, nous laissent voir comment une vertu,
poussée à l’extrême, peut se retourner contre elle-même. L’usage systématique a
conduit à une nouvelle servitude et à deux erreurs principales, semble-t-il :
D’abord, les symbolistes ont trop souvent sacrifié la musicalité intérieure aux
simples jeux de  sonorités; de là l’abus des “cordes” et des “cuivres”. En
outre, justement soucieux des rapports du son et de la pensée, ils ont eu le
tort - quelques-uns d’entre eux, du moins; je songe surtout à René Ghil - de
négliger les divergences individuelles pour la satisfaction de formuler des
lois, des principes, des recettes qui n’ont qu’une valeur de fantaisie. Erreurs
assez manifestes, qui ont enseigné la prudence à leurs successeurs. Il en est
de fait que le rêve de la “fusion des arts”, depuis quelque trente ans, ne
hante plus guère l’imagination de nos contemporains; d’ailleurs, c’est avec les
peintres plutôt qu’avec les musiciens que les représentants des jeunes écoles
ont fait alliance».[52]
Il ne faut pas oublier le fait que les poètes symbolistes furent grandement
influencés par la musique de Wagner, et celle de Verdi non plus ne devait pas
les laisser indifférents. Est-il donc normal, aussi, qu’aux chromatismes de la
peinture, les poètes substituèrent ceux de la musique? Toutes ces approches, à leur tour,
suscitèrent l’inquiétude parmi les académiciens pour qui le symbolisme n’était
qu’un art décadent : «Jean Moréas, cependant, sourcilla au mot
“décadent”; il voyait, au contraire, les caractéristiques d’une renaissance
dans “l’abus de la pompe, l’étrangeté de la métaphore, un vocabulaire neuf où
les harmonies se combinent avec des couleurs et des lignes”. Et Gustave Kahn ne
fut pas long à déclarer sans équivoque : “Bien que toute étiquette soit vaine,
nous nous devons pour l’information exacte des attentifs, de rappeler que
décadent se prononce symboliste”».[53]
Refusé ou accepté, le qualificatif de décadent ne bouleversa pas davantage les
symbolistes.
sonorités; de là l’abus des “cordes” et des “cuivres”. En
outre, justement soucieux des rapports du son et de la pensée, ils ont eu le
tort - quelques-uns d’entre eux, du moins; je songe surtout à René Ghil - de
négliger les divergences individuelles pour la satisfaction de formuler des
lois, des principes, des recettes qui n’ont qu’une valeur de fantaisie. Erreurs
assez manifestes, qui ont enseigné la prudence à leurs successeurs. Il en est
de fait que le rêve de la “fusion des arts”, depuis quelque trente ans, ne
hante plus guère l’imagination de nos contemporains; d’ailleurs, c’est avec les
peintres plutôt qu’avec les musiciens que les représentants des jeunes écoles
ont fait alliance».[52]
Il ne faut pas oublier le fait que les poètes symbolistes furent grandement
influencés par la musique de Wagner, et celle de Verdi non plus ne devait pas
les laisser indifférents. Est-il donc normal, aussi, qu’aux chromatismes de la
peinture, les poètes substituèrent ceux de la musique? Toutes ces approches, à leur tour,
suscitèrent l’inquiétude parmi les académiciens pour qui le symbolisme n’était
qu’un art décadent : «Jean Moréas, cependant, sourcilla au mot
“décadent”; il voyait, au contraire, les caractéristiques d’une renaissance
dans “l’abus de la pompe, l’étrangeté de la métaphore, un vocabulaire neuf où
les harmonies se combinent avec des couleurs et des lignes”. Et Gustave Kahn ne
fut pas long à déclarer sans équivoque : “Bien que toute étiquette soit vaine,
nous nous devons pour l’information exacte des attentifs, de rappeler que
décadent se prononce symboliste”».[53]
Refusé ou accepté, le qualificatif de décadent ne bouleversa pas davantage les
symbolistes. avec héroïsme et arrogance, fiers d’être incompris.
Leur prédilection pour une syntaxe bizarre et anticonventionnelle, épicée de
mots précieux, archaïques et inusités (déterrés des profondeurs des
dictionnaires ou exhumés des textes du passé, s’ils n’étaient pas forgés par
les différents membres du groupe), prit de telles proportions que Paul Adam
sentit bientôt l’urgence de publier un Petit Glossaire pour servir à
l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Tandis que ces auteurs cultivaient consciemment un style qui les
coupait des masses, ils trouvaient, dans leur inaccessibilité même,
confirmation de leur originalité, partageant l’opinion de Wyzewa que “la valeur
esthétique d’une œuvre d’art est toujours en raison inverse du nombre des esprits
qui peuvent la comprendre”. Huysmans l’avait déjà dit dans À rebours : “Si le plus bel air du monde devient
vulgaire, insupportable, dès que le public le fredonne, dès que les orgues s’en
emparent, l’œuvre d’art qui ne demeure pas indifférente aux artistes, qui n’est
point contestée par les sots, qui ne se contente pas de susciter l’enthousiasme
avec héroïsme et arrogance, fiers d’être incompris.
Leur prédilection pour une syntaxe bizarre et anticonventionnelle, épicée de
mots précieux, archaïques et inusités (déterrés des profondeurs des
dictionnaires ou exhumés des textes du passé, s’ils n’étaient pas forgés par
les différents membres du groupe), prit de telles proportions que Paul Adam
sentit bientôt l’urgence de publier un Petit Glossaire pour servir à
l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes. Tandis que ces auteurs cultivaient consciemment un style qui les
coupait des masses, ils trouvaient, dans leur inaccessibilité même,
confirmation de leur originalité, partageant l’opinion de Wyzewa que “la valeur
esthétique d’une œuvre d’art est toujours en raison inverse du nombre des esprits
qui peuvent la comprendre”. Huysmans l’avait déjà dit dans À rebours : “Si le plus bel air du monde devient
vulgaire, insupportable, dès que le public le fredonne, dès que les orgues s’en
emparent, l’œuvre d’art qui ne demeure pas indifférente aux artistes, qui n’est
point contestée par les sots, qui ne se contente pas de susciter l’enthousiasme
 de quelques-uns devient, elle aussi, par cela même, pour les initiés, polluée,
banale, presque repoussante”».[54]
Cette volonté d’être des artistes d’élite produisant pour les élites
contribuait à fermer la tendance sur elle-même. Alors que le réalisme ouvrira
sur le naturalisme, puis la Neue
Sachlichkeit allemande, enfin le réalisme socialiste (et évitons d’aller
jusqu’à son antithèse, le réalisme fantastique), le symbolisme finira par
mourir sur lui-même et sa résurrection ne se produira qu’un siècle plus tard,
avec la floraison de l’esthétique du New
Age. Ce qu’on appelait le décadentisme
peut être pris pour une caricature du symbolisme, ce dont se gardait non seulement
Moréas, mais surtout Mallarmé. Dans une entrevue, le poète du coup de dés, exprimait ainsi ses
vues : «“Dans une société sans
stabilité, sans unité, il ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. De
cette organisation sociale inachevée, qui explique en même temps l’inquiétude
des esprits, naît l’inexpliqué besoin d’individualité dont les manifestations
littéraires présentes sont le reflet direct.” Mallarmé continuait en
définissant les intentions des poètes symbolistes avec des mots qu’Aurier aurait
pu employer pour parler de l’art de Gauguin : “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème
qui est fait du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage
de ce mystère qui constitue le symbolisme :
évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou inversement,
choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrement”».[55]
Outre qu’excellent poète, Mallarmé allait directement au but du projet
symboliste.
de quelques-uns devient, elle aussi, par cela même, pour les initiés, polluée,
banale, presque repoussante”».[54]
Cette volonté d’être des artistes d’élite produisant pour les élites
contribuait à fermer la tendance sur elle-même. Alors que le réalisme ouvrira
sur le naturalisme, puis la Neue
Sachlichkeit allemande, enfin le réalisme socialiste (et évitons d’aller
jusqu’à son antithèse, le réalisme fantastique), le symbolisme finira par
mourir sur lui-même et sa résurrection ne se produira qu’un siècle plus tard,
avec la floraison de l’esthétique du New
Age. Ce qu’on appelait le décadentisme
peut être pris pour une caricature du symbolisme, ce dont se gardait non seulement
Moréas, mais surtout Mallarmé. Dans une entrevue, le poète du coup de dés, exprimait ainsi ses
vues : «“Dans une société sans
stabilité, sans unité, il ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. De
cette organisation sociale inachevée, qui explique en même temps l’inquiétude
des esprits, naît l’inexpliqué besoin d’individualité dont les manifestations
littéraires présentes sont le reflet direct.” Mallarmé continuait en
définissant les intentions des poètes symbolistes avec des mots qu’Aurier aurait
pu employer pour parler de l’art de Gauguin : “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème
qui est fait du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage
de ce mystère qui constitue le symbolisme :
évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou inversement,
choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrement”».[55]
Outre qu’excellent poète, Mallarmé allait directement au but du projet
symboliste. en Angleterre, en
Espagne, il prit le meilleur en en tirant l’idée d’une fonction spéciale du
poète. Il connut Verlaine, Mallarmé, et Wilde; la rencontre d’HOFMANNSTHAL, en 1891, à Vienne, eut une grande importance
dans sa vie, et plus tard son ami viennois collaborera aux Cahiers pour l’art. De ce périodique naîtra autour de George
une école qui rend sa place à l’essai en Allemagne, et lutte contre la tendance
à l’érudition sans originalité, contre l’école historique aussi. Elle suscitera
de nombreux essayistes : Friedrich Gundolf, Ernst Bertram, Berthold Vallentin,
Max Kommerell, Robert Boehringer. Mais ce cercle qui se formait autour de
George vint à prendre un autre sens. Il se souda en une volonté d’aristocratie
de l’art et il fit naître en lui l’esprit de la bande, le goût de l’ésotérisme.
Un nietzschéisme de plus en plus hautain y domina, et le groupe d’amitié virile
- et aussi équivoque - qui entoura Stefan George, et lui donna, avant 1914, le
nom de führer, préfigure par certains
côtés d’autres groupes semblables qui se formeront après la guerre, et rallièrent
rapidement le nazisme. Chez George, et dans le “George-Ring”, le privilège
aristocratique conféré par la voyance poétique, tourna vite à l’orgueil
nietzschéen».[56]
On ne peut donc négliger une portée idéologique du symbolisme allemand sur le
nationalisme au début du XXe siècle, privilège que le cercle qui entourait
Mallarmé n’eut pas. En France, outre les décadents sulfureux, le symbolisme
s’abîma (ou ressuscita joyeusement) dans le théâtre d’Alfred Jarry. Il ne faut
pas sous-estimer l’influence que la poétique de Mallarmé eut sur Jarry : «Pour les symbolistes - et surtout Mallarmé,
le langage était doué de significations mystérieuses qui augmentaient avec le
nombre des directions différentes que chaque mot pouvait indiquer. Jarry
professait une théorie de l’expression poétique semblable et tout aussi hardie;
il prétendait que tous les sens que l’on peut trouver dans un texte sont
également légitimes. Il n’y a pas de sens véritable et unique qui écarterait
les autres comme erronés».[57]
Et la vérité dans tout cela? Elle
avait éclaté, comme il se devait, sous les forces centrifuges du mouvement. À
cela, Pirandello aurait répondu par sa pièce théâtrale : À chacun sa vérité. D’où, par
corollaire, l’inexistence de la réalité des réalistes. La perception finissait
par l’emporter sur l’observation.
en Angleterre, en
Espagne, il prit le meilleur en en tirant l’idée d’une fonction spéciale du
poète. Il connut Verlaine, Mallarmé, et Wilde; la rencontre d’HOFMANNSTHAL, en 1891, à Vienne, eut une grande importance
dans sa vie, et plus tard son ami viennois collaborera aux Cahiers pour l’art. De ce périodique naîtra autour de George
une école qui rend sa place à l’essai en Allemagne, et lutte contre la tendance
à l’érudition sans originalité, contre l’école historique aussi. Elle suscitera
de nombreux essayistes : Friedrich Gundolf, Ernst Bertram, Berthold Vallentin,
Max Kommerell, Robert Boehringer. Mais ce cercle qui se formait autour de
George vint à prendre un autre sens. Il se souda en une volonté d’aristocratie
de l’art et il fit naître en lui l’esprit de la bande, le goût de l’ésotérisme.
Un nietzschéisme de plus en plus hautain y domina, et le groupe d’amitié virile
- et aussi équivoque - qui entoura Stefan George, et lui donna, avant 1914, le
nom de führer, préfigure par certains
côtés d’autres groupes semblables qui se formeront après la guerre, et rallièrent
rapidement le nazisme. Chez George, et dans le “George-Ring”, le privilège
aristocratique conféré par la voyance poétique, tourna vite à l’orgueil
nietzschéen».[56]
On ne peut donc négliger une portée idéologique du symbolisme allemand sur le
nationalisme au début du XXe siècle, privilège que le cercle qui entourait
Mallarmé n’eut pas. En France, outre les décadents sulfureux, le symbolisme
s’abîma (ou ressuscita joyeusement) dans le théâtre d’Alfred Jarry. Il ne faut
pas sous-estimer l’influence que la poétique de Mallarmé eut sur Jarry : «Pour les symbolistes - et surtout Mallarmé,
le langage était doué de significations mystérieuses qui augmentaient avec le
nombre des directions différentes que chaque mot pouvait indiquer. Jarry
professait une théorie de l’expression poétique semblable et tout aussi hardie;
il prétendait que tous les sens que l’on peut trouver dans un texte sont
également légitimes. Il n’y a pas de sens véritable et unique qui écarterait
les autres comme erronés».[57]
Et la vérité dans tout cela? Elle
avait éclaté, comme il se devait, sous les forces centrifuges du mouvement. À
cela, Pirandello aurait répondu par sa pièce théâtrale : À chacun sa vérité. D’où, par
corollaire, l’inexistence de la réalité des réalistes. La perception finissait
par l’emporter sur l’observation.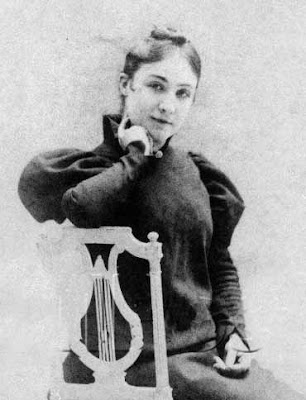 en scène un neurasthénique, Dartigny. Voici le commentaire
qu’en fait Dorothy Knowles : «Paul
Dartigny, âme très sensible, ayant tout essayé dans la vie, et dégoûté de tout,
aspire à l’anéantissement complet de son être. Cependant quelque chose en lui
se révolte contre cette solution, cherchant un au-delà païen où règne la
tranquillité et où la Mort, maîtresse absolue, sera son amante bien-aimée. Le
premier acte montre l’immense contraste entre le pessimisme désillusionné de
Dartigny et l’optimisme joyeux du bourgeois Jacques Durand. Durand et Lucile,
la maîtresse de Dartigny, pour servir leurs intérêts, essayent de le détourner
de ses idées de suicide mais l’abandonnent lorsque cet intérêt n’existe plus.
Après leur départ, celui-ci prend, dans la solitude de son fumoir, un cigare
empoisonné et se met tranquillement à fumer pour la dernière fois. Le décor du
deuxième acte représente un jardin, mais le véritable milieu est le cerveau du
héros. Là s’objectivent les deux idées qui l’obsèdent depuis longtemps, les
“moi” différents qui forment son être. Là, la vie, sous l’“apparence” de
Lucile, dispute avec la mort, une femme voilée, la possession de la victime. La
vie, par la bouche de Lucille, lui reproche de la quitter volontairement, pour
le retenir, essaie le pouvoir de tous ses charmes, évoquant leurs moments de
bonheur. La femme voilée, c’est l’attendue mais aussi l’inconnue, car
interrogée sur son être, elle répond “je ne sais pas”. Ces hallucinations
produites par le nérium
en scène un neurasthénique, Dartigny. Voici le commentaire
qu’en fait Dorothy Knowles : «Paul
Dartigny, âme très sensible, ayant tout essayé dans la vie, et dégoûté de tout,
aspire à l’anéantissement complet de son être. Cependant quelque chose en lui
se révolte contre cette solution, cherchant un au-delà païen où règne la
tranquillité et où la Mort, maîtresse absolue, sera son amante bien-aimée. Le
premier acte montre l’immense contraste entre le pessimisme désillusionné de
Dartigny et l’optimisme joyeux du bourgeois Jacques Durand. Durand et Lucile,
la maîtresse de Dartigny, pour servir leurs intérêts, essayent de le détourner
de ses idées de suicide mais l’abandonnent lorsque cet intérêt n’existe plus.
Après leur départ, celui-ci prend, dans la solitude de son fumoir, un cigare
empoisonné et se met tranquillement à fumer pour la dernière fois. Le décor du
deuxième acte représente un jardin, mais le véritable milieu est le cerveau du
héros. Là s’objectivent les deux idées qui l’obsèdent depuis longtemps, les
“moi” différents qui forment son être. Là, la vie, sous l’“apparence” de
Lucile, dispute avec la mort, une femme voilée, la possession de la victime. La
vie, par la bouche de Lucille, lui reproche de la quitter volontairement, pour
le retenir, essaie le pouvoir de tous ses charmes, évoquant leurs moments de
bonheur. La femme voilée, c’est l’attendue mais aussi l’inconnue, car
interrogée sur son être, elle répond “je ne sais pas”. Ces hallucinations
produites par le nérium 

 L’occultisme apparaît
ici sous la forme d’un double mouvement, celui de la kénose, la corporéité (masculine) du spirituel (féminin), et
l’évhémérisme, la spiritualisation (masculine) de la matière (féminine). Humain
et Dieu en même temps, le langage symboliste aurait pour but, par la
suggestivité, par l’équivalent, de
réconcilier finalement Dieu et le monde. Voilà surtout pourquoi l’image de la
femme est si importante dans l’Imaginaire symboliste. Elle est la médiatrice
des extrêmes. Selon la direction du mouvement, elle est l’une et/ou l’autre. Le
premier état correspond au discours uranien de l’âme (la psychée) féminine
revêtue d’un corps d’homme. Mais il peut être vu également comme la femme
morte, emportée par sa féminité ou son état de femme jusqu’à se noyer dans ses
propres eaux, enroulée par ses longs cheveux autour de algues et de la
végétation aquatique. Wilde et Rossetti réconciliés. Le second état serait l’équivalent
des figures cauchemardesques que l’on retrouvera dans les tableaux de Moreau et
de Redon. Le pouvoir de captation par le regard intense, le viol de la chair
par l’agressivité des passions, qu’elles soient masochistes ou tout simplement
sadiques, l’anarchie semée par des viragos qui agissent sous les ordres du
grand Satan de Félicien Rops, qui parcourt les villes, semant la haine,
L’occultisme apparaît
ici sous la forme d’un double mouvement, celui de la kénose, la corporéité (masculine) du spirituel (féminin), et
l’évhémérisme, la spiritualisation (masculine) de la matière (féminine). Humain
et Dieu en même temps, le langage symboliste aurait pour but, par la
suggestivité, par l’équivalent, de
réconcilier finalement Dieu et le monde. Voilà surtout pourquoi l’image de la
femme est si importante dans l’Imaginaire symboliste. Elle est la médiatrice
des extrêmes. Selon la direction du mouvement, elle est l’une et/ou l’autre. Le
premier état correspond au discours uranien de l’âme (la psychée) féminine
revêtue d’un corps d’homme. Mais il peut être vu également comme la femme
morte, emportée par sa féminité ou son état de femme jusqu’à se noyer dans ses
propres eaux, enroulée par ses longs cheveux autour de algues et de la
végétation aquatique. Wilde et Rossetti réconciliés. Le second état serait l’équivalent
des figures cauchemardesques que l’on retrouvera dans les tableaux de Moreau et
de Redon. Le pouvoir de captation par le regard intense, le viol de la chair
par l’agressivité des passions, qu’elles soient masochistes ou tout simplement
sadiques, l’anarchie semée par des viragos qui agissent sous les ordres du
grand Satan de Félicien Rops, qui parcourt les villes, semant la haine,  la
discorde et la guerre. Mais il peut être vu autrement, comme la maîtrise de
l’artisan qui façonne la matière dans le but de créer des objets ornementataux
parcourus de traits associés à la femme et devant servir à décorer les lieux
publics. Swinburne et Morris réconciliés à leur tour. Le discours occulte est
repris et transformé par le style symboliste. On y trouve là non pas une mais
plusieurs alternatives spirituelles potentielles à l’esprit en quête de
mystères et de symboles vivants. Il faut reconnaître toutefois que cette
démarche profite de deux adversités rendus incompatibles. D’un côté, il y a
l’échec du catholicisme nouveau qui «se
demande à quoi sert l’effort humain si la vie est soumise à des lois de fer
contre lesquelles on ne peut rien. L’intelligence peut se contenter de cette
négation, mais l’intelligence n’est pas tout; la science laisse l’âme
insatisfaite parce qu’elle donne au problème de la destinée une réponse
purement intellectuelle. Au-dessus des théories, il y a la vie, et la vie ne se
nourrit pas de documents décevants et de sèches analyses».[62]
En face, la génération de jeunes esprits assoiffés de spiritualisme : «réagissant contre le naturalisme et le
scientisme à la mode, pressentait en lui un maître de l’inconnaissable qui
enveloppe toujours la condition humaine».[63]
Entre les deux, «déjà la notion
d’initiation imprègne les esquisses de la mentalité symboliste».[64]
Les mystères n’étaient plus ceux que l’on croyait jusqu’alors. Et ni
l’abaissement de Dieu dans une vulgaire enveloppe charnelle, ni une élévation
sociale qui ferait des esclaves par nature, des maîtres par l’action politique
ne tiennent devant la vérité. Le
symbolisme dérivait ainsi du merveilleux pour s’acheminer vers le fantastique,
et c’est dans cette dérive qu’il passa par l’ouverture donnant sur l’occultisme
et l’ésotérisme.
la
discorde et la guerre. Mais il peut être vu autrement, comme la maîtrise de
l’artisan qui façonne la matière dans le but de créer des objets ornementataux
parcourus de traits associés à la femme et devant servir à décorer les lieux
publics. Swinburne et Morris réconciliés à leur tour. Le discours occulte est
repris et transformé par le style symboliste. On y trouve là non pas une mais
plusieurs alternatives spirituelles potentielles à l’esprit en quête de
mystères et de symboles vivants. Il faut reconnaître toutefois que cette
démarche profite de deux adversités rendus incompatibles. D’un côté, il y a
l’échec du catholicisme nouveau qui «se
demande à quoi sert l’effort humain si la vie est soumise à des lois de fer
contre lesquelles on ne peut rien. L’intelligence peut se contenter de cette
négation, mais l’intelligence n’est pas tout; la science laisse l’âme
insatisfaite parce qu’elle donne au problème de la destinée une réponse
purement intellectuelle. Au-dessus des théories, il y a la vie, et la vie ne se
nourrit pas de documents décevants et de sèches analyses».[62]
En face, la génération de jeunes esprits assoiffés de spiritualisme : «réagissant contre le naturalisme et le
scientisme à la mode, pressentait en lui un maître de l’inconnaissable qui
enveloppe toujours la condition humaine».[63]
Entre les deux, «déjà la notion
d’initiation imprègne les esquisses de la mentalité symboliste».[64]
Les mystères n’étaient plus ceux que l’on croyait jusqu’alors. Et ni
l’abaissement de Dieu dans une vulgaire enveloppe charnelle, ni une élévation
sociale qui ferait des esclaves par nature, des maîtres par l’action politique
ne tiennent devant la vérité. Le
symbolisme dérivait ainsi du merveilleux pour s’acheminer vers le fantastique,
et c’est dans cette dérive qu’il passa par l’ouverture donnant sur l’occultisme
et l’ésotérisme. positiviste : l’accent porte de moins en moins sur les fantômes proprement
dits, de plus en plus sur la hantise psychique des héros, par exemple dans The
Turn of the Screw de Henry James (1898)
et Dracula».[65] Même apolitique, le
symbolisme devenait un milieu où les idées politiques de droites s’associaient
volontiers à l’attrait pour l’ésotérisme : «Le symbolisme développe des formes plus nettes d’apolitisme, par
l’individualisme artistique et le culte exclusif de la beauté. De là, les
expériences d’écriture les plus audacieuses : instrumentisme de René Ghil,
théâtre du silence chez Maeterlinck (La Princesse Maleine, 1890), hermétisme médiéval de César-Antéchrist (1895) de Jarry. Et encore, de remarquables
excentricités : culte du revolver chez Jarry, satanisme de Guaita et de
Huysman, ésotérisme de Péladan… Auteur d’Istar et de la série intitulée La Décadence latine, Joséphin Péladan, dit “le Sâr Péladan”,
positiviste : l’accent porte de moins en moins sur les fantômes proprement
dits, de plus en plus sur la hantise psychique des héros, par exemple dans The
Turn of the Screw de Henry James (1898)
et Dracula».[65] Même apolitique, le
symbolisme devenait un milieu où les idées politiques de droites s’associaient
volontiers à l’attrait pour l’ésotérisme : «Le symbolisme développe des formes plus nettes d’apolitisme, par
l’individualisme artistique et le culte exclusif de la beauté. De là, les
expériences d’écriture les plus audacieuses : instrumentisme de René Ghil,
théâtre du silence chez Maeterlinck (La Princesse Maleine, 1890), hermétisme médiéval de César-Antéchrist (1895) de Jarry. Et encore, de remarquables
excentricités : culte du revolver chez Jarry, satanisme de Guaita et de
Huysman, ésotérisme de Péladan… Auteur d’Istar et de la série intitulée La Décadence latine, Joséphin Péladan, dit “le Sâr Péladan”,  crée avec Guaita l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix, qu’il refonde en Ordre de la Rose-Croix
catholique et esthétique du Temple et du Graal en 1891. Il s’attire de cruels
sobriquets: on l’appelle tour à tour “le Sâr Pédalant” ou bien “Artaxerfesse”.
Malgré cela, ce “Mage d’Épinal” joue un rôle important dans la constitution du
symbolisme et dans le culte fin de siècle de la beauté musicale, poétique et
picturale. La cérémonie d’ouverture du Salon de la Rose-Croix, chez le grand
collectionneur Durand-Ruel, obtient un grand succès, en attirant soixante
artistes et vingt mille Parisiens. Naturellement, Péladan déteste Zola, qu’il
qualifie de pourceau».[66]
Qu’importe la naïveté des symbolistes, les mages savaient qui, dans la société,
était prêt à les nourrir, ce qui n’égara pas un esprit critique comme celui de l’anarcho-syndicaliste
Fernand Pelloutier, animateur des Bourses du Travail, qui dénonçait dans ses
conférences le stade ultime d’abaissement idéologique et politique où conduisait
cette fascination pour l’occulte : ainsi, «en 1896, c’est
crée avec Guaita l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix, qu’il refonde en Ordre de la Rose-Croix
catholique et esthétique du Temple et du Graal en 1891. Il s’attire de cruels
sobriquets: on l’appelle tour à tour “le Sâr Pédalant” ou bien “Artaxerfesse”.
Malgré cela, ce “Mage d’Épinal” joue un rôle important dans la constitution du
symbolisme et dans le culte fin de siècle de la beauté musicale, poétique et
picturale. La cérémonie d’ouverture du Salon de la Rose-Croix, chez le grand
collectionneur Durand-Ruel, obtient un grand succès, en attirant soixante
artistes et vingt mille Parisiens. Naturellement, Péladan déteste Zola, qu’il
qualifie de pourceau».[66]
Qu’importe la naïveté des symbolistes, les mages savaient qui, dans la société,
était prêt à les nourrir, ce qui n’égara pas un esprit critique comme celui de l’anarcho-syndicaliste
Fernand Pelloutier, animateur des Bourses du Travail, qui dénonçait dans ses
conférences le stade ultime d’abaissement idéologique et politique où conduisait
cette fascination pour l’occulte : ainsi, «en 1896, c’est  incontestablement au symbolisme que Pelloutier en a. Les
symbolistes ont été pour la plupart, en cette fin de siècle, influencés par
diverses formes d’ésotérisme, dont le poète ésotérique Jules Bois - cité par
Pelloutier - a fait l’inventaire dans son livre le Satanisme et la Magie (1895). On sait d’autre part l’existence
vers 1888 d’un groupe d’ésotéristes groupés autour de Stanislas de Guaïta, ami
de Barrès, Augustin Chaboseau, auteur d’un Essai sur la philosophie
bouddhique, Papus et Joséphin Péladan, le
“sar”, qui constituera bientôt une Rose-Croix catholique dissidente avec Élémir
Bourges, après la mise à l’Index de la Rose-Croix. D’autre part, une nouvelle
forme d’exotisme, la théosophie, s’inspirant des théogonies extrême-orientales
et du culte d’Isis se répand en France, sous l’influence de Mme Blavatsky à
partir de 1880. En témoignent la fondation de la loge Isis en 1887 et la
création de la revue le Lotus rouge. Rappelons aussi l’Isis de Villiers de l’Isle-Adam en 1862. Enfin,
l’érotisme ésotérique est à la mode; les messes noires évoquées par Pelloutier,
ce sont par exemple celles du fameux abbé Boulian, disciple de Vintras et
organisateur à Lyon d’un “culte marial” d’un genre spécial. Huysmans le prit au
sérieux, et le mit en scène dans Là-bas».[67]
Comment, dans l’urgence des crises sociales, ne pas se révolter de voir les
esthètes se régaler de cette nourriture indigeste pour l’esprit mais si
suggestible pour exciter les sens et affiner la sensibilité?
incontestablement au symbolisme que Pelloutier en a. Les
symbolistes ont été pour la plupart, en cette fin de siècle, influencés par
diverses formes d’ésotérisme, dont le poète ésotérique Jules Bois - cité par
Pelloutier - a fait l’inventaire dans son livre le Satanisme et la Magie (1895). On sait d’autre part l’existence
vers 1888 d’un groupe d’ésotéristes groupés autour de Stanislas de Guaïta, ami
de Barrès, Augustin Chaboseau, auteur d’un Essai sur la philosophie
bouddhique, Papus et Joséphin Péladan, le
“sar”, qui constituera bientôt une Rose-Croix catholique dissidente avec Élémir
Bourges, après la mise à l’Index de la Rose-Croix. D’autre part, une nouvelle
forme d’exotisme, la théosophie, s’inspirant des théogonies extrême-orientales
et du culte d’Isis se répand en France, sous l’influence de Mme Blavatsky à
partir de 1880. En témoignent la fondation de la loge Isis en 1887 et la
création de la revue le Lotus rouge. Rappelons aussi l’Isis de Villiers de l’Isle-Adam en 1862. Enfin,
l’érotisme ésotérique est à la mode; les messes noires évoquées par Pelloutier,
ce sont par exemple celles du fameux abbé Boulian, disciple de Vintras et
organisateur à Lyon d’un “culte marial” d’un genre spécial. Huysmans le prit au
sérieux, et le mit en scène dans Là-bas».[67]
Comment, dans l’urgence des crises sociales, ne pas se révolter de voir les
esthètes se régaler de cette nourriture indigeste pour l’esprit mais si
suggestible pour exciter les sens et affiner la sensibilité?

 seulement d’œuvres qui,
comme celles de Mallarmé et de Rimbaud, échappent à la classification - mais de
la poésie symboliste dans son ensemble, fût-ce dans ses expressions mineures :
“pureté”, “tenue” culte de la “noblesse d’expression”, c’est tout cela, se
rappelle Breton, qui le “dignifiait” à ses yeux. Et il cite Paul Fort, René
Ghil, Saint-Pol Roux, Jean Royère (directeur de La Phalange, qui publie ses premiers vers). Francis
Vielé-Griffin, Pierre Louÿs, Huysmans (qu’il ne sépare pas des poètes). Le
peintre qui correspond à cette beauté symboliste, et qui a été la première
admiration de Breton dans l’ordre plastique, c’est Gustave Moreau…».[68]
Les œuvres de Moreau sont, en effet, imbues d’étrangetés inquiétantes. Certaines
de ses compositions rappellent l’art de Monsu Desiderio du XVIIe siècle.
D’autres s’inscriraient dans la veine des préraphaélites. Son Jupiter et Sémélé est entièrement dominé
par le regard ahuri du dieu. C’est ce qui permet au critique Jean Paris d’écrire :
«On peut parler ainsi, chez Gustave
Moreau, d’un regard dévorant. D’un regard dont, étrangement, la spiritualité
s’exprime par
seulement d’œuvres qui,
comme celles de Mallarmé et de Rimbaud, échappent à la classification - mais de
la poésie symboliste dans son ensemble, fût-ce dans ses expressions mineures :
“pureté”, “tenue” culte de la “noblesse d’expression”, c’est tout cela, se
rappelle Breton, qui le “dignifiait” à ses yeux. Et il cite Paul Fort, René
Ghil, Saint-Pol Roux, Jean Royère (directeur de La Phalange, qui publie ses premiers vers). Francis
Vielé-Griffin, Pierre Louÿs, Huysmans (qu’il ne sépare pas des poètes). Le
peintre qui correspond à cette beauté symboliste, et qui a été la première
admiration de Breton dans l’ordre plastique, c’est Gustave Moreau…».[68]
Les œuvres de Moreau sont, en effet, imbues d’étrangetés inquiétantes. Certaines
de ses compositions rappellent l’art de Monsu Desiderio du XVIIe siècle.
D’autres s’inscriraient dans la veine des préraphaélites. Son Jupiter et Sémélé est entièrement dominé
par le regard ahuri du dieu. C’est ce qui permet au critique Jean Paris d’écrire :
«On peut parler ainsi, chez Gustave
Moreau, d’un regard dévorant. D’un regard dont, étrangement, la spiritualité
s’exprime par  l’instinct animal de la manducation. Dans une époque où
l’artiste, aliéné, tiendra bientôt le symbole pour une possession, c’est par
l’œil que ce métaphysicien a choisi de conquérir sa plus haute réalité. La
vision sera moins pour lui un substitut d’appropriation qu’une vraie
déglutition du monde, à la façon de ces bêtes qui sur leurs proies lancent
tentacules ou filets, pour s’en repaître en un éclair. Car l’œil mange. Il y
avait jadis en Italie, écrit Gaston Bachelard citant le Dictionnaire
infernal de Collin de Plancy, “des
sorcières qui, d’un seul regard, mangeaient le
cœur des hommes et le dedans des concombres”. Et Merleau-Ponty : “Ce
n’est pas un hasard si souvent, dans la peinture hollandaise, et dans beaucoup
d’autres, un intérieur désert est “digéré” par l’œil rond du miroir. Ce regard
préhumain est l’emblème de celui du peintre.” C’est pourquoi il sera chargé d’accomplir
dans l’imaginaire un acte interdit dans la réalité. De la Sphynge ou de l’Hydre
gorgées de sang humain à la Vierge repue de martyrs, du Cyclope “mangeant des
yeux” sa Galatée à Diomède dévoré par ses chevaux, la peinture de Moreau,
malgré son statisme, est le lieu d’une constante anthropophagie. Tous les
mécanismes fascinateurs qu’elle met en jeu de plus en plus subtils, compliqués,
efficaces, n’ont d’autre fin que cette prédation, cette dévoration fulgurante
des apparences…».[69]
L’œil sera également un
l’instinct animal de la manducation. Dans une époque où
l’artiste, aliéné, tiendra bientôt le symbole pour une possession, c’est par
l’œil que ce métaphysicien a choisi de conquérir sa plus haute réalité. La
vision sera moins pour lui un substitut d’appropriation qu’une vraie
déglutition du monde, à la façon de ces bêtes qui sur leurs proies lancent
tentacules ou filets, pour s’en repaître en un éclair. Car l’œil mange. Il y
avait jadis en Italie, écrit Gaston Bachelard citant le Dictionnaire
infernal de Collin de Plancy, “des
sorcières qui, d’un seul regard, mangeaient le
cœur des hommes et le dedans des concombres”. Et Merleau-Ponty : “Ce
n’est pas un hasard si souvent, dans la peinture hollandaise, et dans beaucoup
d’autres, un intérieur désert est “digéré” par l’œil rond du miroir. Ce regard
préhumain est l’emblème de celui du peintre.” C’est pourquoi il sera chargé d’accomplir
dans l’imaginaire un acte interdit dans la réalité. De la Sphynge ou de l’Hydre
gorgées de sang humain à la Vierge repue de martyrs, du Cyclope “mangeant des
yeux” sa Galatée à Diomède dévoré par ses chevaux, la peinture de Moreau,
malgré son statisme, est le lieu d’une constante anthropophagie. Tous les
mécanismes fascinateurs qu’elle met en jeu de plus en plus subtils, compliqués,
efficaces, n’ont d’autre fin que cette prédation, cette dévoration fulgurante
des apparences…».[69]
L’œil sera également un  élément-clef dans l’œuvre d’Odilon Redon. Qui ne fut
pas touché par cette tête décollée suspendue dans le vide dans L’Apparition (1875), saint Jean-Baptiste
apparaissant à Salomé au moment où s’achève la danse sacrificielle. L’obsession
de la castration domine l’œuvre de Moreau, telle cette Jeune fille thrace portant la tête d’Orphée : «Épreuve de vérité. Écho de l’expérience
anxiogène du célibataire. Où le complexe d’Œdipe entre en résonance avec le
complexe de castration. Plasticité de la libido. Est-ce par hasard que le
visage de la jeune femme rappelle les traits du portrait de la mère du peintre?
Tel que nous le donne une vieille photographie. Et qu’il rappelle aussi, note
Ernest Chesneau, “la Salomé des livres saints qui contemplait, elle aussi, mais
de quel regard, la tête coupée de saint Jean-Baptiste”».[70]
Prométhée et son aigle, saint Sébastien et ses flèches, la Sphynge et Œdipe sur
fond d’atmosphère aqueuse, des femmes alanguies dont on ne sait si elles sont
vivantes ou mortes, des prétendants de Pénélope, enfin la débauche juchée sur
un piédestal, venant de déboulonner un saint de la tradition
élément-clef dans l’œuvre d’Odilon Redon. Qui ne fut
pas touché par cette tête décollée suspendue dans le vide dans L’Apparition (1875), saint Jean-Baptiste
apparaissant à Salomé au moment où s’achève la danse sacrificielle. L’obsession
de la castration domine l’œuvre de Moreau, telle cette Jeune fille thrace portant la tête d’Orphée : «Épreuve de vérité. Écho de l’expérience
anxiogène du célibataire. Où le complexe d’Œdipe entre en résonance avec le
complexe de castration. Plasticité de la libido. Est-ce par hasard que le
visage de la jeune femme rappelle les traits du portrait de la mère du peintre?
Tel que nous le donne une vieille photographie. Et qu’il rappelle aussi, note
Ernest Chesneau, “la Salomé des livres saints qui contemplait, elle aussi, mais
de quel regard, la tête coupée de saint Jean-Baptiste”».[70]
Prométhée et son aigle, saint Sébastien et ses flèches, la Sphynge et Œdipe sur
fond d’atmosphère aqueuse, des femmes alanguies dont on ne sait si elles sont
vivantes ou mortes, des prétendants de Pénélope, enfin la débauche juchée sur
un piédestal, venant de déboulonner un saint de la tradition 
 extraordinaire, unique. C’est un mystérieux enfermé en
plein Paris, dans une cellule où ne pénètre même plus le bruit de la vie
contemporaine qui bat furieusement pourtant les portes du cloître. Abîmé dans
l’extase, il voit resplendir les féeriques visions, les sanglantes apothéoses
des autres âges” (J.-K. Huysmans). Cet artiste est un visionnaire hanté par le
secret des vieilles théogonies, le symbolisme des races primitives. Sa peinture
grandiose et marmoréenne possède une saveur bizarre. Elle est comme “un
enchantement singulier, une incantation vous remuant jusqu’au fond des
entrailles, comme celle de certains poèmes de Baudelaire…” (ibid.) Œuvres
déconcertantes où se trouvent confrontés sur une même surface esprit et
matière, sans aucune communion possible. Étranges figures isolées, silencieuses
et superbes, qui ne prennent aucune part apparente au drame qui les entoure,
foudroyées dans une immobilité contemplative, une indifférente mollesse. Oui,
les personnages de Gustave Moreau ont quelque chose “de beaux animaux à
tristesse végétale”. Ses Salomés, “avec leur charme de grandes fleurs passives
et vénériennes, poussées dans des siècles sacrilèges et jusqu’à nous épanouies
par l’occulte pouvoir des damnables souvenirs” (J. Lorrain), sont terriblement
inquiétantes».[72]
En 1889, c’est à la manière de
Gustave Moreau que le publiciste, auteur de La
France juive, Édouard Drumont, décrivait, «autour du lit de pourpre et de fumier où se meurt cette société en
décomposition, le Peuple attend».[73]
C’était l’époque de la crise boulangiste et, comme tant d’autres, il attendait
le coup mortel qui serait porté à la République, coup qui ne vint pas.
extraordinaire, unique. C’est un mystérieux enfermé en
plein Paris, dans une cellule où ne pénètre même plus le bruit de la vie
contemporaine qui bat furieusement pourtant les portes du cloître. Abîmé dans
l’extase, il voit resplendir les féeriques visions, les sanglantes apothéoses
des autres âges” (J.-K. Huysmans). Cet artiste est un visionnaire hanté par le
secret des vieilles théogonies, le symbolisme des races primitives. Sa peinture
grandiose et marmoréenne possède une saveur bizarre. Elle est comme “un
enchantement singulier, une incantation vous remuant jusqu’au fond des
entrailles, comme celle de certains poèmes de Baudelaire…” (ibid.) Œuvres
déconcertantes où se trouvent confrontés sur une même surface esprit et
matière, sans aucune communion possible. Étranges figures isolées, silencieuses
et superbes, qui ne prennent aucune part apparente au drame qui les entoure,
foudroyées dans une immobilité contemplative, une indifférente mollesse. Oui,
les personnages de Gustave Moreau ont quelque chose “de beaux animaux à
tristesse végétale”. Ses Salomés, “avec leur charme de grandes fleurs passives
et vénériennes, poussées dans des siècles sacrilèges et jusqu’à nous épanouies
par l’occulte pouvoir des damnables souvenirs” (J. Lorrain), sont terriblement
inquiétantes».[72]
En 1889, c’est à la manière de
Gustave Moreau que le publiciste, auteur de La
France juive, Édouard Drumont, décrivait, «autour du lit de pourpre et de fumier où se meurt cette société en
décomposition, le Peuple attend».[73]
C’était l’époque de la crise boulangiste et, comme tant d’autres, il attendait
le coup mortel qui serait porté à la République, coup qui ne vint pas. Le second maître de
la peinture symboliste fut Odilon Redon (1840-1916), pas moins dérangeant que
Moreau. Nous naviguons toujours dans l’âme féminine trouble des formes
ondulées : coiffures, végétaux, reflets des pierres précieuses et l’onde -
très différent de ceux des impressionnistes -, sur lequel va apparaître
bientôt, porté par le courant, le cadavre d’Ophélie, morte noyée. Là encore, le
ballon en forme de globe oculaire qui s’apprête à se poser à la surface du lac;
ces femmes fantomatiques issues de l’une de ces séances spirites tenues à
Jersey chez l’exilé Hugo ou à Paris devant les savants rassemblés par
Flammarion et Janet, parce qu’ils sont dessinés au fusain, angoissent davantage
le spectateur. La thèse esthétique de Redon est simple : «Tout en reconnaissant comme base la
nécessité de la réalité vue […] l’art
véritable est dans la réalité sentie».[74]
Comme Gustave Moreau, «sur un plan
esthétique, la démarche de Redon équivaut à une initiation, une descente dans
l’Inferno du corps, de l’inconscient.
Et ainsi va naître, écrit John Rewald, “cet univers bizarre de créatures
improbables, investies d’une vie à elles, respirant en dépit de leurs
grotesques anomalies selon des lois secrètes qu’aucun Darwin ne pouvait
découvrir”. Bestiaire de la nuit où tout s’anime d’une fièvre diffuse,
élémentaire, où toute apparition en appellent d’autres suivant d’obscures
mutations, comme au sein d’un rêve interminable, qui doit peu, en fin de
compte, au laborieux fantastique…».[75]
Pour
Le second maître de
la peinture symboliste fut Odilon Redon (1840-1916), pas moins dérangeant que
Moreau. Nous naviguons toujours dans l’âme féminine trouble des formes
ondulées : coiffures, végétaux, reflets des pierres précieuses et l’onde -
très différent de ceux des impressionnistes -, sur lequel va apparaître
bientôt, porté par le courant, le cadavre d’Ophélie, morte noyée. Là encore, le
ballon en forme de globe oculaire qui s’apprête à se poser à la surface du lac;
ces femmes fantomatiques issues de l’une de ces séances spirites tenues à
Jersey chez l’exilé Hugo ou à Paris devant les savants rassemblés par
Flammarion et Janet, parce qu’ils sont dessinés au fusain, angoissent davantage
le spectateur. La thèse esthétique de Redon est simple : «Tout en reconnaissant comme base la
nécessité de la réalité vue […] l’art
véritable est dans la réalité sentie».[74]
Comme Gustave Moreau, «sur un plan
esthétique, la démarche de Redon équivaut à une initiation, une descente dans
l’Inferno du corps, de l’inconscient.
Et ainsi va naître, écrit John Rewald, “cet univers bizarre de créatures
improbables, investies d’une vie à elles, respirant en dépit de leurs
grotesques anomalies selon des lois secrètes qu’aucun Darwin ne pouvait
découvrir”. Bestiaire de la nuit où tout s’anime d’une fièvre diffuse,
élémentaire, où toute apparition en appellent d’autres suivant d’obscures
mutations, comme au sein d’un rêve interminable, qui doit peu, en fin de
compte, au laborieux fantastique…».[75]
Pour  Redon, le symbolisme est un jeu assez simple de l’Imaginaire : «Qu’ai-je mis en mes ouvrages pour leur
suggérer tant de subtilités? J’y ai mis une petite porte ouverte sur le
mystère. J’ai fait des fictions. C’est à eux d’aller plus loin».[76]
Eux, c’est-à-dire aux spectateurs. Ses fusains et ses toiles, moins chargés que
celles de Moreau, apparaissent pour certains, comme de vrais figures sorties de
l’inconscient. Comme en parlait le critique Aurier en 1891 : «Odilon Redon, dont les lithographies sont
des cauchemars. Le doigt de [cet] artiste semble déchirer, autour de nous, le
voile de tous les mystères… et sa bouche semble nous crier que le résultat de
toute science humaine, de toute pensée est un frisson de peur dans l’infini de
la nuit».[77] Redon semble s’amuser de
ces frayeurs, un peu comme son modèle littéraire Edgar Poe. Ainsi, lorsqu’il
affirme que «le sens du mystère, c’est
d’être tout le temps dans l’équivoque, dans les double, triple aspects, des
soupçons d’aspect (images dans images), formes qui vont être, ou qui le seront
selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que suggestives,
puisqu’elles apparaissent».[78]
N’est-ce pas là une évocation au poème de Poe, du rêve dans le rêve? Voilà sans doute pourquoi «Redon fut incompris jusqu’à la fin du siècle car il peignait des objets
et des êtres qui n’existaient pas dans le monde mais seulement dans sa vision
subjective»,[79] seulement dans des
cauchemars qui surgissent dans des rêves. Cette subjectivité donnait le
symbolisme à son meilleur et le paradoxe réside dans le fait que ce sont les
écrivains symbolistes qui le comprirent le moins.
Redon, le symbolisme est un jeu assez simple de l’Imaginaire : «Qu’ai-je mis en mes ouvrages pour leur
suggérer tant de subtilités? J’y ai mis une petite porte ouverte sur le
mystère. J’ai fait des fictions. C’est à eux d’aller plus loin».[76]
Eux, c’est-à-dire aux spectateurs. Ses fusains et ses toiles, moins chargés que
celles de Moreau, apparaissent pour certains, comme de vrais figures sorties de
l’inconscient. Comme en parlait le critique Aurier en 1891 : «Odilon Redon, dont les lithographies sont
des cauchemars. Le doigt de [cet] artiste semble déchirer, autour de nous, le
voile de tous les mystères… et sa bouche semble nous crier que le résultat de
toute science humaine, de toute pensée est un frisson de peur dans l’infini de
la nuit».[77] Redon semble s’amuser de
ces frayeurs, un peu comme son modèle littéraire Edgar Poe. Ainsi, lorsqu’il
affirme que «le sens du mystère, c’est
d’être tout le temps dans l’équivoque, dans les double, triple aspects, des
soupçons d’aspect (images dans images), formes qui vont être, ou qui le seront
selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que suggestives,
puisqu’elles apparaissent».[78]
N’est-ce pas là une évocation au poème de Poe, du rêve dans le rêve? Voilà sans doute pourquoi «Redon fut incompris jusqu’à la fin du siècle car il peignait des objets
et des êtres qui n’existaient pas dans le monde mais seulement dans sa vision
subjective»,[79] seulement dans des
cauchemars qui surgissent dans des rêves. Cette subjectivité donnait le
symbolisme à son meilleur et le paradoxe réside dans le fait que ce sont les
écrivains symbolistes qui le comprirent le moins. «Bien
que quelques-uns des écrivains symbolistes fussent imperméables à l’art de
Redon, la plupart d’entre eux furent attirés par son ésotérisme, sa profonde
originalité, son mysticisme délicat et son inquiétante imagination».[80]
Huysmans n’était pas hostile à Redon. Mais Redon lui apparaissait comme la fin
d’une tradition qui avait dominé au XIXe siècle : «“Si nous exceptons Goya et Gustave Moreau, dont Redon est, en somme,
dans ses parties saines, un bien lointain élève, écrivait Huysmans, nous ne lui
trouverons d’ancêtres que parmi des musiciens peut-être et certainement parmi
des poètes.” Parlant de “parties saines”, le romancier insinuait qu’il y en
avait de malsaines (ce côté maladif auquel Wyzewa était si sensible). Huysmans
devait dire dans À rebours que les
dessins de Redon étaient “en dehors de tout, ils sautaient pour la plupart
par-dessus les bornes de la peinture, ils innovaient un fantastique très
spécial de maladie et de délire”. Il est
«Bien
que quelques-uns des écrivains symbolistes fussent imperméables à l’art de
Redon, la plupart d’entre eux furent attirés par son ésotérisme, sa profonde
originalité, son mysticisme délicat et son inquiétante imagination».[80]
Huysmans n’était pas hostile à Redon. Mais Redon lui apparaissait comme la fin
d’une tradition qui avait dominé au XIXe siècle : «“Si nous exceptons Goya et Gustave Moreau, dont Redon est, en somme,
dans ses parties saines, un bien lointain élève, écrivait Huysmans, nous ne lui
trouverons d’ancêtres que parmi des musiciens peut-être et certainement parmi
des poètes.” Parlant de “parties saines”, le romancier insinuait qu’il y en
avait de malsaines (ce côté maladif auquel Wyzewa était si sensible). Huysmans
devait dire dans À rebours que les
dessins de Redon étaient “en dehors de tout, ils sautaient pour la plupart
par-dessus les bornes de la peinture, ils innovaient un fantastique très
spécial de maladie et de délire”. Il est  possible que ce soit ce qui ait attiré
les poètes symbolistes : en effet, Redon se trouva bientôt l’objet d’une sorte
de louange intéressée qui était soulevée moins par la compréhension de son
œuvre que par l’approbation de ses tendances».[81]
Ce sont les fusains de Redon qui livrent cet aspect malsain qu’y reconnaît Huysmans : «Le noir de Redon est un noir total que rien ne prostitue, un noir sourd
qui n’éveille aucune sensualité : “Il est agent de l’esprit bien plus que la
belle couleur de la palette ou du prisme.” L’austérité de ses fusains appartient
au silence des ténèbres. J’apprécie surtout le fantastique singulier de ses
dessins. Que se soit à travers l’expression de l’épouvantable araignée “logeant
au milieu de son corps une face humaine” (J.-K. Huysmans) ou celle des yeux
fous “jaillissant des visages humains, déformés, comme dans des verres de
bouteille, par le cauchemar” (ibid.), cet artiste demeure pour moi “le Prince
des mystérieux rêves, le Paysagiste des eaux souterraines et des déserts
bouleversés de lave (…) Le subtil Lithographe de la Douleur, le Nécroman du crayon, égaré pour le plaisir de quelques aristocrates de l’art,
dans le milieu démocratique du Paris moderne” (ibid.)».[82]
Le Prince du rêve, son Cyclope, son Christ, ses arachnoïdes grimaçantes, enfin la mort masquée qui
sonne le glas, sont de ces noirs sourds
qui n’éveillent aucune sensualité. Rien que l’angoisse des ténèbres.
possible que ce soit ce qui ait attiré
les poètes symbolistes : en effet, Redon se trouva bientôt l’objet d’une sorte
de louange intéressée qui était soulevée moins par la compréhension de son
œuvre que par l’approbation de ses tendances».[81]
Ce sont les fusains de Redon qui livrent cet aspect malsain qu’y reconnaît Huysmans : «Le noir de Redon est un noir total que rien ne prostitue, un noir sourd
qui n’éveille aucune sensualité : “Il est agent de l’esprit bien plus que la
belle couleur de la palette ou du prisme.” L’austérité de ses fusains appartient
au silence des ténèbres. J’apprécie surtout le fantastique singulier de ses
dessins. Que se soit à travers l’expression de l’épouvantable araignée “logeant
au milieu de son corps une face humaine” (J.-K. Huysmans) ou celle des yeux
fous “jaillissant des visages humains, déformés, comme dans des verres de
bouteille, par le cauchemar” (ibid.), cet artiste demeure pour moi “le Prince
des mystérieux rêves, le Paysagiste des eaux souterraines et des déserts
bouleversés de lave (…) Le subtil Lithographe de la Douleur, le Nécroman du crayon, égaré pour le plaisir de quelques aristocrates de l’art,
dans le milieu démocratique du Paris moderne” (ibid.)».[82]
Le Prince du rêve, son Cyclope, son Christ, ses arachnoïdes grimaçantes, enfin la mort masquée qui
sonne le glas, sont de ces noirs sourds
qui n’éveillent aucune sensualité. Rien que l’angoisse des ténèbres. 

 lamas et ses fleurs volantes. Art féminin
hanté ici aussi par la castration, la dévoration par la femme cannibale, lignes
ondulées des airs et des eaux, fleurs mélancoliques morbides, l’œuvre de Redon
appartient à la même pensée que celle de Gustave Moreau : «Redon affirma toujours que son imagination
prenait racine dans l’observation de la nature, que ses dessins étaient
“vrais”, que les êtres fantastiques qu’il créait, les visions démoniaques qu’il
fixait en blanc et noir, appartenaient à un monde qui n’était jamais absolument
détaché de la réalité. Selon ses propres mots : “Toute mon originalité consiste
à faire vivre humainement des êtres invraisemblables selon les lois du
vraisemblable, en mettant, autant que possible, la logique du visible au
service de l’invisible.” Il put y réussir parce que les fantômes qui hantaient
ses rêves n’étaient pas de pures inventions comme celles de Moreau, ni des
images soigneusement polies comme celles de Puvis; c’étaient des êtres ou des
formes qu’il avait vus et qu’il faisait revivre dans un langage purement
lamas et ses fleurs volantes. Art féminin
hanté ici aussi par la castration, la dévoration par la femme cannibale, lignes
ondulées des airs et des eaux, fleurs mélancoliques morbides, l’œuvre de Redon
appartient à la même pensée que celle de Gustave Moreau : «Redon affirma toujours que son imagination
prenait racine dans l’observation de la nature, que ses dessins étaient
“vrais”, que les êtres fantastiques qu’il créait, les visions démoniaques qu’il
fixait en blanc et noir, appartenaient à un monde qui n’était jamais absolument
détaché de la réalité. Selon ses propres mots : “Toute mon originalité consiste
à faire vivre humainement des êtres invraisemblables selon les lois du
vraisemblable, en mettant, autant que possible, la logique du visible au
service de l’invisible.” Il put y réussir parce que les fantômes qui hantaient
ses rêves n’étaient pas de pures inventions comme celles de Moreau, ni des
images soigneusement polies comme celles de Puvis; c’étaient des êtres ou des
formes qu’il avait vus et qu’il faisait revivre dans un langage purement
 pictural. Il exécuta même des séries de lithographies et de dessins inspirés
par Poe et Flaubert, parvenant à des effets mystérieux par les lignes, les
contrastes et la composition, sans emprunter trop de symboles à la littérature.
Pour lui, la poésie n’était pas seulement un jeu de lignes, un assemblage de
couleurs; la poésie était partie inhérente de son imagination et de sa vision.
Il n’avait pas besoin de rechercher l’équivalent plastique de ses émotions
parce que ses œuvres n’étaient pas une traduction d’idées d’un moyen
d’expression dans un autre. Redon vivait dans un monde de rêves beaux et
inquiétants, inséparables de la réalité; ces rêves étant réels pour lui, il ne
prenait pas la peine de découvrir leur signification. Ce qu’il désirait,
c’était les exprimer avec les couleurs les plus voluptueuses, les plus
puissantes, ou les plus subtiles oppositions de blanc et noir. Or il n’était
pas facile, à une époque de naturalisme et de rationalisme, de trouver un
public pour les créations d’un esprit à la fois tourmenté et serein. Comme
c’était à prévoir, ceux qui voyaient poindre avec appréhension la littérature
symbolistes se sentaient également mal à l’aise devant l’art de Redon».[83]
L’art symboliste ne parvenait, pas plus que l’art réaliste, à produire des
œuvres optimistes. Nous n’étions plus dans le XVIIIe siècle conquérant, avec
ses scènes grivoises, ces nus féminins rosés du rococo ou les fesses rondes des
néo-classiques combattants romains pour la délivrance des Sabines.
pictural. Il exécuta même des séries de lithographies et de dessins inspirés
par Poe et Flaubert, parvenant à des effets mystérieux par les lignes, les
contrastes et la composition, sans emprunter trop de symboles à la littérature.
Pour lui, la poésie n’était pas seulement un jeu de lignes, un assemblage de
couleurs; la poésie était partie inhérente de son imagination et de sa vision.
Il n’avait pas besoin de rechercher l’équivalent plastique de ses émotions
parce que ses œuvres n’étaient pas une traduction d’idées d’un moyen
d’expression dans un autre. Redon vivait dans un monde de rêves beaux et
inquiétants, inséparables de la réalité; ces rêves étant réels pour lui, il ne
prenait pas la peine de découvrir leur signification. Ce qu’il désirait,
c’était les exprimer avec les couleurs les plus voluptueuses, les plus
puissantes, ou les plus subtiles oppositions de blanc et noir. Or il n’était
pas facile, à une époque de naturalisme et de rationalisme, de trouver un
public pour les créations d’un esprit à la fois tourmenté et serein. Comme
c’était à prévoir, ceux qui voyaient poindre avec appréhension la littérature
symbolistes se sentaient également mal à l’aise devant l’art de Redon».[83]
L’art symboliste ne parvenait, pas plus que l’art réaliste, à produire des
œuvres optimistes. Nous n’étions plus dans le XVIIIe siècle conquérant, avec
ses scènes grivoises, ces nus féminins rosés du rococo ou les fesses rondes des
néo-classiques combattants romains pour la délivrance des Sabines.
 mort, le deuil, tous dans des décors
minimalistes propres aux intérieurs des foyers scandinaves : «Le projet que Munch développe est fascinant.
Dès qu’il échappe à la séduction spéculaire et que, sur la frayeur, il invente
l’onde du désir, la trace du cauchemar, l’intonation de l’angoisse, l’image
entre en crue. En subir l’emprise, ce n’est pas seulement éprouver une
expérience humaine. C’est se laisser fouetter par la puissance du langage.
Charnelle. Elle exprime, comme Mallarmé l’entend de la poésie, le “sens
mystérieux des aspects de l’existence”. Comme si l’aventure plastique se
passait, telle la vie littéraire, à révéler la présence, au dedans des accords
et significations. Comme Mallarmé, il faut, aurait pu dire Munch, “penser de
tout son corps”. Toute son œuvre, dès qu’elle abandonne la procédure mimétique
- c’est-à-dire dès
mort, le deuil, tous dans des décors
minimalistes propres aux intérieurs des foyers scandinaves : «Le projet que Munch développe est fascinant.
Dès qu’il échappe à la séduction spéculaire et que, sur la frayeur, il invente
l’onde du désir, la trace du cauchemar, l’intonation de l’angoisse, l’image
entre en crue. En subir l’emprise, ce n’est pas seulement éprouver une
expérience humaine. C’est se laisser fouetter par la puissance du langage.
Charnelle. Elle exprime, comme Mallarmé l’entend de la poésie, le “sens
mystérieux des aspects de l’existence”. Comme si l’aventure plastique se
passait, telle la vie littéraire, à révéler la présence, au dedans des accords
et significations. Comme Mallarmé, il faut, aurait pu dire Munch, “penser de
tout son corps”. Toute son œuvre, dès qu’elle abandonne la procédure mimétique
- c’est-à-dire dès  ces années parisiennes - et sans jamais avoir recours à la
matière historique, au discours mythique, est divagation de forces.
Ruissellement d’intempéries. Tension. La couleur, la tache, la ligne, le
graphe, le gramme sont subordonnés à une fonction centrale : faire écho aux
pulsions. Il est temps de dire de Munch
qu’il se roule dans la pâte: de telle sorte qu’il ébranle les unités
signifiantes traditionnelles (à l’inverse de la calligraphie de Moreau). De là
la censure en extase. La ligne en frisson. Le fluide étalement. Le spasme
visqueux. Écriture violente. Flottante. Désirante. À cordes. Voiles, voilures.
Jaillissante. Elle est jaillissement;
à rapprocher - démon de l’analogie - du feu fondamental, du phénomène d’effulgences
que J.-P Richard isole chez Mallarmé
comme donnée immédiate de la conscience créatrice, comme “mode forcené et quasi
physiologique” identifiable à la furie
comme “mouvement sauvage d’un génie qui se précipiterait hors de lui-même
ces années parisiennes - et sans jamais avoir recours à la
matière historique, au discours mythique, est divagation de forces.
Ruissellement d’intempéries. Tension. La couleur, la tache, la ligne, le
graphe, le gramme sont subordonnés à une fonction centrale : faire écho aux
pulsions. Il est temps de dire de Munch
qu’il se roule dans la pâte: de telle sorte qu’il ébranle les unités
signifiantes traditionnelles (à l’inverse de la calligraphie de Moreau). De là
la censure en extase. La ligne en frisson. Le fluide étalement. Le spasme
visqueux. Écriture violente. Flottante. Désirante. À cordes. Voiles, voilures.
Jaillissante. Elle est jaillissement;
à rapprocher - démon de l’analogie - du feu fondamental, du phénomène d’effulgences
que J.-P Richard isole chez Mallarmé
comme donnée immédiate de la conscience créatrice, comme “mode forcené et quasi
physiologique” identifiable à la furie
comme “mouvement sauvage d’un génie qui se précipiterait hors de lui-même  vers
le havre vague d’une expression. […]
tout indique que entre les deux hommes la sympathie que fonde l’imaginaire
biologique, la subversion topologique, la dimension cosmique du corps traversé
de contractions douloureuses. C’est pourquoi sans doute encore y a-t-il chez
Munch une figure de l’onde qui
pourrait être mise en regard de la figure mallarméenne du pli telle que la relève J.-P. Richard pour
joindre l’érotique au sensible : “le pli étant à la fois sexe, feuillage,
miroir, livre, tombeau”, toutes réalités que l’un et l’autre rassemblent en un
rêve spécifique d’intimité».[84]
Mais également, angoisse, solitude et incommunicabilité hantises d’un monde bourgeois satisfait de
lui, mais inquiet; une classe qui avait appris à détourner le regard de la réalité devant laquelle elle se sentait saisie d'une anxiété qui ne lui laissait plus que deux options. Ou bien se retenir au point de refouler en elle son sentiment de détresse face à la condition humaine ou pousser le pire cri que l'on puisse entendre et qui résonnera devant les boucheries de la Seconde Guerre de Trente Ans (1914-1945).
vers
le havre vague d’une expression. […]
tout indique que entre les deux hommes la sympathie que fonde l’imaginaire
biologique, la subversion topologique, la dimension cosmique du corps traversé
de contractions douloureuses. C’est pourquoi sans doute encore y a-t-il chez
Munch une figure de l’onde qui
pourrait être mise en regard de la figure mallarméenne du pli telle que la relève J.-P. Richard pour
joindre l’érotique au sensible : “le pli étant à la fois sexe, feuillage,
miroir, livre, tombeau”, toutes réalités que l’un et l’autre rassemblent en un
rêve spécifique d’intimité».[84]
Mais également, angoisse, solitude et incommunicabilité hantises d’un monde bourgeois satisfait de
lui, mais inquiet; une classe qui avait appris à détourner le regard de la réalité devant laquelle elle se sentait saisie d'une anxiété qui ne lui laissait plus que deux options. Ou bien se retenir au point de refouler en elle son sentiment de détresse face à la condition humaine ou pousser le pire cri que l'on puisse entendre et qui résonnera devant les boucheries de la Seconde Guerre de Trente Ans (1914-1945).

 développement des relations humaines. L'ambiance luthérienne y était pour quelque chose. L'inquiétude du salut domine un grand nombre de toiles du peintre. La modernité lui semble avoir tué l'esprit humain. Les scènes répétées de deuil, d'agonie, de veillée funèbre sont là pour rappeler la disparition d'un monde que l'on laisse s'échapper, sans penser même le retenir. Et l'épouvante s'empare de la fillette auprès de sa mère décédée (1901). Le sexe ne suffit pas à servir de truchement entre l'homme et la femme. Les lueurs des rayons crépusculaires du soleil nordique surprend le personnage du Cri et lui fait réaliser la raison que ce monde est en train de perdre pour des chimères de progrès et de bonheur. Le prix à payer est trop lourd. La faute de Judas retombe sur le commun des passants. Tous se détournent de la foi qui seule pourrait les sauver. Une panique folle s'empare des masques dénués d'âme dans le Golgotha. C'est par cette toile effarante que, en 1900, Munch célébra le dix-neufcentième anniversaire de naissance de Jésus. Ces inquiétudes inouïes qui envahirent l'esprit de Munch envahit également celui de beaucoup de ses contemporains, et le Belge James Ensor (1860-1949), qui devait être témoin de la catastrophe annoncée, rejoint non seulement les mêmes thèmes que ceux de Munch, mais également le même cynisme désespéré.
développement des relations humaines. L'ambiance luthérienne y était pour quelque chose. L'inquiétude du salut domine un grand nombre de toiles du peintre. La modernité lui semble avoir tué l'esprit humain. Les scènes répétées de deuil, d'agonie, de veillée funèbre sont là pour rappeler la disparition d'un monde que l'on laisse s'échapper, sans penser même le retenir. Et l'épouvante s'empare de la fillette auprès de sa mère décédée (1901). Le sexe ne suffit pas à servir de truchement entre l'homme et la femme. Les lueurs des rayons crépusculaires du soleil nordique surprend le personnage du Cri et lui fait réaliser la raison que ce monde est en train de perdre pour des chimères de progrès et de bonheur. Le prix à payer est trop lourd. La faute de Judas retombe sur le commun des passants. Tous se détournent de la foi qui seule pourrait les sauver. Une panique folle s'empare des masques dénués d'âme dans le Golgotha. C'est par cette toile effarante que, en 1900, Munch célébra le dix-neufcentième anniversaire de naissance de Jésus. Ces inquiétudes inouïes qui envahirent l'esprit de Munch envahit également celui de beaucoup de ses contemporains, et le Belge James Ensor (1860-1949), qui devait être témoin de la catastrophe annoncée, rejoint non seulement les mêmes thèmes que ceux de Munch, mais également le même cynisme désespéré.


 Isidore Ducasse, né à Montevideo en Uruguay, était mort de faim, à l'âge de 24 ans,
durant le siège de Paris en 1870. Fils d’une famille d’administrateurs à la
Chancellerie de Montevideo, fuyant la guerre civile en Uruguay, il sera
rattrapé par la guerre franco-prussienne. Revêtant les atours de la noblesse,
Ducasse signa ses œuvres poétiques du nom de comte de Lautréamont. Poésie en prose, les Chants de Maldoror ne seront publiés qu’en 1885 et vite lus par
Alfred Jarry qui qualifiera son auteur comme appartenant à l’univers de la pataphysique. Les surréalistes, un peu plus tard,
regarderons Lautréamont comme le premier des leurs. Pour Huysmans, déjà habitué
à l’art des Moreau et Redon, Lautréamont était leur frère en lettres et se
demanda : «Que diable pouvait faire
dans la vie l’homme qui a écrit d’aussi terribles rêves?», alors que Léon
Bloy lui consacra, dès 1890, une critique admirative intitulée Le cabanon de Prométhée. La force des
images est sans doute ce qui domine dans l’œuvre de Lautréamont, qui s’adresse
aux lecteurs avec une vive interpellation : «“Oui, bonne gens, c’est moi qui vous ordonne de brûler sur une pelle
rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute, aux lèvres de
vermouth, qui, répandant dans une lutte
Isidore Ducasse, né à Montevideo en Uruguay, était mort de faim, à l'âge de 24 ans,
durant le siège de Paris en 1870. Fils d’une famille d’administrateurs à la
Chancellerie de Montevideo, fuyant la guerre civile en Uruguay, il sera
rattrapé par la guerre franco-prussienne. Revêtant les atours de la noblesse,
Ducasse signa ses œuvres poétiques du nom de comte de Lautréamont. Poésie en prose, les Chants de Maldoror ne seront publiés qu’en 1885 et vite lus par
Alfred Jarry qui qualifiera son auteur comme appartenant à l’univers de la pataphysique. Les surréalistes, un peu plus tard,
regarderons Lautréamont comme le premier des leurs. Pour Huysmans, déjà habitué
à l’art des Moreau et Redon, Lautréamont était leur frère en lettres et se
demanda : «Que diable pouvait faire
dans la vie l’homme qui a écrit d’aussi terribles rêves?», alors que Léon
Bloy lui consacra, dès 1890, une critique admirative intitulée Le cabanon de Prométhée. La force des
images est sans doute ce qui domine dans l’œuvre de Lautréamont, qui s’adresse
aux lecteurs avec une vive interpellation : «“Oui, bonne gens, c’est moi qui vous ordonne de brûler sur une pelle
rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute, aux lèvres de
vermouth, qui, répandant dans une lutte  mélancolique entre le bien et le mal
des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait,
partout, le vide universel”. Poésie de révolte. Écriture dévorante (dévorante
du langage pré-établi), dégagée des convenances de l’art (faire avec les
entrailles du système verbal). Textes tendus. Sauvages. Pleins de “poisons”,
d’“émanations mortelles”. Véhicule des “eaux ironiques de l’éther” et de toutes
les images du “cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l’ombre”:
le symbolisme commence dès que le mot se déplace sur le curseur de l’imaginaire
et que, de surcroît, il s’engage, porté par l’onde pulsionnelle, sur l’axe de
la condensation métaphorique».[86]
Les cauchemars de Redon renvoient, effectivement, à ceux de Lautréamont, pleins
de métamorphoses de l’être qui échappe à sa nature, voire à sa réalité :
mélancolique entre le bien et le mal
des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait,
partout, le vide universel”. Poésie de révolte. Écriture dévorante (dévorante
du langage pré-établi), dégagée des convenances de l’art (faire avec les
entrailles du système verbal). Textes tendus. Sauvages. Pleins de “poisons”,
d’“émanations mortelles”. Véhicule des “eaux ironiques de l’éther” et de toutes
les images du “cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l’ombre”:
le symbolisme commence dès que le mot se déplace sur le curseur de l’imaginaire
et que, de surcroît, il s’engage, porté par l’onde pulsionnelle, sur l’axe de
la condensation métaphorique».[86]
Les cauchemars de Redon renvoient, effectivement, à ceux de Lautréamont, pleins
de métamorphoses de l’être qui échappe à sa nature, voire à sa réalité : énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n’ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent, jusqu’à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie d’ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, et qui n’est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il, si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre (je n’ose pas dire corps) ne le nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et, quand l’un d’eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu’il ne s’en échappe un, et ne vienne gratter, avec sa bouche, le dedans de votre oreille : il serait ensuite capable d’entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim : il faut que chacun vivre. Mais, quand un parti déjoue complètement les ruses de l’autre, ils ne trouvent rien de mieux que de ne pas se gêner, et sucent la graisse délicate qui couvre mes côtes : j’y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place : elle m’a rendu eunuque, cette infâme. Oh! si j’avais pu me défendre avec mes bras paralysés; mais, je crois plutôt qu’ils se sont changés en bûches. Quoi qu’il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons, qui ne croissent plus, ont jeté à un chien, qui n’a pas refusé, l’intérieur de mes testicules : l’épiderme, soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L’anus a été intercepté par un crabe; encouragé par mon inertie, il garde l’entrée avec ses pinces, et me fait beaucoup de mal! Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les deux parties charnues qui forment le derrière humain, et, se cramponnant à leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression constante, que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu’il est resté deux monstres sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c’est un glaive. Oui, oui… je n’y faisais pas attention… votre demande est juste. Vous désirez savoir, n’est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins? Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement; cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir ce qui n’est peut-être qu’un rêve, sachez que l’homme, quand il a su que j’avais fait vœu de vivre avec la maladie et l’immobilité jusqu’à ce que j’eusse vaincu le Créateur, marcha, derrière moi, sur la pointe des pieds, mais, non pas si doucement, que je ne l’entendisse. Je ne perçus plus rien, pendant un instant qui ne fut pas long…» (Chant IV).

 pourquoi le
symbolisme, tout en étant unefu ite du monde réel, traverse l’épaisseur de la
réalité pour en étaler l’équivalent en
rêves démoniaques et en cauchemars effroyables. Aucun autre poète symboliste
n’alla aussi loin dans cette direction que Lautréamont. Pas même Rimbaud :
«La solution de la vie simple, de la voie
droite et de la tâche limitée qu’il accueille maintenant comme la vérité de son
existence renouvelée, n’est, elle-même, pas simple. Tout le monde le comprend :
à un tel instant, trois ans avant Rimbaud, après une expérience à la fois
analogue et fort différente (car, conduite tout entière à travers un livre où
pourtant sa vie a été de fond en comble mise à l’épreuve, cette expérience, par
son propre mouvement, l’a porté à ce point où il lui faut s’en détourner, la
rejeter et accueillir la rigueur “très sévère” de “l’heure nouvelle”),
Lautréamont - après avoir passé en enfer une saison toute semblable, même par
la nature de la hantise érotique - en est exactement à cet “Adieu” qui va jeter
Rimbaud dans le désert du Harrar. Mais le même “Adieu” jette Lautréamont dans
un désert bien plus lugubre, celui du bien, et l’on voit la différence. De même
que l’expérience qui a été celle de Rimbaud, par certains côtés plus
méthodique, plus théorique et plus volontaire, a cependant intéressé, autant
qu’on le présume, davantage sa vie, a été aussi bien une aventure vécue qu’une
aventure du langage, de même le congédiement de l’expérience n’a apparemment de
conséquences que pour la vie de Rimbaud et l’enferme dans cette vie comme dans
une tombe. Lautréamont qui n’a pu se délivrer de lui-même que par l’expérience
d’un livre, ne peut se délivrer de cette expérience que par un autre livre. Lui
aussi a inventé “de
pourquoi le
symbolisme, tout en étant unefu ite du monde réel, traverse l’épaisseur de la
réalité pour en étaler l’équivalent en
rêves démoniaques et en cauchemars effroyables. Aucun autre poète symboliste
n’alla aussi loin dans cette direction que Lautréamont. Pas même Rimbaud :
«La solution de la vie simple, de la voie
droite et de la tâche limitée qu’il accueille maintenant comme la vérité de son
existence renouvelée, n’est, elle-même, pas simple. Tout le monde le comprend :
à un tel instant, trois ans avant Rimbaud, après une expérience à la fois
analogue et fort différente (car, conduite tout entière à travers un livre où
pourtant sa vie a été de fond en comble mise à l’épreuve, cette expérience, par
son propre mouvement, l’a porté à ce point où il lui faut s’en détourner, la
rejeter et accueillir la rigueur “très sévère” de “l’heure nouvelle”),
Lautréamont - après avoir passé en enfer une saison toute semblable, même par
la nature de la hantise érotique - en est exactement à cet “Adieu” qui va jeter
Rimbaud dans le désert du Harrar. Mais le même “Adieu” jette Lautréamont dans
un désert bien plus lugubre, celui du bien, et l’on voit la différence. De même
que l’expérience qui a été celle de Rimbaud, par certains côtés plus
méthodique, plus théorique et plus volontaire, a cependant intéressé, autant
qu’on le présume, davantage sa vie, a été aussi bien une aventure vécue qu’une
aventure du langage, de même le congédiement de l’expérience n’a apparemment de
conséquences que pour la vie de Rimbaud et l’enferme dans cette vie comme dans
une tombe. Lautréamont qui n’a pu se délivrer de lui-même que par l’expérience
d’un livre, ne peut se délivrer de cette expérience que par un autre livre. Lui
aussi a inventé “de  nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs,
de nouvelles langues”, mais quand il “enterre” tout cela, quand il s’enterre
lui-même, c’est encore au sein de la littérature, et son reniement est un
reniement d’abord littéraire. En principe, il n’y a rien là de très
remarquable, et cette manière de se renier peut apparaître banale et non pas
exemplaire comme celle de Rimbaud. Et toutefois, un tel reniement banal, et
même par quelque côté gênant, déplaisant, prend à la fin la même signification
mythique et donne lieu à une énigme non moins étrange et non moins fabuleuse que
celle qui va auréoler Rimbaud».[87]
Car la poésie symboliste n’atteint que très rarement un tel niveau de violence
et de fantastique. En général, comme le note Angenot, «cette poétique du premier moment “symboliste”, malgré son ostentation
d’“à vau-l’eau” de l’âme “dolente”, découvre parfois une musique sous les mots,
le pulsionnel sous le sémantique…».[88]
À ce titre, les poètes se conformaient, avant même sa rédaction, au manifeste
de Maurice Denis. Pour eux, «le but
n’était plus de décrire ou de peindre la nature, mais de suggérer et de communiquer
les impressions des sens, d’une manière subtile et secrète, comme par exemple,
le firent Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Les symbolistes n’essayaient pas de
traduire leurs impressions par des moyens naturalistes, ou bien en faisant
appel à la raison, mais au contraire, de manière tout émotionnelle, par
l’emploi des rythmes musicaux, des sons et des associations suggestives».[89]
Ce que réussirent au plus haut point Paul Verlaine et Arthur Rimbaud.
nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs,
de nouvelles langues”, mais quand il “enterre” tout cela, quand il s’enterre
lui-même, c’est encore au sein de la littérature, et son reniement est un
reniement d’abord littéraire. En principe, il n’y a rien là de très
remarquable, et cette manière de se renier peut apparaître banale et non pas
exemplaire comme celle de Rimbaud. Et toutefois, un tel reniement banal, et
même par quelque côté gênant, déplaisant, prend à la fin la même signification
mythique et donne lieu à une énigme non moins étrange et non moins fabuleuse que
celle qui va auréoler Rimbaud».[87]
Car la poésie symboliste n’atteint que très rarement un tel niveau de violence
et de fantastique. En général, comme le note Angenot, «cette poétique du premier moment “symboliste”, malgré son ostentation
d’“à vau-l’eau” de l’âme “dolente”, découvre parfois une musique sous les mots,
le pulsionnel sous le sémantique…».[88]
À ce titre, les poètes se conformaient, avant même sa rédaction, au manifeste
de Maurice Denis. Pour eux, «le but
n’était plus de décrire ou de peindre la nature, mais de suggérer et de communiquer
les impressions des sens, d’une manière subtile et secrète, comme par exemple,
le firent Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Les symbolistes n’essayaient pas de
traduire leurs impressions par des moyens naturalistes, ou bien en faisant
appel à la raison, mais au contraire, de manière tout émotionnelle, par
l’emploi des rythmes musicaux, des sons et des associations suggestives».[89]
Ce que réussirent au plus haut point Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. 


 impatients de parvenir à une fusion plus intime du vers
et du son, cherchant des images suggestives et un vocabulaire revivifié,
trouvaient exemple et inspiration dans l’œuvre de ces aînés. “Charles
Baudelaire doit être considéré comme le véritable précurseur du présent
mouvement, proclamait Moréas; Stéphane Mallarmé le lotit du sens du mystère et
de l’ineffable; Paul Verlaine brisa en son honneur les cruelles entraves du
vers que les doigts prestigieux de Théodore de Banville avaient assoupli
auparavant”».[96]
Édouard Dujardin, éditeur de la Revue
Wagnérienne, «croit pouvoir dire que
le modèle symphoniste et totalitaire offert par Wagner est à l’origine du
“mouvement symboliste”. Kaléidoscope héraldique : où le son prétend clamer la
couleur de l’espace, la forêt mimer l’onde, le monstre siffler la chevauchée,
la sirène tracer une rumeur. Le wagnérisme comme phénomène d’extase
individuelle et collective est, pour les évadés du siècle, lyrisme tonique,
abîme du rêve, dérive romantique, réceptacle de fantasmes»,[97]
il semblerait que pour «Mallarmé, le
théâtre symboliste suppose l’éclatement de la figure, la dissolution de toute
impatients de parvenir à une fusion plus intime du vers
et du son, cherchant des images suggestives et un vocabulaire revivifié,
trouvaient exemple et inspiration dans l’œuvre de ces aînés. “Charles
Baudelaire doit être considéré comme le véritable précurseur du présent
mouvement, proclamait Moréas; Stéphane Mallarmé le lotit du sens du mystère et
de l’ineffable; Paul Verlaine brisa en son honneur les cruelles entraves du
vers que les doigts prestigieux de Théodore de Banville avaient assoupli
auparavant”».[96]
Édouard Dujardin, éditeur de la Revue
Wagnérienne, «croit pouvoir dire que
le modèle symphoniste et totalitaire offert par Wagner est à l’origine du
“mouvement symboliste”. Kaléidoscope héraldique : où le son prétend clamer la
couleur de l’espace, la forêt mimer l’onde, le monstre siffler la chevauchée,
la sirène tracer une rumeur. Le wagnérisme comme phénomène d’extase
individuelle et collective est, pour les évadés du siècle, lyrisme tonique,
abîme du rêve, dérive romantique, réceptacle de fantasmes»,[97]
il semblerait que pour «Mallarmé, le
théâtre symboliste suppose l’éclatement de la figure, la dissolution de toute
 personnification, il est un théâtre de l’Idée, du son, de la voix. “Est-ce qu’un
fait spirituel - se demande-t-il -, l’épanouissement de symboles ou leur
préparation, nécessite un lieu, pour s’y développer, autre que le fictif foyer
de vision dardé par le regard d’une foule! Saint des Saints, mais mental. Alors
y aboutissent, dans quelque éclair suprême, d’où s’éveille la Figure que Nul
n’est, chaque attitude mimique prise par elle à un rythme inclus dans la
symphonie, et le délivrant! alors viennent expirer comme aux pieds de cette
incarnation, non sans qu’un lien certain les apparente ainsi à son humanité,
ces raréfactions et ces sommités naturelles que la Musique rend…”».[98]
Et Wyzeva de la revue Art moderne (1889)
de conclure : «C’est ainsi que M.
Mallarmé a été conduit à voir dans la poésie l’expression des symboles,
c’est-à-dire des correspondances mystérieuses et profondes qui existent entre
toutes chosesI».[99]
Par contre, dans son Journal, François Coppée écrivait, dès 1871 : «Mallarmé
devient plus fou que jamais. Je reparlerai de lui et longuement. Cet exquis
insensé en vaut la peine. Mais je note ici la meilleure folie d’hier soir. La
lune le gêne. Il explique le symbolisme des étoiles, dont le désordre dans le
firmament lui paraît l’image du hasard. Mais la lune, qu’il appelle avec mépris
“ce fromage”, lui semble inutile. Il
personnification, il est un théâtre de l’Idée, du son, de la voix. “Est-ce qu’un
fait spirituel - se demande-t-il -, l’épanouissement de symboles ou leur
préparation, nécessite un lieu, pour s’y développer, autre que le fictif foyer
de vision dardé par le regard d’une foule! Saint des Saints, mais mental. Alors
y aboutissent, dans quelque éclair suprême, d’où s’éveille la Figure que Nul
n’est, chaque attitude mimique prise par elle à un rythme inclus dans la
symphonie, et le délivrant! alors viennent expirer comme aux pieds de cette
incarnation, non sans qu’un lien certain les apparente ainsi à son humanité,
ces raréfactions et ces sommités naturelles que la Musique rend…”».[98]
Et Wyzeva de la revue Art moderne (1889)
de conclure : «C’est ainsi que M.
Mallarmé a été conduit à voir dans la poésie l’expression des symboles,
c’est-à-dire des correspondances mystérieuses et profondes qui existent entre
toutes chosesI».[99]
Par contre, dans son Journal, François Coppée écrivait, dès 1871 : «Mallarmé
devient plus fou que jamais. Je reparlerai de lui et longuement. Cet exquis
insensé en vaut la peine. Mais je note ici la meilleure folie d’hier soir. La
lune le gêne. Il explique le symbolisme des étoiles, dont le désordre dans le
firmament lui paraît l’image du hasard. Mais la lune, qu’il appelle avec mépris
“ce fromage”, lui semble inutile. Il  rêve sérieusement un âge plus savant de
l’humanité où on la dissoudra très facilement par des moyens chimiques. Un seul
point l’inquiète: la cessation des marées, et ce bouleversement rythmique de la
mer est nécessaire à sa théorie du symbolisme du décor humain. Hélas! hélas!
pauvre raison humaine…».[100]
Mais Mallarmé ne s’en inquiétait pas pour autant, «Alors (de l’Absolu) son esprit se formant par le hasard absolu de
ce fait) il dit à tout ce vacarme :
certainement il y a là un acte - c’est mon devoir de le proclamer : cette folie
existe».[101] Bientôt, la critique
commença à s’opposer à certaines de ses œuvres, en particulier son poème
musical. L’après-midi d’un faune, après
que le Théâtre-Français le refusa en 1865 : «L’injure faite à Mallarmé […]
lui donne peut-être la tentation de s’en remettre à d’autres que ses
compatriotes du soin de goûter ses vers; ou bien les trésors poétiques
étrangers lui semblent pouvoir apporter au lyrisme français de précieux
enrichissements. Peut-être trouve-t-il à ces étranges artistes de Londres de la
fin du XIXe siècle, venus après George Eliot, et aux préraphaélites, un charme
irrésistible. Le voici, pour quelque temps, en étroite liaison avec les
écrivains anglais. Il expédie régulièrement à l’Athenæum ses courtes et claires notes et donne à O’
Shaughnessy des nouvelles de ses livres et des éditeurs lambins : “le Faune
dont l’après-midi menace d’aboutir en la nuit éternelle; et Vathek plus oublié par l’imprimeur que le rituel
ancien d’une momie”…».[102]
Il faudra attendre la mise en musique par Debussy pour que ce poème trouve
finalement son publique.
rêve sérieusement un âge plus savant de
l’humanité où on la dissoudra très facilement par des moyens chimiques. Un seul
point l’inquiète: la cessation des marées, et ce bouleversement rythmique de la
mer est nécessaire à sa théorie du symbolisme du décor humain. Hélas! hélas!
pauvre raison humaine…».[100]
Mais Mallarmé ne s’en inquiétait pas pour autant, «Alors (de l’Absolu) son esprit se formant par le hasard absolu de
ce fait) il dit à tout ce vacarme :
certainement il y a là un acte - c’est mon devoir de le proclamer : cette folie
existe».[101] Bientôt, la critique
commença à s’opposer à certaines de ses œuvres, en particulier son poème
musical. L’après-midi d’un faune, après
que le Théâtre-Français le refusa en 1865 : «L’injure faite à Mallarmé […]
lui donne peut-être la tentation de s’en remettre à d’autres que ses
compatriotes du soin de goûter ses vers; ou bien les trésors poétiques
étrangers lui semblent pouvoir apporter au lyrisme français de précieux
enrichissements. Peut-être trouve-t-il à ces étranges artistes de Londres de la
fin du XIXe siècle, venus après George Eliot, et aux préraphaélites, un charme
irrésistible. Le voici, pour quelque temps, en étroite liaison avec les
écrivains anglais. Il expédie régulièrement à l’Athenæum ses courtes et claires notes et donne à O’
Shaughnessy des nouvelles de ses livres et des éditeurs lambins : “le Faune
dont l’après-midi menace d’aboutir en la nuit éternelle; et Vathek plus oublié par l’imprimeur que le rituel
ancien d’une momie”…».[102]
Il faudra attendre la mise en musique par Debussy pour que ce poème trouve
finalement son publique.  L’influence du symbolisme français fraya son
chemin en Allemagne, avec le poète Stefan George (1868-1933) dont nous avons
déjà parlé. Avant qu’il ne devienne le chantre du nationalisme dans son pays, «lorsqu’il était jeune, il se promena pas mal
à l’étranger, à Paris où il fréquenta les poètes symbolistes, et à Londres où
il fut en contact avec les préraphaélites. Ces deux mouvements restèrent les
influences principales d’une vie entièrement consacrée à la poésie. De retour
en Allemagne, il rassembla autour de lui une école dont l’esthétique nouvelle
voulait ressusciter les modèles de la beauté pure en art et en poésie, à
l’encontre du réalisme populaire, et du dominant et fruste réalisme représenté
par exemple par Gerhardt Hauptmann. George recherchait à la fois une perfection
classique, des effets musicaux et les images du symbolisme. […] En 1892, il fond le Blätter für die kunst dont la publication se poursuivit
L’influence du symbolisme français fraya son
chemin en Allemagne, avec le poète Stefan George (1868-1933) dont nous avons
déjà parlé. Avant qu’il ne devienne le chantre du nationalisme dans son pays, «lorsqu’il était jeune, il se promena pas mal
à l’étranger, à Paris où il fréquenta les poètes symbolistes, et à Londres où
il fut en contact avec les préraphaélites. Ces deux mouvements restèrent les
influences principales d’une vie entièrement consacrée à la poésie. De retour
en Allemagne, il rassembla autour de lui une école dont l’esthétique nouvelle
voulait ressusciter les modèles de la beauté pure en art et en poésie, à
l’encontre du réalisme populaire, et du dominant et fruste réalisme représenté
par exemple par Gerhardt Hauptmann. George recherchait à la fois une perfection
classique, des effets musicaux et les images du symbolisme. […] En 1892, il fond le Blätter für die kunst dont la publication se poursuivit
 jusqu’en 1919. Ce journal prêchait le culte de la beauté dans la vie comme dans
l’art, le goût de la perfection, et un humanisme qui tenait du mysticisme
religieux. Ce culte était ésotérique et n’eut qu’un petit nombre d’élus,
fortement réfractaires aux tendances populaires démocratiques. George se
considérait comme une sorte de prêtre et de prophète, ce qu’il était; après la
guerre 1914-1918, il affirmait qu’il avait trop souffert de la véritable
laideur, du matérialisme et de la brutalité de l’époque pour ne pas avoir prévu
la catastrophe».[103]
En Belgique, c’est en Émile Verhaeren (1855-1916) qu’«il faut voir le poète qui a passé, sur le plan moral, du pour au contre
et dont la tâche, du jour où il repoussa la tentation de la neurasténie, fut de
s’apprivoiser peu à peu au milieu de ce monde moderne qu’il haïssait depuis
qu’il ne reconnaissait plus en lui l’œuvre de Dieu. Il y a peu d’exemples d’un
semblable essai de “transmutation des valeurs”, d’une volonté si peu déguisée
de faire jaillir la joie de la souffrance. Si Verhaeren se refuse désormais à
rejeter quoi que ce soit qui existe, c’est pour mieux s’avancer au delà et
embrasser “la vie ardente et contradictoire”. Mais ce qu’il importe de noter,
c’est que ce vaste mouvement d’extraversion correspond à l’évolution générale
des esprits, de l’époque symboliste à la guerre”. “Ce que tous subissent en
Verhaeren, disait, en 1904, M. Marius-Ary Leblond, c’est la passion.” Une
audience si large, en effet, tant d’échos éveillés de proche
jusqu’en 1919. Ce journal prêchait le culte de la beauté dans la vie comme dans
l’art, le goût de la perfection, et un humanisme qui tenait du mysticisme
religieux. Ce culte était ésotérique et n’eut qu’un petit nombre d’élus,
fortement réfractaires aux tendances populaires démocratiques. George se
considérait comme une sorte de prêtre et de prophète, ce qu’il était; après la
guerre 1914-1918, il affirmait qu’il avait trop souffert de la véritable
laideur, du matérialisme et de la brutalité de l’époque pour ne pas avoir prévu
la catastrophe».[103]
En Belgique, c’est en Émile Verhaeren (1855-1916) qu’«il faut voir le poète qui a passé, sur le plan moral, du pour au contre
et dont la tâche, du jour où il repoussa la tentation de la neurasténie, fut de
s’apprivoiser peu à peu au milieu de ce monde moderne qu’il haïssait depuis
qu’il ne reconnaissait plus en lui l’œuvre de Dieu. Il y a peu d’exemples d’un
semblable essai de “transmutation des valeurs”, d’une volonté si peu déguisée
de faire jaillir la joie de la souffrance. Si Verhaeren se refuse désormais à
rejeter quoi que ce soit qui existe, c’est pour mieux s’avancer au delà et
embrasser “la vie ardente et contradictoire”. Mais ce qu’il importe de noter,
c’est que ce vaste mouvement d’extraversion correspond à l’évolution générale
des esprits, de l’époque symboliste à la guerre”. “Ce que tous subissent en
Verhaeren, disait, en 1904, M. Marius-Ary Leblond, c’est la passion.” Une
audience si large, en effet, tant d’échos éveillés de proche 
 pensée et l’imagination. «Dans ses études d’inspiration bergsonienne sur l’Attitude du
lyrisme contemporain, Tancrède de Visan
fut conduit à faire de la poésie une sorte de métaphysique irrégulière et à
définir le rôle essentiel de l’image, qui tend à symboliser de manière
concrète, à incarner, un “état d’âme” se développant dans la durée. Il ne faut
pas que le poète ait le dessein de décorer un voile linguistique qui le
séparerait de la réalité véritable qui réside en lui-même. Sa seule intention
légitime doit être de pénétrer jusqu’au cœur de cette réalité. S’il échoue
fatalement malgré ses efforts, si les images qui s’offrent à lui ne peuvent
être en définitive que des symboles - non pas l’être même, mais quelque chose
qui est cependant plus qu’un indice, qu’un signe, et auquel l’être participe -
il n’en doit pas moins se vouer à l’expression aussi directe que possible de
cet ineffable. L’esthétique symboliste, conclut T. de Visan, avec les
apparences du paradoxe, “est celle qui prétend se passer de symboles”; entendez
qu’elle répudie le symbole indirect, volontairement élaboré, pour inviter le
poète à s’approcher de la nature nue et à l’attirer dans le flux des images. Il
affirme que le langage concret du poème, en nous donnant le sentiment intense
du réel, nous apporte en définitive une connaissance de ce réel qui dépasse en
authenticité celle qui pourrait naître en nous de n’importe quel agencement de
concepts».[106]
Il est vrai qu’en
pensée et l’imagination. «Dans ses études d’inspiration bergsonienne sur l’Attitude du
lyrisme contemporain, Tancrède de Visan
fut conduit à faire de la poésie une sorte de métaphysique irrégulière et à
définir le rôle essentiel de l’image, qui tend à symboliser de manière
concrète, à incarner, un “état d’âme” se développant dans la durée. Il ne faut
pas que le poète ait le dessein de décorer un voile linguistique qui le
séparerait de la réalité véritable qui réside en lui-même. Sa seule intention
légitime doit être de pénétrer jusqu’au cœur de cette réalité. S’il échoue
fatalement malgré ses efforts, si les images qui s’offrent à lui ne peuvent
être en définitive que des symboles - non pas l’être même, mais quelque chose
qui est cependant plus qu’un indice, qu’un signe, et auquel l’être participe -
il n’en doit pas moins se vouer à l’expression aussi directe que possible de
cet ineffable. L’esthétique symboliste, conclut T. de Visan, avec les
apparences du paradoxe, “est celle qui prétend se passer de symboles”; entendez
qu’elle répudie le symbole indirect, volontairement élaboré, pour inviter le
poète à s’approcher de la nature nue et à l’attirer dans le flux des images. Il
affirme que le langage concret du poème, en nous donnant le sentiment intense
du réel, nous apporte en définitive une connaissance de ce réel qui dépasse en
authenticité celle qui pourrait naître en nous de n’importe quel agencement de
concepts».[106]
Il est vrai qu’en  cette époque qui se rapprochait de la Grande Guerre, «outre le néo-mallarmisme et le
néo-impressionnisme de la Phalange,
le goût se maintenait de la vie “maudite”, du non-conformisme moral et
intellectuel, du bizarre et de l’exceptionnel. On a pu rattacher à cette
tradition post-romantique et décadente la sensibilité de plus d’un poète
fantaisiste; or, c’est à l’aile avancée du “fantaisisme” que se placent les
trois hommes qui ont contribué plus que personne sans doute à donner à la
poésie des années de guerre et d’après-guerre son orientation : André Salmon, Max
Jacob, Guillaume Apollinaire».[107].Était-il
donc possible pour le symbolisme de s’écarter de cette veine pessimiste qui la
conduisait au décadentisme? Pour les principaux théoriciens, le décadentisme
trahissait l’esprit du symbolisme pour qui tout rêve n’est pas condamné à virer
au cauchemar. Moréas mettait déjà en garde, dès 1886, en soulignant combien la mouvance
était «ennemie de l’enseignement, de la
déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie
symboliste cherche : à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins, ne
serait pas son but à elle-même, mais qui tout en servant à exprimer l’Idée
demeurerait sujette. L’Idée à son tour ne doit pas se laisser voir priver des
somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel de
l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée en
soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains,
tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont là
des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques
avec des Idées primordiales…».[108]
Il en alla tout autrement.
cette époque qui se rapprochait de la Grande Guerre, «outre le néo-mallarmisme et le
néo-impressionnisme de la Phalange,
le goût se maintenait de la vie “maudite”, du non-conformisme moral et
intellectuel, du bizarre et de l’exceptionnel. On a pu rattacher à cette
tradition post-romantique et décadente la sensibilité de plus d’un poète
fantaisiste; or, c’est à l’aile avancée du “fantaisisme” que se placent les
trois hommes qui ont contribué plus que personne sans doute à donner à la
poésie des années de guerre et d’après-guerre son orientation : André Salmon, Max
Jacob, Guillaume Apollinaire».[107].Était-il
donc possible pour le symbolisme de s’écarter de cette veine pessimiste qui la
conduisait au décadentisme? Pour les principaux théoriciens, le décadentisme
trahissait l’esprit du symbolisme pour qui tout rêve n’est pas condamné à virer
au cauchemar. Moréas mettait déjà en garde, dès 1886, en soulignant combien la mouvance
était «ennemie de l’enseignement, de la
déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie
symboliste cherche : à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins, ne
serait pas son but à elle-même, mais qui tout en servant à exprimer l’Idée
demeurerait sujette. L’Idée à son tour ne doit pas se laisser voir priver des
somptueuses simarres des analogies extérieures, car le caractère essentiel de
l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée en
soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains,
tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont là
des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques
avec des Idées primordiales…».[108]
Il en alla tout autrement. puissance suggestive, pouvait
contribuer : «La grande voix qui
lancera pendant des années l’anathème contre les riches, va bientôt commencer à
se faire entendre : elle portera loin la renommée de John Ruskin (1819-1900),
le premier propagandiste de la Beauté qu’ait connu l’Angleterre. Non sans avoir
dénoncé au préalable ce qui la rend impossible, la misère. La pourriture des
slums de Londres, de Liverpool, de Manchester, de Birmingham, l’esclavage des
ouvriers de l’âge d’or du libéralisme, seront toujours présents aux yeux de
celui qui fut, non seulement un historien d’art et un esthète mais aussi un
réformateur social et un moment de la conscience de son époque: “Tant de tonnes
de minerai ont été fondues, tant de balles de coton changées en tissus, mais
combien de vigoureuses mains paralysées, combien de jeunes volontés atteintes,
combien d’enfants frappés dans leur croissance?” Dans une telle situation, pas
d’art possible».[109]
Il fallait donc réformer la société industrielle et capitaliste non pas
seulement pour équilibrer les richesses, mais afin de sauver l’art lui-même.
C’est ainsi que «l’évangile ruskinien
prône la charité plutôt que la justice. Tout l’effort de ce “tory socialiste”
que fut Ruskin tendait en effet à essayer d’adapter les relations morales
unissant le squire à son groupe campagnard du temps de la “joyeuse Angleterre”,
aux foules urbaines. Dans cette perspective, les “capitaines d’industrie”
devaient être des suzerains accordant protection à leurs
puissance suggestive, pouvait
contribuer : «La grande voix qui
lancera pendant des années l’anathème contre les riches, va bientôt commencer à
se faire entendre : elle portera loin la renommée de John Ruskin (1819-1900),
le premier propagandiste de la Beauté qu’ait connu l’Angleterre. Non sans avoir
dénoncé au préalable ce qui la rend impossible, la misère. La pourriture des
slums de Londres, de Liverpool, de Manchester, de Birmingham, l’esclavage des
ouvriers de l’âge d’or du libéralisme, seront toujours présents aux yeux de
celui qui fut, non seulement un historien d’art et un esthète mais aussi un
réformateur social et un moment de la conscience de son époque: “Tant de tonnes
de minerai ont été fondues, tant de balles de coton changées en tissus, mais
combien de vigoureuses mains paralysées, combien de jeunes volontés atteintes,
combien d’enfants frappés dans leur croissance?” Dans une telle situation, pas
d’art possible».[109]
Il fallait donc réformer la société industrielle et capitaliste non pas
seulement pour équilibrer les richesses, mais afin de sauver l’art lui-même.
C’est ainsi que «l’évangile ruskinien
prône la charité plutôt que la justice. Tout l’effort de ce “tory socialiste”
que fut Ruskin tendait en effet à essayer d’adapter les relations morales
unissant le squire à son groupe campagnard du temps de la “joyeuse Angleterre”,
aux foules urbaines. Dans cette perspective, les “capitaines d’industrie”
devaient être des suzerains accordant protection à leurs  ouvriers chargés de
jouer le rôle de vassaux fidèles».[110]
Ce socialisme chrétien, qui idéalisait d’une façon fantaisites les liens féodaux, avait de quoi plaire aux capitaines d’industrie, mais il apparut très
vite insuffisant malgré l’amélioration des conditions des prolétaires anglais
dans le dernier tiers du XIXe siècle. William Morris (1834-1896) voulait que
cet art pénètre dans la quotidienneté. Ruskin pensait encore aux grands
édifices, aux usines, aux bureaux administratifs, il s’adressait donc
essentiellement aux architectes : «L’appel
lancé par Ruskin aux architectes pour qu’ils s’inspirent des leçons de la
Nature ne va être que trop entendu. […]
Faire passer la nature dans l’édifice? C’est le but que vont se proposer Horta
à Bruxelles, Guimard à Paris, Gaudi à Barcelone. Dans cette voie périlleuse,
n’y a-t-il pas danger de se perdre dans l’ornement? Certes oui et pour une
bonne raison: “La fonction de l’ornement est de nous rendre
ouvriers chargés de
jouer le rôle de vassaux fidèles».[110]
Ce socialisme chrétien, qui idéalisait d’une façon fantaisites les liens féodaux, avait de quoi plaire aux capitaines d’industrie, mais il apparut très
vite insuffisant malgré l’amélioration des conditions des prolétaires anglais
dans le dernier tiers du XIXe siècle. William Morris (1834-1896) voulait que
cet art pénètre dans la quotidienneté. Ruskin pensait encore aux grands
édifices, aux usines, aux bureaux administratifs, il s’adressait donc
essentiellement aux architectes : «L’appel
lancé par Ruskin aux architectes pour qu’ils s’inspirent des leçons de la
Nature ne va être que trop entendu. […]
Faire passer la nature dans l’édifice? C’est le but que vont se proposer Horta
à Bruxelles, Guimard à Paris, Gaudi à Barcelone. Dans cette voie périlleuse,
n’y a-t-il pas danger de se perdre dans l’ornement? Certes oui et pour une
bonne raison: “La fonction de l’ornement est de nous rendre  heureux.” Ruskin
voulait que l’art soit générateur de joie et tous les hommes de l’Art Nouveau
lutteront aussi pour qu’il soit un art du bonheur».[111]
Avec Morris, les thèmes symbolistes s’incarnèrent essentiellement dans l’art
décoratif, qui finit par s'émanciper pour devenir tout simplement le style Art déco avec l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925. L’illustration, bien sûr, mais aussi les motifs de tapisseries, les
dessins sur verre (potiches, vases, vaisselles, poteries) qui répandront les
images végétales qui deviendront l’emblème du Modern Style : «L’adhésion
de Morris au socialisme date de 1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste
et en poète, d’abord soucieux de son œuvre. Il a cependant protesté contre les
massacres de populations chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur
des Irlandais affamés. Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier
parti socialiste organisé en Angleterre - est un pas décisif que les
Conservateurs ne pardonneront pas au tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans
la presse. Morris ne s’entendra d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de
parti: il fondera son propre mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera
les conférences pour prouver à ses auditeurs que l’organisation industrielle
qu’ils subissent est incompatible avec toute idée de bonheur et de beauté».[112] C’est
ainsi que William Morris devint sans doute l’artiste symboliste le plus engagé
politiquement, même si son socialisme appartenait non pas à l’espèce des luttes
de classes mais plutôt à celle des accommodements.
heureux.” Ruskin
voulait que l’art soit générateur de joie et tous les hommes de l’Art Nouveau
lutteront aussi pour qu’il soit un art du bonheur».[111]
Avec Morris, les thèmes symbolistes s’incarnèrent essentiellement dans l’art
décoratif, qui finit par s'émanciper pour devenir tout simplement le style Art déco avec l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925. L’illustration, bien sûr, mais aussi les motifs de tapisseries, les
dessins sur verre (potiches, vases, vaisselles, poteries) qui répandront les
images végétales qui deviendront l’emblème du Modern Style : «L’adhésion
de Morris au socialisme date de 1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste
et en poète, d’abord soucieux de son œuvre. Il a cependant protesté contre les
massacres de populations chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur
des Irlandais affamés. Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier
parti socialiste organisé en Angleterre - est un pas décisif que les
Conservateurs ne pardonneront pas au tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans
la presse. Morris ne s’entendra d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de
parti: il fondera son propre mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera
les conférences pour prouver à ses auditeurs que l’organisation industrielle
qu’ils subissent est incompatible avec toute idée de bonheur et de beauté».[112] C’est
ainsi que William Morris devint sans doute l’artiste symboliste le plus engagé
politiquement, même si son socialisme appartenait non pas à l’espèce des luttes
de classes mais plutôt à celle des accommodements. être
opprimé”. Ils ont été ses véritables successeurs, le Belge Van de Velde,
professeur à l’Université populaire de Bruxelles, le Français Gallé, membre de
la Ligue des Droits de l’Homme, les Sécessionnistes de Munich groupés autour de
Jugend, la revue de
“l’Anti-Allemagne”. “L’Art Social” sera l’une des composantes de l’Art Nouveau,
ce fait essentiel ne doit jamais être oublié. Pour W. Morris comme pour ses
continuateurs, le souci de la beauté du home fut la pièce maîtresse d’un art au service du peuple».[113] Jusqu’à la fin de
sa vie, il maintint une pareille ardeur à promouvoir le nouveau style décoratif
inspiré des thèmes symbolistes avec la volonté que la condition humaine
s’améliore pour le bénéfice de tous. C’est encore suite à l’un de ces
affrontements rendus coutumiers qu’il fit une dernière intervention sur le
sujet : «La dernière prise de
position publique de Morris avait été une lettre envoyée au Daily Chronicle, le 9 novembre 1893, à propos d’un lock-out
minier. Il y renouvelait sa croyance en l’apparition d’un art qui serait
l’expression d’une société régénérée par le socialisme: “On verra bientôt,
écrivait Morris, naître cet art nouveau qui sera l’expression du plaisir de la
vie et sera fondé sur le bien-être du peuple. Le premier pas à faire vers la
renaissance de l’art doit être l’amélioration de la condition des ouvriers.
Leur existence doit être moins précaire et moins sujette aux privations, leurs
heures de travail doivent être moins nombreuses, leur condition assurée contre
tous les hasards du commerce par des lois. Mais encore une fois cette
amélioration ne pourra être réalisée que par les efforts des travailleurs
eux-mêmes. Par nous et non pour nous doit être leur devise”».[114]
Morris mourut avec la satisfaction de constater que son appel avait été entendu
et que le Modern Style attirait des
artisans en art décoratif soucieux d’une large diffusion des motifs
symbolistes.
être
opprimé”. Ils ont été ses véritables successeurs, le Belge Van de Velde,
professeur à l’Université populaire de Bruxelles, le Français Gallé, membre de
la Ligue des Droits de l’Homme, les Sécessionnistes de Munich groupés autour de
Jugend, la revue de
“l’Anti-Allemagne”. “L’Art Social” sera l’une des composantes de l’Art Nouveau,
ce fait essentiel ne doit jamais être oublié. Pour W. Morris comme pour ses
continuateurs, le souci de la beauté du home fut la pièce maîtresse d’un art au service du peuple».[113] Jusqu’à la fin de
sa vie, il maintint une pareille ardeur à promouvoir le nouveau style décoratif
inspiré des thèmes symbolistes avec la volonté que la condition humaine
s’améliore pour le bénéfice de tous. C’est encore suite à l’un de ces
affrontements rendus coutumiers qu’il fit une dernière intervention sur le
sujet : «La dernière prise de
position publique de Morris avait été une lettre envoyée au Daily Chronicle, le 9 novembre 1893, à propos d’un lock-out
minier. Il y renouvelait sa croyance en l’apparition d’un art qui serait
l’expression d’une société régénérée par le socialisme: “On verra bientôt,
écrivait Morris, naître cet art nouveau qui sera l’expression du plaisir de la
vie et sera fondé sur le bien-être du peuple. Le premier pas à faire vers la
renaissance de l’art doit être l’amélioration de la condition des ouvriers.
Leur existence doit être moins précaire et moins sujette aux privations, leurs
heures de travail doivent être moins nombreuses, leur condition assurée contre
tous les hasards du commerce par des lois. Mais encore une fois cette
amélioration ne pourra être réalisée que par les efforts des travailleurs
eux-mêmes. Par nous et non pour nous doit être leur devise”».[114]
Morris mourut avec la satisfaction de constater que son appel avait été entendu
et que le Modern Style attirait des
artisans en art décoratif soucieux d’une large diffusion des motifs
symbolistes.
 recherche, c’est de rendre une image de la perception, une synthèse des
sensations. Sans doute Schopenhauer a-t-il aussi joué un certain rôle dans
cette conception de la nature. Le symboliste Émile Bernard portait toujours sur
lui un volume des œuvres du philosophe, pendant ses promenades en Bretagne, et
il était fiévreusement discuté à Pont-Aven, par le groupe rassemblé autour de
Gauguin. Justement cette réaction contre le naturalisme, et cette aspiration
consciente vers une synthèse, exprimée en peinture par une ligne de contour
ferme et enveloppante, furent d’une certaine importance pour l’Art Nouveau. Les
courants littéraires contribuent à expliquer le goût du symbole dans le style
art nouveau. Aucun style ensuite n’a été aussi musical, et n’a eu une telle
foison de symboles dans sa forme ornementale».[115]
Cette musicalité allait se retrouver dans les aménagements décoratifs du Modern Style. Déjà, «dans le pastel de Burne-Jones The Pelican, 1881, se trouvent plusieurs des
traits caractéristiques de l’école, par exemple une prédilection très marquée
pour un format haut et étroit, combiné avec un linéarisme vertical. En plus, il
fait usage de la ligne serpentine et ondulante. Nous retrouvons les mêmes
tendances chez Walter Crane, surtout dans ses cartons de 1886-1887 pour une
mosaïque».[116]
Le disciple le plus important de Morris fut, en effet, Walter Crane
(1845-1915), qui devint l’un des animateurs principaux du mouvement artistique
des Arts & Crafts : «La réputation européenne de Walter Crane
fut, en son temps, au moins aussi étendue que celle de son maître. Elle tint à
ses ouvrages pour enfants, unanimement appréciés et imités, et surtout à ses
papiers peints. Toutes les revues d’art de la fin du XIXe siècle leur ont
consacré des articles enthousiastes. L’un des plus significatifs, par son
écriture artiste, est celui qu’Henry Van de Velde publia dans L’Art Moderne de Bruxelles en juin 1893 : “Ce fut
l’émigration spontanée vers les murs de tout son peuple de filles-fleurs et
d’êtres sylvains et tous les animaux partis également des
recherche, c’est de rendre une image de la perception, une synthèse des
sensations. Sans doute Schopenhauer a-t-il aussi joué un certain rôle dans
cette conception de la nature. Le symboliste Émile Bernard portait toujours sur
lui un volume des œuvres du philosophe, pendant ses promenades en Bretagne, et
il était fiévreusement discuté à Pont-Aven, par le groupe rassemblé autour de
Gauguin. Justement cette réaction contre le naturalisme, et cette aspiration
consciente vers une synthèse, exprimée en peinture par une ligne de contour
ferme et enveloppante, furent d’une certaine importance pour l’Art Nouveau. Les
courants littéraires contribuent à expliquer le goût du symbole dans le style
art nouveau. Aucun style ensuite n’a été aussi musical, et n’a eu une telle
foison de symboles dans sa forme ornementale».[115]
Cette musicalité allait se retrouver dans les aménagements décoratifs du Modern Style. Déjà, «dans le pastel de Burne-Jones The Pelican, 1881, se trouvent plusieurs des
traits caractéristiques de l’école, par exemple une prédilection très marquée
pour un format haut et étroit, combiné avec un linéarisme vertical. En plus, il
fait usage de la ligne serpentine et ondulante. Nous retrouvons les mêmes
tendances chez Walter Crane, surtout dans ses cartons de 1886-1887 pour une
mosaïque».[116]
Le disciple le plus important de Morris fut, en effet, Walter Crane
(1845-1915), qui devint l’un des animateurs principaux du mouvement artistique
des Arts & Crafts : «La réputation européenne de Walter Crane
fut, en son temps, au moins aussi étendue que celle de son maître. Elle tint à
ses ouvrages pour enfants, unanimement appréciés et imités, et surtout à ses
papiers peints. Toutes les revues d’art de la fin du XIXe siècle leur ont
consacré des articles enthousiastes. L’un des plus significatifs, par son
écriture artiste, est celui qu’Henry Van de Velde publia dans L’Art Moderne de Bruxelles en juin 1893 : “Ce fut
l’émigration spontanée vers les murs de tout son peuple de filles-fleurs et
d’êtres sylvains et tous les animaux partis également des  albums légendaires se
mirent à les suivre à travers de très rythmiques végétations. Car c’est sur une
architecture d’assez identiques volutes que se déroulent la plupart de ces
épisodes; les lignes de très spéciale souplesse partent en fusées
tirebouchonnantes et se résument en les frises que la tradition anglaise veut
larges excessivement; là, sans heurt trop évident dévie le motif dans le sens
horizontal de la cimaise qu’il se met à longer”. L’art de Walter Crane est un
mélange d’inspirations diverses propre à la période dans laquelle il s’est
épanoui. Un critique belge l’avait bien vu dès 1891 lorsqu’il écrivait : “Aux
influences préraphaélites, à des souvenirs de graveurs allemands et de la
première renaissance italienne, les influences combinées de l’art grec et de
l’art japonais s’ajoutèrent, déterminant une des plus incontestables
personnalités contemporaines”».[117]
Mais Crane n’était pas seul à poursuivre l’évangile de Ruskin et de Morris; «d’une plus vaste envergure fut Arthur H.
Mackmurdo (1851-1942), en qui certains voudraient voir le véritable inventeur
des ornements de flamme qui allaient embraser l’Europe».[118]
albums légendaires se
mirent à les suivre à travers de très rythmiques végétations. Car c’est sur une
architecture d’assez identiques volutes que se déroulent la plupart de ces
épisodes; les lignes de très spéciale souplesse partent en fusées
tirebouchonnantes et se résument en les frises que la tradition anglaise veut
larges excessivement; là, sans heurt trop évident dévie le motif dans le sens
horizontal de la cimaise qu’il se met à longer”. L’art de Walter Crane est un
mélange d’inspirations diverses propre à la période dans laquelle il s’est
épanoui. Un critique belge l’avait bien vu dès 1891 lorsqu’il écrivait : “Aux
influences préraphaélites, à des souvenirs de graveurs allemands et de la
première renaissance italienne, les influences combinées de l’art grec et de
l’art japonais s’ajoutèrent, déterminant une des plus incontestables
personnalités contemporaines”».[117]
Mais Crane n’était pas seul à poursuivre l’évangile de Ruskin et de Morris; «d’une plus vaste envergure fut Arthur H.
Mackmurdo (1851-1942), en qui certains voudraient voir le véritable inventeur
des ornements de flamme qui allaient embraser l’Europe».[118]
 En France également l’art décoratif suivit la
vague venue des îles britanniques. Eugène Grasset (1845-1917) reprenait le
vieux thème, souvent abandonné, du retour à la décoration médiévale. «Au cours de la visite que lui fait Henry
Nocq, en 1896, pour les besoins de sa fameuse enquête sur l’évolution des
industries d’art, Grasset - qui n’en est pas, comme tous ses pareils, à une
contradiction près - condamne formellement le mal suprême, l’archéologie. Il
faut revenir au Moyen Âge, non pour le copier, mais pour reprendre le mouvement
là où la Renaissance l’a interrompu. Comme les imagiers de l’époque médiévale,
on doit trouver dans la nature tous les éléments de décoration désirables. La
nature, voilà le grand livre d’art ornemental à consulter sans cesse».[119]
Évidemment, comme les restaurations de Viollet-le-Duc, le Moyen Âge de Grousset
avait, lui aussi, sa part de fantaisies proprement de son
En France également l’art décoratif suivit la
vague venue des îles britanniques. Eugène Grasset (1845-1917) reprenait le
vieux thème, souvent abandonné, du retour à la décoration médiévale. «Au cours de la visite que lui fait Henry
Nocq, en 1896, pour les besoins de sa fameuse enquête sur l’évolution des
industries d’art, Grasset - qui n’en est pas, comme tous ses pareils, à une
contradiction près - condamne formellement le mal suprême, l’archéologie. Il
faut revenir au Moyen Âge, non pour le copier, mais pour reprendre le mouvement
là où la Renaissance l’a interrompu. Comme les imagiers de l’époque médiévale,
on doit trouver dans la nature tous les éléments de décoration désirables. La
nature, voilà le grand livre d’art ornemental à consulter sans cesse».[119]
Évidemment, comme les restaurations de Viollet-le-Duc, le Moyen Âge de Grousset
avait, lui aussi, sa part de fantaisies proprement de son  époque. Un autre
artisan symboliste, de Nancy, Émile Gallé (1846-1904) fut connu pour ses vases
dessinés aux motifs floraux ou aquatiques : «Gallé mérite d’être classé parmi les Symbolistes. Il avait d’ailleurs une remarquable connaissance, non seulement de Hugo et de Baudelaire, mais
aussi de tous les poètes de son temps qu’il cite sans cesse. Quelquefois,
également, il fait penser à un Des Esseintes envoûté par la nature : “L’artiste
du décor a des missions à remplir, plus hautes peut-être que semer de la joie.
Il tient dans ses mains l’illusion, mais aussi des réalités, les promesses et
la consolation, le mirage et le baume. Je veux que le peintre des murailles qui
m’enserrent soit poète, qu’il soit magicien, qu’il fasse de ces boiseries des
bosquets lointains, de ces tapis des prairies, de ces tentures l’éther où,
captif, j’aspire”».[120]
C’est ici que se confirme combien le Zeitgeist
propre au symbolisme caractérisa l’ensemble des œuvres aussi bien
littéraires qu’artistiques dans l’ensemble de l’Occident. Plus que Morris
encore, Gallé pensait aux décorations d’intérieur des foyers populaires :
«Ce rôle magnifique de décorateur, Gallé,
prêtre de l’art social, ne le pensait pas réservé au service d’une élite. Son
généreux idéalisme a marqué d’un accent particulier l’art nouveau nancéien,
l’art de la fleur dans tout et pour tous : “Certes, écrivait Gallé, je déteste
les idiotes batailles de fleurs; j’hésite même à sacrifier la fleur à
l’agrément, à l’étude. Aujourd’hui, il faut les jeter sous les pieds des
barbares et des païens! Il faut répandre la grâce touchante de leur mort sur
les objets les plus modestes. Qu’importe si des centaines de jolis brins de vie
agonisent dans la poussière sous les bêtes et les fauves pourvu qu’un unique
passant, dans ces foules déshéritées des sentiers fleuris, rapporte
époque. Un autre
artisan symboliste, de Nancy, Émile Gallé (1846-1904) fut connu pour ses vases
dessinés aux motifs floraux ou aquatiques : «Gallé mérite d’être classé parmi les Symbolistes. Il avait d’ailleurs une remarquable connaissance, non seulement de Hugo et de Baudelaire, mais
aussi de tous les poètes de son temps qu’il cite sans cesse. Quelquefois,
également, il fait penser à un Des Esseintes envoûté par la nature : “L’artiste
du décor a des missions à remplir, plus hautes peut-être que semer de la joie.
Il tient dans ses mains l’illusion, mais aussi des réalités, les promesses et
la consolation, le mirage et le baume. Je veux que le peintre des murailles qui
m’enserrent soit poète, qu’il soit magicien, qu’il fasse de ces boiseries des
bosquets lointains, de ces tapis des prairies, de ces tentures l’éther où,
captif, j’aspire”».[120]
C’est ici que se confirme combien le Zeitgeist
propre au symbolisme caractérisa l’ensemble des œuvres aussi bien
littéraires qu’artistiques dans l’ensemble de l’Occident. Plus que Morris
encore, Gallé pensait aux décorations d’intérieur des foyers populaires :
«Ce rôle magnifique de décorateur, Gallé,
prêtre de l’art social, ne le pensait pas réservé au service d’une élite. Son
généreux idéalisme a marqué d’un accent particulier l’art nouveau nancéien,
l’art de la fleur dans tout et pour tous : “Certes, écrivait Gallé, je déteste
les idiotes batailles de fleurs; j’hésite même à sacrifier la fleur à
l’agrément, à l’étude. Aujourd’hui, il faut les jeter sous les pieds des
barbares et des païens! Il faut répandre la grâce touchante de leur mort sur
les objets les plus modestes. Qu’importe si des centaines de jolis brins de vie
agonisent dans la poussière sous les bêtes et les fauves pourvu qu’un unique
passant, dans ces foules déshéritées des sentiers fleuris, rapporte  une fleur à
la maison!”».[121]
Jusqu’à la fin, le Modern Style restera
imbu du socialisme utopique de ses origines. Le docteur Henry Cazalis
(1840-1909), alias Jean Lahor, renouvellera la profession de foi en une amélioration du sort de l’humanité par les arts : «Étudiant en 1901, l’Art Nouveau au point de vue social, Jean Lahor
réclamera, lui aussi, “l’art dans tout” : “Car nous voulons, écrit-il, et c’est
vraiment l’une des tendances encore de l’Art Nouveau, nous voulons donc que
l’art soit distribué à tous, comme l’air et la lumière, et nous voulons qu’il
soit partout, dans la maison de l’artisan comme en la nôtre, et à l’école comme
au collège,
une fleur à
la maison!”».[121]
Jusqu’à la fin, le Modern Style restera
imbu du socialisme utopique de ses origines. Le docteur Henry Cazalis
(1840-1909), alias Jean Lahor, renouvellera la profession de foi en une amélioration du sort de l’humanité par les arts : «Étudiant en 1901, l’Art Nouveau au point de vue social, Jean Lahor
réclamera, lui aussi, “l’art dans tout” : “Car nous voulons, écrit-il, et c’est
vraiment l’une des tendances encore de l’Art Nouveau, nous voulons donc que
l’art soit distribué à tous, comme l’air et la lumière, et nous voulons qu’il
soit partout, dans la maison de l’artisan comme en la nôtre, et à l’école comme
au collège,  comme en toutes ces casernes universitaires, généralement si laides
et lugubres toujours, comme à l’hôpital même, et dans nos gares, partout enfin
où s’assemble une foule humaine, et surtout peut-être une foule populaire”».[122]
À l’ère généralisée du grand
renfermement, les socialistes symbolistes ne voulaient pas que l’humanité
oublie le souffle de la nature, la beauté des astres, la vitalité des oiseaux,
des bêtes et des poissons. Il fallait permettre à la nature, et surtout aux
mystères qu’elle renferme, de pénétrer à nouveau, ne serait-ce que sous la
forme artistique (même mensongère selon Wilde), dans les demeures : peinte
sur les vases, fabriquée dans de la porcelaine, illustrée sur les vitraux
d’abat-jour, gravée en relief sur les tapisseries murale et les tapis de
plancher, tissée dans les rideaux et les tentures. L’ornementation pour ne pas
perdre son humanité, comme un rappel d’un monde ancien, ce que le titre du beau
livre de Peter Laslett rappelait : ce
monde que nous avons perdu.
comme en toutes ces casernes universitaires, généralement si laides
et lugubres toujours, comme à l’hôpital même, et dans nos gares, partout enfin
où s’assemble une foule humaine, et surtout peut-être une foule populaire”».[122]
À l’ère généralisée du grand
renfermement, les socialistes symbolistes ne voulaient pas que l’humanité
oublie le souffle de la nature, la beauté des astres, la vitalité des oiseaux,
des bêtes et des poissons. Il fallait permettre à la nature, et surtout aux
mystères qu’elle renferme, de pénétrer à nouveau, ne serait-ce que sous la
forme artistique (même mensongère selon Wilde), dans les demeures : peinte
sur les vases, fabriquée dans de la porcelaine, illustrée sur les vitraux
d’abat-jour, gravée en relief sur les tapisseries murale et les tapis de
plancher, tissée dans les rideaux et les tentures. L’ornementation pour ne pas
perdre son humanité, comme un rappel d’un monde ancien, ce que le titre du beau
livre de Peter Laslett rappelait : ce
monde que nous avons perdu. symbolisme des œuvres d’élite à la production d’objets décoratifs de
masse, le symbolisme subissait une modification profonde dans la façon
d’aborder ses principes. «On ne peut
s’empêcher de penser aux paroles du Nabi hollandais Jan Verkade : “Il n’existe
pas de tableaux, seulement un décor”».[123]
C’est en ce sens que le Modern Style contribua,
à sa façon, à la dissolution du symbolisme au tournant du XXe siècle. Ainsi, «au moment où le symbolisme se meurt,
l’aspect symbolique de l’Art Nouveau perd également son sens. Il est vrai aussi
que dans la mesure où l’Art Nouveau représente un contre-mouvement, une
réaction contre le passé, il perd sa signification quand on s’est débarrassé du
chaos stylistique du XIXe siècle. Il a montré assez d’énergie pour couper les
ponts avec le passé, mais pas assez cependant pour bâtir l’avenir. Il arrive
alors ce qui est arrivé maintes fois auparavant dans l’histoire du style en
Europe, on se retourne vers les normes bien connues et sans surprises du
classicisme».[124]
Cette époque trouva aussi la fin du symbolisme en littérature où les effets
commencèrent à tenir une place plus importante. On imagine mal la pataphysique
de Jarry sans les costumes de Père Ubu et de sa femme. Ce théâtre de
symbolisme des œuvres d’élite à la production d’objets décoratifs de
masse, le symbolisme subissait une modification profonde dans la façon
d’aborder ses principes. «On ne peut
s’empêcher de penser aux paroles du Nabi hollandais Jan Verkade : “Il n’existe
pas de tableaux, seulement un décor”».[123]
C’est en ce sens que le Modern Style contribua,
à sa façon, à la dissolution du symbolisme au tournant du XXe siècle. Ainsi, «au moment où le symbolisme se meurt,
l’aspect symbolique de l’Art Nouveau perd également son sens. Il est vrai aussi
que dans la mesure où l’Art Nouveau représente un contre-mouvement, une
réaction contre le passé, il perd sa signification quand on s’est débarrassé du
chaos stylistique du XIXe siècle. Il a montré assez d’énergie pour couper les
ponts avec le passé, mais pas assez cependant pour bâtir l’avenir. Il arrive
alors ce qui est arrivé maintes fois auparavant dans l’histoire du style en
Europe, on se retourne vers les normes bien connues et sans surprises du
classicisme».[124]
Cette époque trouva aussi la fin du symbolisme en littérature où les effets
commencèrent à tenir une place plus importante. On imagine mal la pataphysique
de Jarry sans les costumes de Père Ubu et de sa femme. Ce théâtre de  marionnettes
hissé à hauteur d’hommes émanait tout droit de l’esprit symboliste et même
mallarméen : «La “tête de cheval en
carton qu’il se pendrait au cou” pouvait rappeler que la vision du spectateur
se contenterait sans peine d’un détail qui éveille l’attention pour la fixer,
ainsi évoquée, sur une réalité plus ample. Un vrai cheval sur la scène aurait
brisé au contraire cette attention
exigée du public : un réalisme propre aux pièces du théâtre du Boulevard aurait
apporté une possibilité de succès dû à des raisons différentes de celles
désirées par Jarry et que celui-ci ne voulait devoir qu’à une certaine
conception personnelle de l’Art. Par cette “tête de cheval en carton qu’il se
pendrait au cou” Jarry affirmait les principes de recherche de l’absolu qui,
après Mallarmé et Laforgue, menaient les poètes symbolistes à échapper au
mécanisme des routines verbales et visuelles : il fallait saisir la signification à son point d’existence le plus réduit et,
donc, abandonner les accessoires qui flattent la vue mais égarent la vision».[125]
Alfred Jarry (1873-1907), fondateur de la Pataphysique dont il reconnaissait en
Lautréamont un précurseur, était définie par l’un de ses personnages, le
docteur Faustroll, comme étant une
science des solutions
marionnettes
hissé à hauteur d’hommes émanait tout droit de l’esprit symboliste et même
mallarméen : «La “tête de cheval en
carton qu’il se pendrait au cou” pouvait rappeler que la vision du spectateur
se contenterait sans peine d’un détail qui éveille l’attention pour la fixer,
ainsi évoquée, sur une réalité plus ample. Un vrai cheval sur la scène aurait
brisé au contraire cette attention
exigée du public : un réalisme propre aux pièces du théâtre du Boulevard aurait
apporté une possibilité de succès dû à des raisons différentes de celles
désirées par Jarry et que celui-ci ne voulait devoir qu’à une certaine
conception personnelle de l’Art. Par cette “tête de cheval en carton qu’il se
pendrait au cou” Jarry affirmait les principes de recherche de l’absolu qui,
après Mallarmé et Laforgue, menaient les poètes symbolistes à échapper au
mécanisme des routines verbales et visuelles : il fallait saisir la signification à son point d’existence le plus réduit et,
donc, abandonner les accessoires qui flattent la vue mais égarent la vision».[125]
Alfred Jarry (1873-1907), fondateur de la Pataphysique dont il reconnaissait en
Lautréamont un précurseur, était définie par l’un de ses personnages, le
docteur Faustroll, comme étant une
science des solutions 
 une attitude envers la
vie, et qui comportait bien des nuances. Historiquement, elle correspondait au
désir de tailler une place à la beauté dans le dur et matérialiste univers des
Victoriens. Chez les Préraphaélites et chez Ruskin, ce désir s’accompagnait de
justifications morales et religieuses. Chez Walter Pater, dont Wilde, dès
Oxford, se proclama le disciple, ces justifications apparaissaient beaucoup
moins, et le culte de la beauté trouvait davantage en lui-même sa fin, Wilde
devait aller plus loin. Sa religion du beau devint, à la longue, si fanatique qu’elle
se refusait à reconnaître, ou même à prendre au sérieux, d’autres valeurs.
Wilde fut l’esthète pur, intransigeant. Et son esthétisme se nuança presque dès
le début d’immoralisme et de tendances antisociales».[127]
Wilde cultiva très jeune cet esthétisme de lui-même, par son habillement
excentrique, ses réparties flamboyantes et ce qui allait devenir son vice qui ne l’empêcha pas de contracter
mariage et de se montrer bon père de famille. Appartenir aux uraniens, porter l’œillet vert, symbole
de reconnaissance entre homosexuels à une époque où le code criminel pouvait
s’appliquer en toute rigueur à leur pratique, semblait devenir une attitude
proprement préraphaélique. Mais Wilde n’avait pas été le seul à passer par
Oxford et adopter la marginalité sexuelle.
une attitude envers la
vie, et qui comportait bien des nuances. Historiquement, elle correspondait au
désir de tailler une place à la beauté dans le dur et matérialiste univers des
Victoriens. Chez les Préraphaélites et chez Ruskin, ce désir s’accompagnait de
justifications morales et religieuses. Chez Walter Pater, dont Wilde, dès
Oxford, se proclama le disciple, ces justifications apparaissaient beaucoup
moins, et le culte de la beauté trouvait davantage en lui-même sa fin, Wilde
devait aller plus loin. Sa religion du beau devint, à la longue, si fanatique qu’elle
se refusait à reconnaître, ou même à prendre au sérieux, d’autres valeurs.
Wilde fut l’esthète pur, intransigeant. Et son esthétisme se nuança presque dès
le début d’immoralisme et de tendances antisociales».[127]
Wilde cultiva très jeune cet esthétisme de lui-même, par son habillement
excentrique, ses réparties flamboyantes et ce qui allait devenir son vice qui ne l’empêcha pas de contracter
mariage et de se montrer bon père de famille. Appartenir aux uraniens, porter l’œillet vert, symbole
de reconnaissance entre homosexuels à une époque où le code criminel pouvait
s’appliquer en toute rigueur à leur pratique, semblait devenir une attitude
proprement préraphaélique. Mais Wilde n’avait pas été le seul à passer par
Oxford et adopter la marginalité sexuelle.
 Un autre esprit de la même famille fut
l’illustrateur et graveur Aubrey Beardsley (1872-1898), qui, comme Lautréamont
et Rimbaud, passa pour un génie précoce. Il est vrai que, comme le premier, son
décès prématuré jeta une ombre maudite sur son œuvre. Grand lecteur d’Edgar
Poe, dont il illustra les contes, Beardsley fut très tôt atteint de tuberculose
qui devait l’emporter à 26 ans. Sa carrière ne dura elle, que cinq années
(1893-97) et fit ses débuts en exécutant les cinq cents vignettes et
illustrations pour La Morte d’Arthur de
Sir Thomas Malory : «Aubrey
Beardsley était né à Brighton le 21 août 1872. Sa mère dessinait des
silhouettes dans le goût du XVIIIe siècle : l’artiste aura toujours un goût
très vif pour cette époque où il puisera de nombreux thèmes. Aubrey arrive à
Londres en 1888; il travaille d’abord dans une compagnie d’assurances tout en
dessinant et un libraire s’intéresse à lui. […] Les critiques avaient commencé à voir en ce garçon prodige le
successeur de W. Morris, mais ils pensent maintenant de plus en plus se trouver
en face du décadent type. Car Beardsley se crée
Un autre esprit de la même famille fut
l’illustrateur et graveur Aubrey Beardsley (1872-1898), qui, comme Lautréamont
et Rimbaud, passa pour un génie précoce. Il est vrai que, comme le premier, son
décès prématuré jeta une ombre maudite sur son œuvre. Grand lecteur d’Edgar
Poe, dont il illustra les contes, Beardsley fut très tôt atteint de tuberculose
qui devait l’emporter à 26 ans. Sa carrière ne dura elle, que cinq années
(1893-97) et fit ses débuts en exécutant les cinq cents vignettes et
illustrations pour La Morte d’Arthur de
Sir Thomas Malory : «Aubrey
Beardsley était né à Brighton le 21 août 1872. Sa mère dessinait des
silhouettes dans le goût du XVIIIe siècle : l’artiste aura toujours un goût
très vif pour cette époque où il puisera de nombreux thèmes. Aubrey arrive à
Londres en 1888; il travaille d’abord dans une compagnie d’assurances tout en
dessinant et un libraire s’intéresse à lui. […] Les critiques avaient commencé à voir en ce garçon prodige le
successeur de W. Morris, mais ils pensent maintenant de plus en plus se trouver
en face du décadent type. Car Beardsley se crée  systématiquement une réputation
de dépravé et de blasphémateur : il pose au cynique qui aime jouer du piano
avec un squelette installé à côté de lui. Beardsley participe au mouvement qui
transforme l’affiche anglaise à partir de 1894, quand une équipe de jeunes
artistes revient de Paris. On retient surtout celle, de petit format, qui a été
conçue pour les murs des stations du métro londonien, le “Tube”. Il s’agit
d’une affiche pour l’Avenue Theatre qui présente Une comédie de soupirs. Deux tons insolites, pourpre et vert. Une
femme aux sourcils épais et aux lèvres sensuelles attend, énigmatique, derrière
un rideau de gaze. C’est déjà la “Beardsley woman”, l’archétype de la
femme-goule, en loup et gants noirs, que l’artiste va bientôt multiplier avec
un goût pervers. Mêlées à des nudités androgynes, ces créatures infernales vont
épouvanter les imprudents lecteurs du Yellow Book. Il n’est pas possible de tolérer plus longtemps que les hommes
ressemblent à des
systématiquement une réputation
de dépravé et de blasphémateur : il pose au cynique qui aime jouer du piano
avec un squelette installé à côté de lui. Beardsley participe au mouvement qui
transforme l’affiche anglaise à partir de 1894, quand une équipe de jeunes
artistes revient de Paris. On retient surtout celle, de petit format, qui a été
conçue pour les murs des stations du métro londonien, le “Tube”. Il s’agit
d’une affiche pour l’Avenue Theatre qui présente Une comédie de soupirs. Deux tons insolites, pourpre et vert. Une
femme aux sourcils épais et aux lèvres sensuelles attend, énigmatique, derrière
un rideau de gaze. C’est déjà la “Beardsley woman”, l’archétype de la
femme-goule, en loup et gants noirs, que l’artiste va bientôt multiplier avec
un goût pervers. Mêlées à des nudités androgynes, ces créatures infernales vont
épouvanter les imprudents lecteurs du Yellow Book. Il n’est pas possible de tolérer plus longtemps que les hommes
ressemblent à des  femmes et que celles-ci affectent des allures viriles et
surtout une physionomie constamment équivoque».[129]
L'univers de Beardsley, comme celui de Poe ou de Wilde, était hanté par les femmes corpulentes ou vénéneuses, les morts incertaines, l'angoisse de la castration (Salomé). Les allusions médiévales qu'il avait apprises à créer pour La Morte d'Arthur, l'accompagnèrent dans toutes ses compositions ultérieures. Comme dans sa personne, la mort faisait son œuvre. De plus, comme Wilde et Swinburne, Beardsley portait l’œillet vert, et comme l’on était
en plein scandale du procès Wilde, il décida d’aller soigner sa tuberculose en
France : «Pendant les mois qui
suivirent la condamnation de Wilde, les Décadents se turent. En janvier 1896,
un éditeur de livres érotiques, Léonard Smithers, lance un nouveau brulôt, The
Savoy : Beardley fait partie de l’équipe de rédaction. Mais, rongé par la
tuberculose, il est de plus en plus malade. Il se jette dans le catholicisme et
demande à un ami de détruire tous ses dessins obscènes avant de mourir à Menton
le 16 mars 1898. Il avait vingt-six ans».[130]
Non seulement les œuvres de ces auteurs symbolistes encourageaient les
expériences corruptrices des mœurs et attisaient un certain
femmes et que celles-ci affectent des allures viriles et
surtout une physionomie constamment équivoque».[129]
L'univers de Beardsley, comme celui de Poe ou de Wilde, était hanté par les femmes corpulentes ou vénéneuses, les morts incertaines, l'angoisse de la castration (Salomé). Les allusions médiévales qu'il avait apprises à créer pour La Morte d'Arthur, l'accompagnèrent dans toutes ses compositions ultérieures. Comme dans sa personne, la mort faisait son œuvre. De plus, comme Wilde et Swinburne, Beardsley portait l’œillet vert, et comme l’on était
en plein scandale du procès Wilde, il décida d’aller soigner sa tuberculose en
France : «Pendant les mois qui
suivirent la condamnation de Wilde, les Décadents se turent. En janvier 1896,
un éditeur de livres érotiques, Léonard Smithers, lance un nouveau brulôt, The
Savoy : Beardley fait partie de l’équipe de rédaction. Mais, rongé par la
tuberculose, il est de plus en plus malade. Il se jette dans le catholicisme et
demande à un ami de détruire tous ses dessins obscènes avant de mourir à Menton
le 16 mars 1898. Il avait vingt-six ans».[130]
Non seulement les œuvres de ces auteurs symbolistes encourageaient les
expériences corruptrices des mœurs et attisaient un certain  goût pour les
perversions qui brûlaient de braise recouverte par la morale victorienne, mais
elles faisaient de ces goûts le nouveau vice
anglais au regard du continent, comme en témoigne ce qui se passa à Paris après
l’exposition de joaillerie au magasin S. Bing et que commenta Arsène Alexandre,
dans le Figaro du 28 décembre
1895 : «De prime abord, A. Alexandre
déclarait qu’il jugeait la tentative de Bing avec “une sympathie totalement
dépourvue de bienveillance” et manifestait une allergie totale aux pièces
modernes rassemblées par l’un des premiers introducteurs en France de l’art
japonais et chinois. Le critique était sorti du magasin “fatigué, malade,
exaspéré, avec les nerfs à vif et la tête pleine de cauchemars dansants”. Sa
conclusion reflétait la xénophobie et le racisme habituels des milieux de
droite: “Tout cela sent l’Anglais vicieux, la Juive morphinomane ou le Belge
roublards, ou une agréable salade de ces trois poisons”».[131]
Il est vrai que le procès Wilde se déroulait à peu près au même moment où
éclata l’affaire Dreyfus. Le procès Wilde révélait au grand public, comme s’il semblait
l’ignorer, que ces choses dont
parlaient une certaine poésie s’accomplissait pour de vrai dans bien des
comportements. Le décadentisme, pour le reste de l’Europe, serait apparu comme ce
vice anglais si chaque nation n’avait
eu, et souvent en de hauts lieux de la société, ses propres scandales de
perversions sexuelles.
goût pour les
perversions qui brûlaient de braise recouverte par la morale victorienne, mais
elles faisaient de ces goûts le nouveau vice
anglais au regard du continent, comme en témoigne ce qui se passa à Paris après
l’exposition de joaillerie au magasin S. Bing et que commenta Arsène Alexandre,
dans le Figaro du 28 décembre
1895 : «De prime abord, A. Alexandre
déclarait qu’il jugeait la tentative de Bing avec “une sympathie totalement
dépourvue de bienveillance” et manifestait une allergie totale aux pièces
modernes rassemblées par l’un des premiers introducteurs en France de l’art
japonais et chinois. Le critique était sorti du magasin “fatigué, malade,
exaspéré, avec les nerfs à vif et la tête pleine de cauchemars dansants”. Sa
conclusion reflétait la xénophobie et le racisme habituels des milieux de
droite: “Tout cela sent l’Anglais vicieux, la Juive morphinomane ou le Belge
roublards, ou une agréable salade de ces trois poisons”».[131]
Il est vrai que le procès Wilde se déroulait à peu près au même moment où
éclata l’affaire Dreyfus. Le procès Wilde révélait au grand public, comme s’il semblait
l’ignorer, que ces choses dont
parlaient une certaine poésie s’accomplissait pour de vrai dans bien des
comportements. Le décadentisme, pour le reste de l’Europe, serait apparu comme ce
vice anglais si chaque nation n’avait
eu, et souvent en de hauts lieux de la société, ses propres scandales de
perversions sexuelles. opportuniste était à la source de la pornographie,
de l’immoralisme, du galimatias et des barbouillages déments qui prétendaient
succéder à la noble tradition de l’art français. […] Plus grave, elle avait dévitalisé le corps social».[132]
Si «le nationalisme bourgeois s’accorde
fort bien du cosmopolitisme des “citoyens sans patrie, traversant les
frontières et les cultures”: Mucha, Rops, Masek, Schwabe à Paris, Böcklin à
Florence, Burne-Jones à Rome, Linger et Toorop à Bruxelles, Von Marées à
Naples, Villiers de l’Isle-Adam à Lucerne…»,[133]
la bourgeoisie française commença à éprouver des doutes lorsqu’en 1886, on vit
les symbolistes recevoir la dangereuse communarde revenue de son long exil de
la Nouvelle-Calédonie, Louise Michel : «…la “Vierge rouge”, la “Velléda de l’anarchie” que Baju appelle à la
tribune du Décadent, le 20 novembre
de cette même année, pour parler littérature devant Mallarmé, Moréas, Ghil, de
Gourmont, Morice, etc.: “Nos sens sont encore imparfaits, avance Louise Michel,
mais la pensée de l’homme pourra prendre tous les sons, toutes les harmonies,
toutes les formes… Les anarchistes, comme les décadents, veulent
l’anéantissement du vieux monde. Les décadents créent l’anarchie du style.”
Qu’une ligne de démarcation ne puisse être tracée entre décadent et
anarchistes, anarchistes et symbolistes, décadents et symbolistes est d’autant
plus évident que dans le milieu littéraire la confusion règne entre les uns et
les autres : une confusion qui ne passe pas nécessairement par le territoire de
la révolte politique, puisque aussi bien “l’âme bariolée tachetée d’anarchisme”
ne semble pouvoir recouvrir le symbolisme que dans la mesure où, par opposition
à toute tradition, celui-ci prône l’innovation radicale et la levée de tout
interdit : pour se révéler comme riposte à toutes les clôtures».[134]
Se pouvait-il que le symbolisme portât en lui autant de menaces que le réalisme,
allant jusqu’à s’associer avec l’anarchisme comme le second s’associait avec le
marxisme?
opportuniste était à la source de la pornographie,
de l’immoralisme, du galimatias et des barbouillages déments qui prétendaient
succéder à la noble tradition de l’art français. […] Plus grave, elle avait dévitalisé le corps social».[132]
Si «le nationalisme bourgeois s’accorde
fort bien du cosmopolitisme des “citoyens sans patrie, traversant les
frontières et les cultures”: Mucha, Rops, Masek, Schwabe à Paris, Böcklin à
Florence, Burne-Jones à Rome, Linger et Toorop à Bruxelles, Von Marées à
Naples, Villiers de l’Isle-Adam à Lucerne…»,[133]
la bourgeoisie française commença à éprouver des doutes lorsqu’en 1886, on vit
les symbolistes recevoir la dangereuse communarde revenue de son long exil de
la Nouvelle-Calédonie, Louise Michel : «…la “Vierge rouge”, la “Velléda de l’anarchie” que Baju appelle à la
tribune du Décadent, le 20 novembre
de cette même année, pour parler littérature devant Mallarmé, Moréas, Ghil, de
Gourmont, Morice, etc.: “Nos sens sont encore imparfaits, avance Louise Michel,
mais la pensée de l’homme pourra prendre tous les sons, toutes les harmonies,
toutes les formes… Les anarchistes, comme les décadents, veulent
l’anéantissement du vieux monde. Les décadents créent l’anarchie du style.”
Qu’une ligne de démarcation ne puisse être tracée entre décadent et
anarchistes, anarchistes et symbolistes, décadents et symbolistes est d’autant
plus évident que dans le milieu littéraire la confusion règne entre les uns et
les autres : une confusion qui ne passe pas nécessairement par le territoire de
la révolte politique, puisque aussi bien “l’âme bariolée tachetée d’anarchisme”
ne semble pouvoir recouvrir le symbolisme que dans la mesure où, par opposition
à toute tradition, celui-ci prône l’innovation radicale et la levée de tout
interdit : pour se révéler comme riposte à toutes les clôtures».[134]
Se pouvait-il que le symbolisme portât en lui autant de menaces que le réalisme,
allant jusqu’à s’associer avec l’anarchisme comme le second s’associait avec le
marxisme?
 Pourtant rien n’indique, comme on l’a dit, que
le symbolisme eût changé foncièrement la vision de son engagement social. Les
symbolistes restaient des isolés, des affranchis qui ne travaillaient que pour
le petit nombre. Ainsi Puvis de Chavannes – que ses élèves, dont plusieurs
parmi eux se retrouveront parmi les impressionnistes, appelaient Pubis de
Cheval -, «s’était, en 1869 déjà, donné à
cette “volupté aristocratique” qui consiste “à ne penser qu’au très petit
nombre”, à se tenir loin de la “foule versatile et indifférente” pour lui
opposer “l’amour-refuge du beau et du vrai”. Re-tranchement idéaliste.
Détachement apparent. Pour mieux faire de l’image le lieu où se rassemble
l’idéologie dominante».[135]
Ce qui avait changé depuis ce temps, c’était l’ouverture même du symbolisme à
dialoguer avec toutes les formes d’art, y compris l’impressionnisme, rejeton
pourtant du réalisme honni. Madsen remarque ce «trait intéressant du symbolisme [qu']est le lien intime qui existe entre les
écrivains et les autres artistes. Valloton, Maillol, Bonnard, Denis et
Toulouse-Lautrec écrivaient dans les toutes nouvelles revues symbolistes comme La
Plume (1889), Le Mercure de France (1890), et La Revue Blanche (1891). Prouvé et Gallé, eux, travaillaient
en collaboration. Tous les artistes de ce milieu étaient liés les uns aux
autres, et imprégnés des mêmes idées. Nous retrouvons le même phénomène en
Angleterre où Algernon Swinburne, prince des poètes esthétiques, était
intimement lié aux préraphaélites. Il dédie son drame The Queen Mother au poète et peintre Rossetti, et Laus Veneris à Burne Jones, qui, en retour, donna le même titre à l’un de ses
Pourtant rien n’indique, comme on l’a dit, que
le symbolisme eût changé foncièrement la vision de son engagement social. Les
symbolistes restaient des isolés, des affranchis qui ne travaillaient que pour
le petit nombre. Ainsi Puvis de Chavannes – que ses élèves, dont plusieurs
parmi eux se retrouveront parmi les impressionnistes, appelaient Pubis de
Cheval -, «s’était, en 1869 déjà, donné à
cette “volupté aristocratique” qui consiste “à ne penser qu’au très petit
nombre”, à se tenir loin de la “foule versatile et indifférente” pour lui
opposer “l’amour-refuge du beau et du vrai”. Re-tranchement idéaliste.
Détachement apparent. Pour mieux faire de l’image le lieu où se rassemble
l’idéologie dominante».[135]
Ce qui avait changé depuis ce temps, c’était l’ouverture même du symbolisme à
dialoguer avec toutes les formes d’art, y compris l’impressionnisme, rejeton
pourtant du réalisme honni. Madsen remarque ce «trait intéressant du symbolisme [qu']est le lien intime qui existe entre les
écrivains et les autres artistes. Valloton, Maillol, Bonnard, Denis et
Toulouse-Lautrec écrivaient dans les toutes nouvelles revues symbolistes comme La
Plume (1889), Le Mercure de France (1890), et La Revue Blanche (1891). Prouvé et Gallé, eux, travaillaient
en collaboration. Tous les artistes de ce milieu étaient liés les uns aux
autres, et imprégnés des mêmes idées. Nous retrouvons le même phénomène en
Angleterre où Algernon Swinburne, prince des poètes esthétiques, était
intimement lié aux préraphaélites. Il dédie son drame The Queen Mother au poète et peintre Rossetti, et Laus Veneris à Burne Jones, qui, en retour, donna le même titre à l’un de ses



 l’esthète issu d’Oxford et
du symbolisme. Jean des Esseintes, maladif, excentrique, opiomane y passe en
revue ses goûts et ses dégoûts. Fidèle en cela au credo du mouvement, il cherche
la vérité par-delà la réalité
manifeste du monde. Sa vie est meublée par l’oisiveté, les études stériles, la
recherche de parfums raffinés à partir d’un jardin de fleurs vénéneuses. Cette
non-existence se déroule dans une atmosphère décorée des tableaux de Gustave
Moreau et des œuvres de Odilon Redon qui influencèrent l’esthétisme de
Huysmans : «Henri de Régnier affirma
plus tard qu’il était convaincu que les relations personnelles que Huysmans avait
eues avec Moreau et Redon avaient ranimé chez lui “une propension au rêve pur,
une tendance aux exils évasifs hors du présent”. Ainsi que Huysmans l’écrivait
lui-même : “Le tout est […] de savoir
s’abstraire suffisamment pour amener l’hallucination et pouvoir substituer le
rêve de la réalité à la réalité même.” Pour le héros de Huysmans, des
Esseintes, “l’artifice paraissait la marque distinctive du génie de l’homme.
Comme il le disait, la nature a fait son temps; elle a définitivement lassé,
par la dégoûtante uniformité de ces paysages et de ses ciels, l’attentive
patience des raffinés… À n’en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a
maintenant la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu
où il s’agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l’artifice”».[139]
Des Esseintes apparaît comme le parfait représentant de cette
l’esthète issu d’Oxford et
du symbolisme. Jean des Esseintes, maladif, excentrique, opiomane y passe en
revue ses goûts et ses dégoûts. Fidèle en cela au credo du mouvement, il cherche
la vérité par-delà la réalité
manifeste du monde. Sa vie est meublée par l’oisiveté, les études stériles, la
recherche de parfums raffinés à partir d’un jardin de fleurs vénéneuses. Cette
non-existence se déroule dans une atmosphère décorée des tableaux de Gustave
Moreau et des œuvres de Odilon Redon qui influencèrent l’esthétisme de
Huysmans : «Henri de Régnier affirma
plus tard qu’il était convaincu que les relations personnelles que Huysmans avait
eues avec Moreau et Redon avaient ranimé chez lui “une propension au rêve pur,
une tendance aux exils évasifs hors du présent”. Ainsi que Huysmans l’écrivait
lui-même : “Le tout est […] de savoir
s’abstraire suffisamment pour amener l’hallucination et pouvoir substituer le
rêve de la réalité à la réalité même.” Pour le héros de Huysmans, des
Esseintes, “l’artifice paraissait la marque distinctive du génie de l’homme.
Comme il le disait, la nature a fait son temps; elle a définitivement lassé,
par la dégoûtante uniformité de ces paysages et de ses ciels, l’attentive
patience des raffinés… À n’en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a
maintenant la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu
où il s’agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l’artifice”».[139]
Des Esseintes apparaît comme le parfait représentant de cette  forme de vie
prêchée par Puvis de Chavannes, une sorte de taedium vitæ centrée sur l’exploration de ses propres sensations.
Même si on n’y retrouve pas le masochisme de Swinburne, l’atmosphère baigne dans
l’odeur de varech : «Alors “sous le ciel
bas, dans l’air mou, les murs des maisons ont des sueurs noires et leurs
soupiraux fétident; la dégoûtation de l’existence s’accentue et le spleen
écrase; les semailles d’ordures que chacun a dans l’âme éclosent; des besoins
de sales ribotes agitent les gens austères et, dans le cerveau des gens
considérés, des désirs de forçats vont naître”. Chimie des sensations. Énergie
de la sensualité. Le naturalisme est mis en échec».[140]
Ce qui place essentiellement Huysmans dans le cercle des symbolistes, c’est son
mépris des masses démocratiques, son goût pour l’élitisme et surtout la fuite
de la modernité telle que présentée par le réalisme et le naturalisme : «Pour changer d’air (“Je cherchais vaguement
à m’évader d’un cul-de-sac où je suffoquais”), il imagine alors un personnage
tout aussi dégoûté de la vie que ses précédentes marionnettes mais qui, par la
culture et la richesse mises au service d’une imagination exubérante, va, après
des tribulations communes, tenter de fuir toutes les platitudes de l’existence
en vivant la plus extravagante des aventures closes. C’est, en effet, en ne
bougeant pratiquement pas de la villa de banlieue où il a fait retraite que le
duc Jean des Esseintes pousse au paroxysme de l’artifice son goût démesuré du
rare, de l’étrange, du non-pareil en tout genre. Fuyant la vulgarité du siècle,
il fait de ses jours une rhapsodie de sensations exceptionnelles et de sa
maison un kaléidoscope de correspondances “baudelairiennes où les sons, les
couleurs, les parfums, les saveurs et les émotions se répondent dans une
luxueuse harmonie”».[141]
forme de vie
prêchée par Puvis de Chavannes, une sorte de taedium vitæ centrée sur l’exploration de ses propres sensations.
Même si on n’y retrouve pas le masochisme de Swinburne, l’atmosphère baigne dans
l’odeur de varech : «Alors “sous le ciel
bas, dans l’air mou, les murs des maisons ont des sueurs noires et leurs
soupiraux fétident; la dégoûtation de l’existence s’accentue et le spleen
écrase; les semailles d’ordures que chacun a dans l’âme éclosent; des besoins
de sales ribotes agitent les gens austères et, dans le cerveau des gens
considérés, des désirs de forçats vont naître”. Chimie des sensations. Énergie
de la sensualité. Le naturalisme est mis en échec».[140]
Ce qui place essentiellement Huysmans dans le cercle des symbolistes, c’est son
mépris des masses démocratiques, son goût pour l’élitisme et surtout la fuite
de la modernité telle que présentée par le réalisme et le naturalisme : «Pour changer d’air (“Je cherchais vaguement
à m’évader d’un cul-de-sac où je suffoquais”), il imagine alors un personnage
tout aussi dégoûté de la vie que ses précédentes marionnettes mais qui, par la
culture et la richesse mises au service d’une imagination exubérante, va, après
des tribulations communes, tenter de fuir toutes les platitudes de l’existence
en vivant la plus extravagante des aventures closes. C’est, en effet, en ne
bougeant pratiquement pas de la villa de banlieue où il a fait retraite que le
duc Jean des Esseintes pousse au paroxysme de l’artifice son goût démesuré du
rare, de l’étrange, du non-pareil en tout genre. Fuyant la vulgarité du siècle,
il fait de ses jours une rhapsodie de sensations exceptionnelles et de sa
maison un kaléidoscope de correspondances “baudelairiennes où les sons, les
couleurs, les parfums, les saveurs et les émotions se répondent dans une
luxueuse harmonie”».[141] et la magie.
Comme le premier roman, À rebours, Là-bas
est avant tout un roman philosophique sur la nature du Mal. Les
préoccupations métaphysiques de Huysmans y sont de plus en plus présentes, mais
il en est encore au merveilleux spirite, aux êtres femelles mi-humains,
mi-démons qui seraient à la source des érotismes pathologiques : «Pour qu’elles deviennent des individualités,
il leur faut s’objectiver. Et, pour cela, les humains leur sont nécessaires.
Ils le sont de deux manières bien différentes l’une de l’autre. La première est
caractérisée par une totale absence de volonté. L’esprit de l’homme, engourdi
et incapable de s’opposer aux vibrations de la vie cosmique, entre en quelque
sorte en communion avec la nature tout entière. “Tout s’anime, écrit
et la magie.
Comme le premier roman, À rebours, Là-bas
est avant tout un roman philosophique sur la nature du Mal. Les
préoccupations métaphysiques de Huysmans y sont de plus en plus présentes, mais
il en est encore au merveilleux spirite, aux êtres femelles mi-humains,
mi-démons qui seraient à la source des érotismes pathologiques : «Pour qu’elles deviennent des individualités,
il leur faut s’objectiver. Et, pour cela, les humains leur sont nécessaires.
Ils le sont de deux manières bien différentes l’une de l’autre. La première est
caractérisée par une totale absence de volonté. L’esprit de l’homme, engourdi
et incapable de s’opposer aux vibrations de la vie cosmique, entre en quelque
sorte en communion avec la nature tout entière. “Tout s’anime, écrit  notre
auteur, le minéral lui aussi, et une sympathie puissante semble entraîner les
règnes les uns vers les autres.” Cette
sympathie semble uniquement d’ordre érotique. Ce qui attire ainsi les incubes
et fait soupirer les humains, c’est l’instinct sexuel. L’auteur retrouve ainsi
cette image chère à une partie du XIXe siècle finissant, laquelle fait de
l’homme la victime d’une sexualité avilissante et dégradante. La dépendance
passe ici par l’intermonde et sa population de larves. Ceux que les incubes
atteignent ainsi, ce sont “les organismes maladifs, énervés par un célibat
prolongé ou par toute autre cause. Chez eux, la résistance morale est presque
nulle, la volonté atrophiée. Ils sont en quelque sorte
notre
auteur, le minéral lui aussi, et une sympathie puissante semble entraîner les
règnes les uns vers les autres.” Cette
sympathie semble uniquement d’ordre érotique. Ce qui attire ainsi les incubes
et fait soupirer les humains, c’est l’instinct sexuel. L’auteur retrouve ainsi
cette image chère à une partie du XIXe siècle finissant, laquelle fait de
l’homme la victime d’une sexualité avilissante et dégradante. La dépendance
passe ici par l’intermonde et sa population de larves. Ceux que les incubes
atteignent ainsi, ce sont “les organismes maladifs, énervés par un célibat
prolongé ou par toute autre cause. Chez eux, la résistance morale est presque
nulle, la volonté atrophiée. Ils sont en quelque sorte  le réceptacle de toutes
les impressions de l’extérieur. C’est pourquoi l’incubat s’observe surtout dans
les cloîtres. Ces phénomènes étant d’ordre astral, avec violente répercussion
sur le corps physique, avant d’agir sur les parties génitales, affectent
d’abord les organes qui sont le plus en rapport avec le corps astral, les
poumons et les viscères de la poitrine. Une angoisse immense étreint l’être qui
sent l’approche de l’incube ou du succube. La gorge se serre; un commencement
de suffocation se produit, en même temps toutes les muqueuses sont caressées
par des titillements voluptueux. Il semble qu’un amant extraordinairement
expert vous enveloppe, vous pénètre, se fond en vous. La jouissance est alors
insensée, la dépense nerveuse terrible. L’imagination s’exalte, la clairvoyance
somnambulique arrive. Vous voyez distinctement l’âme fantastique et glauque qui
vous travaille, qui vous fait grincer les dents dans les spasmes. Puis soudain,
il s’évanouit. Mais lorsqu’on a supporté une fois cette accointance, l’esprit
reste fortement affecté”».[142]
Il peut paraître paradoxale que Là-bas prépare
la conversion de Huysmans au catholicisme. Comme Léon Bloy, son contemporain,
Huysmans navigait entre son vieux fond
de réalisme et l’aspiration à une spiritualité déficiente dans ce monde
matérialiste et uniquement préoccupé de progrès techniques et d’enrichissements
financiers.
le réceptacle de toutes
les impressions de l’extérieur. C’est pourquoi l’incubat s’observe surtout dans
les cloîtres. Ces phénomènes étant d’ordre astral, avec violente répercussion
sur le corps physique, avant d’agir sur les parties génitales, affectent
d’abord les organes qui sont le plus en rapport avec le corps astral, les
poumons et les viscères de la poitrine. Une angoisse immense étreint l’être qui
sent l’approche de l’incube ou du succube. La gorge se serre; un commencement
de suffocation se produit, en même temps toutes les muqueuses sont caressées
par des titillements voluptueux. Il semble qu’un amant extraordinairement
expert vous enveloppe, vous pénètre, se fond en vous. La jouissance est alors
insensée, la dépense nerveuse terrible. L’imagination s’exalte, la clairvoyance
somnambulique arrive. Vous voyez distinctement l’âme fantastique et glauque qui
vous travaille, qui vous fait grincer les dents dans les spasmes. Puis soudain,
il s’évanouit. Mais lorsqu’on a supporté une fois cette accointance, l’esprit
reste fortement affecté”».[142]
Il peut paraître paradoxale que Là-bas prépare
la conversion de Huysmans au catholicisme. Comme Léon Bloy, son contemporain,
Huysmans navigait entre son vieux fond
de réalisme et l’aspiration à une spiritualité déficiente dans ce monde
matérialiste et uniquement préoccupé de progrès techniques et d’enrichissements
financiers. En cela, même en se convertissant au
catholicisme, les vieilles obsessions de Huysmans demeurèrent. Son Moyen Âge,
comme celui des Préraphaélites, restait une reconstitution purement imaginaire :
«Ce Moyen Âge de Huysmans ne sera pas
celui des universités et de leurs sommes théologiques, - mais celui des
cathédrales, de leur symbolique, de leurs “symbologistes” (pour employer ce mot
si précis qui donne son titre à l’un des chapitres du livre de M. Baldick);
celui des béguinages, et de leurs béates stigmatisées et visionnaires; celui
des monastères et de leur liturgie. Huysmans en cela était bien de son temps…».[143]
Il y avait plus de thèmes ésotériques dans ce catholicisme que de véritables
épreuves spirituelles, comme le souligne Henri Mondor, «Huysmans est tout au Symbolisme catholique, de source divine. Il
préfère, à celle de Littré, la définition de Hugues de Saint-Victor. “Le symbole
est la représentation allégorique d’un principe chrétien sous une forme
sensible”».[144]
Fulcanelli et son mystère des cathédrales n’était plus très loin.
En cela, même en se convertissant au
catholicisme, les vieilles obsessions de Huysmans demeurèrent. Son Moyen Âge,
comme celui des Préraphaélites, restait une reconstitution purement imaginaire :
«Ce Moyen Âge de Huysmans ne sera pas
celui des universités et de leurs sommes théologiques, - mais celui des
cathédrales, de leur symbolique, de leurs “symbologistes” (pour employer ce mot
si précis qui donne son titre à l’un des chapitres du livre de M. Baldick);
celui des béguinages, et de leurs béates stigmatisées et visionnaires; celui
des monastères et de leur liturgie. Huysmans en cela était bien de son temps…».[143]
Il y avait plus de thèmes ésotériques dans ce catholicisme que de véritables
épreuves spirituelles, comme le souligne Henri Mondor, «Huysmans est tout au Symbolisme catholique, de source divine. Il
préfère, à celle de Littré, la définition de Hugues de Saint-Victor. “Le symbole
est la représentation allégorique d’un principe chrétien sous une forme
sensible”».[144]
Fulcanelli et son mystère des cathédrales n’était plus très loin. ressurgiront dans différents courants artistiques ou
idéologiques tout au long du XXe siècle. Voilà pourquoi son biographe, Duployé,
reconnaît qu’«“À Rebours a eu le mérite
de faire prendre conscience aux jeunes d’alors qu’une nouvelle forme de
sensibilité s’était esquissée, …Jean des Esseintes décide de se réfugier loin
de l’incessant déluge de la sottise humaine : anywhere out of the world. Ses nerfs malades exigent un raffinement
extrême : il substitue le rêve à la réalité, et ne supporte le réel que s’il
paraît factice… Ainsi naquit l’âme collective d’une génération dégoûtée de
vivre la vie quotidienne, épuisée de sensations rares et d’irréel… (Hommes pour
qui) leurs accessoires de prédilection jouent le rôle de mots de passe. Ce
langage chiffré permet aux initiés de se reconnaître car il ne cesse de faire
appel aux idoles qu’on vénère : Baudelaire, et par conséquent Edgar Poe, Puvis
de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon, Bresdin, les préraphaélites anglais
qui peignent l’allégorie et le mystère, Richard Wagner, enfin. Les amateurs
d’art possèdent chez eux des reproductions de Beata Beatrix, sainte Cécile,
Salomé : ‘Telle tête de Burne-Jones…, la
jeune fille d’Orphée de Gustave Moreau
nous fera sangloter’ (J. Laforgue). Ils se délectent comme des Esseintes à la
lecture de Villiers de l’Isle-Adam, Verlaine,
ressurgiront dans différents courants artistiques ou
idéologiques tout au long du XXe siècle. Voilà pourquoi son biographe, Duployé,
reconnaît qu’«“À Rebours a eu le mérite
de faire prendre conscience aux jeunes d’alors qu’une nouvelle forme de
sensibilité s’était esquissée, …Jean des Esseintes décide de se réfugier loin
de l’incessant déluge de la sottise humaine : anywhere out of the world. Ses nerfs malades exigent un raffinement
extrême : il substitue le rêve à la réalité, et ne supporte le réel que s’il
paraît factice… Ainsi naquit l’âme collective d’une génération dégoûtée de
vivre la vie quotidienne, épuisée de sensations rares et d’irréel… (Hommes pour
qui) leurs accessoires de prédilection jouent le rôle de mots de passe. Ce
langage chiffré permet aux initiés de se reconnaître car il ne cesse de faire
appel aux idoles qu’on vénère : Baudelaire, et par conséquent Edgar Poe, Puvis
de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon, Bresdin, les préraphaélites anglais
qui peignent l’allégorie et le mystère, Richard Wagner, enfin. Les amateurs
d’art possèdent chez eux des reproductions de Beata Beatrix, sainte Cécile,
Salomé : ‘Telle tête de Burne-Jones…, la
jeune fille d’Orphée de Gustave Moreau
nous fera sangloter’ (J. Laforgue). Ils se délectent comme des Esseintes à la
lecture de Villiers de l’Isle-Adam, Verlaine,  Mallarmé. Ils se rendent en
pèlerinage à Bayreuth, car Wagner a dominé l’épo-
Mallarmé. Ils se rendent en
pèlerinage à Bayreuth, car Wagner a dominé l’épo-






















































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire