L'histoire… n’est pas une science, mais
Sommaire:
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_19.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/lage-de-croissance.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_17.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_16.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_15.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur.html
Bibliographie et Table des Matières
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2011/05/une-histoire-de-saint-jean-sur-richelieu.html
 reproductions photographiques prises au cours des deux
derniers siècles. Tout cela témoigne de l’activité maritime sur le Richelieu.
La première véritable monographie reste cependant celle, publiée en 1937, Saint-Jean-de-Québec, par
le R.-P. Jean-Dominique Brosseau (1867-1945), de l’ordre des Dominicains. Si
nous comparons son ouvrage au genre de monographies de paroisses plutôt
apologétiques que véritablement historiques publiées à l’époque, nous pouvons
nous considérer chanceux d’avoir pu bénéficier de cet ouvrage méthodique. Neuf
ans plus tard, l’historien Gustave Lanctot (1883-1975), archiviste et historien
né à Saint-Constant, présente, en présence des notables de la ville, l’évêque
Mgr Forget et Mgr Armand Chaussé, Supérieur du Collège de Saint-Jean, ainsi que
du maire Alcide Côté, un Bref historique de Saint-Jean du Richelieu, qui
sera publié en brochure chez Ducharme, à Montréal. Ce Bref historique contient
des informations manquantes chez
reproductions photographiques prises au cours des deux
derniers siècles. Tout cela témoigne de l’activité maritime sur le Richelieu.
La première véritable monographie reste cependant celle, publiée en 1937, Saint-Jean-de-Québec, par
le R.-P. Jean-Dominique Brosseau (1867-1945), de l’ordre des Dominicains. Si
nous comparons son ouvrage au genre de monographies de paroisses plutôt
apologétiques que véritablement historiques publiées à l’époque, nous pouvons
nous considérer chanceux d’avoir pu bénéficier de cet ouvrage méthodique. Neuf
ans plus tard, l’historien Gustave Lanctot (1883-1975), archiviste et historien
né à Saint-Constant, présente, en présence des notables de la ville, l’évêque
Mgr Forget et Mgr Armand Chaussé, Supérieur du Collège de Saint-Jean, ainsi que
du maire Alcide Côté, un Bref historique de Saint-Jean du Richelieu, qui
sera publié en brochure chez Ducharme, à Montréal. Ce Bref historique contient
des informations manquantes chez  Brosseau, bien qu’il soit centré sur le
premier siècle et demi de l’histoire de la Ville. Lanctot dit même qu’il n’est
pas nécessaire de poursuivre au-delà «l’évolution de Saint-Jean durant les
trente dernières années, puisque cette période relève de l’histoire
contemporaine, histoire connue et présente dans toutes les mémoires». Pour
Lanctot, il s’agissait surtout de dégager une «belle leçon qui est une leçon
de constance et de durée, de labeur et de progrès» qui montre Saint-Jean
dressée «comme un superbe exemple de fidélité aux vertus ancestrales, de
ténacité dans le labeur et de confiance en l’avenir».[1]
Cette moralité, qui se conforme au genre du conte, voudrait que toute histoire
commence par «Il était une fois…» et se termine par «…ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants». Or, comme nous le verrons, la
conférence de Lanctot survenait au moment même où Saint-Jean vivait une crise,
celle de la modernité, des bouleversements sociaux et la remise en question de
ces valeurs et des hiérarchies. L’intrusion des capitaux étrangers, précisément
à partir du début du siècle - à l'intérieur de ces années que Lanctot refuse
d'évoquer -, menaçaient cette constance et cette fidélité aux vertus
ancestrales. Voilà une apologétique qui ressemble davantage à un chant du
cygne.
Brosseau, bien qu’il soit centré sur le
premier siècle et demi de l’histoire de la Ville. Lanctot dit même qu’il n’est
pas nécessaire de poursuivre au-delà «l’évolution de Saint-Jean durant les
trente dernières années, puisque cette période relève de l’histoire
contemporaine, histoire connue et présente dans toutes les mémoires». Pour
Lanctot, il s’agissait surtout de dégager une «belle leçon qui est une leçon
de constance et de durée, de labeur et de progrès» qui montre Saint-Jean
dressée «comme un superbe exemple de fidélité aux vertus ancestrales, de
ténacité dans le labeur et de confiance en l’avenir».[1]
Cette moralité, qui se conforme au genre du conte, voudrait que toute histoire
commence par «Il était une fois…» et se termine par «…ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants». Or, comme nous le verrons, la
conférence de Lanctot survenait au moment même où Saint-Jean vivait une crise,
celle de la modernité, des bouleversements sociaux et la remise en question de
ces valeurs et des hiérarchies. L’intrusion des capitaux étrangers, précisément
à partir du début du siècle - à l'intérieur de ces années que Lanctot refuse
d'évoquer -, menaçaient cette constance et cette fidélité aux vertus
ancestrales. Voilà une apologétique qui ressemble davantage à un chant du
cygne. Évidemment, chaque période de l’histoire de Saint-Jean a eu ses
historiens. Comment ignorer les ouvrages fouillés de Jacques Castonguay sur le
fort de Saint-Jean? Ou ceux de Réal Fortin qui ont poursuivi l’étude du fait
militaire, allant du rang de la Bataille à la navigation sur le Richelieu. Bateaux
et épaves du Richelieu, publié chez Mille-Roches, est également de 1978.
L’essor du commerce maritime au début du XIXe siècle est le sujet d’une
conférence de J.-Roland Robert, ancien directeur de la Société d’histoire du
Haut-Richelieu. Au cours des récentes décennies ont été produites des thèses
universitaires, dont celle de Kathleen Lord, Municipal aid and industrial
development : Saint-Jean, Quebec,
Évidemment, chaque période de l’histoire de Saint-Jean a eu ses
historiens. Comment ignorer les ouvrages fouillés de Jacques Castonguay sur le
fort de Saint-Jean? Ou ceux de Réal Fortin qui ont poursuivi l’étude du fait
militaire, allant du rang de la Bataille à la navigation sur le Richelieu. Bateaux
et épaves du Richelieu, publié chez Mille-Roches, est également de 1978.
L’essor du commerce maritime au début du XIXe siècle est le sujet d’une
conférence de J.-Roland Robert, ancien directeur de la Société d’histoire du
Haut-Richelieu. Au cours des récentes décennies ont été produites des thèses
universitaires, dont celle de Kathleen Lord, Municipal aid and industrial
development : Saint-Jean, Quebec,  1848–1914, qui nous apporte une
meilleure connaissance de la Banque de Saint-Jean et de son fondateur, Louis
Molleur. En 2011, Jean Gaudette a publié chez Septentrion, L'émergence de la modernité urbaine au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu - 1880-1930 qui se
révèle une véritable mine de renseignements qui seront très utiles pour cette
synthèse. Pour sa part, Lionel Fortin s’est intéressé surtout à la biographie
de personnages importants tels le premier maire, Nelson Mott et Félix-Gabriel
Marchand. La plupart de ces ouvrages sont parues au cours des années 70 du XXe
siècle, ouvrages suscités et publiés dans une époque d’effervescence
nationaliste où le Québec se cherchait une fierté et une identité positive.
Après l’échec référendaire de 1980, le goût de l’histoire a été fortement
détourné pour des savoirs autres, ce qui n’empêche pas les journaux ou la Ville
de publier des reportages historiques lors des fêtes commémoratives.
1848–1914, qui nous apporte une
meilleure connaissance de la Banque de Saint-Jean et de son fondateur, Louis
Molleur. En 2011, Jean Gaudette a publié chez Septentrion, L'émergence de la modernité urbaine au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu - 1880-1930 qui se
révèle une véritable mine de renseignements qui seront très utiles pour cette
synthèse. Pour sa part, Lionel Fortin s’est intéressé surtout à la biographie
de personnages importants tels le premier maire, Nelson Mott et Félix-Gabriel
Marchand. La plupart de ces ouvrages sont parues au cours des années 70 du XXe
siècle, ouvrages suscités et publiés dans une époque d’effervescence
nationaliste où le Québec se cherchait une fierté et une identité positive.
Après l’échec référendaire de 1980, le goût de l’histoire a été fortement
détourné pour des savoirs autres, ce qui n’empêche pas les journaux ou la Ville
de publier des reportages historiques lors des fêtes commémoratives. pêche sera pratiquée commercialement jusqu’au milieu du XXe
siècle) et le trop répandu crapet. Ainsi, 8% des prises totales d’anguilles au
Canada étaient faites dans la baie Missisquoi et le Richelieu encore à la fin
du XXe siècle. D’autre part, le Richelieu s’avère être une voie naturelle pour guider
les oiseaux migrateurs, dont les outardes nous sont les plus familières. Ces
migrations s’effectuent au printemps et à l’automne et plusieurs oiseaux
viennent y nicher pour se reproduire. Des comptages journaliers vont jusqu’à
enregistrer le passage de 100 000 canards et oies sauvages au cours du
printemps. Dans l’ensemble, on y rencontre la bernache du Canada, la grande oie
blanche, le canard noir, le mallard, le pilet, la sarcelle à ailes bleues et la
sarcelle à ailes vertes, le canard huppé, le milouin, le morillon, le garot
commun, le morillon à collier et le bec-scie… On a ainsi enregistré jusqu’à 25
espèces d’oiseaux aquatiques. Outre les grands mammifères tels l’ours, le
chevreuil et le loup, c’est le rat musqué qui s’est avéré, au cours des années,
le plus important animal à fourrure de la vallée du Richelieu, surclassant le
castor, la loutre et le vison. À lui seul, il représente 90% de la récolte des
fourrures.
pêche sera pratiquée commercialement jusqu’au milieu du XXe
siècle) et le trop répandu crapet. Ainsi, 8% des prises totales d’anguilles au
Canada étaient faites dans la baie Missisquoi et le Richelieu encore à la fin
du XXe siècle. D’autre part, le Richelieu s’avère être une voie naturelle pour guider
les oiseaux migrateurs, dont les outardes nous sont les plus familières. Ces
migrations s’effectuent au printemps et à l’automne et plusieurs oiseaux
viennent y nicher pour se reproduire. Des comptages journaliers vont jusqu’à
enregistrer le passage de 100 000 canards et oies sauvages au cours du
printemps. Dans l’ensemble, on y rencontre la bernache du Canada, la grande oie
blanche, le canard noir, le mallard, le pilet, la sarcelle à ailes bleues et la
sarcelle à ailes vertes, le canard huppé, le milouin, le morillon, le garot
commun, le morillon à collier et le bec-scie… On a ainsi enregistré jusqu’à 25
espèces d’oiseaux aquatiques. Outre les grands mammifères tels l’ours, le
chevreuil et le loup, c’est le rat musqué qui s’est avéré, au cours des années,
le plus important animal à fourrure de la vallée du Richelieu, surclassant le
castor, la loutre et le vison. À lui seul, il représente 90% de la récolte des
fourrures.«"Cette année 1897 aura compté pour notre famille. Elle a commencé d’abord par troistremblements de terre qui m’ont terrifiée et ébranlée pour plusieurs mois. Au second, je me suis sauvée à Québec, avec Gaby - sa fille, - mes nerfs ne pouvant plus soutenir l’anxiété où les mettait la crainte d’une autre secousse. C’était à la fin de mars. Jeudi, le 27 mai, jour de l’Ascension, papa était ici dans la soirée, (à Montréal), en route pour Québec. Comme nous causions dans le salon, lui, Raoul et moi, il en vint une autre secousse qui dura plusieurs secondes. Je marchais et n’eus que le temps de me rendre dans le passage et d’attendre là le dénouement, qui fut inoffensif. En somme : plus de bruit que de besogne". Or ceci lui rappelle un souvenir d’enfance, qui garde aussi son intérêt : "Je me souviens du premier tremblement de terre dont j’ai été témoin. J’étais enfant, à Saint-Jean, au premier étage de la maison. J’accourus à la tête de l’escalier et demeurai là, une main sur le poteau et sentant osciller la maison. La seconde fois, c’est il y a quatre ans, chez ma tante Laberge (à Saint-Jean). Le bruit ressemblait au tonnerre et la vaisselle dansa. Quelle sensation!…"»[4]
 l’extrémité des festons de la moraine frontale. Ils se réunirent en
une grande nappe : le lac Alonquin, ancêtre des Grands Lacs. L’écoulement ne se
faisait pas par le Lac Érié et le Saint-Laurent, mais par le Lac Ontario et
l’Hudson. La mer tendait à recouvrir les zones basses pendant les
Interglaciaires, envahissant la Mer de Champlain, à Yoldia arctica».[5]
Lorsque le lobe des glaciers formant un barrage vis-à-vis Québec se retira,
l’eau de mer pénétra dans la Plaine du Saint-Laurent. L’étendue d’eau salée
devint la Mer de Champlain. Avec le retrait des glaciers, le continent se
libéra peu à peu de son manteau de glace, laissant les eaux de la Mer de
Champlain, bordées de plages de sable et de gravier. Ces résidus, auxquels on
donne le nom de terrasses, recouverts d’argiles, constituèrent les
anciens bas-fonds. Le fait que ces diverses plages sont étalées en gradins
semble prouver que le retirement de la mer s’est opéré par à-coups successifs,
entre lesquels le niveau de l’eau est demeuré assez longtemps stationnaire. Le
fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu sont les vestiges des canaux de
drainage lors du relèvement continental.
l’extrémité des festons de la moraine frontale. Ils se réunirent en
une grande nappe : le lac Alonquin, ancêtre des Grands Lacs. L’écoulement ne se
faisait pas par le Lac Érié et le Saint-Laurent, mais par le Lac Ontario et
l’Hudson. La mer tendait à recouvrir les zones basses pendant les
Interglaciaires, envahissant la Mer de Champlain, à Yoldia arctica».[5]
Lorsque le lobe des glaciers formant un barrage vis-à-vis Québec se retira,
l’eau de mer pénétra dans la Plaine du Saint-Laurent. L’étendue d’eau salée
devint la Mer de Champlain. Avec le retrait des glaciers, le continent se
libéra peu à peu de son manteau de glace, laissant les eaux de la Mer de
Champlain, bordées de plages de sable et de gravier. Ces résidus, auxquels on
donne le nom de terrasses, recouverts d’argiles, constituèrent les
anciens bas-fonds. Le fait que ces diverses plages sont étalées en gradins
semble prouver que le retirement de la mer s’est opéré par à-coups successifs,
entre lesquels le niveau de l’eau est demeuré assez longtemps stationnaire. Le
fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu sont les vestiges des canaux de
drainage lors du relèvement continental.
Les sédiments de la Mer de Champlain sont répartis en 3 groupes : les argiles, les sables et les graviers qui proviendraient des matériaux apportés à la mer par le glacier ou encore du remaniement de la moraine de
 fond par le jeu
des vagues. Les dépôts glaciaires furent triés et classés, les fines argiles
étant entraînées par l’action de l’eau vers les profondeurs, alors que les
graviers furent poussés sur la grève, au-dessus des sables. «À en juger par
l’altitude à laquelle nous retrouvons ces dépôts sur les fleuves des vallées,
nous pouvons évaluer à 600 pieds environs, la hauteur atteinte par la Mer
Champlain au-dessus du niveau actuel du fleuve».[6]
De cette argile et de ces graviers, les industriels de la poterie sauront
exploiter les possibilités pour créer les merveilleuses poteries de la St Johns Stone
Chinaware.
fond par le jeu
des vagues. Les dépôts glaciaires furent triés et classés, les fines argiles
étant entraînées par l’action de l’eau vers les profondeurs, alors que les
graviers furent poussés sur la grève, au-dessus des sables. «À en juger par
l’altitude à laquelle nous retrouvons ces dépôts sur les fleuves des vallées,
nous pouvons évaluer à 600 pieds environs, la hauteur atteinte par la Mer
Champlain au-dessus du niveau actuel du fleuve».[6]
De cette argile et de ces graviers, les industriels de la poterie sauront
exploiter les possibilités pour créer les merveilleuses poteries de la St Johns Stone
Chinaware. de ces migrants
vinrent s’établir dans l’est du continent. Ils fabriquaient des pointes de
projectiles de forme lancéolée, à la base concave et portant un élèvement
longitudinal appelé cannelure et qui facilitait son emmanchement. C’est ce que
les anthropologues appellent la culture de Clovis. Ces peuples vivaient
non loin de la Mer de Champlain qui commençait à se vider (vers 12 000 ans). Il
y a 7 000 ans, d’autres petits groupes de chasseurs et de pécheurs commencèrent
à pénétrer dans la Plaine du Saint-Laurent. Nous savons peu de choses du
peuplement de la vallée du Richelieu à part les vestiges de cette période
archaïque retrouvée à la Pointe des Rapides Fryers, près de Chambly. Si nous
devons nous consoler de ne pas avoir trouvé de sépultures, du moins avons-nous
là un site rare de l’archéologie préhistorique : une structure d’habitation qui
peut nous renseigner sur la vie des premiers habitants de la vallée du
Richelieu :
de ces migrants
vinrent s’établir dans l’est du continent. Ils fabriquaient des pointes de
projectiles de forme lancéolée, à la base concave et portant un élèvement
longitudinal appelé cannelure et qui facilitait son emmanchement. C’est ce que
les anthropologues appellent la culture de Clovis. Ces peuples vivaient
non loin de la Mer de Champlain qui commençait à se vider (vers 12 000 ans). Il
y a 7 000 ans, d’autres petits groupes de chasseurs et de pécheurs commencèrent
à pénétrer dans la Plaine du Saint-Laurent. Nous savons peu de choses du
peuplement de la vallée du Richelieu à part les vestiges de cette période
archaïque retrouvée à la Pointe des Rapides Fryers, près de Chambly. Si nous
devons nous consoler de ne pas avoir trouvé de sépultures, du moins avons-nous
là un site rare de l’archéologie préhistorique : une structure d’habitation qui
peut nous renseigner sur la vie des premiers habitants de la vallée du
Richelieu :«Habituellement, on vivait en petites bandes familiales, réparties sur de vastes territoires de chasse. Près d’un cours d’eau, on construisait une petite maison circulaire, de 5 ou 6 mètres de diamètre, probablement soutenue par un pieu central, comme le montre la structure d’habitation des Rapides Fryers (Clermont 74). Un foyer intérieur assurait lachaleur, la cuisson des aliments et le séchage des viandes et poissons. Le père avec ses fils aînés pouvaient s’éloigner du campement pour la trappe, la chasse et la pêche, pendant que la mère, aidée de ses filles, veillait à la préparation des repas, au séchage des viandes, au traitement des peaux et, en saison, à la cueillette. Lorsque le gibier commençait à se faire rare dans les environs et que les chasseurs devaient trop s’éloigner du campement, on le déménageait tout simplement ailleurs. En certaines périodes, comme à la fin de l’été et au début de l’automne, alors que les végétaux sont prêts à être cueillis et que les poissons s’assemblent pour le frai et les migrations, on pouvait se réunir en groupes plus nombreux et ériger de petits villages. Là on collaborait à la quête alimentaire afin d’accumuler certains surplus pour l’hiver, on faisait des échanges, on réalisait les unions, on racontait ses exploits de chasse, on participait aux mythes et on vivait les rituels collectifs».[7]
Les Iroquois, vers 1570 croit-on, sont victimes des Algonkins, champions chasseurs et experts en fabrication de canots. Ils livrent une guerre sans merci aux Iroquois, considérés alors comme des êtres inférieurs. En 1534, Cartier visita la bourgade d’Hochelaga, peuplée d’Iroquois; dès 1609, lors des premiers voyages de Champlain en notre région, ceux-ci sont déjà refoulés au sud du Lac Champlain. Cette guerre prendra une dimensions nouvelle avec l’arrivée des Européens. Hurons et Algonkins s’allient avec les Français, alors que les Iroquois, terrifiés par l’arquebuse meurtrière de Champlain, engagent des alliances avec les Hollandais d’abord, puis les Anglais. Ceux-ci n’hésitent pas à fournir des fusils aux Iroquois alors que les Français refusent toujours de fournir des armes à leurs alliés, de peur de les voir se retourner contre eux. L’effet sera désastreux. Les Hurons et leurs alliés autochtones seront exterminés impitoyablement. Entre 1630 et 1640, la Huronie est réduite de 30 000 à 10 000 individus. Les épidémies et l’acculturation anéantissent ce qui reste de la tribu. Les Iroquois se tournent ensuite contre les Algonkins et les Montagnais qui doivent, pour survivre, s’étioler le long d’un système de réseaux suivant les affluents du Saint-Laurent. Les Algonkins seront quasi anéantis à leur tour ou refoulés loin vers le nord. Cette histoire des confrontations amérindiennes commença par se dérouler dans la vallée du Richelieu.
 Iroquois, conduits
par Samuel de Champlain (±1570-1635), qui avait signé un pacte d’assistance
mutuelle avec les tribus huronnes et algonquines. Champlain, donna à la rivière
le nom de son commanditaire, le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII,
placé à la tête de la Compagnie des Cent Associés. C'est en juin 1603 que
Champlain voulut, pour la première fois, remonter la rivière, mais il dut
s'arrêter à 5 ou 6 lieues de l'embouchure, sa barque ne pouvant plus passer. Il
explora alors les environs et rebroussa chemin. Obligé par ses alliés
autochtones, c'est en 1609 qu'il décida de revenir en menant une campagne
militaire contre leurs ennemis communs, les Iroquois. Parti de Québec avec 12 hommes,
Champlain remonta le fleuve, escorté par des canots hurons, algonkins et
montagnais. Il s'arrêta deux jours à l'embouchure de la rivière où se dresse
aujourd'hui la ville de Sorel afin de s'approvisionner en gibier et poissons.
Cependant, la campagne débuta fort mal. Le conseil de guerre entre les tribus,
indisciplinées, se saborda à cause de conflits de personnalités entre
différents chefs. Plusieurs d'entre eux vont se dissocier de l'expédition.
Iroquois, conduits
par Samuel de Champlain (±1570-1635), qui avait signé un pacte d’assistance
mutuelle avec les tribus huronnes et algonquines. Champlain, donna à la rivière
le nom de son commanditaire, le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII,
placé à la tête de la Compagnie des Cent Associés. C'est en juin 1603 que
Champlain voulut, pour la première fois, remonter la rivière, mais il dut
s'arrêter à 5 ou 6 lieues de l'embouchure, sa barque ne pouvant plus passer. Il
explora alors les environs et rebroussa chemin. Obligé par ses alliés
autochtones, c'est en 1609 qu'il décida de revenir en menant une campagne
militaire contre leurs ennemis communs, les Iroquois. Parti de Québec avec 12 hommes,
Champlain remonta le fleuve, escorté par des canots hurons, algonkins et
montagnais. Il s'arrêta deux jours à l'embouchure de la rivière où se dresse
aujourd'hui la ville de Sorel afin de s'approvisionner en gibier et poissons.
Cependant, la campagne débuta fort mal. Le conseil de guerre entre les tribus,
indisciplinées, se saborda à cause de conflits de personnalités entre
différents chefs. Plusieurs d'entre eux vont se dissocier de l'expédition.Le convoi s'engage sur la rivière et les premiers 15 lieues sont navigués facilement. C'est au bassin de Chambly que les explorateurs doivent s'arrêter à cause des rapides qui se dressent en barrage sérieux et que les Indiens disent infranchissables. Le portage s'impose donc comme seul moyen de franchir les rapides, et au-dessus de cet obstacle, la rivière n'est guère navigable sur une distance de plus de 9 milles. Nous sommes alors au début juillet, les eaux commencent à baisser et Champlain débarque avec 7 hommes pour voir s'il n'y a pas moyen de faire du portage. Peine perdue, son embarcation est trop lourde pour être transportée. Il faut donc franchir les rapides tandis qu'un détachement va prendre la route à travers bois. Champlain ne garde alors avec lui que 2 Français tandis qu'il renvoie les autres à Québec, puis se met à serrer la rive, suivant le trajet du canal actuel en longeant l'île Sainte-Thérèse «qui tient trois lieues de long, remplie des plus beaux pins que j'eusse vus».
Il est fort probable que le rapide de Saint-Jean fut le terme du portage et sur le site de la ville actuelle, Champlain rallia sa petite troupe. Conduite à la manière indienne, précédée d'éclaireurs et suivie de vieux chasseurs chargés de l'approvisionnement, l'expédition s'achemine vers le Lac Champlain. Si les îles du Richelieu que Champlain rencontre sont recouvertes d'épaisses futaies, elles sont en outre, habitées de chevreuils, de cerfs et d'ours. Les canots ne voyagent que de nuit afin de ne pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Finalement, l'explorateur atteint l'immense nappe d'eau qui porte aujourd'hui son nom, puis de là, transfère dans le lac Saint-Sacrement (lac George), et c'est sur le site actuel de Crown Point qu'il rencontra définitivement les Iroquois.
La suite est assez connue. Champlain impressionna les Iroquois avec une mise en scène dans la disposition du rang de bataille et surtout par l'arquebuse qui crache du feu en couchant deux ou trois des chefs ennemis. Cette première rencontre se solda par une victoire des alliés français qui firent 12 prisonniers que les Hurons s'attardèrent à «horriblement» torturer. Champlain voulut bien les en empêcher, mais le rapport de force qu'il représentait n'était pas suffisant. Forts de leur succès, les alliés revinrent à Québec et, une année plus tard, c'est la revanche des Iroquois à l'embouchure du Richelieu. Désormais approvisionnés en armes par les Hollandais de Fort Orange (Albany), les Iroquois s'acharneront contre Champlain et ses alliés. Les dangers que représentait la rivière des Iroquois retarda longtemps la colonisation de la vallée.
«Nous fûmes deux jours à remonter cette rivière jusqu'à une chute d'eau (le rapide deChambly) qui nous força de mettre pied à terre et de marcher 6 jours dans les bois. (C'était suivre la route le long de l'île Sainte-Thérèse pour atteindre la tête du Rapide de Saint-Jean)… Je ne raconterai pas ici tout ce que j’eus à souffrir dans ce voyage, il suffit de dire que nous avions à porter nos bagages dans les bois, par des chemins non frayés, où l’on ne trouve que des pierres, des ronces, des trous, de l’eau et de la neige; celle-ci n’avait pas encore entièrement disparu. Nous étions nu-pieds, et nous restions à jeun quelquefois jusqu’à 3 et 4 heures après-midi, et souvent pendant la journée entière, exposés à la pluie et mouillés jusqu’aux os. Nous avions même à traverser quelque fois des torrents et des rivières…»[8]
 Entretemps, revenu en Nouvelle-France, le Père Jogues est envoyé comme
ambassadeur auprès des Iroquois pour ratifier un traité de paix signé en 1646
aux Trois-Rivières. La mission obtint un tel succès que le Père veut y
retourner pour évangéliser les Iroquois, apaisé semble-t-il. Le 24 septembre
1646, pour la troisième fois, accompagné du donné Jean de La Lande et de 4 Hurons,
il s’embarque sur la rivière des Iroquois. Arrivés au lac
Saint-Sacrement, et «après un revirement d’humeur», les Iroquois
s’emparent d’eux, les tiennent prisonniers puis les tuent.
Entretemps, revenu en Nouvelle-France, le Père Jogues est envoyé comme
ambassadeur auprès des Iroquois pour ratifier un traité de paix signé en 1646
aux Trois-Rivières. La mission obtint un tel succès que le Père veut y
retourner pour évangéliser les Iroquois, apaisé semble-t-il. Le 24 septembre
1646, pour la troisième fois, accompagné du donné Jean de La Lande et de 4 Hurons,
il s’embarque sur la rivière des Iroquois. Arrivés au lac
Saint-Sacrement, et «après un revirement d’humeur», les Iroquois
s’emparent d’eux, les tiennent prisonniers puis les tuent. Tracy. En plus de 22
hommes du régiment, Tracy emmène avec lui les 4 compagnies d’Orléans, de
Groglie, de Chambellé et de Poitou, ce qui porte les forces de l’expédition à 1
200 hommes. Le but de la mission est d’exterminer entièrement les
Iroquois et, pour ce faire, on conçoit un plan en deux étapes : d’abord, assurer
la maîtrise du Richelieu en construisant un chapelet de forts puis, de là,
aller écraser l’ennemi chez lui. Ce commandement bicéphale est souvent l’objet
de conflits de personnalités entre Salières et Tracy, un caractère autoritaire
et prétentieux. On commence la réalisation du plan militaire le 25
août 1665, par la construction d’un fort à l’embouchure du Richelieu afin de
fermer l’accès au Saint-Laurent. Le fort sera donné en commandement au
capitaine Pierre de Saurel. Plus haut sur le Richelieu, M. de Chambly plante
une palissade carrée de 144 pieds de côté par 15 de hauteur qui devient le fort
Saint-Louis (ou Chambly) devant servir d’entrepôt et de refuge aux éventuels
colons. Le 2 octobre suivant, à 3 lieues plus haut que le fort, M. de Salières lui-même,
à la tête de 7 compagnies, entreprend la construction du fort Saint-Thérèse.
Tracy. En plus de 22
hommes du régiment, Tracy emmène avec lui les 4 compagnies d’Orléans, de
Groglie, de Chambellé et de Poitou, ce qui porte les forces de l’expédition à 1
200 hommes. Le but de la mission est d’exterminer entièrement les
Iroquois et, pour ce faire, on conçoit un plan en deux étapes : d’abord, assurer
la maîtrise du Richelieu en construisant un chapelet de forts puis, de là,
aller écraser l’ennemi chez lui. Ce commandement bicéphale est souvent l’objet
de conflits de personnalités entre Salières et Tracy, un caractère autoritaire
et prétentieux. On commence la réalisation du plan militaire le 25
août 1665, par la construction d’un fort à l’embouchure du Richelieu afin de
fermer l’accès au Saint-Laurent. Le fort sera donné en commandement au
capitaine Pierre de Saurel. Plus haut sur le Richelieu, M. de Chambly plante
une palissade carrée de 144 pieds de côté par 15 de hauteur qui devient le fort
Saint-Louis (ou Chambly) devant servir d’entrepôt et de refuge aux éventuels
colons. Le 2 octobre suivant, à 3 lieues plus haut que le fort, M. de Salières lui-même,
à la tête de 7 compagnies, entreprend la construction du fort Saint-Thérèse.«Il avait la forme d’un rectangle et mesurait environ 150 pieds sur 90. Chaque coin du rectangle se prolongeait en bastion. Un fossé de 4 pieds de profondeur et d’un pied de largeur fut d’abord creusé pour recevoir les pieux de la palissade qui s’élevaient à 15 pieds au-dessus du sol. Pour assurer une meilleure protection aux éventuels tireurs, d’autres pieux, moins élevés furent plantés à l’intérieur en guise de double palissade. Enfin, la banquette de tir (sorte de plate-forme pour les tireurs) s’élevait à un pied et demi au-dessus du sol».[9]
 Frédière entraîna
sa disgrâce. Le 6 janvier 1666, les plus hautes autorités de la colonie, dont
Courcelle et le nouvel intendant, Jean Talon, arrivés tous deux sur les mêmes
navires qui transportaient le régiment de Carignan, se réunissent pour discuter
d’une stratégie de campagne. Jusque-là, M. de Salières tenait résidence au fort
Sainte-Thérèse, prêt à porter combat à l’ennemi. Les stratèges prévoient tout
dans les moindres détails, sauf la rigueur du climat canadien pour des soldats
européens. Ayant préparé une expédition à l’européenne, les forces françaises
qui comprennent 500 hommes dirigés par le gouverneur en personne, parcourent
une longue marche de Québec à Trois-Rivières, puis de là à l’embouchure du
Richelieu. Finalement regroupés au fort Saint-Thérèse, elles sont encouragées
par l’arrivée d’un renfort de soldats bien aguerris et équipés à la mode des
trappeurs. Ce sont les officiers Chambly, Rougemont, Petit et Mignardé avec
leurs compagnies, puis Charles Le Moyne avec 70 volontaires de Montréal. Ce
sont des soldats chevronnés qui connaissent bien l’Iroquois pour l’avoir
pourchassé à plusieurs reprises. L’expédition se met en route le 30 janvier,
comprenant de 500 à 600 braves.
Frédière entraîna
sa disgrâce. Le 6 janvier 1666, les plus hautes autorités de la colonie, dont
Courcelle et le nouvel intendant, Jean Talon, arrivés tous deux sur les mêmes
navires qui transportaient le régiment de Carignan, se réunissent pour discuter
d’une stratégie de campagne. Jusque-là, M. de Salières tenait résidence au fort
Sainte-Thérèse, prêt à porter combat à l’ennemi. Les stratèges prévoient tout
dans les moindres détails, sauf la rigueur du climat canadien pour des soldats
européens. Ayant préparé une expédition à l’européenne, les forces françaises
qui comprennent 500 hommes dirigés par le gouverneur en personne, parcourent
une longue marche de Québec à Trois-Rivières, puis de là à l’embouchure du
Richelieu. Finalement regroupés au fort Saint-Thérèse, elles sont encouragées
par l’arrivée d’un renfort de soldats bien aguerris et équipés à la mode des
trappeurs. Ce sont les officiers Chambly, Rougemont, Petit et Mignardé avec
leurs compagnies, puis Charles Le Moyne avec 70 volontaires de Montréal. Ce
sont des soldats chevronnés qui connaissent bien l’Iroquois pour l’avoir
pourchassé à plusieurs reprises. L’expédition se met en route le 30 janvier,
comprenant de 500 à 600 braves. commerçants hollandais, depuis peu passés sous domination anglaise,
l’armée de M. de Courcelle n’a plus rien d’impressionnante car le voyage à
travers les forêts, en plein hiver, l’a réduite à l’état d’une véritable loque.
Il est heureux qu’elle n’ait pas eu à faire face à l’ennemi. Le retour sera encore
plus pénible. Les Iroquois, chaussés de raquettes qui leur permettent de se
déplacer plus commodément et rapidement, ne cessent de harceler la petite
troupe, tuant en diverses escarmouches 5 ou 6 soldats, un lieutenant, blessant
2 capitaines et 2 volontaires dont l’un meurt suite à ses blessures. Rendu au
20 février, les Français doivent retraiter de nuit et parviennent enfin au fort
Sainte-Thérèse dans un état pitoyable. Ce désastre entraînera les militaires à
choisir éventuellement deux autres sites sur lesquels élever des forts. Ce
seront les forts Saint-Jean et Sainte-Anne appelés à servir de relais et de
tremplins pour une éventuelle revanche prévue pour l’automne 1666. Le fort
Sainte-Thérèse ne jouera plus désormais de rôle de tête de pont. Abandonné dès
1667, il recevra occasionnellement une garnison et restera un entrepôt de
vivres et de munitions approvisionnant le fort Saint-Frédéric. Le seigneur de
Bleury y tiendra un magasin militaire et un fourneau à goudron. Peu à peu, des
maisons seront construites aux alentours jusqu’en juin 1760 quand le major
anglais Rogers y mettra le feu. En août de la même année, les troupes de
Haviland viendront s’y installer et dresseront d’importants retranchements sur
l’emplacement où jadis s’élevait le fort Sainte-Thérèse.[10]
commerçants hollandais, depuis peu passés sous domination anglaise,
l’armée de M. de Courcelle n’a plus rien d’impressionnante car le voyage à
travers les forêts, en plein hiver, l’a réduite à l’état d’une véritable loque.
Il est heureux qu’elle n’ait pas eu à faire face à l’ennemi. Le retour sera encore
plus pénible. Les Iroquois, chaussés de raquettes qui leur permettent de se
déplacer plus commodément et rapidement, ne cessent de harceler la petite
troupe, tuant en diverses escarmouches 5 ou 6 soldats, un lieutenant, blessant
2 capitaines et 2 volontaires dont l’un meurt suite à ses blessures. Rendu au
20 février, les Français doivent retraiter de nuit et parviennent enfin au fort
Sainte-Thérèse dans un état pitoyable. Ce désastre entraînera les militaires à
choisir éventuellement deux autres sites sur lesquels élever des forts. Ce
seront les forts Saint-Jean et Sainte-Anne appelés à servir de relais et de
tremplins pour une éventuelle revanche prévue pour l’automne 1666. Le fort
Sainte-Thérèse ne jouera plus désormais de rôle de tête de pont. Abandonné dès
1667, il recevra occasionnellement une garnison et restera un entrepôt de
vivres et de munitions approvisionnant le fort Saint-Frédéric. Le seigneur de
Bleury y tiendra un magasin militaire et un fourneau à goudron. Peu à peu, des
maisons seront construites aux alentours jusqu’en juin 1760 quand le major
anglais Rogers y mettra le feu. En août de la même année, les troupes de
Haviland viendront s’y installer et dresseront d’importants retranchements sur
l’emplacement où jadis s’élevait le fort Sainte-Thérèse.[10] Casson, Sulpicien et MM. Albanel et Haffeix, Jésuites) sont du voyage. Suite à
un retard, la troupe quitte le fort Sainte-Thérèse le 28 septembre et atteint
les bourgades iroquoises au moment où le temps commence à se gâter. M. de Tracy
et ses hommes prennent d’assaut les deux premières bourgades qu’ils
rencontrent, mais l’alarme ayant été donnée, les Iroquois s’étaient enfuis des
autres villages que les Français trouvèrent désertés. Alors, le commandant fait
mettre le feu et jette les provisions à la rivière ou tout simplement, les fait
brûler. Ainsi réduits par le froid et la faim, M. de Tracy espérait bien
enlever aux Iroquois le goût de revenir terroriser la colonie. «Les
résultats acquis étaient satisfaisants sans être tout à fait rassurants»
(R.P. Brosseau). Le sachant très bien, Tracy renforce les positions du
Richelieu. Cela implique qu’il faut «serrer» les constructions militaires. On
commence à élever, à l’entrée du lac Champlain, le futur fort Sainte-Anne, et
un autre à la tête des rapides de Saint-Jean, qui servira de base et d’appui au
plus avancé. Plus tard s’ajouteront à cette chaîne les forts de l’île-aux-Noix,
Saint-Frédéric et Carillon, les derniers bastions de la colonie française.
Casson, Sulpicien et MM. Albanel et Haffeix, Jésuites) sont du voyage. Suite à
un retard, la troupe quitte le fort Sainte-Thérèse le 28 septembre et atteint
les bourgades iroquoises au moment où le temps commence à se gâter. M. de Tracy
et ses hommes prennent d’assaut les deux premières bourgades qu’ils
rencontrent, mais l’alarme ayant été donnée, les Iroquois s’étaient enfuis des
autres villages que les Français trouvèrent désertés. Alors, le commandant fait
mettre le feu et jette les provisions à la rivière ou tout simplement, les fait
brûler. Ainsi réduits par le froid et la faim, M. de Tracy espérait bien
enlever aux Iroquois le goût de revenir terroriser la colonie. «Les
résultats acquis étaient satisfaisants sans être tout à fait rassurants»
(R.P. Brosseau). Le sachant très bien, Tracy renforce les positions du
Richelieu. Cela implique qu’il faut «serrer» les constructions militaires. On
commence à élever, à l’entrée du lac Champlain, le futur fort Sainte-Anne, et
un autre à la tête des rapides de Saint-Jean, qui servira de base et d’appui au
plus avancé. Plus tard s’ajouteront à cette chaîne les forts de l’île-aux-Noix,
Saint-Frédéric et Carillon, les derniers bastions de la colonie française. C’est donc tard dans l’automne 1666 qu’on éleva le premier fort
Saint-Jean. M. de Salières, second de Tracy, s’occupa personnellement de
l’érection du fort qui n’était probablement qu’une construction en bois
protégée par une enceinte de pieux plantés à la hâte, moins solide que les murs
de pierres du fort Chambly. Pour cause, on ne pensait s’en servir que comme
point de ravitaillement. Ce n’est que plus tard qu’il servira de point d’appui
aux postes de Saint-Frédéric, de Carillon et de l’Île-aux-Noix. Il fut placé
sous la responsabilité d’Alexandre Berthier (1638-1708), premier commandant du
fort Saint-Jean On sait que Mgr de Laval s’y arrêta en 1668, mais,
contrairement aux forts situés dans le Bas-Richelieu, où, une fois les Iroquois
pacifiés, les soldats se transformèrent en colons, établissant les premiers
villages sous la direction de leurs commandants, Saurel et Saint-Ours, le fort
Saint-Jean demeura quasi isolé. Pour effet, nous ignorons son emplacement
précis. Le bon sens,
C’est donc tard dans l’automne 1666 qu’on éleva le premier fort
Saint-Jean. M. de Salières, second de Tracy, s’occupa personnellement de
l’érection du fort qui n’était probablement qu’une construction en bois
protégée par une enceinte de pieux plantés à la hâte, moins solide que les murs
de pierres du fort Chambly. Pour cause, on ne pensait s’en servir que comme
point de ravitaillement. Ce n’est que plus tard qu’il servira de point d’appui
aux postes de Saint-Frédéric, de Carillon et de l’Île-aux-Noix. Il fut placé
sous la responsabilité d’Alexandre Berthier (1638-1708), premier commandant du
fort Saint-Jean On sait que Mgr de Laval s’y arrêta en 1668, mais,
contrairement aux forts situés dans le Bas-Richelieu, où, une fois les Iroquois
pacifiés, les soldats se transformèrent en colons, établissant les premiers
villages sous la direction de leurs commandants, Saurel et Saint-Ours, le fort
Saint-Jean demeura quasi isolé. Pour effet, nous ignorons son emplacement
précis. Le bon sens,  aidé d’indices archéologiques, laissent croire que son
emplacement original se situait sur le terrain où s’élève l’actuel Collège
Militaire Royal, endroit des plus propices à la navigation libre jusqu’à la
tête du lac Champlain. Sa construction n’est pas située avec exactitude dans le
temps. Nous savons qu’il fut construit en automne 1666 et les documents nous
suggèrent un laps de temps allant du 15 août (le Père Le Mercier) jusqu’à la
fin même de l’automne (Benjamin Sulte). Ainsi, le défrichement du site actuel
de la ville aurait commencé au début d’août 1666. La Relation du Père Le
Mercier donne le nom de L’Assomption au fort situé entre le fort Sainte-Thérèse
et le fort Sainte-Anne, «la coutume de l’époque voulait que l’on nommât les
forts en suivant le calendrier des fêtes religieuses», et le 15 août est la
fête de l’Assomption. Mais le fort aurait vu son nom changé pour celui de fort
Saint-Jean-Baptiste, en l’honneur du ministre Jean-Baptiste Colbert.
aidé d’indices archéologiques, laissent croire que son
emplacement original se situait sur le terrain où s’élève l’actuel Collège
Militaire Royal, endroit des plus propices à la navigation libre jusqu’à la
tête du lac Champlain. Sa construction n’est pas située avec exactitude dans le
temps. Nous savons qu’il fut construit en automne 1666 et les documents nous
suggèrent un laps de temps allant du 15 août (le Père Le Mercier) jusqu’à la
fin même de l’automne (Benjamin Sulte). Ainsi, le défrichement du site actuel
de la ville aurait commencé au début d’août 1666. La Relation du Père Le
Mercier donne le nom de L’Assomption au fort situé entre le fort Sainte-Thérèse
et le fort Sainte-Anne, «la coutume de l’époque voulait que l’on nommât les
forts en suivant le calendrier des fêtes religieuses», et le 15 août est la
fête de l’Assomption. Mais le fort aurait vu son nom changé pour celui de fort
Saint-Jean-Baptiste, en l’honneur du ministre Jean-Baptiste Colbert. un
magasin pour les armes et provisions. Un mémoire de Talon datant de 1667
atteste que 20 hommes et un sergent sont en fonction au fort Saint-Jean et le
premier commandant de la garnison du fort est le capitaine Alexandre Berthier
du régiment de Carignan qui avait participé à l’expédition de Tracy. En 1669,
le minutieux intendant Talon, commentant l’administration de la Compagnie des
Indes Occidentales, évalue ainsi les dépenses pour la construction et
l’entretien des forts du Richelieu : «En 1665 (…) pour la première
construction des cinq forts avancés, Richelieu, Saint-Louis et Sainte-Thérèse,
durant la première année, leur augmentation par Saint-Jean et Sainte-Anne, et
entretien dans les trois suivantes, a été dépensé la somme de 15,000 livres».[11]
En 1672, une route reliant les différents forts du Richelieu était achevée,
mais dès l’installation du nouveau gouverneur, Louis de Buade, comte de
Frontenac, qui entre très vite en opposition avec l’intendant Talon, ordonne
d’abandonner le fort Saint-Jean qui sera brûlé peu après, très probablement par
les Iroquois.
un
magasin pour les armes et provisions. Un mémoire de Talon datant de 1667
atteste que 20 hommes et un sergent sont en fonction au fort Saint-Jean et le
premier commandant de la garnison du fort est le capitaine Alexandre Berthier
du régiment de Carignan qui avait participé à l’expédition de Tracy. En 1669,
le minutieux intendant Talon, commentant l’administration de la Compagnie des
Indes Occidentales, évalue ainsi les dépenses pour la construction et
l’entretien des forts du Richelieu : «En 1665 (…) pour la première
construction des cinq forts avancés, Richelieu, Saint-Louis et Sainte-Thérèse,
durant la première année, leur augmentation par Saint-Jean et Sainte-Anne, et
entretien dans les trois suivantes, a été dépensé la somme de 15,000 livres».[11]
En 1672, une route reliant les différents forts du Richelieu était achevée,
mais dès l’installation du nouveau gouverneur, Louis de Buade, comte de
Frontenac, qui entre très vite en opposition avec l’intendant Talon, ordonne
d’abandonner le fort Saint-Jean qui sera brûlé peu après, très probablement par
les Iroquois. les lieux quasi désertés. La seigneurie de
Sabrevois de Bleury était située sur la rive droite du Richelieu. De Bleury
pouvait se présenter comme un seigneur, mais il pratiquait surtout le commerce,
et son talent pratique rendit de grands services d’approvisionnement des forts quand
il mit aux ordres de l’intendance ses ressources de munitionnaire. On a vu
qu’il avait construit, en 1741, auprès du vieux fort Sainte-Thérèse, un magasin
pour les provisions destinées au fort Saint-Frédéric.
les lieux quasi désertés. La seigneurie de
Sabrevois de Bleury était située sur la rive droite du Richelieu. De Bleury
pouvait se présenter comme un seigneur, mais il pratiquait surtout le commerce,
et son talent pratique rendit de grands services d’approvisionnement des forts quand
il mit aux ordres de l’intendance ses ressources de munitionnaire. On a vu
qu’il avait construit, en 1741, auprès du vieux fort Sainte-Thérèse, un magasin
pour les provisions destinées au fort Saint-Frédéric.«Il fallait construire les barques pour transporter munitions et vivres au Fort lointain de Saint-Frédéric. Le bois ne manquait pas, mais bien le goudron, pour rendre étanches ces embarcations de fortune, construites à la hâte. Tout auprès du Fort de Sainte-Thérèse, Bleury se construisit un four à goudron. Les pins et autres résineux abondaient sur l’île, rien de plus facile que d’en recueillir la poix. Son commerce lui permettait d’obtenir les huiles et corps gras, et le tout mélangé dans ses fourneaux donnait à l’Intendance une substance de première nécessité, peu dispendieuse et rémunératrice pour l’ingénieux fournisseur. Lorsque le Fort de Saint-Jean fut reconstruit en 1748, le magasin et tout le matériel du Fort de Sainte-Thérèse y fut transporté. Le four dut continuer encore à fonctionner, aussi longtemps du moins qu’on eut besoin de ses services pour la construction de bateaux».[12]
 parcelle de terre était «le fait français
en ces lieux», c’est-à-dire la présence de colons. Le 1er avril 1733, le
sieur Clément Sabrevois de Bleury reçoit la concession où se dresse aujourd’hui
la ville d’Iberville. Les chênes de sa concession serviront à construire des
Vaisseaux du Roy. Yvonne Labelle, dans sa Monographie d’Iberville, rappelle
comment «Clément de Sabrevois, officier de l’armée canadienne, s’adonnait au
commerce et à l’industrie. Il était propriétaire de scieries, de ferme, de
maisons. Il s’occupait à construire des bateaux pour le service de Sa Majesté.
Ainsi par une Ordonnance des "Intendants du Canada’ de 1730 à 1731… il était
permis aux Sieurs Abbé Lepage et de Bleury" de faire exploiter sur
diverses seigneuries, 2 000 pieds cubes de chêne, pour la construction d’une
Flûte de 500 tonneaux pour le service du Roi, du cinquième octobre 1731. Signé
: Hocquart (Intendant)"».[13]
Voyant que Bleury ne respecte pas l’obligation d’établir des colons sur sa
seigneurie, le gouverneur Beauharnois et l’indendant Hocquart la lui retirent,
en attendant que son ami, l’intendant Bigot, la lui restitue (30 octobre 1750).
parcelle de terre était «le fait français
en ces lieux», c’est-à-dire la présence de colons. Le 1er avril 1733, le
sieur Clément Sabrevois de Bleury reçoit la concession où se dresse aujourd’hui
la ville d’Iberville. Les chênes de sa concession serviront à construire des
Vaisseaux du Roy. Yvonne Labelle, dans sa Monographie d’Iberville, rappelle
comment «Clément de Sabrevois, officier de l’armée canadienne, s’adonnait au
commerce et à l’industrie. Il était propriétaire de scieries, de ferme, de
maisons. Il s’occupait à construire des bateaux pour le service de Sa Majesté.
Ainsi par une Ordonnance des "Intendants du Canada’ de 1730 à 1731… il était
permis aux Sieurs Abbé Lepage et de Bleury" de faire exploiter sur
diverses seigneuries, 2 000 pieds cubes de chêne, pour la construction d’une
Flûte de 500 tonneaux pour le service du Roi, du cinquième octobre 1731. Signé
: Hocquart (Intendant)"».[13]
Voyant que Bleury ne respecte pas l’obligation d’établir des colons sur sa
seigneurie, le gouverneur Beauharnois et l’indendant Hocquart la lui retirent,
en attendant que son ami, l’intendant Bigot, la lui restitue (30 octobre 1750).«Lors de la construction du fort Carillon, il est chargé de son approvisionnement. Le 22 septembre 1756, il s’y rend avec trente bateaux; le 2 octobre suivant, avec soixante-dix bateaux. Ce même jour, Péan… écrit à Lévis pour lui dire qu’il est occupé à faire un arrangement avec Bleury afin qu’il n’aille plus à Carillon avec moins de cinquante bateaux, "et que les hommes soient rendus à Saint-Jean au moment de son arrivée pour qu’il ne se perde pas un instant". (…) Malgré la lettre de Péan, Bleury se rend à Carillon avec trente-cinq bateaux le 11 octobre. Le 25 du même mois son convoi comprend 54 bateaux. Dans son journal, Bougainville nous apprend que Bleury reçoit dix-huit sous pour chaque livre qu’il transporte pour le roi et que chacun de ses bateaux est chargé de trois tonnes. Ajoutons à ces recettes les profits que lui rapportait la vente de diverses marchandises pour son propre compte».[15]
 l’approvisionner. La
guerre anglo-française reprit au cours de 1744 et la Vallée du Richelieu
retrouva son activité d’antan. En 1748, le gouverneur d’alors, Roland-Michel Barrin de La Galissonière (1646-1737) pense aussitôt au site de l’ancien fort
construit en 1666. Il formule une ordonnance à Gaspard-Joseph Chaussegros de
Léry fils (1682-1756), ingénieur militaire, afin de tracer les plans du
deuxième fort Saint-Jean ainsi que de la consolidation du Chemin Saint-Jean. Ce
nouveau fort coûte cher - $ 50 000, selon l’historien Lanctot - et les
commentaires sont éloquents : «C’est bien de l’argent pour un fort de
piquets», écrit l’intendant Bigot. Et le ministre auquel il s’adresse lui
répond : «Il n’est que trop vraisemblable qu’il doit y avoir eu beaucoup
d’abus»! C’est au printemps de 1748 qu’avaient commencé les travaux de
construction, mais ce n’est qu’en mars 1749 qu’ils furent complétés.
L’ingénieur de Léry séjourne au fort du 27 avril au 12 décembre 1748 afin de
veiller à la construction du fort. Malgré la bonne température, la maladie et
le manque d’enthousiasme des ouvriers ralentissent le travail. Le gouverneur de
La Galissonnière ne vient le visiter qu’en février 1749, un mois avant que le
chantier cesse ses opérations. C’est une structure en forme de quadrilatère de
près de 200 pieds de côté, flanquée à chaque coin d’un bastion. C’est du moins
le fort que décrit le naturaliste suédois Peher Kalm qui le visite en cette
année 1749 :
l’approvisionner. La
guerre anglo-française reprit au cours de 1744 et la Vallée du Richelieu
retrouva son activité d’antan. En 1748, le gouverneur d’alors, Roland-Michel Barrin de La Galissonière (1646-1737) pense aussitôt au site de l’ancien fort
construit en 1666. Il formule une ordonnance à Gaspard-Joseph Chaussegros de
Léry fils (1682-1756), ingénieur militaire, afin de tracer les plans du
deuxième fort Saint-Jean ainsi que de la consolidation du Chemin Saint-Jean. Ce
nouveau fort coûte cher - $ 50 000, selon l’historien Lanctot - et les
commentaires sont éloquents : «C’est bien de l’argent pour un fort de
piquets», écrit l’intendant Bigot. Et le ministre auquel il s’adresse lui
répond : «Il n’est que trop vraisemblable qu’il doit y avoir eu beaucoup
d’abus»! C’est au printemps de 1748 qu’avaient commencé les travaux de
construction, mais ce n’est qu’en mars 1749 qu’ils furent complétés.
L’ingénieur de Léry séjourne au fort du 27 avril au 12 décembre 1748 afin de
veiller à la construction du fort. Malgré la bonne température, la maladie et
le manque d’enthousiasme des ouvriers ralentissent le travail. Le gouverneur de
La Galissonnière ne vient le visiter qu’en février 1749, un mois avant que le
chantier cesse ses opérations. C’est une structure en forme de quadrilatère de
près de 200 pieds de côté, flanquée à chaque coin d’un bastion. C’est du moins
le fort que décrit le naturaliste suédois Peher Kalm qui le visite en cette
année 1749 :«Saint-Jean est un fort en bois, qui fut bâti par les Français en 1748, à l’embouchure du Lac Champlain, sur la rive occidentale, comme place de défense pour la protection du pays d’alentour, qu’on avait alors l’intention de coloniser. Ce fort devait servir pour l’emmagasinage des ammunitions et des provisions que l’on envoyait ordinairement à Montréal à Saint-Frédéric où l’on se rend en yatch de Saint-Jean, tandis que plus bas à deux portées de mousquet. il y a des battures de pierre où le courant est très rapide, et qu’on ne peut franchir qu’en bateaux plats, et ensuite transbordées en des yatchs avant d’arriver à destination.
Le Fort Saint-Jean occupe un terrain bas et sablonneux, (on dirait plutôt glaiseux), et le pays aux alentours est une plaine unie couverte d’arbres. De forme quadrangulaire, il renferme une enceinte d’un arpent carré. Les deux angles qui regardent le Lac sont défendus chacun par un ouvrage en bois à quatre étages, reposant sur un soubassement en pierre, de la hauteur environ d’une brasse et demie, vrais polygones garnis de meurtrières et de machicoulis. Aux deux autres angles du côté de terre, sont érigées de petites maisons en bois à deux étages, servant en même temps de casernes et de défenses. Le fort est enclos d’une palissade de pieux pointus, hauts de deux brasses et demie, et enfoncés en terre, serrés les uns contre les autres : ils sont faits avec le bois qu’on appelle Thuya, regardé comme le plus durable ici, et à cause de cela de beaucoup préféré au sapin. Un peu plus bas, la palissade est à double rang, l’un dans l’autre. On a élevé tout le long de ces pieux à une hauteur de plus de deux verges, une large plateforme, avec des garde-corps, dans l’intérieur du fort, pour la protection des soldats, qui, de là peuvent tirer sur l’ennemi, sans s’exposer eux-mêmes. L’année dernière (1748), la garnison comptait deux cents hommes (le fort venait à peine d’être fini) mais aujourd’hui, il n’y a que le commandant, un commissaire, un boulanger et six soldats pour prendre soin du fort et surveiller le transport des provisions. Le gouverneur actuel est le Chevalier de Gannes, gentilhomme très aimable et beau-frère de M. de Lusignan, gouverneur du Fort de Saint-Frédéric. Le terrain d’alentour, sur les deux côtés de la rivière, est riche et fertile, mais encore inhabité, quoiqu’on parle d’y faire des établissements au plus tôt.
Par tout le Canada les Français donnent aux moustiques le nom de marangoins, mot emprunté à la langue sauvage. Ces insectes sont en nombre si prodigieux dans les boisqui avoisinent le Fort de Saint-Jean qu’on le surnommerait avec plus d’à propos le Fort aux marangoins. La situation basse et marécageuse du pays et les forêts épaisses qui le couvrent favorisent beaucoup leur accroissement. Ils diminueront, sans doute comme ailleurs, quand les bois seront abattus, les marais desséchés et la culture établie.
Quelques personnes sont arrivées ici, ce soir, venant de Laprairie, avec des chevaux que le Gouvernement m’envoie à ma demande. Saint-Jean ne compte qu’un an d’existence, personne ne s’y est fixé, ce qui explique la rareté de ces utiles solipèdes».[17]
«Sa figure est un parfait carré de 30 toises de côté extérieur flanqué de quatre bastions d’égale capacité. Les courtines sont formées de pieux serrés l’un contre l’autre, percés de créneaux à hauteur de 8 à 9 pieds, et derrière lesquels est une banquette volante en charpente ainsi que le profil le représente. Dans chacun des 2 bastions du côté de face à la rivière est établi un bâtiment sur mur de maçonnerie de 6 pieds de hauteur, élevé ensuite de pièces sur pièces, percé d’embrazures et de créneaux, et couvert de planches; la distribution consiste en un rez de chaussée, en un étage, auquel on monte par des escaliers placés en dehors et en un grenier. Les troupes commises à la garde de ce fort sont logées dans l’étage du bastion de la droite de l’entrée et le garde magasin occupe celui de la gauche; le rez de chaussée et le grenier à l’un et à l’autre servent de magasins aux vivres et aux approvisionnements quelconques. Dans chacun des 2 autres bastions, est un bâtiment isolé de l’enceinte; l’un, situé à droite de l’entrée sert de logement à l’officier commandant, l’autre de boulangerie».[18]
 proximité du fort afin de laisser un vaste terrain
découvert où il serait difficile à l’ennemi d’approcher, mais un rapport de
l’intendant Bigot, daté du 1er juillet 1749, donne une idée assez précise de
l’ambition de développer la région : «…tant pour la sûreté de ce fort, et
pour pouvoir à l’avenir former un bourg ou village aux environs, que pour faire
des prairies et y semer des grains pour les besoins de la garnison, nous avons
réservé et réservons pour et au nom de sa Majesté, une étendue de terre de 20
arpents de front de chaque côté du dit Fort le long de la dite rivière St-Jean,
sur 30 de profondeur…»[19]
Pour G. Lanctot, ce rapport équivaut à la charte royale de la fondation de la
ville de Saint-Jean. Il n’y a pas encore vraiment de colonie à Saint-Jean, les
habitants travaillant essentiellement au fort alors sous le commandement du
sieur de Gannes, officier dans les troupes de la Marine. Sous Talon, il en a
coûté 15 000 livres à la France pour la construction de 5 forts et leur
entretien en 3 années; le nouveau fort Saint-Jean coûte à lui seul le double
(30 000 livres) en l’espace d’une année seulement. La Galissonnière ne cesse de
recommander l’économie et la réduction des dépenses tandis qu’au salon de
madame Bégon,[20] on ne cesse
de se plaindre de la mauvaise qualité de la construction de bois, retenant les
conseils de l’ingénieur Franquet pour solidifier le fort. Il est vrai que Bigot
y a des intérêts personnels. C’est lui qui fait soudainement monter le tarif
des transports entre le fort Saint-Jean et le fort Saint-Frédéric de 148 à 525 livres
la charge. Les grands magasiniers du fort, Hautray et Billeau, sont complices
des malversations, de même que le commandant Joachim de Sasquespée, ce qui lui
vaudra plus tard de passer avec Bigot en haute cour de justice.[21]
proximité du fort afin de laisser un vaste terrain
découvert où il serait difficile à l’ennemi d’approcher, mais un rapport de
l’intendant Bigot, daté du 1er juillet 1749, donne une idée assez précise de
l’ambition de développer la région : «…tant pour la sûreté de ce fort, et
pour pouvoir à l’avenir former un bourg ou village aux environs, que pour faire
des prairies et y semer des grains pour les besoins de la garnison, nous avons
réservé et réservons pour et au nom de sa Majesté, une étendue de terre de 20
arpents de front de chaque côté du dit Fort le long de la dite rivière St-Jean,
sur 30 de profondeur…»[19]
Pour G. Lanctot, ce rapport équivaut à la charte royale de la fondation de la
ville de Saint-Jean. Il n’y a pas encore vraiment de colonie à Saint-Jean, les
habitants travaillant essentiellement au fort alors sous le commandement du
sieur de Gannes, officier dans les troupes de la Marine. Sous Talon, il en a
coûté 15 000 livres à la France pour la construction de 5 forts et leur
entretien en 3 années; le nouveau fort Saint-Jean coûte à lui seul le double
(30 000 livres) en l’espace d’une année seulement. La Galissonnière ne cesse de
recommander l’économie et la réduction des dépenses tandis qu’au salon de
madame Bégon,[20] on ne cesse
de se plaindre de la mauvaise qualité de la construction de bois, retenant les
conseils de l’ingénieur Franquet pour solidifier le fort. Il est vrai que Bigot
y a des intérêts personnels. C’est lui qui fait soudainement monter le tarif
des transports entre le fort Saint-Jean et le fort Saint-Frédéric de 148 à 525 livres
la charge. Les grands magasiniers du fort, Hautray et Billeau, sont complices
des malversations, de même que le commandant Joachim de Sasquespée, ce qui lui
vaudra plus tard de passer avec Bigot en haute cour de justice.[21] troupe de Saint-Jean
se vit augmenter de 1 500 miliciens, 1 000 soldats et 600 autochtones venus de
Montréal entre le 10 et le 20 août 1755. À l’approche du conflit imminent, des
mouvements de troupes sont dirigés vers la vallée du Richelieu. Au début du
mois d’août, le chemin de Saint-Jean est parcouru par des voitures chargées de
munitions se rendant à Saint-Jean où 2 petits navires font la navette vers le
fort Saint-Frédéric, gravement menacé par les troupes anglaises. Bon stratège,
le marquis de Montcalm saisit tout de suite l’importance du Richelieu dans la
défense de la Nouvelle-France. Il reprend l’idée de La Galissonnière de faire
du fort Saint-Jean un emplacement pour un chantier naval et une «grande
place d’armes» devant servir d’entrepôt aux forts avancés, le tout relié
directement à Laprairie par une bonne voie carrossable. Dès la fin d’août 1756,
un bataillon du régiment de Béarn dirigé par M. Pouchot vient rendre compte de
l’état lamentable du chemin de Saint-Jean, toujours recouvert par les marécages
de 2 à 3 pieds d’eau. Les réparations de Pouchot s’avéreront bientôt
insatisfaisantes et le 22 septembre suivant, le bataillon de La Sarre se mettra
à travailler sur le chemin à son tour. Le gouverneur Vaudreuil-Cavaignal envoie
même un sculpteur pour construire un chemin sur la rivière de l’Acadie, mais le
sculpteur doit retourner à son véritable travail car les travaux sont
suspendus.
troupe de Saint-Jean
se vit augmenter de 1 500 miliciens, 1 000 soldats et 600 autochtones venus de
Montréal entre le 10 et le 20 août 1755. À l’approche du conflit imminent, des
mouvements de troupes sont dirigés vers la vallée du Richelieu. Au début du
mois d’août, le chemin de Saint-Jean est parcouru par des voitures chargées de
munitions se rendant à Saint-Jean où 2 petits navires font la navette vers le
fort Saint-Frédéric, gravement menacé par les troupes anglaises. Bon stratège,
le marquis de Montcalm saisit tout de suite l’importance du Richelieu dans la
défense de la Nouvelle-France. Il reprend l’idée de La Galissonnière de faire
du fort Saint-Jean un emplacement pour un chantier naval et une «grande
place d’armes» devant servir d’entrepôt aux forts avancés, le tout relié
directement à Laprairie par une bonne voie carrossable. Dès la fin d’août 1756,
un bataillon du régiment de Béarn dirigé par M. Pouchot vient rendre compte de
l’état lamentable du chemin de Saint-Jean, toujours recouvert par les marécages
de 2 à 3 pieds d’eau. Les réparations de Pouchot s’avéreront bientôt
insatisfaisantes et le 22 septembre suivant, le bataillon de La Sarre se mettra
à travailler sur le chemin à son tour. Le gouverneur Vaudreuil-Cavaignal envoie
même un sculpteur pour construire un chemin sur la rivière de l’Acadie, mais le
sculpteur doit retourner à son véritable travail car les travaux sont
suspendus.«Ce sera un carré long avec quatre bastions, deux côtés auront chacun soixante toises et les deux autres quatre-vingts; un fossé qui aura dix-huit pieds de large par en bas, trente-six pieds par en haut, deux portes l’une vers la rivière; et le fort sera construit de façon qu’on puisse, sans changer rien aux édifices intérieurs, au lieu de l’enceinte en pieux, faire un rempart terrassé et le revêtir; et si jamais cela a lieu, non seulement Saint-Jean sera une place d’armes pour entrepôt, mais capable de soutenir un siège et sauver la colonie».[22]
 Sarre, du Languedoc et de
Guyenne, plus de nombreux miliciens. Le tout s’engage sur le Richelieu les 28,
29 et 30 juin. Comme le dit Jacques Castonguay : «C’est certainement au
cours de ces opérations que le fort Saint-Jean connut les plus fortes
concentrations de troupes françaises de son histoire». En juillet 1757,
vont et viennent des flottilles indiennes sous la direction de François Piquet,
missionnaire, aidé du Sulpicien Mathavet et du Jésuite Roubaud, respectivement
missionnaires des Nipissings et des Abénakis. Escortés par d’autres autochtones
de diverses tribus ennemies des Iroquois, les missionnaires, par «de courtes
exhortations en différents dialectes retracèrent les obligations d’un guerrier
que la religion conduit au combat…» Tout au long de cette année, Montcalm
ne cessera d’envoyer ses régiments, les uns après les autres, pour consolider
l’impossible chemin Saint-Jean, mais en vain. La savane reprend toujours ses
droits sur la route.
Sarre, du Languedoc et de
Guyenne, plus de nombreux miliciens. Le tout s’engage sur le Richelieu les 28,
29 et 30 juin. Comme le dit Jacques Castonguay : «C’est certainement au
cours de ces opérations que le fort Saint-Jean connut les plus fortes
concentrations de troupes françaises de son histoire». En juillet 1757,
vont et viennent des flottilles indiennes sous la direction de François Piquet,
missionnaire, aidé du Sulpicien Mathavet et du Jésuite Roubaud, respectivement
missionnaires des Nipissings et des Abénakis. Escortés par d’autres autochtones
de diverses tribus ennemies des Iroquois, les missionnaires, par «de courtes
exhortations en différents dialectes retracèrent les obligations d’un guerrier
que la religion conduit au combat…» Tout au long de cette année, Montcalm
ne cessera d’envoyer ses régiments, les uns après les autres, pour consolider
l’impossible chemin Saint-Jean, mais en vain. La savane reprend toujours ses
droits sur la route. anglais. Dès les
premiers mois, les forts de Carillon et Saint-Frédéric sont abandonnés; les
troupes se replient aux estacades rapidement élevées à l’île-aux-Noix. Afin de
raffermir les fortifications de Saint-Jean, on envoie «quatre pièces de fonte
de six sur affûts de campagne, avec cinq cent boulets et deux canonniers»,
tandis qu’on y ajoute une enceinte de pieux. «Mais pour Bourlamaque, le fort
construit par Desandrouins demeurait un fort "habillé de neuf sur sa
vieille forme". Rien de plus». Dès septembre 1758, une première alerte
avait éveillé la garnison du fort Saint-Jean, constituée de 150 hommes, qui
prit une troupe de 18 miliciens déserteurs de Carillon pour une escouade
anglaise. La panique oblige la venue de renforts de Chambly et de Laprairie. En
mai 1760, une seconde alerte s’avère confirmée cette fois, quand le major
Robert Rogers s’approche du fort avec 300 hommes. Devant la fortification et
l’importance de la garnison, il décide de faire demi-tour. Trois mois plus
tard, le glas sonne pour de bon. Le brigadier William Haviland, avec un peu
plus de 2 000 hommes que transportent 410 embarcations, s’approche de
l’île-aux-Noix défendue par Bougainville. M. de Roquemaure, lieutenant-colonel
du régiment de la Reine, commande aux 1 043 soldats et miliciens du fort
Saint-Jean, dont le moral est au plus bas et la situation matérielle critique.
Devant les désertions répétées, on brandit la menace de l’échafaud. La panique
s’empare des derniers résistants français au Canada.
anglais. Dès les
premiers mois, les forts de Carillon et Saint-Frédéric sont abandonnés; les
troupes se replient aux estacades rapidement élevées à l’île-aux-Noix. Afin de
raffermir les fortifications de Saint-Jean, on envoie «quatre pièces de fonte
de six sur affûts de campagne, avec cinq cent boulets et deux canonniers»,
tandis qu’on y ajoute une enceinte de pieux. «Mais pour Bourlamaque, le fort
construit par Desandrouins demeurait un fort "habillé de neuf sur sa
vieille forme". Rien de plus». Dès septembre 1758, une première alerte
avait éveillé la garnison du fort Saint-Jean, constituée de 150 hommes, qui
prit une troupe de 18 miliciens déserteurs de Carillon pour une escouade
anglaise. La panique oblige la venue de renforts de Chambly et de Laprairie. En
mai 1760, une seconde alerte s’avère confirmée cette fois, quand le major
Robert Rogers s’approche du fort avec 300 hommes. Devant la fortification et
l’importance de la garnison, il décide de faire demi-tour. Trois mois plus
tard, le glas sonne pour de bon. Le brigadier William Haviland, avec un peu
plus de 2 000 hommes que transportent 410 embarcations, s’approche de
l’île-aux-Noix défendue par Bougainville. M. de Roquemaure, lieutenant-colonel
du régiment de la Reine, commande aux 1 043 soldats et miliciens du fort
Saint-Jean, dont le moral est au plus bas et la situation matérielle critique.
Devant les désertions répétées, on brandit la menace de l’échafaud. La panique
s’empare des derniers résistants français au Canada.«Le lendemain, soit le 29 août, dans la nuit, le signal est donné : "J’apprends à ce moment, mande Roquemaure, l’arrivée d’un diable avec beaucoup de monde qui vient vers Saint-Jean. Il n’est pas douteux qu’il ne soit escorté de beaucoup de berges, ce qui fait que je vais songer à ma retraite". On ouvre donc les portes du fort et ce qui reste du bataillon de La Reine et du Royal-Roussillon en sort à la faveur de l’obscurité. Tous les bateaux à fond plat et les charrettes disponibles sont utilisées. On apporte avec soi des munitions et des vivres pour 5 jours. C’est alors que M. de Villejoin, aidé de 20 hommes, se prépare à exécuter la triste mission qu’on lui a confiée. La nuit est encore totale lorsqu’un ciel devenu écarlate réveille la forêt et prévient les Anglais de l’abandon et de l’anéantissement du fort Saint-Jean…»[23]
 fort Saint-Jean. Avec la défaite, Bleury passa en
France avec les troupes en automne 1760, mais par peur de perdre ses terres
sans en tirer le moindre centime, il revint en 1763. Il finira par vendre sa
seigneurie à un officier anglais, Gabriel Christie (1722-1799), d’origine
écossaise et à un aventurier américain, Moses Hazen (1733-1803). Entre 1764 et
1775, ils achètent toutes les anciennes seigneuries établies autour de
Saint-Jean. Ils acquirent ainsi les seigneuries de Lacolle et de Léry, puis
en société avec un compatriote, John Campbell, celle de Noyan. Une seule leur
échappa, celle de Foucault (entre Noyan et la frontière américaine). Sur la
rive gauche du Richelieu, la baronnie de Longueuil n’était pas à vendre et le
site sur lequel se dresse de nos jours la ville de Saint-Jean leur écahppait de
même. Un rapport d’experts datant de 1760 mentionne quelques noms des premiers
habitants collés au fort :
fort Saint-Jean. Avec la défaite, Bleury passa en
France avec les troupes en automne 1760, mais par peur de perdre ses terres
sans en tirer le moindre centime, il revint en 1763. Il finira par vendre sa
seigneurie à un officier anglais, Gabriel Christie (1722-1799), d’origine
écossaise et à un aventurier américain, Moses Hazen (1733-1803). Entre 1764 et
1775, ils achètent toutes les anciennes seigneuries établies autour de
Saint-Jean. Ils acquirent ainsi les seigneuries de Lacolle et de Léry, puis
en société avec un compatriote, John Campbell, celle de Noyan. Une seule leur
échappa, celle de Foucault (entre Noyan et la frontière américaine). Sur la
rive gauche du Richelieu, la baronnie de Longueuil n’était pas à vendre et le
site sur lequel se dresse de nos jours la ville de Saint-Jean leur écahppait de
même. Un rapport d’experts datant de 1760 mentionne quelques noms des premiers
habitants collés au fort :«On y voit les noms de madame Babuty, dont la maison de pierre confinait au fort, de McComb et Jourdonnay, tout auprès, d’un Faille et d’un Girard, noms bien connus dans les alentours; à la savane de Saint-Luc : Pierre Brosseau et Ambroise de Mers dont les descendants ont colonisé à leur tour les paroisses environnantes. Ont signé ce document : P. Boileau, Jacques Roy, Pierre Miville, Louis Drenville, Charles Chenette, Pierre Raga, Jean Delisle». Un autre Anglais, Robertson, habite la ville qui, en 1764, est constituée de douze concessions dont la moitié est inexploitée.
 serait appelé à se développer, commencent à
louer des terrains. En 1764, ils louent 5 grandes terres comprenant toute la
partie centrale où se dresse la ville actuelle : «Pour ne rien laisser
échapper, ils louèrent, pour un terme de quatorze années, de M. Deschambault,
représentant de la Baronne de Longueil, le terrain même du fort, réduit à dix
arpents de largeur. Cette location stipulait que le bail deviendrait nul, au
cas où Sa Majesté reprendrait possession du fort. Par ses acquisitions et
d’autres encore aux environs, ces deux hommes d’affaires devenaient
pratiquement les maîtres du Richelieu supérieur». L’exploitation de ces
terres ne revint pas à Christie, militaire de carrière, incapable en affaires,
mais à Moses Hazen qui saute sur l’occasion que son partenaire est en passe de
devenir le plus grand propriétaire foncier du Canada, pour se joindre à la
fructueuse aventure. Seul, il va gérer l’exploitation des propriétés indivises.[24]
serait appelé à se développer, commencent à
louer des terrains. En 1764, ils louent 5 grandes terres comprenant toute la
partie centrale où se dresse la ville actuelle : «Pour ne rien laisser
échapper, ils louèrent, pour un terme de quatorze années, de M. Deschambault,
représentant de la Baronne de Longueil, le terrain même du fort, réduit à dix
arpents de largeur. Cette location stipulait que le bail deviendrait nul, au
cas où Sa Majesté reprendrait possession du fort. Par ses acquisitions et
d’autres encore aux environs, ces deux hommes d’affaires devenaient
pratiquement les maîtres du Richelieu supérieur». L’exploitation de ces
terres ne revint pas à Christie, militaire de carrière, incapable en affaires,
mais à Moses Hazen qui saute sur l’occasion que son partenaire est en passe de
devenir le plus grand propriétaire foncier du Canada, pour se joindre à la
fructueuse aventure. Seul, il va gérer l’exploitation des propriétés indivises.[24]Suivent les dix arpents du fort, loués à Christie et Hazen : soit sept arpents divisés en deux lots de trois et de quatre arpents puis trois autres comprenant la banlieue du fort. Là s’élevait, à un arpent et demi du lot précédent, la maison de pierre bâtie par Christie.
Les six arpents suivants appartenant à la veuve de Christophe Babuty, un munitionnaire au service des troupes françaises venues au Canada, sous le commandement de Montcalm.
Les six arpents suivants au notaire Grisé.
Puis cinq lots, de trois arpents chacun, appartenant : le 1er à Jacques Faille; le 2e à Françoise Leblanc, veuve de Charles Grageon (Greshon); le 3e à Pierre Bignon; le 4e à Antoine Girard; le 5e à Jacques Bureau».[26]
«De 1760 à 1775, le fort Saint-Jean connut la déchéance. Les ronces, les arbrisseaux et les herbes folles se frayèrent un chemin à travers les palissades calcinées. On ne trouvait plus que quelques casernes construites après le départ des troupes françaises et dont une partie seulement était utilisée. Seul le débarcadère connaissait une certaine activité : on y voyait occasionnellement une ou deux embarcations affectées au transport des vivres et aussi quelques soldats, commerçants et colons. Un sloop de la Royal Navy armé de 2 canons de 6 pouces s’y trouvait également»[27]
 et 10 soldats et les Américains le savaient.
Le 17 mai au matin, un sloop anglais est abordé, les casernes encerclées et un
groupe d’Américains isole le fort qui, en quelques instants, est obligé de se
rendre. Les 12 militaires de la garnison sont rapidement faits prisonniers et
les vivres arrivés le 14 mai précédent sont saisis. Benedict Arnold, informé que les
renforts ne tarderont pas à arriver, ordonne la destruction des bateaux qu’il
ne peut ramener et fait appareiller le sloop pour disparaître en amont du fort.
Moses Hazen, qui a senti ses biens menacés, a été porter la nouvelle de
l’incursion à Montréal et de là, la nouvelle se transmet à Québec. Le même
soir, après qu’Arnold eut pillé le fort Saint-Jean, un détachement de Green
Mountain Boys dirigé par Ethan Allen, vient occuper les lieux, mais, informé de
l’approche d’un détachement de 140 hommes dirigé par le major Charles Preston
(± 1735-1800), il évacue la place dès le lendemain matin : «Preston et ses
hommes atteignirent Saint-Jean après le retrait des rebelles. Ils y restèrent
environ 24 heures, le temps de manger et de se reposer; ils regagnèrent
Montréal le samedi 20 mai. Leur départ laissait de nouveau Saint-Jean sans
protection. Les troupes anglaises étant très clairsemées dans la région de
Montréal et le gros des forces se trouvant toujours à Québec, on dut faire
appel aux volontaires canadiens pour assurer la relève. C’est ainsi que le
lieutenant Samuel MacKay et cinquante Canadiens occupèrent le fort jusqu’à
l’arrivée des troupes en garnison dans la capitale».[29]
et 10 soldats et les Américains le savaient.
Le 17 mai au matin, un sloop anglais est abordé, les casernes encerclées et un
groupe d’Américains isole le fort qui, en quelques instants, est obligé de se
rendre. Les 12 militaires de la garnison sont rapidement faits prisonniers et
les vivres arrivés le 14 mai précédent sont saisis. Benedict Arnold, informé que les
renforts ne tarderont pas à arriver, ordonne la destruction des bateaux qu’il
ne peut ramener et fait appareiller le sloop pour disparaître en amont du fort.
Moses Hazen, qui a senti ses biens menacés, a été porter la nouvelle de
l’incursion à Montréal et de là, la nouvelle se transmet à Québec. Le même
soir, après qu’Arnold eut pillé le fort Saint-Jean, un détachement de Green
Mountain Boys dirigé par Ethan Allen, vient occuper les lieux, mais, informé de
l’approche d’un détachement de 140 hommes dirigé par le major Charles Preston
(± 1735-1800), il évacue la place dès le lendemain matin : «Preston et ses
hommes atteignirent Saint-Jean après le retrait des rebelles. Ils y restèrent
environ 24 heures, le temps de manger et de se reposer; ils regagnèrent
Montréal le samedi 20 mai. Leur départ laissait de nouveau Saint-Jean sans
protection. Les troupes anglaises étant très clairsemées dans la région de
Montréal et le gros des forces se trouvant toujours à Québec, on dut faire
appel aux volontaires canadiens pour assurer la relève. C’est ainsi que le
lieutenant Samuel MacKay et cinquante Canadiens occupèrent le fort jusqu’à
l’arrivée des troupes en garnison dans la capitale».[29] Congrès
continental désigna, le 19 juin, Philip Schuyler pour commander une expédition
dont la mission était d’envahir le Canada. Cet homme frêle et maladif prit
comme adjoint le brigadier-général Richard Montgomery (1738-1775). À l’approche
du mois de septembre, la colonne était prête à se mettre en route. Schuyler
pouvait compter sur environ 2 000 hommes fournis par les états du New York (4
régiments) et du Connecticut (4 compagnies) et plusieurs centaines d’hommes
mobilisés s’ajoutèrent à l’unité du colonel Benjamin Hinman qui attendait déjà
au sud du lac Champlain. De ce côté-ci de la frontière, dès le 19 mai, le général
britannique Thomas Gage avait ordonné de regrouper ses troupes dans la région
du lac Champlain. La stratégie était simple : oublier pour le moment Québec et
Montréal, fortifier Saint-Jean de façon à bloquer le passage vers le
Saint-Laurent, et construire quelques vaisseaux assez lourds pour reprendre si
possible la maîtrise du lac. Il appartint donc au major Preston de ressusciter,
pour une troisième fois, le fort Saint-Jean.
Congrès
continental désigna, le 19 juin, Philip Schuyler pour commander une expédition
dont la mission était d’envahir le Canada. Cet homme frêle et maladif prit
comme adjoint le brigadier-général Richard Montgomery (1738-1775). À l’approche
du mois de septembre, la colonne était prête à se mettre en route. Schuyler
pouvait compter sur environ 2 000 hommes fournis par les états du New York (4
régiments) et du Connecticut (4 compagnies) et plusieurs centaines d’hommes
mobilisés s’ajoutèrent à l’unité du colonel Benjamin Hinman qui attendait déjà
au sud du lac Champlain. De ce côté-ci de la frontière, dès le 19 mai, le général
britannique Thomas Gage avait ordonné de regrouper ses troupes dans la région
du lac Champlain. La stratégie était simple : oublier pour le moment Québec et
Montréal, fortifier Saint-Jean de façon à bloquer le passage vers le
Saint-Laurent, et construire quelques vaisseaux assez lourds pour reprendre si
possible la maîtrise du lac. Il appartint donc au major Preston de ressusciter,
pour une troisième fois, le fort Saint-Jean.«La redoute sud construite au centre du vieux fort français était longue d’environ deux cent cinquante pieds et large de deux cents. En plus de plusieurs traverses ou cloisons protectrices, elle contenait six bâtiments; trois casernes réservées aux officiers, aux hommes et aux volontaires canadiens-français; une poudrière; un magasin et un bâtiment à l’usage des ingénieurs. La redoute nord, reliée à la redoute sud par une tranchée, était située un peu plus haut que [l’ancienne] usine de filtration de Saint-Jean. Un peu plus grande que la première, elle comprenait aussi plusieurs traverses et entourait la maison de Moses Hazen et du colonel Christie. De juillet à septembre, plus de trois cents hommes travaillèrent à ces constructions. Un journal conservé aux Archives nationales et que James Thomas Flexner, dans son livre The Traitor and the Spy : Benedict Arnold and John André a récemment attribué à John André, décrit ainsi l’état des travaux le 17 septembre : "Nos redoutes étaient à cette date (si elles n’étaient pas achevées) du moins dans un état qui nous permettait de les défendre; l’intérieur du parapet et des embrasures étaient gazonnés. Le fossé était muni de fascines et les canons étaient mis en place, bien qu’à la vérité les plates-formes fussent très mauvaises. Nous avions deux obusiers de 8 pouces et 8 mortiers dit Royaux ou Cohorn, environ 30 pièces d’artillerie, parmi lesquelles 2 légers canons de cuivre, calibre 24, 6 canons de fer, calibre 9. Les autres étaient de calibre moindre et de cuivre pour la plupart».[30]
 maîtrise
du lac Champlain. Il décide donc, sans plus tarder, de se mettre en marche. De
son côté, le souffreteux Schuyler obtient la neutralité des Six-Nations. Le 4
septembre, Montgomery débarque à l’île-aux-Noix où il est rejoint le lendemain
par Schuyler. «Le 6 septembre, Schuyler à la tête de mille hommes environ
tente un premier débarquement au sud du fort, là où se trouve aujourd’hui le
club de golf. Les deux frères de Lorimier et 60 indiens les attaquent vivement
et les forcent à retraîter plus au sud».[31]
Le lendemain, Schuyler décide de regagner l’île-aux-Noix, tandis que le 8
septembre, d’importants renforts américains viennent renforcer la première
troupe : 300 hommes du Connecticut, 400 du New York et quelques artilleurs
traînant 5 canons et 2 mortiers. Ainsi, les 10 et 11 septembre, environ 1 000
hommes débarquent de nouveau au sud du fort, tout près du ruisseau Bernier, ou
Montgomery Creek. Durant la nuit, le colonel R. Ritama et 500 hommes
essayent à 2 reprises de contourner le fort Saint-Jean par l’ouest, mais la
peur s’empare d’eux et reviennent, pris de panique à l’île-aux-Noix : «L’inexpérience
a cette fois raison des Américains» (J. Castonguay).
maîtrise
du lac Champlain. Il décide donc, sans plus tarder, de se mettre en marche. De
son côté, le souffreteux Schuyler obtient la neutralité des Six-Nations. Le 4
septembre, Montgomery débarque à l’île-aux-Noix où il est rejoint le lendemain
par Schuyler. «Le 6 septembre, Schuyler à la tête de mille hommes environ
tente un premier débarquement au sud du fort, là où se trouve aujourd’hui le
club de golf. Les deux frères de Lorimier et 60 indiens les attaquent vivement
et les forcent à retraîter plus au sud».[31]
Le lendemain, Schuyler décide de regagner l’île-aux-Noix, tandis que le 8
septembre, d’importants renforts américains viennent renforcer la première
troupe : 300 hommes du Connecticut, 400 du New York et quelques artilleurs
traînant 5 canons et 2 mortiers. Ainsi, les 10 et 11 septembre, environ 1 000
hommes débarquent de nouveau au sud du fort, tout près du ruisseau Bernier, ou
Montgomery Creek. Durant la nuit, le colonel R. Ritama et 500 hommes
essayent à 2 reprises de contourner le fort Saint-Jean par l’ouest, mais la
peur s’empare d’eux et reviennent, pris de panique à l’île-aux-Noix : «L’inexpérience
a cette fois raison des Américains» (J. Castonguay). les New Hampshire Rangers s’établissent
au nord du fort, tandis que les hommes de Brown et les Green Mountain Boys de
Seth Warner sont envoyés à Laprairie et à Longueuil. Le 18, le capitaine Strong,
avec 100 hommes de troupe, 100 volontaires, un officier d’artillerie ayant une
pièce de campagne contre-attaquent et forcent les Américains à se retirer pour
quelques heures de la route qu’ils controlent au nord du fort. Trois jours plus
tard, Montgomery installe une première batterie composée de 2 mortiers au sud
du fort, à environ 400 verges de la redoute la plus avancée. Le 24 septembre,
Ethan Allen et ses volontaires attaquent Montréal. L’opération s’avère un échec
et Allen est lui-même fait prisonnier par la milice montréalaise. «Le 10
octobre : le siège se prolonge beaucoup trop pour Montgomery. Incapable de
faire fléchir la garnison commandée par le major Preston, il aurait aimé
prendre le fort d’assaut, mais les troupes du Connecticut préfèrent installer
une batterie sur la rive est du Richelieu (à Iberville), espérant ainsi
neutraliser la redoute nord et les vaisseaux anglais».
les New Hampshire Rangers s’établissent
au nord du fort, tandis que les hommes de Brown et les Green Mountain Boys de
Seth Warner sont envoyés à Laprairie et à Longueuil. Le 18, le capitaine Strong,
avec 100 hommes de troupe, 100 volontaires, un officier d’artillerie ayant une
pièce de campagne contre-attaquent et forcent les Américains à se retirer pour
quelques heures de la route qu’ils controlent au nord du fort. Trois jours plus
tard, Montgomery installe une première batterie composée de 2 mortiers au sud
du fort, à environ 400 verges de la redoute la plus avancée. Le 24 septembre,
Ethan Allen et ses volontaires attaquent Montréal. L’opération s’avère un échec
et Allen est lui-même fait prisonnier par la milice montréalaise. «Le 10
octobre : le siège se prolonge beaucoup trop pour Montgomery. Incapable de
faire fléchir la garnison commandée par le major Preston, il aurait aimé
prendre le fort d’assaut, mais les troupes du Connecticut préfèrent installer
une batterie sur la rive est du Richelieu (à Iberville), espérant ainsi
neutraliser la redoute nord et les vaisseaux anglais».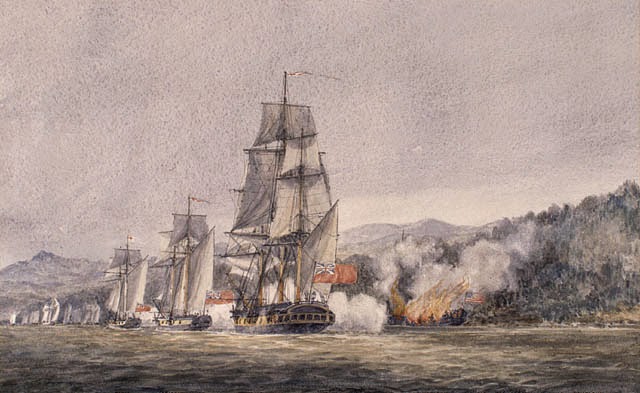 voyait réduit à l’extrême pénurie. La perte
du fort Chambly dut être un choc moral pour les 567 soldats réguliers et les
volontaires qui occupent le fort Saint-Jean. De plus, on y dénombre 80 femmes
et enfants alors que le fort ne comprend qu’une caserne pour 25 hommes. On
érige alors des huttes ou des tentes pour abriter la population réfugiée dans
le fort. Au début, des tentes s’étaient élevées entre les redoutes, mais, dès
les premiers bombardements, il fallut penser à les installer dans les redoutes.
Les Américains se montrant plus tôt que prévu, les occupants anglais n’avaient
pu s’installer convenablement; il n’y avait que 20 literies pour 200 hommes.
Les convois apportant le ravitaillement sont saisis par l’ennemi les 18 et 21
septembre, au ruisseau Jackwood (rue Loyola actuelle). Mais Preston ne manque
pas de plans : «…deux forts bien retranchés, une bonne ligne de
communication entre les deux; une golette armée de douze canons et une galère
de trente rames, armée d’un canon d’assez gros calibre, pouvant tirer des
boulets de 20 livres, étaient ancrées en face de la redoute nord et pouvaient à
l’occasion aller bombarder les Américains à leur camp sud et en direction de
leur camp nord (rue Loyola)».[32]
Mais la flotte anglaise neutralisée et les approvisionnements fournis par la
cession du fort Chambly augmentèrent la combativité des soldats américains.
Deux jours plus tard, les résistants sont découragés. Jusque-là, avec
ingéniosité, ils ont paré les coups portés par l’ennemi; maintenant ils se
laissent de plus en plus envahir par le désespoir à mesure que l’heure de
l’assaut final approche :
voyait réduit à l’extrême pénurie. La perte
du fort Chambly dut être un choc moral pour les 567 soldats réguliers et les
volontaires qui occupent le fort Saint-Jean. De plus, on y dénombre 80 femmes
et enfants alors que le fort ne comprend qu’une caserne pour 25 hommes. On
érige alors des huttes ou des tentes pour abriter la population réfugiée dans
le fort. Au début, des tentes s’étaient élevées entre les redoutes, mais, dès
les premiers bombardements, il fallut penser à les installer dans les redoutes.
Les Américains se montrant plus tôt que prévu, les occupants anglais n’avaient
pu s’installer convenablement; il n’y avait que 20 literies pour 200 hommes.
Les convois apportant le ravitaillement sont saisis par l’ennemi les 18 et 21
septembre, au ruisseau Jackwood (rue Loyola actuelle). Mais Preston ne manque
pas de plans : «…deux forts bien retranchés, une bonne ligne de
communication entre les deux; une golette armée de douze canons et une galère
de trente rames, armée d’un canon d’assez gros calibre, pouvant tirer des
boulets de 20 livres, étaient ancrées en face de la redoute nord et pouvaient à
l’occasion aller bombarder les Américains à leur camp sud et en direction de
leur camp nord (rue Loyola)».[32]
Mais la flotte anglaise neutralisée et les approvisionnements fournis par la
cession du fort Chambly augmentèrent la combativité des soldats américains.
Deux jours plus tard, les résistants sont découragés. Jusque-là, avec
ingéniosité, ils ont paré les coups portés par l’ennemi; maintenant ils se
laissent de plus en plus envahir par le désespoir à mesure que l’heure de
l’assaut final approche :«L’avantage des constructions de terre (parapets et traverses) du fort Saint-Jean était incontestable; la réparation se faisait rapidement et peu de matériaux étaient requis. Mais avec un automne d’intempéries, comme ce fut le cas en 1775, ces fortifications devinrent un immense bourbier.
Les bombardements causèrent de nombreux dommages et les soldats qui, en plus d’avoir à tenir un poste de sentinelle, tous les deux jours, devaient travailler à la restauration, s’épuisèrent rapidement. Il y avait très peu d’abris pour se reposer. De plus, il fallut en arriver à rationner la nourriture et les soldats n’eurent bientôt droit qu’à une demi-livre de pain et à un quart de livre de lard par jour, tandis que les volontaires canadiens bénéficiaient d’un traitement de faveur avec un pain et demi par jour.
Les soldats de faction se divisaient à peu près ainsi : cent pour la redoute sud et cinquante pour la redoute nord».[33]
 fois,
c’est le désarroi qui s’empare des assiégés, surtout quand le 30 octobre,
Carleton échoue dans une tentative de débarquement à Longueuil afin de se
porter au secours de la garnison assiégée : «Plus les jours passaient, moins
on arrivait à combler les trous de bombes et à réparer les dommages. Foucher
raconte qu’une bombe de 150 livres creusa un trou de 10 pieds (3 m) de diamètre
et de 5 à 6 pieds (1,5 à 1,8 m) de profondeur et que les rebelles tirèrent
mille coups de canons dans la seule journée du premier novembre. Ce même jour,
une partie des abris et des provisions fut détruite par les boulets; la
garnison était désespérée et le 3 novembre, les articles de la capitulation
furent acceptés. Il ne restait alors que 3 jours de vivres, un peu de poudre et
3 boîtes de munitions pour les canons».[34]
Le 3 novembre 1775 marqua la reddition de Preston. Le nombre des tués et
blessés s’élevait à 40 et la troupe était faite prisonnière avec les honneurs
de la guerre.[35]
fois,
c’est le désarroi qui s’empare des assiégés, surtout quand le 30 octobre,
Carleton échoue dans une tentative de débarquement à Longueuil afin de se
porter au secours de la garnison assiégée : «Plus les jours passaient, moins
on arrivait à combler les trous de bombes et à réparer les dommages. Foucher
raconte qu’une bombe de 150 livres creusa un trou de 10 pieds (3 m) de diamètre
et de 5 à 6 pieds (1,5 à 1,8 m) de profondeur et que les rebelles tirèrent
mille coups de canons dans la seule journée du premier novembre. Ce même jour,
une partie des abris et des provisions fut détruite par les boulets; la
garnison était désespérée et le 3 novembre, les articles de la capitulation
furent acceptés. Il ne restait alors que 3 jours de vivres, un peu de poudre et
3 boîtes de munitions pour les canons».[34]
Le 3 novembre 1775 marqua la reddition de Preston. Le nombre des tués et
blessés s’élevait à 40 et la troupe était faite prisonnière avec les honneurs
de la guerre.[35] l’affrontement qui se déroula sur le site actuel du club de golf, opposait
Montgomery au capitaine Claude Nicolas Guillaume chevalier De Lorimier
(1744-1825), défenseur du fort Saint-Jean avec son frère Jean-Claude Chamily De
Lorimier. Le capitaine De Lorimier, qui joua également un rôle d’éclaireur pour
le gouverneur Carleton en vue de sauver le fort, parvint à repousser l’ennemi.
D’autres défenseurs, issus de la population française, participèrent également
à la défense du fort Saint-Jean, dont Charles De Lotbinière (1748-1822) et
Ignace-Michel-Louis-Antoine De Salaberry (1752-1828). Durant tout le siège,
Antoine Foucher, qui était présent, rédigea le récit détaillé des faits et
gestes des assiégés et de l’ennemi. On y apprend ainsi la mort du premier
volontaire canadien, Beaubien Desaulniers, le 7 septembre 1775. La longue
résistance du fort Saint-Jean eut pour effet de retarder suffisamment les
Américains qui devaient courir désormais contre l’arrivée de l’hiver. Une fois
Preston s’étant rendu à Montgomery, celui-ci s’avança rapidement jusqu’à
Montréal, d’où le gouverneur Carleton parvint à s’échapper de justesse pour
regagner Québec et y organiser la défense de la citadelle. C’est là, dans un
assaut ultime, que Montgomery fut tué le soir du 31 décembre.
l’affrontement qui se déroula sur le site actuel du club de golf, opposait
Montgomery au capitaine Claude Nicolas Guillaume chevalier De Lorimier
(1744-1825), défenseur du fort Saint-Jean avec son frère Jean-Claude Chamily De
Lorimier. Le capitaine De Lorimier, qui joua également un rôle d’éclaireur pour
le gouverneur Carleton en vue de sauver le fort, parvint à repousser l’ennemi.
D’autres défenseurs, issus de la population française, participèrent également
à la défense du fort Saint-Jean, dont Charles De Lotbinière (1748-1822) et
Ignace-Michel-Louis-Antoine De Salaberry (1752-1828). Durant tout le siège,
Antoine Foucher, qui était présent, rédigea le récit détaillé des faits et
gestes des assiégés et de l’ennemi. On y apprend ainsi la mort du premier
volontaire canadien, Beaubien Desaulniers, le 7 septembre 1775. La longue
résistance du fort Saint-Jean eut pour effet de retarder suffisamment les
Américains qui devaient courir désormais contre l’arrivée de l’hiver. Une fois
Preston s’étant rendu à Montgomery, celui-ci s’avança rapidement jusqu’à
Montréal, d’où le gouverneur Carleton parvint à s’échapper de justesse pour
regagner Québec et y organiser la défense de la citadelle. C’est là, dans un
assaut ultime, que Montgomery fut tué le soir du 31 décembre.  américain envoya une délégation dirigée par
Benjamin Franklin, Samuel Chase, Charles Carroll of Carrollton accompagné de
son frère, l’évêque catholique John Carroll en vue de convaincre les Canadiens de
joindre la cause américaine. Celle-ci fut logée une nuit chez Moses Hazen avant
de regagner le château Ramzay à Montréal. Hazen, qui se ravisa après le premier
moment de panique, décida de «trahir» en rejoignant l’armée d’invasion. Cette
trahison s’explique par 3 raisons : ses origines; les dettes et les procès qui
s’accumulaient sur sa tête - procès qu’il perd contre Patrick Kelley; procès
qu’il perd contre Louis Marchand; contre Ducalvet et 20 autres, sans oublier
ceux de Christie -, enfin son goût inné de l’aventure qui ne pouvait être
récompensé qu’après la victoire
américain envoya une délégation dirigée par
Benjamin Franklin, Samuel Chase, Charles Carroll of Carrollton accompagné de
son frère, l’évêque catholique John Carroll en vue de convaincre les Canadiens de
joindre la cause américaine. Celle-ci fut logée une nuit chez Moses Hazen avant
de regagner le château Ramzay à Montréal. Hazen, qui se ravisa après le premier
moment de panique, décida de «trahir» en rejoignant l’armée d’invasion. Cette
trahison s’explique par 3 raisons : ses origines; les dettes et les procès qui
s’accumulaient sur sa tête - procès qu’il perd contre Patrick Kelley; procès
qu’il perd contre Louis Marchand; contre Ducalvet et 20 autres, sans oublier
ceux de Christie -, enfin son goût inné de l’aventure qui ne pouvait être
récompensé qu’après la victoire  définitive des rebelles. Quoi qu’il en soit, le
18 septembre, il tenta un coup de force contre le fort Saint-Jean au ruisseau
Jackwood et fut fait prisonnier. Envoyé à Montréal pour répondre de sa
trahison, il fut redirigé par Carleton vers Québec lorsqu’il est délivré par
ses compatriotes. Après la chute de Montréal, il y revient et en est nommé
commandant le 20 mars 1776. De plus, il est placé à la tête du mouvement révolutionnaire
canadien. Lorsqu’il est remplacé le 18 avril par Arnold, il refuse d’exécuter
l’ordre de piller les magasins de Montréal, évitant de perdre pour toujours la
confiance des autorités britanniques. Hazen suivit les troupes américaines et
dut dire adieu à ses propriétés de Saint-Jean et d’Iberville. Il combattit
vaillement pour les Américains durant la guerre, fut nommé brigadier-général et
une fois qu’elle fut terminée, il reçut une concession de terres
définitive des rebelles. Quoi qu’il en soit, le
18 septembre, il tenta un coup de force contre le fort Saint-Jean au ruisseau
Jackwood et fut fait prisonnier. Envoyé à Montréal pour répondre de sa
trahison, il fut redirigé par Carleton vers Québec lorsqu’il est délivré par
ses compatriotes. Après la chute de Montréal, il y revient et en est nommé
commandant le 20 mars 1776. De plus, il est placé à la tête du mouvement révolutionnaire
canadien. Lorsqu’il est remplacé le 18 avril par Arnold, il refuse d’exécuter
l’ordre de piller les magasins de Montréal, évitant de perdre pour toujours la
confiance des autorités britanniques. Hazen suivit les troupes américaines et
dut dire adieu à ses propriétés de Saint-Jean et d’Iberville. Il combattit
vaillement pour les Américains durant la guerre, fut nommé brigadier-général et
une fois qu’elle fut terminée, il reçut une concession de terres 
 dans le
Vermont. Hazen mourut à Troy le 30 janvier 1802, où Charlotte, son épouse
canadienne, l’avait suivi. Ayant renoncée par son mariage à la religion
catholique, elle réintégra son église deux ans après le décès de son époux.
Hazen laissa un nom dans la région, que l’on attribua au ruisseau sur la rive
est qui se déverse dans le Richelieu, et une demeure traditionnelle en pierre
qui fut baptisée Manoir Hazen seulement parce qu’elle était sise à côté de
l’embouchure du ruisseau. Manoir que Moses Hazen n’a jamais connu et encore
moins habitél et où ne logea ni Franklin, ni Chase, ni aucun des membres de la
Commission américaine.
dans le
Vermont. Hazen mourut à Troy le 30 janvier 1802, où Charlotte, son épouse
canadienne, l’avait suivi. Ayant renoncée par son mariage à la religion
catholique, elle réintégra son église deux ans après le décès de son époux.
Hazen laissa un nom dans la région, que l’on attribua au ruisseau sur la rive
est qui se déverse dans le Richelieu, et une demeure traditionnelle en pierre
qui fut baptisée Manoir Hazen seulement parce qu’elle était sise à côté de
l’embouchure du ruisseau. Manoir que Moses Hazen n’a jamais connu et encore
moins habitél et où ne logea ni Franklin, ni Chase, ni aucun des membres de la
Commission américaine. abrité,
au printemps 1776, jusqu’à 3 000 malades. Plusieurs milliers d’hommes de
troupes y séjournèrent, et lorsque le temps de la débâcle sonna, il servit
encore de point d’appui à la retraite des envahisseurs. Le 16 juin, l’armée en
retraite mit le feu au fort de Chambly et les soldats qui y étaient cantonnés
se sauvèrent à Saint-Jean, talonnés par les troupes britanniques. Quand ces
dernières atteignirent le fort Saint-jean, le soir du 18, ils ne retrouvèrent
qu’un brasier en flammes et déserté. La guerre d’Indépendance allait désormais
se poursuivre sur le territoire américain. Le 18 juin 1776, le général Burgoyne
ne trouva qu’une seule arrière-garde d’une quarantaine d’hommes commandés par
le major T. Bigelow et une vingtaine de canons abandonnés. N’ayant plus
d’embarcation utilisable, l’armée anglaise resta bloquée à Saint-Jean dans sa
poursuite contre les rebelles. L’incapacité et le manque d’organisation des
généraux britanniques permirent ainsi aux rebelles de se replier et de refaire
leur force.
abrité,
au printemps 1776, jusqu’à 3 000 malades. Plusieurs milliers d’hommes de
troupes y séjournèrent, et lorsque le temps de la débâcle sonna, il servit
encore de point d’appui à la retraite des envahisseurs. Le 16 juin, l’armée en
retraite mit le feu au fort de Chambly et les soldats qui y étaient cantonnés
se sauvèrent à Saint-Jean, talonnés par les troupes britanniques. Quand ces
dernières atteignirent le fort Saint-jean, le soir du 18, ils ne retrouvèrent
qu’un brasier en flammes et déserté. La guerre d’Indépendance allait désormais
se poursuivre sur le territoire américain. Le 18 juin 1776, le général Burgoyne
ne trouva qu’une seule arrière-garde d’une quarantaine d’hommes commandés par
le major T. Bigelow et une vingtaine de canons abandonnés. N’ayant plus
d’embarcation utilisable, l’armée anglaise resta bloquée à Saint-Jean dans sa
poursuite contre les rebelles. L’incapacité et le manque d’organisation des
généraux britanniques permirent ainsi aux rebelles de se replier et de refaire
leur force.


.svg.png)






















































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire