 |
| La Grande Muraille, vue de l'espace |
INTRODUCTION
Depuis plus de trente ans, je m'affaire à retracer l'évolution de la conscience historique de la civilisation occidentale. Ce qui importe pour moi n'est pas tant jusqu'à quel point ais-je bien ou mal interprété cette civilisation mienne, mais comment la méthode-synthèse d'investigation que j'ai élaborée peut permettre d'affiner cette lecture. Je tiens pour vrai que la notion de conscience, fortement teintée de métaphysique, peut s'identifier plus concrètement et plus scientifiquement à la notion de représentation mentale. Je tiens également pour vrai que la notion de conscience historique en est une de conscience collective qui, tout comme la conscience individuelle, comprend également un inconscient collectif constitué des résidus psychiques nés des interdits et des transgressions sociales. Enfin, je tiens pour vrai que la conscience historique est structurée comme une représentation sociale autour de trois dimensions qui la constituent par une énergie interattractive : une dimension de l'Imaginaire qui est l'absolue nécessité de tisser une connaissance historique autour d'un sens de l'unité, sens géographique (poétique de l'espace), temporel
 (poétique du temps) et développemental
(poétique de l'intrigue); une dimension du Symbolique qui est mue par la
Psyché pour laquelle le sens de l'histoire est l'enjeu des pulsions de
vie (Éros) et de mort (Thanatos) conduisant à des alternances de mouvements
centripètes (attraction) et centrifuges (répulsion); enfin une dimension de l'Idéologique commandée par le
vivre-ensemble à l'origine des communautés et des sociétés, le Socius,
qui se définit par les intérêts, les valeurs et les normes socio-culturelles. De
l'interattraction de ces trois dimensions naissent donc des Mythistoires comme
des interprétations théologiques et philosophiques de l'Histoire, seule
activité raisonnée de l'intellect devant la cueillette des informations concernant
le développement des communautés humaines. Le but de toutes philosophies de l'histoire est de fournir aux humains une interprétation intelligible de
leur développement dans l'espace et dans le temps.
(poétique du temps) et développemental
(poétique de l'intrigue); une dimension du Symbolique qui est mue par la
Psyché pour laquelle le sens de l'histoire est l'enjeu des pulsions de
vie (Éros) et de mort (Thanatos) conduisant à des alternances de mouvements
centripètes (attraction) et centrifuges (répulsion); enfin une dimension de l'Idéologique commandée par le
vivre-ensemble à l'origine des communautés et des sociétés, le Socius,
qui se définit par les intérêts, les valeurs et les normes socio-culturelles. De
l'interattraction de ces trois dimensions naissent donc des Mythistoires comme
des interprétations théologiques et philosophiques de l'Histoire, seule
activité raisonnée de l'intellect devant la cueillette des informations concernant
le développement des communautés humaines. Le but de toutes philosophies de l'histoire est de fournir aux humains une interprétation intelligible de
leur développement dans l'espace et dans le temps. J'entreprends donc de tracer une
rapide esquisse de ce que pourrait être la civilisation extrême-orientale lue à
travers le prisme de la méthode-synthèse que j'ai suivie et dont les fibres remontent à la méthode comparatiste d'Arnold Toynbee. Depuis, ma lecture s'est inspirée
des meilleures interprétations des mécanismes sociaux et psychologiques qui
m'apparaissent se joindre d'une façon complémentaire dans la discipline de la
psychologie collective. Aborder une civilisation à laquelle nous sommes
étrangers impose de ne pas effectuer de transferts de notre
compréhension de la civilisation occidentale sur la civilisation étrangère.
Seulement quelqu'un provenant de cette civilisation pourrait reprendre la
méthode-synthèse et l'assumer le plus honnêtement possible en connaissant ces
civilisations de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons
qu'expliquer une civilisation étrangère dans son développement historique et
que sa compréhension nous demeure à jamais inaccessible. Cela veut tout
simplement dire que nous devons prendre les meilleures dispositions objectives
pour ne pas nous perdre dans des écarts subjectifs dans le but de valider ou
dévaluer une civilisation quelconque : celle de l'autre comme la nôtre propre.
J'entreprends donc de tracer une
rapide esquisse de ce que pourrait être la civilisation extrême-orientale lue à
travers le prisme de la méthode-synthèse que j'ai suivie et dont les fibres remontent à la méthode comparatiste d'Arnold Toynbee. Depuis, ma lecture s'est inspirée
des meilleures interprétations des mécanismes sociaux et psychologiques qui
m'apparaissent se joindre d'une façon complémentaire dans la discipline de la
psychologie collective. Aborder une civilisation à laquelle nous sommes
étrangers impose de ne pas effectuer de transferts de notre
compréhension de la civilisation occidentale sur la civilisation étrangère.
Seulement quelqu'un provenant de cette civilisation pourrait reprendre la
méthode-synthèse et l'assumer le plus honnêtement possible en connaissant ces
civilisations de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons
qu'expliquer une civilisation étrangère dans son développement historique et
que sa compréhension nous demeure à jamais inaccessible. Cela veut tout
simplement dire que nous devons prendre les meilleures dispositions objectives
pour ne pas nous perdre dans des écarts subjectifs dans le but de valider ou
dévaluer une civilisation quelconque : celle de l'autre comme la nôtre propre. (1893-1966),
publié dans la très sérieuse collection Librairie philosophique J. Vrin (1969),
voici un auteur japonais qui porte un regard de synthèse sur l'Histoire de la
Chine. Ce livre, écrit dans le contexte de la guerre sino-japonaise amorcée en
1937 par un japonais opposant au régime militaire national et à son idée de la
Grande Coopération Asiatique, trouve dans le taoïsme la synthèse identitaire de
cette histoire : «Le Yi-King est grand et infiniment vaste, rien ne peut
exister hors de lui et il contient tout». Cette pensée, avant même d'avoir
la moindre essence historique, contient la base du sens de l'unité qui
permet de constituer une historicité. L'élève d'Ohsawa, Clim. Yoshimi, peut
ainsi écrire, résumant la pensée essentielle du maître : «Ainsi le Principe
Unique domine la grande constitution de l'Univers et jusqu'à la constitution de
l'âme et du corps humains et se retrouve même au milieu du noyau atomique. Tout
est constitué par cette combinaison yin-yang. Toutes les expériences se
trouvent dans les livres de G. Oshawa, illustrées par d'innombrables exemples.
Ainsi, comme le dit Ohsawa, l'Histoire est le meilleur des livres de classe
pour étudier le Principe Unique» (p. 12). Tout cela est aussi métaphysique
que les idées de Platon
(1893-1966),
publié dans la très sérieuse collection Librairie philosophique J. Vrin (1969),
voici un auteur japonais qui porte un regard de synthèse sur l'Histoire de la
Chine. Ce livre, écrit dans le contexte de la guerre sino-japonaise amorcée en
1937 par un japonais opposant au régime militaire national et à son idée de la
Grande Coopération Asiatique, trouve dans le taoïsme la synthèse identitaire de
cette histoire : «Le Yi-King est grand et infiniment vaste, rien ne peut
exister hors de lui et il contient tout». Cette pensée, avant même d'avoir
la moindre essence historique, contient la base du sens de l'unité qui
permet de constituer une historicité. L'élève d'Ohsawa, Clim. Yoshimi, peut
ainsi écrire, résumant la pensée essentielle du maître : «Ainsi le Principe
Unique domine la grande constitution de l'Univers et jusqu'à la constitution de
l'âme et du corps humains et se retrouve même au milieu du noyau atomique. Tout
est constitué par cette combinaison yin-yang. Toutes les expériences se
trouvent dans les livres de G. Oshawa, illustrées par d'innombrables exemples.
Ainsi, comme le dit Ohsawa, l'Histoire est le meilleur des livres de classe
pour étudier le Principe Unique» (p. 12). Tout cela est aussi métaphysique
que les idées de Platon  et la dialectique yin-yang peut très bien faire écho à
la dialectique hégélienne. Mais le Principe Unique n'est pas le Dieu de Platon pas plus que l'idéalisme dialectique n'est le Yi-King, qu'importent les
confusions qu'on a pu faire à cet égard.
Les 4 000 ans d'Histoire de la Chine de Ohsawa est bien une philosophie
de l'histoire qui appartient à la civilisation extrême-orientale et rédigée au moment où ses deux
grands pôles, la Chine et le Japon, se rencontrent au cours de la plus
terrible guerre de leur histoire. M'engager dans cette voie ne
donnerait pas le résultat auquel je souhaiterais parvenir car je ne ferais que singer
la manière de penser d'Ohsawa. J'aime mieux rester authentique et regarder
le cours du fil de cette histoire en utilisant la méthode-synthèse que j'ai
développée, en la contre-vérifiant sommairement à partir de ce que la connaissance historique
peut me livrer sur cette histoire multi-millénaire.
et la dialectique yin-yang peut très bien faire écho à
la dialectique hégélienne. Mais le Principe Unique n'est pas le Dieu de Platon pas plus que l'idéalisme dialectique n'est le Yi-King, qu'importent les
confusions qu'on a pu faire à cet égard.
Les 4 000 ans d'Histoire de la Chine de Ohsawa est bien une philosophie
de l'histoire qui appartient à la civilisation extrême-orientale et rédigée au moment où ses deux
grands pôles, la Chine et le Japon, se rencontrent au cours de la plus
terrible guerre de leur histoire. M'engager dans cette voie ne
donnerait pas le résultat auquel je souhaiterais parvenir car je ne ferais que singer
la manière de penser d'Ohsawa. J'aime mieux rester authentique et regarder
le cours du fil de cette histoire en utilisant la méthode-synthèse que j'ai
développée, en la contre-vérifiant sommairement à partir de ce que la connaissance historique
peut me livrer sur cette histoire multi-millénaire. Poétique de l'espace. Comme Hérodote disait que l'Égypte était un don du Nil,
la Chine est un don de deux grands fleuves, le Hoang Ho (Fleuve Jaune) et le Yangzi Jiang (Fleuve Bleu). C'est autour de ces deux grandes voies d'accès
que la Chine du Nord et la Chine du Sud se développeront au cours des siècles.
À l'opposée, la mer a donné l'Empire du Soleil Levant, le Japon, mais aussi à
la péninsule coréenne, pont de transhumance de la Chine vers le Japon. Par contre les peuples de l'Asie du Sud-Est ont subi régulièrement les
invasions (et la domination) de peuples venus du Nord, malgré la formidable
civilisation érigée par les Khmers. Le couple Japon/Chine suggère une
comparaison facile avec le couple Grande-Bretagne/France mais elle trahit
l'énoncé du géographe Mackinder qui considérait que les pays insulaires
étaient de mœurs plus libérales et commerciales que les peuples continentaux
orientés vers le despotisme et le contrôle despotique. L’archipel du Japon
n’est pas l’archipel britannique comme la Chine n’est pas la France et les
limes des plateaux asiatiques, d’où déborderont successivement Huns et
Turco-Mongols, encore moins l’Allemagne! Il faut éviter de succomber aux comparaisons apparentes.
Poétique de l'espace. Comme Hérodote disait que l'Égypte était un don du Nil,
la Chine est un don de deux grands fleuves, le Hoang Ho (Fleuve Jaune) et le Yangzi Jiang (Fleuve Bleu). C'est autour de ces deux grandes voies d'accès
que la Chine du Nord et la Chine du Sud se développeront au cours des siècles.
À l'opposée, la mer a donné l'Empire du Soleil Levant, le Japon, mais aussi à
la péninsule coréenne, pont de transhumance de la Chine vers le Japon. Par contre les peuples de l'Asie du Sud-Est ont subi régulièrement les
invasions (et la domination) de peuples venus du Nord, malgré la formidable
civilisation érigée par les Khmers. Le couple Japon/Chine suggère une
comparaison facile avec le couple Grande-Bretagne/France mais elle trahit
l'énoncé du géographe Mackinder qui considérait que les pays insulaires
étaient de mœurs plus libérales et commerciales que les peuples continentaux
orientés vers le despotisme et le contrôle despotique. L’archipel du Japon
n’est pas l’archipel britannique comme la Chine n’est pas la France et les
limes des plateaux asiatiques, d’où déborderont successivement Huns et
Turco-Mongols, encore moins l’Allemagne! Il faut éviter de succomber aux comparaisons apparentes. elles-mêmes formées horizontalement et
pourquoi existe-t-il un vaste plateau au Nord au delà du Kouen-Loun. Ce sont
des questions très intéressantes du point de vue de la naissance et du
développement de la terre» (p. 23). Aujourd'hui, la paléogéographie nous
explique que les deux chaînes se sont formées par l'effet du sous-continent
indien, détaché de la côte est de l'Afrique et continue toujours de foncer
sur le continent asiatique, faisant ressurgir les fonds marins jusqu'aux plus
hauts sommets du monde. Cette vision géographique commande le sens de l'unité
de l'espace. Contrairement à la péninsule européenne où les chaînes de
montagnes et les fleuves semblent majoritairement aller à la verticale, du nord
au sud, en Asie, c'est de l'ouest vers l'est que vont chaînes de montagnes et
fleuves majeurs : «Sur ce plateau au Nord du Kouen-Loun, il y a 10.000 ans,
tout un peuple voyageait de l'Ouest vers l'Est. C'étaient les ancêtres du
peuple Chinois. Il a fallu plus de 5.000 ans à ce peuple pour parvenir à
l'extrême-Est de ce plateau où se trouve le fleuve Jaune (HOANG-HO) qui jaillit
du Tibet et se jette dans le Golfe de PETCHILI ou HOPE (3.750 kms). Ce peuple
descendait le fil du fleuve. Un esprit est caché dans les eaux, il s'exprime
par métempsychose : c'est l'Ordre de l'Univers» (p. 23). Bref, du sens de
l'unité dans l'espace découle l'unité de temps et d'intrigue. La conquête du continent asiatique inverse celle du continent américain. Par la Corée, ces migrants
pénètreront dans l'archipel japonais de même qu'en contournant l'Himalaya, ils
peupleront la péninsule de l'Asie du Sud-Est. Alors que la préhistoire et
l'histoire européenne ont émergé de deux mers intérieures, la Méditerranée et
la Baltique, c'est la terra firma qui est à l'origine de la civilisation
extrême-orientale.
elles-mêmes formées horizontalement et
pourquoi existe-t-il un vaste plateau au Nord au delà du Kouen-Loun. Ce sont
des questions très intéressantes du point de vue de la naissance et du
développement de la terre» (p. 23). Aujourd'hui, la paléogéographie nous
explique que les deux chaînes se sont formées par l'effet du sous-continent
indien, détaché de la côte est de l'Afrique et continue toujours de foncer
sur le continent asiatique, faisant ressurgir les fonds marins jusqu'aux plus
hauts sommets du monde. Cette vision géographique commande le sens de l'unité
de l'espace. Contrairement à la péninsule européenne où les chaînes de
montagnes et les fleuves semblent majoritairement aller à la verticale, du nord
au sud, en Asie, c'est de l'ouest vers l'est que vont chaînes de montagnes et
fleuves majeurs : «Sur ce plateau au Nord du Kouen-Loun, il y a 10.000 ans,
tout un peuple voyageait de l'Ouest vers l'Est. C'étaient les ancêtres du
peuple Chinois. Il a fallu plus de 5.000 ans à ce peuple pour parvenir à
l'extrême-Est de ce plateau où se trouve le fleuve Jaune (HOANG-HO) qui jaillit
du Tibet et se jette dans le Golfe de PETCHILI ou HOPE (3.750 kms). Ce peuple
descendait le fil du fleuve. Un esprit est caché dans les eaux, il s'exprime
par métempsychose : c'est l'Ordre de l'Univers» (p. 23). Bref, du sens de
l'unité dans l'espace découle l'unité de temps et d'intrigue. La conquête du continent asiatique inverse celle du continent américain. Par la Corée, ces migrants
pénètreront dans l'archipel japonais de même qu'en contournant l'Himalaya, ils
peupleront la péninsule de l'Asie du Sud-Est. Alors que la préhistoire et
l'histoire européenne ont émergé de deux mers intérieures, la Méditerranée et
la Baltique, c'est la terra firma qui est à l'origine de la civilisation
extrême-orientale. L'archipel japonais fut d'abord peuplé par les Aïnous qui provenaient vraisemblablement de Sibérie vers -1300 av. J.-C., leurs ancêtres ayant migré
vers Hokkaidō,
les îles Kouriles, l'île de Sakhaline et
le sud de la péninsule du Kamtchatka. C'est-à-dire 1000 ans avant la traversée de la péninsule coréenne jusqu'à l'île de Honshū par les peuples de Wa
qui sont les ancêtres du peuple
Yamato, formant l'essentiel des Japonais actuels. Là, les nomades asiatiques sont devenus le peuple
japonais dont les îles donnent le sens de l'unité dans l'espace. Ainsi, depuis l'unification Ming, la Chine est-elle restée l'un des pôles de la civilisation
extrême-orientale nettement marqué par son point de gravitation de l'Empire
céleste : l'Empire du Milieu, alors que le Japon, par son autonomie
géographique, ethnique et politique est devenu l'Empire du Soleil Levant, lié à
sa position maritime et, comme son nom en chinois, l'Empire à l'est de
l'Empire du Milieu.
L'archipel japonais fut d'abord peuplé par les Aïnous qui provenaient vraisemblablement de Sibérie vers -1300 av. J.-C., leurs ancêtres ayant migré
vers Hokkaidō,
les îles Kouriles, l'île de Sakhaline et
le sud de la péninsule du Kamtchatka. C'est-à-dire 1000 ans avant la traversée de la péninsule coréenne jusqu'à l'île de Honshū par les peuples de Wa
qui sont les ancêtres du peuple
Yamato, formant l'essentiel des Japonais actuels. Là, les nomades asiatiques sont devenus le peuple
japonais dont les îles donnent le sens de l'unité dans l'espace. Ainsi, depuis l'unification Ming, la Chine est-elle restée l'un des pôles de la civilisation
extrême-orientale nettement marqué par son point de gravitation de l'Empire
céleste : l'Empire du Milieu, alors que le Japon, par son autonomie
géographique, ethnique et politique est devenu l'Empire du Soleil Levant, lié à
sa position maritime et, comme son nom en chinois, l'Empire à l'est de
l'Empire du Milieu. configuration actuelle des frontières des États et des
zones de peuplement. La Poétique du temps, son nom le suggère, est cinétique.
Aussi, les États se font et se défont. Tout commence par des variétés diverses
et hostiles qui se rassemblent pour s'unir en un État primitif, puis cet État
se défait, se morcelle, se réunifie, est morcelé encore par des schismes
intérieurs et des invasions extérieures, se reconstitue encore… Il y a là des États, des Empires, des satellites. Du moins est-ce ce qui ressort de la pensée
d’Ohsawa. Pour lui, le sort de la Chine - ou de son État devrait-on dire - suit
la métaphysique du Yi-King : «L’État de Chou se développa de plus en plus
sous la conduite de leaders éminents tels que Wên Wang, Wu-Wang,
T’Ai-Kung-Wang, Chou-Kung (Tan), etc… Cependant que l’ordre de l’Univers,
yin-yang, la loi du métabolisme, ne lâchait jamais leurs mains. Après une
période de paix d’environ 300 ans, à l’époque de Yu-Wang, l’état est replongé
dans les troubles. Yu-Wang est tué par les Barbares du Nord. Il s’était lui
aussi noyé dans le petit yin et avait adopté la voie descendante, bien que de
grands leaders comme Wu-Wang ou Chu-Kung (Tan) eurent gravi la dure côte du
grand yin, ce qui leur permit d’unifier tous les peuples dans la paix. Puis
vint une période de voie descendante au bout de laquelle l’état se retrouva
dans la pire détresse. À partir de l’époque de P’in-Wang, fils de Yu-Wang, le
brillant état de Chou devint un pays lamentable et "propre à rien".
Comme la splendeur est éphémère! "Dans le monde, tout ce qui est en
abondance commence à manquer" dit-on. Une vie individuelle ne fait
exception à cette règle» (pp. 34-35). Même si un philosophe occidental de
l’histoire en arrivait à tirer une conclusion semblablement mélancolique de
l’Histoire, il ne s’en satisferait guère, à moins qu'il ne soit kantien. Il aurait besoin d’aller plus en profondeur dans les détails, ne pas se contenter d’abstractions métaphysiques avant
d’avoir bien scruté chaque détail du passé tant il est convaincu que le diable
se cache dans les détails et non dans la généralité du mouvement yin et yang. À
côté de cette instabilité de l’unité chinoise dans le temps, Ohsawa présente la
fixité calme de
configuration actuelle des frontières des États et des
zones de peuplement. La Poétique du temps, son nom le suggère, est cinétique.
Aussi, les États se font et se défont. Tout commence par des variétés diverses
et hostiles qui se rassemblent pour s'unir en un État primitif, puis cet État
se défait, se morcelle, se réunifie, est morcelé encore par des schismes
intérieurs et des invasions extérieures, se reconstitue encore… Il y a là des États, des Empires, des satellites. Du moins est-ce ce qui ressort de la pensée
d’Ohsawa. Pour lui, le sort de la Chine - ou de son État devrait-on dire - suit
la métaphysique du Yi-King : «L’État de Chou se développa de plus en plus
sous la conduite de leaders éminents tels que Wên Wang, Wu-Wang,
T’Ai-Kung-Wang, Chou-Kung (Tan), etc… Cependant que l’ordre de l’Univers,
yin-yang, la loi du métabolisme, ne lâchait jamais leurs mains. Après une
période de paix d’environ 300 ans, à l’époque de Yu-Wang, l’état est replongé
dans les troubles. Yu-Wang est tué par les Barbares du Nord. Il s’était lui
aussi noyé dans le petit yin et avait adopté la voie descendante, bien que de
grands leaders comme Wu-Wang ou Chu-Kung (Tan) eurent gravi la dure côte du
grand yin, ce qui leur permit d’unifier tous les peuples dans la paix. Puis
vint une période de voie descendante au bout de laquelle l’état se retrouva
dans la pire détresse. À partir de l’époque de P’in-Wang, fils de Yu-Wang, le
brillant état de Chou devint un pays lamentable et "propre à rien".
Comme la splendeur est éphémère! "Dans le monde, tout ce qui est en
abondance commence à manquer" dit-on. Une vie individuelle ne fait
exception à cette règle» (pp. 34-35). Même si un philosophe occidental de
l’histoire en arrivait à tirer une conclusion semblablement mélancolique de
l’Histoire, il ne s’en satisferait guère, à moins qu'il ne soit kantien. Il aurait besoin d’aller plus en profondeur dans les détails, ne pas se contenter d’abstractions métaphysiques avant
d’avoir bien scruté chaque détail du passé tant il est convaincu que le diable
se cache dans les détails et non dans la généralité du mouvement yin et yang. À
côté de cette instabilité de l’unité chinoise dans le temps, Ohsawa présente la
fixité calme de  l’Empire du Soleil Levant : «En dépit de cette règle du
monde relatif, le Japon vécut 3.000 ans, 10 fois 300 ans, sans jamais tomber
dans la ruine, se développant et prospérant d’une année à l’autre. Voilà la
preuve vivante que celui qui vit l’Ordre de l’Univers est éternel et peut être
éternellement heureux. Il est naturel que l’individu même obtienne un bonheur
stable durant toute sa vie quand il prend l’Ordre de l’Univers, le Principe
Unique, comme base de son existence» (p. 35). Et, pendant cette stabilité
quasi onirique, le yin et le yang continuent de bouleverser les temps du
Céleste Empire : «P’in Wang de Chou abandonna sa capitale et descendit sur
les rives du Fleuve Jaune (c’est la pente descendante). Il s’installe à
Lo-Yang, dans la plaine de l’Est. À partir de cette date et pendant 300 ans, on
parle des "annales des printemps et des automnes" (alternance de
confusion et de conflits)…» (p. 35). Bref, la stabilité de l’unité dans le
temps que représente la chronologie du Japon contraste avec l’alternance
de confusion et de conflits propre au temps historique de la Chine. Le Yin
domine la durée japonaise; le Yang celle de la Chine et de ses satellites du Sud-Est asiatique : le tout
identifie le rythme de la civilisation extrême-orientale.
l’Empire du Soleil Levant : «En dépit de cette règle du
monde relatif, le Japon vécut 3.000 ans, 10 fois 300 ans, sans jamais tomber
dans la ruine, se développant et prospérant d’une année à l’autre. Voilà la
preuve vivante que celui qui vit l’Ordre de l’Univers est éternel et peut être
éternellement heureux. Il est naturel que l’individu même obtienne un bonheur
stable durant toute sa vie quand il prend l’Ordre de l’Univers, le Principe
Unique, comme base de son existence» (p. 35). Et, pendant cette stabilité
quasi onirique, le yin et le yang continuent de bouleverser les temps du
Céleste Empire : «P’in Wang de Chou abandonna sa capitale et descendit sur
les rives du Fleuve Jaune (c’est la pente descendante). Il s’installe à
Lo-Yang, dans la plaine de l’Est. À partir de cette date et pendant 300 ans, on
parle des "annales des printemps et des automnes" (alternance de
confusion et de conflits)…» (p. 35). Bref, la stabilité de l’unité dans le
temps que représente la chronologie du Japon contraste avec l’alternance
de confusion et de conflits propre au temps historique de la Chine. Le Yin
domine la durée japonaise; le Yang celle de la Chine et de ses satellites du Sud-Est asiatique : le tout
identifie le rythme de la civilisation extrême-orientale. ces abstractions
politiques, c’est l’oikouméné qui est cherché, c’est-à-dire l’unité de la
civilisation qui s’identifierait avec la terre entière. Il en va de même de
tous les empires orientaux. L’empereur de Chine considère le pape et les rois
occidentaux comme ses sujets. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, l’oikouménè était
défini, en Occident, par le rayonnement de l'Église catholique romaine. Après les grandes découvertes
et l’établissement des comptoirs coloniaux rivaux aux XVIIe et XVIIIe siècles,
c’est le marché capitaliste et libéral qui reprit le manteau de l’oikouménè et
entendit l’étendre sur la terre entière. L’actuelle mondialisation par le
marché n’est pas l’équivalent d’un État universel, même si les tentacules
politiques, économiques et culturelles américaines enveloppent le globe; c’est
l’Église universelle du libre marché qui agit en tant que modèle imposé et accepté
(en partie ou en totalité) par l’ensemble des civilisations du monde. Les
cultures chinoise, japonaise, vietnamienne, coréenne, n’échappent pas à cette
emprise, malgré la résistance de la Chine de Mao ou la terrible guerre du
Viét-Nam menée par les troupes d’Ho Chi Minh. Un demi-siècle plus tard, leur
nation respective sont entrées de plain pied dans l’économie néo-libérale
mondiale.
ces abstractions
politiques, c’est l’oikouméné qui est cherché, c’est-à-dire l’unité de la
civilisation qui s’identifierait avec la terre entière. Il en va de même de
tous les empires orientaux. L’empereur de Chine considère le pape et les rois
occidentaux comme ses sujets. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, l’oikouménè était
défini, en Occident, par le rayonnement de l'Église catholique romaine. Après les grandes découvertes
et l’établissement des comptoirs coloniaux rivaux aux XVIIe et XVIIIe siècles,
c’est le marché capitaliste et libéral qui reprit le manteau de l’oikouménè et
entendit l’étendre sur la terre entière. L’actuelle mondialisation par le
marché n’est pas l’équivalent d’un État universel, même si les tentacules
politiques, économiques et culturelles américaines enveloppent le globe; c’est
l’Église universelle du libre marché qui agit en tant que modèle imposé et accepté
(en partie ou en totalité) par l’ensemble des civilisations du monde. Les
cultures chinoise, japonaise, vietnamienne, coréenne, n’échappent pas à cette
emprise, malgré la résistance de la Chine de Mao ou la terrible guerre du
Viét-Nam menée par les troupes d’Ho Chi Minh. Un demi-siècle plus tard, leur
nation respective sont entrées de plain pied dans l’économie néo-libérale
mondiale. confucéenne plus que taoïste, finalement, que la
Chine a vécu ses ères discordantes : «En Chine, Lao-Tseu est le premier
homme du Principe Unique. Il a démontré durant cette période de conflits et
d’incompréhension, le principe instructif de Fou-Hi qui datait de 3.000 ans.
Trois mille ans se sont encore écoulés depuis que Lao-Tseu a disparu dans la
Montagne de l’Ouest et bientôt un nouveau Lao-Tseu devra naître en Chine.
Lao-Tseu naquit au Nord-Ouest du pays (yin)» (p. 36). On aurait presque
envie de reconnaître-là une plate réplique des Évangiles : Lao-Tseu est venu,
n’a pas été écouté malgré la vérité de sa conception du Principe Unique,
maintenant, il serait cédulé pour un second retour. À côté, il y a Confucius : «Quant
à Confucius, on ne peut le comparer à Lao-Tseu. Il naquit à l’Est aux environs
de Ch’u-Fu (région yang). Il n’est pas aussi profond que Lao-Tseu. Lao-Tseu
enseignait à fond le monisme dialectique yin-yang, il montrait simplement le
visage de la vérité à l’aide du moins de mots possible. Lui-même a mis ce
principe en pratique jusqu’au bout. Par son propre exemple, il a toujours
exprimé la réalité du monisme dans la vie en éduquant des hommes qui avaient
remplacé leur véritable nature par des connaissances et des concepts. Sa vie
fut à l’image même du Principe
confucéenne plus que taoïste, finalement, que la
Chine a vécu ses ères discordantes : «En Chine, Lao-Tseu est le premier
homme du Principe Unique. Il a démontré durant cette période de conflits et
d’incompréhension, le principe instructif de Fou-Hi qui datait de 3.000 ans.
Trois mille ans se sont encore écoulés depuis que Lao-Tseu a disparu dans la
Montagne de l’Ouest et bientôt un nouveau Lao-Tseu devra naître en Chine.
Lao-Tseu naquit au Nord-Ouest du pays (yin)» (p. 36). On aurait presque
envie de reconnaître-là une plate réplique des Évangiles : Lao-Tseu est venu,
n’a pas été écouté malgré la vérité de sa conception du Principe Unique,
maintenant, il serait cédulé pour un second retour. À côté, il y a Confucius : «Quant
à Confucius, on ne peut le comparer à Lao-Tseu. Il naquit à l’Est aux environs
de Ch’u-Fu (région yang). Il n’est pas aussi profond que Lao-Tseu. Lao-Tseu
enseignait à fond le monisme dialectique yin-yang, il montrait simplement le
visage de la vérité à l’aide du moins de mots possible. Lui-même a mis ce
principe en pratique jusqu’au bout. Par son propre exemple, il a toujours
exprimé la réalité du monisme dans la vie en éduquant des hommes qui avaient
remplacé leur véritable nature par des connaissances et des concepts. Sa vie
fut à l’image même du Principe  Unique» (pp. 36-37). À l’opposé, «Confucius
est un maître de l’éthique. L’éthique en soi n’est pas mauvaise, elle est
simplement un peu trop conceptuelle, passive, négative et yin. C’est pourquoi
elle ne peut jamais prendre une place importante dans la vie quotidienne. C’est
pour cette raison que cette méthode n’a jamais réussi à sauver la situation
politique et sociale en cette période de guerre. Confucius enseigna l’éthique
comme la base de la réalisation de la paix mondiale et son enseignement est
devenu une éducation conceptuelle, séparée de l’éducation de la vie pratique.
On peut imaginer que sa conception était trop yin. En cette période extrêmement
yang, il était bien naturel que cet enseignement fut yin» (p. 37). Et
lorsque nous délaissons la métaphysique comme explication ultime de l’histoire
de la civilisation extrême-orientale, nous aboutissons à ce constat
macrobiotique : «La psychologie se fait connaître par l’entremise du corps,
il ne faut donc pas enseigner la spiritualité séparément de la physiologie. Il
est évident que Confucius n’avait pas nettement séparé l’éducation spirituelle
de l’éducation physiologique, mais il y était enclin. Ainsi ceux qui ruinèrent
le pays de façon désastreuse et cruelle furent les jolies femmes, les repas
gastronomiques et les savants…» (p. 37). Pour un peu, on entendrait
l’explication de la défaite de l’armée française en 1940 donnée par Pétain : l’esprit
de jouissance des Français!
Unique» (pp. 36-37). À l’opposé, «Confucius
est un maître de l’éthique. L’éthique en soi n’est pas mauvaise, elle est
simplement un peu trop conceptuelle, passive, négative et yin. C’est pourquoi
elle ne peut jamais prendre une place importante dans la vie quotidienne. C’est
pour cette raison que cette méthode n’a jamais réussi à sauver la situation
politique et sociale en cette période de guerre. Confucius enseigna l’éthique
comme la base de la réalisation de la paix mondiale et son enseignement est
devenu une éducation conceptuelle, séparée de l’éducation de la vie pratique.
On peut imaginer que sa conception était trop yin. En cette période extrêmement
yang, il était bien naturel que cet enseignement fut yin» (p. 37). Et
lorsque nous délaissons la métaphysique comme explication ultime de l’histoire
de la civilisation extrême-orientale, nous aboutissons à ce constat
macrobiotique : «La psychologie se fait connaître par l’entremise du corps,
il ne faut donc pas enseigner la spiritualité séparément de la physiologie. Il
est évident que Confucius n’avait pas nettement séparé l’éducation spirituelle
de l’éducation physiologique, mais il y était enclin. Ainsi ceux qui ruinèrent
le pays de façon désastreuse et cruelle furent les jolies femmes, les repas
gastronomiques et les savants…» (p. 37). Pour un peu, on entendrait
l’explication de la défaite de l’armée française en 1940 donnée par Pétain : l’esprit
de jouissance des Français!La signification est le sens tiré de la connaissance historique qui permet une intelligibilité affective du
 développement
de la civilisation dans l'espace et dans le temps. Elle interagit donc avec l'historicité, y reçoit la logique de l'articulation des mouvements, des
personnages, des régions et lui fournit une économie des affects entre la
pulsion et la répulsion, l'Éros et Thanatos, le plaisir et la réalité. Revenons au texte d'Ohsawa. Rappelons comment il définit l'historicité : «La
Géographie est la mère de l'Histoire. Si l'on ne connaît pas la mère, on ne
peut connaître l'enfant» (p. 22). La Géographie, entendons le sol, la terre-mère
des religions primitives. Du sol naîtront les peuples, les sociétés, les États.
Du constat de la paléoanthropologie du milieu du XXe siècle, Ohsawa tisse un
mythistoire : «Attiré, ce peuple se déplaçait vers l'Est, habitant forêts et
grottes, mangeant des racines, des noix, du poisson et du gibier. À l'époque de
cette migration se succédèrent plusieurs grands dirigeants. Fou-Hi était l'un
d'eux» (p. 23). Si yin représente le caractère féminin et yang le caractère
masculin, il faut éviter toutefois de confondre la figure avec la personne. Les
grands dirigeants, on le voit tout de suite, sont à la fois chefs de la horde
et aussi figure du Père : «Le père de Fou-Hi était très viril, très yang, sa
mère très féminine, très yin. C'est pourquoi ils s'attiraient profondément et
se disputaient souvent. Le père de Fou-Hi était un homme robuste à barbe de
bûcheron, il avait un peu l'air d'un bandit, la peau brune et le corps
solidement charpenté. La mère au contraire avait le teint clair, la peau douce,
un corps souple et élancé, un caractère doux et calme» (p. 23). Tout cela
ne relève pas de l'historique mais du mythe, mais ce mythe ouvre à la compréhension de l'histoire
dans la mesure où il raconte la distribution des énergies. De l'Éros participe
le yin féminin distribuée par la Terre-Mère. Encastrée entre ses chaînes de
montagne et ses grands fleuves, elle a le teint clair, la peau douce, un
corps souple et élancé, un caractère doux et calme. Il n'est pas question d'insister ici sur la
réalité géographique du vaste territoire chinois : les tremblements de terre
fréquents dus à la pénétration du sous-continent indien sous le plateau
asiatique; les inondations saisonnières, la sécheresse désertique… Par contre,
la figure du yang, le mâle, le père, est encore étranger à la loi. Il est robuste
à barbe de bûcheron, il avait un peu l’air d’un bandit, la peau brune et le
corps solidement charpenté… Son air bandit, tout en étant à la tête de la
famille de Fou-Hi, nous dit qu’Ohsawa ne saurait nous le présenter sous
l’aspect d’une autorité civilisée. C’est un barbare et c’est la mère qui est
chargée de le civiliser. Le Familienroman de Fou-Hi, c’est bien le roman
national de la Chine et par le fait même, de l’Extrême-Orient.
développement
de la civilisation dans l'espace et dans le temps. Elle interagit donc avec l'historicité, y reçoit la logique de l'articulation des mouvements, des
personnages, des régions et lui fournit une économie des affects entre la
pulsion et la répulsion, l'Éros et Thanatos, le plaisir et la réalité. Revenons au texte d'Ohsawa. Rappelons comment il définit l'historicité : «La
Géographie est la mère de l'Histoire. Si l'on ne connaît pas la mère, on ne
peut connaître l'enfant» (p. 22). La Géographie, entendons le sol, la terre-mère
des religions primitives. Du sol naîtront les peuples, les sociétés, les États.
Du constat de la paléoanthropologie du milieu du XXe siècle, Ohsawa tisse un
mythistoire : «Attiré, ce peuple se déplaçait vers l'Est, habitant forêts et
grottes, mangeant des racines, des noix, du poisson et du gibier. À l'époque de
cette migration se succédèrent plusieurs grands dirigeants. Fou-Hi était l'un
d'eux» (p. 23). Si yin représente le caractère féminin et yang le caractère
masculin, il faut éviter toutefois de confondre la figure avec la personne. Les
grands dirigeants, on le voit tout de suite, sont à la fois chefs de la horde
et aussi figure du Père : «Le père de Fou-Hi était très viril, très yang, sa
mère très féminine, très yin. C'est pourquoi ils s'attiraient profondément et
se disputaient souvent. Le père de Fou-Hi était un homme robuste à barbe de
bûcheron, il avait un peu l'air d'un bandit, la peau brune et le corps
solidement charpenté. La mère au contraire avait le teint clair, la peau douce,
un corps souple et élancé, un caractère doux et calme» (p. 23). Tout cela
ne relève pas de l'historique mais du mythe, mais ce mythe ouvre à la compréhension de l'histoire
dans la mesure où il raconte la distribution des énergies. De l'Éros participe
le yin féminin distribuée par la Terre-Mère. Encastrée entre ses chaînes de
montagne et ses grands fleuves, elle a le teint clair, la peau douce, un
corps souple et élancé, un caractère doux et calme. Il n'est pas question d'insister ici sur la
réalité géographique du vaste territoire chinois : les tremblements de terre
fréquents dus à la pénétration du sous-continent indien sous le plateau
asiatique; les inondations saisonnières, la sécheresse désertique… Par contre,
la figure du yang, le mâle, le père, est encore étranger à la loi. Il est robuste
à barbe de bûcheron, il avait un peu l’air d’un bandit, la peau brune et le
corps solidement charpenté… Son air bandit, tout en étant à la tête de la
famille de Fou-Hi, nous dit qu’Ohsawa ne saurait nous le présenter sous
l’aspect d’une autorité civilisée. C’est un barbare et c’est la mère qui est
chargée de le civiliser. Le Familienroman de Fou-Hi, c’est bien le roman
national de la Chine et par le fait même, de l’Extrême-Orient. Voici donc le récit de ce roman familial tel
que raconté par Ohsawa: «Avec des parents aussi différents l’un de l’autre,
Fou-Hi avait beaucoup de difficultés. Les grands hommes naissent toujours de
parents aux caractères diamétralement opposés. Fou-Hi voyait souvent son père
persécuter et battre sa mère. Lui aussi était souvent grondé et frappé par son
père. Parfois il était jeté hors de la caverne et devait passer toute la nuit
en plein froid. Son père l’emmenait à la chasse dans les montagnes ou les
forêts ou à travers les rivières. La coutume d’alors voulait que l’on attrape
un animal au corps-à-corps, sans armes. On devait l’achever à l’aide d’une
pierre ou d’un bâton, jamais rien d’autres. Quand Fou-Hi rentrait bredouille,
son père lui distribuait une volée de coups de poing et le jeune garçon devait
toujours faire le choix entre être griffé et mordu par les bêtes au péril de sa
vie ou être frappé et terriblement battu par son père. Il préféra donc aller se
battre contre les bêtes sauvages. Quand il rentrait chez lui en vainqueur, son
père l’applaudissait. Pour cet enfant, il était préférable de vaincre et d’être
applaudi, plutôt que de perdre et d’être battu comme un martyr» (p. 26).
Voici donc le récit de ce roman familial tel
que raconté par Ohsawa: «Avec des parents aussi différents l’un de l’autre,
Fou-Hi avait beaucoup de difficultés. Les grands hommes naissent toujours de
parents aux caractères diamétralement opposés. Fou-Hi voyait souvent son père
persécuter et battre sa mère. Lui aussi était souvent grondé et frappé par son
père. Parfois il était jeté hors de la caverne et devait passer toute la nuit
en plein froid. Son père l’emmenait à la chasse dans les montagnes ou les
forêts ou à travers les rivières. La coutume d’alors voulait que l’on attrape
un animal au corps-à-corps, sans armes. On devait l’achever à l’aide d’une
pierre ou d’un bâton, jamais rien d’autres. Quand Fou-Hi rentrait bredouille,
son père lui distribuait une volée de coups de poing et le jeune garçon devait
toujours faire le choix entre être griffé et mordu par les bêtes au péril de sa
vie ou être frappé et terriblement battu par son père. Il préféra donc aller se
battre contre les bêtes sauvages. Quand il rentrait chez lui en vainqueur, son
père l’applaudissait. Pour cet enfant, il était préférable de vaincre et d’être
applaudi, plutôt que de perdre et d’être battu comme un martyr» (p. 26). il
fut entraîné par les deux bras du changement de la grande nature. Le climat du
plateau était très rude, le froid et la chaleur s’alternaient perpétuellement :
le froid surtout était mortel. Il découvrit que le principe yin-yang, l’Ordre
de l’Univers, est présent éternellement dans l’Univers tout entier qui est en
perpétuel état de devenir. C’est le fameux Yi-King (le livre des
transmutations). Ce principe du changement n’est pas une science, il est facile
à pratiquer. Fou-Hi voyait le temps passer dans le ciel. Il voyait aussi le
changement des saisons et la face des animaux qui vivent en harmonie avec la
terre. Au milieu d’incessantes vicissitudes, il put découvrir un ordre éternel.
Grâce à ce principe Fou-Hi devint finalement un homme capable de prévoir la
sécheresse, les inondations, les orages, la guerre même, etc… Il en déduisit
les règles fondamentales de l’agriculture, de l’étiquette et de bien d’autres
systèmes. Son peuple menait une vie courageuse et heureuse. Ainsi un grand
homme comme Fou-Hi naît toujours d’un père extrêmement yang et d’une mère
extrêmement yin (c’est-à-dire les deux extrémités). L’électricité est d’autant
plus forte que la différence entre les deux pôles est grande et elle donne
ainsi d’autant plus de lumières et de chaleur» (pp. 26-27).
il
fut entraîné par les deux bras du changement de la grande nature. Le climat du
plateau était très rude, le froid et la chaleur s’alternaient perpétuellement :
le froid surtout était mortel. Il découvrit que le principe yin-yang, l’Ordre
de l’Univers, est présent éternellement dans l’Univers tout entier qui est en
perpétuel état de devenir. C’est le fameux Yi-King (le livre des
transmutations). Ce principe du changement n’est pas une science, il est facile
à pratiquer. Fou-Hi voyait le temps passer dans le ciel. Il voyait aussi le
changement des saisons et la face des animaux qui vivent en harmonie avec la
terre. Au milieu d’incessantes vicissitudes, il put découvrir un ordre éternel.
Grâce à ce principe Fou-Hi devint finalement un homme capable de prévoir la
sécheresse, les inondations, les orages, la guerre même, etc… Il en déduisit
les règles fondamentales de l’agriculture, de l’étiquette et de bien d’autres
systèmes. Son peuple menait une vie courageuse et heureuse. Ainsi un grand
homme comme Fou-Hi naît toujours d’un père extrêmement yang et d’une mère
extrêmement yin (c’est-à-dire les deux extrémités). L’électricité est d’autant
plus forte que la différence entre les deux pôles est grande et elle donne
ainsi d’autant plus de lumières et de chaleur» (pp. 26-27). Tant que la recherche historique ne
se poursuit pas, il est difficile de se départir du mythistoire car il remplit
les vides de notre ignorance. Ces récits aprioristes, comme le récit de la
Genèse dans la Bible ou ceux d'Homère ou du Mahabarata offrent une «métalecture» de
la réalité accessible sous la forme empirique par tous. L'usage qu'en fait
Ohsawa indique à quel point il est difficile de s'en débarrasser. Même lorsque
la paléoanthropologie parvient à retracer les origines ethniques et les
migrations démographiques, ces récits persistent dans la littérature, l'art et
la mémoire collective. Ce qui change, c'est leur statut : de vérité
transcendante, elles se font thématiques de reconnaissance culturelle. Ils
fondent nos affects, contribuent à définir l'Éros et Thanatos aussi
bien dans les liens interpersonnels de membres de la collectivité que dans les relations
sociales entre les groupes et les institutions. Pour Ohsawa, comme pour
beaucoup de Chinois, le récit de Fou-Hi est mythe fondateur et trame, au cours des
millénaires, en deçà des régimes de lois et de pouvoirs, l'économie des affects
de la civilisation.
Tant que la recherche historique ne
se poursuit pas, il est difficile de se départir du mythistoire car il remplit
les vides de notre ignorance. Ces récits aprioristes, comme le récit de la
Genèse dans la Bible ou ceux d'Homère ou du Mahabarata offrent une «métalecture» de
la réalité accessible sous la forme empirique par tous. L'usage qu'en fait
Ohsawa indique à quel point il est difficile de s'en débarrasser. Même lorsque
la paléoanthropologie parvient à retracer les origines ethniques et les
migrations démographiques, ces récits persistent dans la littérature, l'art et
la mémoire collective. Ce qui change, c'est leur statut : de vérité
transcendante, elles se font thématiques de reconnaissance culturelle. Ils
fondent nos affects, contribuent à définir l'Éros et Thanatos aussi
bien dans les liens interpersonnels de membres de la collectivité que dans les relations
sociales entre les groupes et les institutions. Pour Ohsawa, comme pour
beaucoup de Chinois, le récit de Fou-Hi est mythe fondateur et trame, au cours des
millénaires, en deçà des régimes de lois et de pouvoirs, l'économie des affects
de la civilisation. Chine, on retrouve l'alternance du yin et du
yang : «Imagination cosmique et notion de couple s'unissent pour créer les
souverains géniteurs : Izanagi, le dieu, et Izanami, la déesse. Chargés par les
dieux de stabiliser la terre dérivante, ils reçurent d'eux en cadeau une lance
(hoko) : "Alors que ces deux kami se tenaient sur le Pont
Flottant du Ciel, ils plongèrent la hallebarde divine, l'agitèrent en cercle
dans le sel marin et la retirèrent en faisant clapoter l'eau. À ce moment-là,
les gouttes salées qui tombaient de la hallebarde se superposèrent et devinrent
des îles". (Kojihi). Ils passèrent le reste de leurs jours à
enfanter îles et divinités, mais en donnant naissance au feu, Izanami périt,
brûlée à mort. Désespéré, Izanagi s'en fut la chercher aux enfers
Chine, on retrouve l'alternance du yin et du
yang : «Imagination cosmique et notion de couple s'unissent pour créer les
souverains géniteurs : Izanagi, le dieu, et Izanami, la déesse. Chargés par les
dieux de stabiliser la terre dérivante, ils reçurent d'eux en cadeau une lance
(hoko) : "Alors que ces deux kami se tenaient sur le Pont
Flottant du Ciel, ils plongèrent la hallebarde divine, l'agitèrent en cercle
dans le sel marin et la retirèrent en faisant clapoter l'eau. À ce moment-là,
les gouttes salées qui tombaient de la hallebarde se superposèrent et devinrent
des îles". (Kojihi). Ils passèrent le reste de leurs jours à
enfanter îles et divinités, mais en donnant naissance au feu, Izanami périt,
brûlée à mort. Désespéré, Izanagi s'en fut la chercher aux enfers  mais, comme
Orphée, sa curiosité et son impatience le perdirent; terrifié par la vue du
corps décomposé de son épouse, il s'enfuit du monde infernal, poursuivi par
d'impitoyables furies» (D. et V. Elisseeff. La civilisation japonaise, Paris,
Arthaud, Col. Les Grandes civilisations, 1974, p. 26). On retrouve également
dans l'Asie du Sud-Est et dans les mers du Sud de semblables récits de la
création. Les îles naissent de gouttes de boue, comme en Polynésie. Du couple
Izanagi-Izanami naît Amaterasu O-mikami, qui personnifie le soleil et
représente l'ancêtre divin du clan impérial. Comme en Égypte, le soleil est la
déesse qui enfante les hommes et les empereurs sont ses fils qui, comme le Pharaon,
doivent être considérés comme des dieux vivant. La seule différence est
qu'Amon est un dieu masculin alors qu'Amaterasu est une déesse. Son double est
Susanoo, un frère malveillant, violent et perturbateur. Les Elisseeff précisent
toutefois qu'il est «moins l'antithèse de sa sœur qu’un concurrent, un
gêneur, un tourbillon brutal lancé au cœur d’une société policée. Les
fondements historiques de la légende d’Amaterasu et du Susanoo semblent
relativement clairs et l’on pense que cet antagonisme traduit dans la
mythologie l’antique lutte que se livrèrent pour la domination des clans les
pays également évolués du Yamato et d’Izumo» (p. 29). Un peu comme les Han
et les Miao, la dynamique des rivalités entre le Yamato et l’Izumo a fini par
restaurer le Principe Unique.
mais, comme
Orphée, sa curiosité et son impatience le perdirent; terrifié par la vue du
corps décomposé de son épouse, il s'enfuit du monde infernal, poursuivi par
d'impitoyables furies» (D. et V. Elisseeff. La civilisation japonaise, Paris,
Arthaud, Col. Les Grandes civilisations, 1974, p. 26). On retrouve également
dans l'Asie du Sud-Est et dans les mers du Sud de semblables récits de la
création. Les îles naissent de gouttes de boue, comme en Polynésie. Du couple
Izanagi-Izanami naît Amaterasu O-mikami, qui personnifie le soleil et
représente l'ancêtre divin du clan impérial. Comme en Égypte, le soleil est la
déesse qui enfante les hommes et les empereurs sont ses fils qui, comme le Pharaon,
doivent être considérés comme des dieux vivant. La seule différence est
qu'Amon est un dieu masculin alors qu'Amaterasu est une déesse. Son double est
Susanoo, un frère malveillant, violent et perturbateur. Les Elisseeff précisent
toutefois qu'il est «moins l'antithèse de sa sœur qu’un concurrent, un
gêneur, un tourbillon brutal lancé au cœur d’une société policée. Les
fondements historiques de la légende d’Amaterasu et du Susanoo semblent
relativement clairs et l’on pense que cet antagonisme traduit dans la
mythologie l’antique lutte que se livrèrent pour la domination des clans les
pays également évolués du Yamato et d’Izumo» (p. 29). Un peu comme les Han
et les Miao, la dynamique des rivalités entre le Yamato et l’Izumo a fini par
restaurer le Principe Unique. Nous retrouvons la même dualité aux
origines du mythistoire vietnamien, à partir de la dynastie de Hóng Báng : «Selon
la tradition rapportée par les Annales, un arrière-petit fils du mythique
empereur Thán Nóng (Chen Nong), ancêtre de l’agriculture, appelé Dé Minh,
rencontra, au cours d’une tournée dans le Sud, près de la Chaîne des Cinq
Passes, une Tién (Immortelle), dont il eut un fils, Lôc Tuc. Par la suite, Dé
Minh partagea son empire entre son fils aîné Dé Nghi qui reçut le Nord et son fils cadet
Lôc Tuc qui reçut le Sud. Ce dernier régna sous le nom de Kinh-dúóng-vúóng sur
le royaume de Xich Quy», ce qui, pour les Occidentaux veut dire que la
division entre le Nord et le Sud Vietnam remonte à une période bien antérieure
à la guerre civile menée par les opposants communistes et capitalistes.
Poursuivons : «Kinh-dúóng-vúóng épousa la fille du Seigneur de Dóng-dinh
(Tong-t’ing), Thán Long (Dragon Génie), et en eut un fils qui lui succéda sous
le nom de Lac Long Quán (Seigneur Dragon Lac). Lac Long Quán épousa Au Có qui
lui donna cent fils. C’est là l’origine des Bách Vièt (Cent Yue). Un jour le roi dit à sa femme : "Je suis de la race des
Nous retrouvons la même dualité aux
origines du mythistoire vietnamien, à partir de la dynastie de Hóng Báng : «Selon
la tradition rapportée par les Annales, un arrière-petit fils du mythique
empereur Thán Nóng (Chen Nong), ancêtre de l’agriculture, appelé Dé Minh,
rencontra, au cours d’une tournée dans le Sud, près de la Chaîne des Cinq
Passes, une Tién (Immortelle), dont il eut un fils, Lôc Tuc. Par la suite, Dé
Minh partagea son empire entre son fils aîné Dé Nghi qui reçut le Nord et son fils cadet
Lôc Tuc qui reçut le Sud. Ce dernier régna sous le nom de Kinh-dúóng-vúóng sur
le royaume de Xich Quy», ce qui, pour les Occidentaux veut dire que la
division entre le Nord et le Sud Vietnam remonte à une période bien antérieure
à la guerre civile menée par les opposants communistes et capitalistes.
Poursuivons : «Kinh-dúóng-vúóng épousa la fille du Seigneur de Dóng-dinh
(Tong-t’ing), Thán Long (Dragon Génie), et en eut un fils qui lui succéda sous
le nom de Lac Long Quán (Seigneur Dragon Lac). Lac Long Quán épousa Au Có qui
lui donna cent fils. C’est là l’origine des Bách Vièt (Cent Yue). Un jour le roi dit à sa femme : "Je suis de la race des  Dragons, tu es de la race des
Immortels. L’eau et le feu se détruisent : nous vivrons difficilement d’accord.
Il faut maintenant nous séparer". La moitié des enfants avec leur mère
retournèrent dans la montagne, l’autre moitié suivirent leur père et
s’établirent au bord de la Mer Méridionale (Nam Hai). Lac Long Quán transmit le
trône à son fils aîné Hùng-vúóng» (Lê Thá Khôi. Le Viet-Nam, Paris,
Éditions de Minuit, 1955, pp. 82-83). Plus antagoniste que complémentaire, le
mythistoire vietnamien marque l’opposition entre les hommes qui travaillent (le
descendant de l’ancêtre agriculteur) et des femmes qui assurent la pérennité de
la race (l’Immortelle). Ils se rencontrent pour procréer et au bout de la
centaine, partagent la terre vietnamienne en deux parts égales mais opposées. Kinh-dúóng-vúóng le dit
ouvertement à son épouse : nous vivons difficilement d’accord. Plus
terrible qu’en Chine ou au Japon, l’inimitié marque la césure entre les deux
Viet-Nam. Comment pouvait-on se réconcilier et retrouver le Principe Unique?
Dragons, tu es de la race des
Immortels. L’eau et le feu se détruisent : nous vivrons difficilement d’accord.
Il faut maintenant nous séparer". La moitié des enfants avec leur mère
retournèrent dans la montagne, l’autre moitié suivirent leur père et
s’établirent au bord de la Mer Méridionale (Nam Hai). Lac Long Quán transmit le
trône à son fils aîné Hùng-vúóng» (Lê Thá Khôi. Le Viet-Nam, Paris,
Éditions de Minuit, 1955, pp. 82-83). Plus antagoniste que complémentaire, le
mythistoire vietnamien marque l’opposition entre les hommes qui travaillent (le
descendant de l’ancêtre agriculteur) et des femmes qui assurent la pérennité de
la race (l’Immortelle). Ils se rencontrent pour procréer et au bout de la
centaine, partagent la terre vietnamienne en deux parts égales mais opposées. Kinh-dúóng-vúóng le dit
ouvertement à son épouse : nous vivons difficilement d’accord. Plus
terrible qu’en Chine ou au Japon, l’inimitié marque la césure entre les deux
Viet-Nam. Comment pouvait-on se réconcilier et retrouver le Principe Unique? «Le roi de Thuc, dont la demande
avait été repoussée, légua à ses descendants la haine du Van Lang. Le dernier
des Hùng-vúóng, confiant dans la puissance de ses armes, s’était endormi dans
la mollesse. Les troupes de Thuc s’ébranlèrent. Elles étaient arrivées à la
porte de la ville que le roi s’éveillait à peine de son ivresse. Au milieu des
cris de triomphe de ses ennemis, Hùng-vúóng se précipita dans un puits. Ainsi
prit fin la dynastie des Hông Bàng (258 A.C.)
«Le roi de Thuc, dont la demande
avait été repoussée, légua à ses descendants la haine du Van Lang. Le dernier
des Hùng-vúóng, confiant dans la puissance de ses armes, s’était endormi dans
la mollesse. Les troupes de Thuc s’ébranlèrent. Elles étaient arrivées à la
porte de la ville que le roi s’éveillait à peine de son ivresse. Au milieu des
cris de triomphe de ses ennemis, Hùng-vúóng se précipita dans un puits. Ainsi
prit fin la dynastie des Hông Bàng (258 A.C.) «La tradition rapporte que le roi
ne put achever la construction de sa ville qu’avec l’appui surnaturel de Kim
Quy, la Tortue d’Or. Au moment de le quitter, le Génie lui remit en présent une
griffe qui, montée en gâchette sur une arbalète, le rendait invincible. Le
général chinois Triêu Dàqui convoitait Au Lac subit une sanglante défaite. Il
eut alors recours à la ruse et demanda pour son fils Trong Thuy la main de la
fille d’An-dúóng-vúóng, la belle My Châu. Grâce à la confiance de sa femme,
Trong Thuy déroba la griffe miraculeuse qu’il s’empressa de rapporter à son
père.
«La tradition rapporte que le roi
ne put achever la construction de sa ville qu’avec l’appui surnaturel de Kim
Quy, la Tortue d’Or. Au moment de le quitter, le Génie lui remit en présent une
griffe qui, montée en gâchette sur une arbalète, le rendait invincible. Le
général chinois Triêu Dàqui convoitait Au Lac subit une sanglante défaite. Il
eut alors recours à la ruse et demanda pour son fils Trong Thuy la main de la
fille d’An-dúóng-vúóng, la belle My Châu. Grâce à la confiance de sa femme,
Trong Thuy déroba la griffe miraculeuse qu’il s’empressa de rapporter à son
père. cria : "Ton ennemi est derrière
toi!". Le roi trancha la tête de sa fille, puis, tenant à la main une
corne de rhinocéros, il suivit la Tortue et entra dans la mer.
cria : "Ton ennemi est derrière
toi!". Le roi trancha la tête de sa fille, puis, tenant à la main une
corne de rhinocéros, il suivit la Tortue et entra dans la mer. En ce temps-là, une tigresse et une
ourse vivaient dans la même caverne. Elles vinrent prier Hwan-ung de leur
donner forme humaine. Le roi céleste donna à chacune d’elles un bouquet
d’armoise et vingt gousses d’ail et leur dit : "Si vous mangez cette
nourriture sacrée et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant cent
jours, vous deviendrez des êtres humains".
En ce temps-là, une tigresse et une
ourse vivaient dans la même caverne. Elles vinrent prier Hwan-ung de leur
donner forme humaine. Le roi céleste donna à chacune d’elles un bouquet
d’armoise et vingt gousses d’ail et leur dit : "Si vous mangez cette
nourriture sacrée et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant cent
jours, vous deviendrez des êtres humains". rendu ce
pragmatisme inutile, compliqué et peu pratique. Le pragmatisme doit être simple
et facile à comprendre et en même temps très utile et efficace. Une théorie
complexe qu'un spécialiste seul peut comprendre ne sert à rien. (Voilà la
supériorité du P.U. [Principe Unique], de l'I King, le livre des
transmutations dont l'histoire de la Chine et du Japon vue de face et de dos
n'a cessé de démontrer la valeur). En Chine, depuis des temps immémoriaux, les
grands leaders qui avaient découvert et maîtrisé ce Principe de l'Ordre de
l'Univers dirigeaient leur peuple dans la paix. Mais d'autres leaders, intellectuels
de petite envergure, apparurent avec le temps et traduisirent l'Ordre de
l'Univers en de difficiles théories» (p. 21). Ohsawa pense sans doute ici aux confucianistes et aux Lettrés dont l'empereur Shi Houang-ti devait commander de faire brûler tous les livres. Contrairement à l'Athènes classique, Ohsawa se
prononce pour la technè contre la païdéia : «Le peuple, sans
instruction, ne pouvait dès lors continuer à comprendre le
rendu ce
pragmatisme inutile, compliqué et peu pratique. Le pragmatisme doit être simple
et facile à comprendre et en même temps très utile et efficace. Une théorie
complexe qu'un spécialiste seul peut comprendre ne sert à rien. (Voilà la
supériorité du P.U. [Principe Unique], de l'I King, le livre des
transmutations dont l'histoire de la Chine et du Japon vue de face et de dos
n'a cessé de démontrer la valeur). En Chine, depuis des temps immémoriaux, les
grands leaders qui avaient découvert et maîtrisé ce Principe de l'Ordre de
l'Univers dirigeaient leur peuple dans la paix. Mais d'autres leaders, intellectuels
de petite envergure, apparurent avec le temps et traduisirent l'Ordre de
l'Univers en de difficiles théories» (p. 21). Ohsawa pense sans doute ici aux confucianistes et aux Lettrés dont l'empereur Shi Houang-ti devait commander de faire brûler tous les livres. Contrairement à l'Athènes classique, Ohsawa se
prononce pour la technè contre la païdéia : «Le peuple, sans
instruction, ne pouvait dès lors continuer à comprendre le  principe de la vie.
Les savants eux-mêmes se spéciali-
principe de la vie.
Les savants eux-mêmes se spéciali-sèrent de plus en plus et s'abaissèrent jusqu'à raisonner et négliger la pratique du Principe. Les grands leaders de temps très reculés comme Sin-Jên, Fou-Hi et Shen-Nung montraient l'Ordre de l'Univers, la Vérité comme une pratique et non comme une doctrine. Ce sont les savants de l'époque Wên-Wang de Chou qui ont commencé à transformer ce principe en une doctrine difficile, en théories compliquées et qui enfin ont supprimé cette étude au peuple. Quant à Confucius et ses adeptes, ils ont parachevé le crime» (p. 21). Voilà pourquoi la légende de Fou-Hi apparaît si importante aux yeux d'Ohsawa : «Les groupes leaders tels que Fou-Hi enseignaient ce principe de l'Ordre de l'Univers comme un instrument ou une technique de la vie réelle. Ils n'ont enseigné que le Yin et le Yang, avec seulement deux petits signes. Confucius et ses adeptes l'ont transformé en principe difficile, en théories compliquées incompréhensibles aux gens et ont créé une doctrine académique. (Ils utilisaient 64 signes au lieu de deux et ont écrit deux gros volumes sur le Yin et le Yang.) Ceux qui sont responsables du destin impitoyable de ce pays mondial de Chine, grand roi du continent asiatique, ce sont les savants et les leaders qui ont transformé en théories et doctrines difficiles et complexes le Principe de MAKOTO de l'Ordre de l'Univers compréhensible à tous. En ce sens, Confucius a commis une faute et un crime graves. À travers toutes les générations, ceux qui ruinent un état et conduisent le peuple au malheur sont très souvent des savants éminents et professionnels et des idéologistes et leurs disciples. Cela ne se limite pas seulement "aux scribes et aux Pharisiens hypocrites". Cependant l'on ne peut faire de reproches aux gens qui professent à l'Académie ni aux éducateurs, car… [la suite est manquante]» (pp. 21-22).
Quoi qu’il en soit, Ohsawa nous apprend ici à lire les différentes phases de l’histoire chinoise en considérant les métamorphose du yin en yang et vice versa selon les périodes où les empereurs se conduisent en suivant ou en dérogeant à la voie pragmatique du I King : «Maintenant nous allons examiner quels genres de principes sont en vigueur chez le grand peuple Chinois, pourquoi il n’y a pas un seul empire qui ait duré plus de 300 ans et aussi pourquoi un état qui a formé le plus grand Empire, construit la plus grande muraille, qui est encore aujourd’hui un sujet d’émerveillement, a péri en 15 ans seulement» (p. 22). Mais, avant d'en arriver là, au récit du Premier empereur Ts'in Che Houang-ti (nom à alphabet variable, aujourd'hui connu sous le nom de Qin Shi Huangdi.), c’est alors qu'Ohsawa nous raconte le mythe de Fou-Hi. Oshawa utilise (de manière «pragmatique») le mythistoire pour nous introduire à la connaissance historique «objective». Fou-Hi est l’unité de mesure idéologique du comportement de Shi Houang-ti :
 «Quand l’époque des Annales des
Printemps et des Automnes (époque de grande confusion) a atteint 300 ans, 7états se font face, guettant une occasion de conquérir le monde. La Chine entre
dans l’âge yang des guerres continuelles. Cette période dure environ 200 ans
avant que le yang n’atteigne son point culminant. Mais abandonnons cette partie
trop confuse de l’Histoire.
«Quand l’époque des Annales des
Printemps et des Automnes (époque de grande confusion) a atteint 300 ans, 7états se font face, guettant une occasion de conquérir le monde. La Chine entre
dans l’âge yang des guerres continuelles. Cette période dure environ 200 ans
avant que le yang n’atteigne son point culminant. Mais abandonnons cette partie
trop confuse de l’Histoire.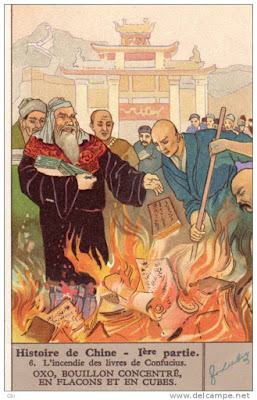 Shih-Huang-Ti (Premier Empereur Souverain), car, affirmait-il, il
représentait à la fois 3 souverains et 5 empereurs. C’est lui qui fit
construire la Grande Muraille, longue de 3.000 kms, afin d’arrêter les invasions barbares du Nord. Shi-Huang-Ti était un homme très éminent et très
yang, un peu comparable à Napoléon et Hitler. C’est pourquoi il affirmait que
les savants et Confucianistes (yin) mettaient les gens en face de dilemmes et
en fait ne servaient à rien. Il fit enterrer plus de 460 Confucianistes
célèbres et brûler tous les livres sauf les livres de l’Agriculture et de la
médecine et le Yi-King. Ne ressemble-t-il pas à Hitler qui fit brûler tous les
livres des savants juifs? Cependant le yang à cette époque atteignit son point
culminant, alors les barbares Mongols s’armèrent et envahirent à nouveau le
territoire. La Grande Muraille, qui ressemble à une chaîne de montagnes
artificielle orientée est-ouest, fut spécialement érigée pour permettre de
résister aux envahisseurs. Toutes les murailles du monde entier sont orientées
est-ouest, que ce soit le mur d’Adrien ou la ligne Maginot, etc… Le pourquoi de
cette orientation est un excellent problème pour ceux qui étudient le Principe
Unique» (pp. 38-39).
Shih-Huang-Ti (Premier Empereur Souverain), car, affirmait-il, il
représentait à la fois 3 souverains et 5 empereurs. C’est lui qui fit
construire la Grande Muraille, longue de 3.000 kms, afin d’arrêter les invasions barbares du Nord. Shi-Huang-Ti était un homme très éminent et très
yang, un peu comparable à Napoléon et Hitler. C’est pourquoi il affirmait que
les savants et Confucianistes (yin) mettaient les gens en face de dilemmes et
en fait ne servaient à rien. Il fit enterrer plus de 460 Confucianistes
célèbres et brûler tous les livres sauf les livres de l’Agriculture et de la
médecine et le Yi-King. Ne ressemble-t-il pas à Hitler qui fit brûler tous les
livres des savants juifs? Cependant le yang à cette époque atteignit son point
culminant, alors les barbares Mongols s’armèrent et envahirent à nouveau le
territoire. La Grande Muraille, qui ressemble à une chaîne de montagnes
artificielle orientée est-ouest, fut spécialement érigée pour permettre de
résister aux envahisseurs. Toutes les murailles du monde entier sont orientées
est-ouest, que ce soit le mur d’Adrien ou la ligne Maginot, etc… Le pourquoi de
cette orientation est un excellent problème pour ceux qui étudient le Principe
Unique» (pp. 38-39). personnalité yang également appartient son «pragmatisme» administratif : «…il
réalisa l’unification de la monnaie, le système des préfectures, l’annulation
du régime féodal, l’expansion du territoire, il fixa les rangs à la cour. Le
pays devint alors ce qui est au nord la Grande Muraille, au sud le Viet-Nam. À
l’époque de Chou, la Chine occupait seulement le territoire compris entre la
Rivière Jaune et le Yang tze-Kiang. Cette expansion fut donc une entreprise
sans pareille qu’un homme ordinaire n’aurait même pas pu envisager. Mais hélas,
comme il en est toujours avec de semblables entreprises et expéditions, les
impôts se firent lourds, le peuple tomba dans une profonde misère et les
savants commencèrent à protester. Alors Shih-Huang-Ti infligea à son peuple de
sévères punitions, ordonna oppressions et répressions, fit brûler les livres et
enterrer vifs les savants. C’est la conséquence normale qui découle d’un chef
extrêmement yang, puisque né et élevé dans une région yin, le plateau le plus
occidental…» (p. 39).
personnalité yang également appartient son «pragmatisme» administratif : «…il
réalisa l’unification de la monnaie, le système des préfectures, l’annulation
du régime féodal, l’expansion du territoire, il fixa les rangs à la cour. Le
pays devint alors ce qui est au nord la Grande Muraille, au sud le Viet-Nam. À
l’époque de Chou, la Chine occupait seulement le territoire compris entre la
Rivière Jaune et le Yang tze-Kiang. Cette expansion fut donc une entreprise
sans pareille qu’un homme ordinaire n’aurait même pas pu envisager. Mais hélas,
comme il en est toujours avec de semblables entreprises et expéditions, les
impôts se firent lourds, le peuple tomba dans une profonde misère et les
savants commencèrent à protester. Alors Shih-Huang-Ti infligea à son peuple de
sévères punitions, ordonna oppressions et répressions, fit brûler les livres et
enterrer vifs les savants. C’est la conséquence normale qui découle d’un chef
extrêmement yang, puisque né et élevé dans une région yin, le plateau le plus
occidental…» (p. 39). milieu géographique (pays - région - ville natale, qui, au
sens large, sont aussi une nourriture). De plus, Shih-Huang-Ti adopta comme
principe directeur le point de vue du savant très yang HAN-FEI, et il écarta
l’opinion des confucianistes yin qui pourtant lui faisait défaut. Le yang
atteignit son point d’explosion, et dès le décès de Shih-Huang-Ti, la
révolution éclata dans tout le sud-est, la région la plus yang. C’est ainsi que
le grand empire disparut au bout de 15 ans seulement. Il est indiscutable que
la vie de ce qui est yang est courte. Quand on devient yang, on doit s’attendre
à avoir une vie brève. Il est dangereux de rester toujours yang après l’âge de
40 ans, bien que l’on doive l’être jusqu’à cet âge. Lorsque ce qui est yang se
ruine, sa ruine même est yang et très voyante. De même un homme énergique et
entreprenant peut mourir brusquement à 40 ou 50 ans d’hémorragie cérébrale ou
de crise cardiaque, ou de maladie hépatique. La capitale de Ch’in, Hsien-Yang,
continua à brûler pendant 3 mois après sa reddition (ce fameux incendie rouge
qui dura trois mois) Shih-Huang-Ti de Ch’in qui fit enterrer vifs des savants
yin ruina son pays à cause de l’opinion d’un
milieu géographique (pays - région - ville natale, qui, au
sens large, sont aussi une nourriture). De plus, Shih-Huang-Ti adopta comme
principe directeur le point de vue du savant très yang HAN-FEI, et il écarta
l’opinion des confucianistes yin qui pourtant lui faisait défaut. Le yang
atteignit son point d’explosion, et dès le décès de Shih-Huang-Ti, la
révolution éclata dans tout le sud-est, la région la plus yang. C’est ainsi que
le grand empire disparut au bout de 15 ans seulement. Il est indiscutable que
la vie de ce qui est yang est courte. Quand on devient yang, on doit s’attendre
à avoir une vie brève. Il est dangereux de rester toujours yang après l’âge de
40 ans, bien que l’on doive l’être jusqu’à cet âge. Lorsque ce qui est yang se
ruine, sa ruine même est yang et très voyante. De même un homme énergique et
entreprenant peut mourir brusquement à 40 ou 50 ans d’hémorragie cérébrale ou
de crise cardiaque, ou de maladie hépatique. La capitale de Ch’in, Hsien-Yang,
continua à brûler pendant 3 mois après sa reddition (ce fameux incendie rouge
qui dura trois mois) Shih-Huang-Ti de Ch’in qui fit enterrer vifs des savants
yin ruina son pays à cause de l’opinion d’un  savant yang… C’est le Karma, vers
lequel nous-mêmes nous acheminons quelquefois» (p. 40). Ohsawa reviendra à
plusieurs reprises sur l’importance de la macrobiotique dans le cours de
l’histoire de la Chine, et cette idéologie trouvera, après la Seconde Guerre
mondiale, des adeptes partout en Occident. Ainsi, un auteur québécois, Jean Pellerin,
intitulera-t-il son essai de philosophie de l’histoire, Faillite de
l’Occident (Montréal, Éditions du Jour, Col. Les Idées du Jour, # D-11,
1963) supposant un «complexe d’Alexandre» expliquant l’agressivité occidentale
par le fait d’être de gros mangeurs de viandes au pacifisme (c’était une époque
où Gandhi avait la cote) végétarien asiatique.
savant yang… C’est le Karma, vers
lequel nous-mêmes nous acheminons quelquefois» (p. 40). Ohsawa reviendra à
plusieurs reprises sur l’importance de la macrobiotique dans le cours de
l’histoire de la Chine, et cette idéologie trouvera, après la Seconde Guerre
mondiale, des adeptes partout en Occident. Ainsi, un auteur québécois, Jean Pellerin,
intitulera-t-il son essai de philosophie de l’histoire, Faillite de
l’Occident (Montréal, Éditions du Jour, Col. Les Idées du Jour, # D-11,
1963) supposant un «complexe d’Alexandre» expliquant l’agressivité occidentale
par le fait d’être de gros mangeurs de viandes au pacifisme (c’était une époque
où Gandhi avait la cote) végétarien asiatique. conseillers sous
prétexte qu’ils présentaient des observations sévères et désagréables. Un
leader révolutionnaire qui assassine un chef violent appelle immanquablement sa
propre ruine. Le karma tourne comme un moulin. Par suite de leurs exigences et
de leur conduite politique et militaire, Han-Fei et son meurtrier Li-Si furent
assassinés à leur tour. Quant à Shih-Huang-Ti, quoiqu’il ait entrepris des
œuvres inégalables, il employa trop la violence. À son grand regret, il fut le
premier, mais aussi le dernier empereur, bien qu’il se crût à l’origine d’une
lignée d’empereurs éternels. Par la suite on détruisit même sa sépulture. Il
utilisa la violence au point de faire enterrer vifs les savants qui lui
représentaient ses erreurs et les dangers qu’il courant. À partir du moment où
un dirigeant réprime la liberté d’opinion, le pays court à sa fin. Ainsi un
grand empire sans précédent disparut en quelques années et pour toujours ainsi
qu’un rêve ou une bulle de savon. Cependant la dynastie de Ch’in parvint malgré
tout à administrer ses territoires et son nom est resté célèbre dans le monde
entier. Le nom de cette dynastie est employé aujourd’hui par le monde entier
comme nom de la Chine éternelle, malgré les 2.000 ans passés et les changements
de dynasties. Cette dynastie Ch’in disparut en effet 15 ans après son
apparition. Si l’on observe l’histoire scrupuleusement, on apprend combien la
violence est éphémère, inutile et nuisible» (pp. 44-45). Évidemment, les
leçons de l’histoire sont indispensables à qui voit se dresser des aspirations
de paix contre la violence des contraintes de son époque. Il y a là un
avertissement que le philosophe envoie aux dirigeants de son pays en pleine
crise belliciste dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.
conseillers sous
prétexte qu’ils présentaient des observations sévères et désagréables. Un
leader révolutionnaire qui assassine un chef violent appelle immanquablement sa
propre ruine. Le karma tourne comme un moulin. Par suite de leurs exigences et
de leur conduite politique et militaire, Han-Fei et son meurtrier Li-Si furent
assassinés à leur tour. Quant à Shih-Huang-Ti, quoiqu’il ait entrepris des
œuvres inégalables, il employa trop la violence. À son grand regret, il fut le
premier, mais aussi le dernier empereur, bien qu’il se crût à l’origine d’une
lignée d’empereurs éternels. Par la suite on détruisit même sa sépulture. Il
utilisa la violence au point de faire enterrer vifs les savants qui lui
représentaient ses erreurs et les dangers qu’il courant. À partir du moment où
un dirigeant réprime la liberté d’opinion, le pays court à sa fin. Ainsi un
grand empire sans précédent disparut en quelques années et pour toujours ainsi
qu’un rêve ou une bulle de savon. Cependant la dynastie de Ch’in parvint malgré
tout à administrer ses territoires et son nom est resté célèbre dans le monde
entier. Le nom de cette dynastie est employé aujourd’hui par le monde entier
comme nom de la Chine éternelle, malgré les 2.000 ans passés et les changements
de dynasties. Cette dynastie Ch’in disparut en effet 15 ans après son
apparition. Si l’on observe l’histoire scrupuleusement, on apprend combien la
violence est éphémère, inutile et nuisible» (pp. 44-45). Évidemment, les
leçons de l’histoire sont indispensables à qui voit se dresser des aspirations
de paix contre la violence des contraintes de son époque. Il y a là un
avertissement que le philosophe envoie aux dirigeants de son pays en pleine
crise belliciste dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Shintoïste, fait qui
exprime la volonté de l’empereur d’écarter toute violence qu’il juge
incompatible avec son désir de gouverner le peuple. Ces empereurs n’ont jamais
édifié de puissantes citadelles aux douves profondes comme l’ont fait hardiment
les responsables de la Chine et des pays Européens. Cependant à certaines
époques dans l’histoire du Japon, les Shogunats de TOKUGAWA et de KAMAKURA ont
réprimé la liberté d’opinion comme le faisaient Shih-Houang-Ti ou la Rome du
Moyen Âge. Mais les empereurs se sont toujours opposés à cette conduite et ont
fait en sorte que cela cesse au plus vite. Voilà l’avantage d’un pays qui est
parvenu à vivre avec l’Ordre de l’Univers, ce Principe d’Unification du Makoto
(Principe qui accepte les oppositions et les unifie). Ce Principe a été retenu
et utilisé à tous les niveaux, y compris dans la vie quotidienne de chaque
individu. Le Principe Instructif est simple et ne présente jamais de théories
complexes ni difficiles» (p. 45). La leçon doit être comprise de tous et, suprême arrogance, semble s'adresser directement à l'Empereur Hiro Hito lui-même.
Shintoïste, fait qui
exprime la volonté de l’empereur d’écarter toute violence qu’il juge
incompatible avec son désir de gouverner le peuple. Ces empereurs n’ont jamais
édifié de puissantes citadelles aux douves profondes comme l’ont fait hardiment
les responsables de la Chine et des pays Européens. Cependant à certaines
époques dans l’histoire du Japon, les Shogunats de TOKUGAWA et de KAMAKURA ont
réprimé la liberté d’opinion comme le faisaient Shih-Houang-Ti ou la Rome du
Moyen Âge. Mais les empereurs se sont toujours opposés à cette conduite et ont
fait en sorte que cela cesse au plus vite. Voilà l’avantage d’un pays qui est
parvenu à vivre avec l’Ordre de l’Univers, ce Principe d’Unification du Makoto
(Principe qui accepte les oppositions et les unifie). Ce Principe a été retenu
et utilisé à tous les niveaux, y compris dans la vie quotidienne de chaque
individu. Le Principe Instructif est simple et ne présente jamais de théories
complexes ni difficiles» (p. 45). La leçon doit être comprise de tous et, suprême arrogance, semble s'adresser directement à l'Empereur Hiro Hito lui-même. Dans l’ensemble des idéologies
élaborées tout au long de l’histoire de la Chine, c’est celle du mandat du
Ciel (天命 : Tiānmìng), apparue sous la dynastie Zhou, qui permet
d’affirmer la légitimité du pouvoir des empereurs. Fondé sur l’approbation que
le Ciel accorde aux dirigeants sages et vertueux, approbation qu’il cesse
d’accorder si ceux-ci ont une conduite mauvaise ou sont corrompus, le mandat
céleste est généralisée en Asie et investit même la définition du Basileus de l’Empire
byzantin aussi bien que son héritier, le Tsar de toutes les Russies. Chaque
manifestation, naturelle ou sociale, peuvent être des messages que le Ciel
envoie à son représentant sur terre. Elle permet aussi bien au peuple de se
rebeller pour une dynastie plus vertueuse que contre une autre jugée corrompue. Il s’agit de décider alors qui détient véritablement le mandat du
Ciel. Le concept se rencontre pour la première fois dans les chroniques écrites
des paroles du duc de Zhou, jeune frère du roi Wu de la dynastie des Zhou
(de 1122 av. J.-C. à 256 av. J.-C.), et qui exerça la régence pendant
l'enfance du petit roi Cheng, fils du roi Wu. Il est considéré par beaucoup
comme ayant été à l'origine de cette notion. Plus tard, le concept de mandat du
Ciel fut invoqué par Mencius, le célèbre philosophe, considéré comme le plus grand
des philosophes chinois après Confucius. Le concept de mandat du Ciel fut utilisé par les
Zhou pour justifier le renversement par eux de la dynastie des Shang, et sera
utilisé par de nombreuses dynasties à venir. Le duc de Zhou expliqua aux sujets
de la dynastie des Shang que si leur roi n'avait pas abusé de son pouvoir, son mandat ne lui aurait pas été retiré.
Dans l’ensemble des idéologies
élaborées tout au long de l’histoire de la Chine, c’est celle du mandat du
Ciel (天命 : Tiānmìng), apparue sous la dynastie Zhou, qui permet
d’affirmer la légitimité du pouvoir des empereurs. Fondé sur l’approbation que
le Ciel accorde aux dirigeants sages et vertueux, approbation qu’il cesse
d’accorder si ceux-ci ont une conduite mauvaise ou sont corrompus, le mandat
céleste est généralisée en Asie et investit même la définition du Basileus de l’Empire
byzantin aussi bien que son héritier, le Tsar de toutes les Russies. Chaque
manifestation, naturelle ou sociale, peuvent être des messages que le Ciel
envoie à son représentant sur terre. Elle permet aussi bien au peuple de se
rebeller pour une dynastie plus vertueuse que contre une autre jugée corrompue. Il s’agit de décider alors qui détient véritablement le mandat du
Ciel. Le concept se rencontre pour la première fois dans les chroniques écrites
des paroles du duc de Zhou, jeune frère du roi Wu de la dynastie des Zhou
(de 1122 av. J.-C. à 256 av. J.-C.), et qui exerça la régence pendant
l'enfance du petit roi Cheng, fils du roi Wu. Il est considéré par beaucoup
comme ayant été à l'origine de cette notion. Plus tard, le concept de mandat du
Ciel fut invoqué par Mencius, le célèbre philosophe, considéré comme le plus grand
des philosophes chinois après Confucius. Le concept de mandat du Ciel fut utilisé par les
Zhou pour justifier le renversement par eux de la dynastie des Shang, et sera
utilisé par de nombreuses dynasties à venir. Le duc de Zhou expliqua aux sujets
de la dynastie des Shang que si leur roi n'avait pas abusé de son pouvoir, son mandat ne lui aurait pas été retiré.**
 chronologie solide sont sans
pareilles dans les autres cultures. Il est en outre surprenant d’observer la
constance et la curieuse obstination avec lesquelles diverses écoles
occidentales ont forgé le mythe du caractère immuable de la société chinoise.
Ce mythe a divers fondements. L’histoire de la Chine, de sa société et de ses
institutions, révèle en effet des traits permanents, un type de développement
particulier. Au cours des trois derniers siècles, son rythme d’évolution fut
incontestablement lent en comparaison de l’étonnante rapidité de transformation
de la civilisation occidentale depuis le XVIe siècle. Cependant, dans le cadre
de ses propres institutions, l’histoire de la Chine a été marquée par une
évolution et un développement dynamiques et continus. La stagnation de la
société chinoise est une légende, déjà énoncée par Hegel - "État sans
histoire" - ou par Ranke - "immobilisme éternel" - et exprimée
ensuite, en termes quelque peu spécieux par les historiens marxistes chinois.
Ceux-ci tendent à placer la Chine dans un contexte de développement social
différent de la norme asiatique, ou simplement à expliciter ce mythe de la
Chine immuable, en intégrant toute l’histoire de la Chine, depuis le IIe siècle
av. J.-C. jusqu’au XIXe siècle ou au XXe siècle, dans une période de stagnation
féodale prolongée. Comparer l’évolution de la société chinoise à celle de la
société occidentale depuis la Renaissance, est une vue de l’esprit absolument fallacieuse»
(D. C. Twitchett, in A. Toynbee (éd.). L’autre moitié du monde, Bruxelles,
Elsevier Séquoia, 1976, p. 40). Tel fut - et tel est encore - l’a priori occidental
devant l’histoire chinoise; un a priori qui ressemble à celui d’une
civilisation égyptienne identique à elle-même de 4,000 av. J.-C jusqu’à la
bataille d’Actium (31 av. J.-C.).
chronologie solide sont sans
pareilles dans les autres cultures. Il est en outre surprenant d’observer la
constance et la curieuse obstination avec lesquelles diverses écoles
occidentales ont forgé le mythe du caractère immuable de la société chinoise.
Ce mythe a divers fondements. L’histoire de la Chine, de sa société et de ses
institutions, révèle en effet des traits permanents, un type de développement
particulier. Au cours des trois derniers siècles, son rythme d’évolution fut
incontestablement lent en comparaison de l’étonnante rapidité de transformation
de la civilisation occidentale depuis le XVIe siècle. Cependant, dans le cadre
de ses propres institutions, l’histoire de la Chine a été marquée par une
évolution et un développement dynamiques et continus. La stagnation de la
société chinoise est une légende, déjà énoncée par Hegel - "État sans
histoire" - ou par Ranke - "immobilisme éternel" - et exprimée
ensuite, en termes quelque peu spécieux par les historiens marxistes chinois.
Ceux-ci tendent à placer la Chine dans un contexte de développement social
différent de la norme asiatique, ou simplement à expliciter ce mythe de la
Chine immuable, en intégrant toute l’histoire de la Chine, depuis le IIe siècle
av. J.-C. jusqu’au XIXe siècle ou au XXe siècle, dans une période de stagnation
féodale prolongée. Comparer l’évolution de la société chinoise à celle de la
société occidentale depuis la Renaissance, est une vue de l’esprit absolument fallacieuse»
(D. C. Twitchett, in A. Toynbee (éd.). L’autre moitié du monde, Bruxelles,
Elsevier Séquoia, 1976, p. 40). Tel fut - et tel est encore - l’a priori occidental
devant l’histoire chinoise; un a priori qui ressemble à celui d’une
civilisation égyptienne identique à elle-même de 4,000 av. J.-C jusqu’à la
bataille d’Actium (31 av. J.-C.). Non seulement
la notion de paléoanthropologie est-elle une notion occidentale, mais les
découvertes faites sur le territoire asiatique de l’histoire avant l’histoire
sont le fait également d’Occidentaux. Opérées dans le contexte du colonialisme,
il a pu apparaître que ces découvertes avaient pour but de stigmatiser encore
plus les glorieuses légendes qui peuplaient les mythistoires orientaux. Quoi
qu’il en soit, c’est dans le courant des années 20 que fut faite la célèbre
découverte du Sinanthrope à Choukoutien (Zhoukoudian) et qui est devenu le
fameux homme de Pékin qui devait disparaître en 1941! Mais ce n’est
pas avant 1963 qu’on découvrit une mandibule et une calotte crânienne mises à
jour respectivement à Ghenjiawo et à Gongwangling. Appartenant à l’espèce Homo
erectus il porte le nom d’Homme de Lantian :
Non seulement
la notion de paléoanthropologie est-elle une notion occidentale, mais les
découvertes faites sur le territoire asiatique de l’histoire avant l’histoire
sont le fait également d’Occidentaux. Opérées dans le contexte du colonialisme,
il a pu apparaître que ces découvertes avaient pour but de stigmatiser encore
plus les glorieuses légendes qui peuplaient les mythistoires orientaux. Quoi
qu’il en soit, c’est dans le courant des années 20 que fut faite la célèbre
découverte du Sinanthrope à Choukoutien (Zhoukoudian) et qui est devenu le
fameux homme de Pékin qui devait disparaître en 1941! Mais ce n’est
pas avant 1963 qu’on découvrit une mandibule et une calotte crânienne mises à
jour respectivement à Ghenjiawo et à Gongwangling. Appartenant à l’espèce Homo
erectus il porte le nom d’Homme de Lantian :  ou 1,7 million d’années, mais de
nouvelles datations leur attribuent un âge beaucoup plus récent : 5 ou 600 000
ans. Le gisement de Zhoukoudian reste le plus important pour la connaissance du
Paléolithique chinois. Situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de
Pékin, il comprend un ensemble de collines calcaires creusées de grottes et de
fissures fossilifères, prospectées et fouillées à partir de 1921, d’abord par
O. Zdansky (1921-1923) qui découvrit les premières dents de Sinanthropes, par
B. Böhlin, puis par W. C. Pei, C. Young et P. Teilhard de Chardin (1927-1940)
et depuis 1949. Quinze sites ont été repérés dont cinq ont livré les vestiges
d’une présence humaine. Le site n° 1 est le plus important par l,abondance de
la faune, de l’industrie et par le nombre d’ossements humains mis au jour.
L’espèce fut dénommée Sinanthropus pekinensis par D. Black en 1927, puis
Pithécanthropus pekinensis du fait de ses caractères anatomiques proches
de ceux du Pithécanthrope de Java et, plus généralement aujourd’hui, Homo
erectus pekinensis, mais le terme Sinanthrope est resté dans le langage
courant. Le site n° 1 est une vaste grotte comblée sur plus de 40 m d’épaisseur
par treize couches principales où alternent des éboulis et des niveaux
paléontologiques et archéologiques datés, d’après la faune, de l’interglaciaire
Mindel-Riss. L’occupation sporadique de la grotte s’étend sur 200 000 ans. Des
couches cendreuses, et surtout des foyers, indiquent que le Sinanthrope
utilisait le feu. Il fut qualifié d’anthropophage du fait de la présence de fragments
osseux humains brisés et calcinés, mais aucun autre indice ne permet de
confirmer cette pratique alimentaire. L’outillage est constitué de très
nombreux éclats d’aspect
ou 1,7 million d’années, mais de
nouvelles datations leur attribuent un âge beaucoup plus récent : 5 ou 600 000
ans. Le gisement de Zhoukoudian reste le plus important pour la connaissance du
Paléolithique chinois. Situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de
Pékin, il comprend un ensemble de collines calcaires creusées de grottes et de
fissures fossilifères, prospectées et fouillées à partir de 1921, d’abord par
O. Zdansky (1921-1923) qui découvrit les premières dents de Sinanthropes, par
B. Böhlin, puis par W. C. Pei, C. Young et P. Teilhard de Chardin (1927-1940)
et depuis 1949. Quinze sites ont été repérés dont cinq ont livré les vestiges
d’une présence humaine. Le site n° 1 est le plus important par l,abondance de
la faune, de l’industrie et par le nombre d’ossements humains mis au jour.
L’espèce fut dénommée Sinanthropus pekinensis par D. Black en 1927, puis
Pithécanthropus pekinensis du fait de ses caractères anatomiques proches
de ceux du Pithécanthrope de Java et, plus généralement aujourd’hui, Homo
erectus pekinensis, mais le terme Sinanthrope est resté dans le langage
courant. Le site n° 1 est une vaste grotte comblée sur plus de 40 m d’épaisseur
par treize couches principales où alternent des éboulis et des niveaux
paléontologiques et archéologiques datés, d’après la faune, de l’interglaciaire
Mindel-Riss. L’occupation sporadique de la grotte s’étend sur 200 000 ans. Des
couches cendreuses, et surtout des foyers, indiquent que le Sinanthrope
utilisait le feu. Il fut qualifié d’anthropophage du fait de la présence de fragments
osseux humains brisés et calcinés, mais aucun autre indice ne permet de
confirmer cette pratique alimentaire. L’outillage est constitué de très
nombreux éclats d’aspect  clactonien mais assez atypiques, on peut néanmoins
distinguer des racloirs de formes très variées, de grossiers grattoires, des
pièces à encoches, des pointes. Il comprend également des choppers et
des chopping-tools, des sphéroïdes (bolas), des objets
nucléiformes et quelques grosses pièces à retouches bifaciales. 88% des outils,
les éclats en particulier, furent taillés dans du quartz filonien et détachés
par la technique bipolaire, un grès fin était aussi utilisé, notamment pour les
galets aménagés et les percuteurs, le cristal de roche et le silex le furent
plus rarement. Cet outillage, pour lequel l’abbé H. Breuil proposa le terme de
Choukouténien, n’évolue guère au cours des temps; on note cependant, vers le
sommet de la stratigraphie, quelques outils mieux élaborés. Le site 13, riche
en faune et daté de la glaciation de Mindel, n’a fourni qu’un chopping-tool
de silex et quelques éclats. Le ste 15, daté du Riss, n’a pas non plus
fourni de vestiges humains, mais une industrie plus soignée que celle des sites
précédents et qui rappelle celle de la vallée de la Fen» (J. Garanger (éd.)
La Préhistoire dans le monde, Paris, P.U.F., Col. Nouvelle Clio -
L’histoire et ses problèmes, 1992, pp. 663-664).
clactonien mais assez atypiques, on peut néanmoins
distinguer des racloirs de formes très variées, de grossiers grattoires, des
pièces à encoches, des pointes. Il comprend également des choppers et
des chopping-tools, des sphéroïdes (bolas), des objets
nucléiformes et quelques grosses pièces à retouches bifaciales. 88% des outils,
les éclats en particulier, furent taillés dans du quartz filonien et détachés
par la technique bipolaire, un grès fin était aussi utilisé, notamment pour les
galets aménagés et les percuteurs, le cristal de roche et le silex le furent
plus rarement. Cet outillage, pour lequel l’abbé H. Breuil proposa le terme de
Choukouténien, n’évolue guère au cours des temps; on note cependant, vers le
sommet de la stratigraphie, quelques outils mieux élaborés. Le site 13, riche
en faune et daté de la glaciation de Mindel, n’a fourni qu’un chopping-tool
de silex et quelques éclats. Le ste 15, daté du Riss, n’a pas non plus
fourni de vestiges humains, mais une industrie plus soignée que celle des sites
précédents et qui rappelle celle de la vallée de la Fen» (J. Garanger (éd.)
La Préhistoire dans le monde, Paris, P.U.F., Col. Nouvelle Clio -
L’histoire et ses problèmes, 1992, pp. 663-664).  l’amas de
coquillages de Omori, entre Yokohama et Tokyo, de restes humains et de tessons
de poterie ancienne. Celle-ci était décorée par l’impression de cordelettes sur
la pâte encore fraîche; ce type d’ornementation, dénommée Jomon en japonais,
allait donner son nom à une longue période la préhistoire de l’archipel : le
Jomon, mais qui ne semblait alors commencer que depuis 5 000 ans; on sait
aujourd’hui que ses débuts sont deux fois plus anciens. Les preuves d’un
Paléolithique japonais sont beaucoup plus récentes, avec la découverte, en
1949, d’un outillage lithique pléistocène dans le site d’Iwajuku, à 90 km au
nord de Tokyo. La connaissance de ce Paléolithique et du Jomon a depuis fait
des progrès important. Bien des points restent cependant encore à élucider
concernant ces deux grandes périodes de la préhistoire japonaise et de leur phase
de transition» (p. 668). En fait, la datation de l’occupation humaine du Japon ne cesse de remonter le temps : «L’époque de l’arrivée de l’homme au Japon reste encore
imprécise. Elle pourrait être fort ancienne, car, durant les régressions
marines des temps glaciaires, l’archipel nippon ne formait qu’une seule terre
reliée au continent asiatique et, notamment, à la Corée (mais ici, aucun site
très archaïque n’a encore été mis au jour, le plus ancien : celui du
Sokchang-ni, ne datant que de 30 000 BC) [Before Common Era]. Les
premiers niveaux du site de Suzudaï, au nord-est de l’île de Kyushu,
dateraient, selon C. Serizawa, de 130 000 à 70 000. Ces datations et l’origine
humaine d’une grande partie des objets lithiques recueillis ont donné lieu à de
nombreuses controverses» (p. 669). D’autres fouilles, dans les années 1980,
ont permis de recueillir des objets lithiques laissant penser «que le
premier peuplement du sud du Japon aurait été antérieur à 150 000 BP»
[Before Present] (p. 669).
l’amas de
coquillages de Omori, entre Yokohama et Tokyo, de restes humains et de tessons
de poterie ancienne. Celle-ci était décorée par l’impression de cordelettes sur
la pâte encore fraîche; ce type d’ornementation, dénommée Jomon en japonais,
allait donner son nom à une longue période la préhistoire de l’archipel : le
Jomon, mais qui ne semblait alors commencer que depuis 5 000 ans; on sait
aujourd’hui que ses débuts sont deux fois plus anciens. Les preuves d’un
Paléolithique japonais sont beaucoup plus récentes, avec la découverte, en
1949, d’un outillage lithique pléistocène dans le site d’Iwajuku, à 90 km au
nord de Tokyo. La connaissance de ce Paléolithique et du Jomon a depuis fait
des progrès important. Bien des points restent cependant encore à élucider
concernant ces deux grandes périodes de la préhistoire japonaise et de leur phase
de transition» (p. 668). En fait, la datation de l’occupation humaine du Japon ne cesse de remonter le temps : «L’époque de l’arrivée de l’homme au Japon reste encore
imprécise. Elle pourrait être fort ancienne, car, durant les régressions
marines des temps glaciaires, l’archipel nippon ne formait qu’une seule terre
reliée au continent asiatique et, notamment, à la Corée (mais ici, aucun site
très archaïque n’a encore été mis au jour, le plus ancien : celui du
Sokchang-ni, ne datant que de 30 000 BC) [Before Common Era]. Les
premiers niveaux du site de Suzudaï, au nord-est de l’île de Kyushu,
dateraient, selon C. Serizawa, de 130 000 à 70 000. Ces datations et l’origine
humaine d’une grande partie des objets lithiques recueillis ont donné lieu à de
nombreuses controverses» (p. 669). D’autres fouilles, dans les années 1980,
ont permis de recueillir des objets lithiques laissant penser «que le
premier peuplement du sud du Japon aurait été antérieur à 150 000 BP»
[Before Present] (p. 669). Ce que laissent
supposer les nouvelles découvertes en paléoanthropologie japonaise est cette
particularité qu’on semble ne retrouver nulle part ailleurs : c’est que les Japonais vécurent la création de leur terre : «C’est un lieu commun de rappeler que
le Japon est couvert de volcans encore bien actifs ou dont les méfaits datent
d’une époque relativement récente, et que des tremblements de terre le secouent
perpétuellement. Il est plus émouvant de penser que des hommes vécurent
véritablement la création de l’archipel. Tel est néanmoins le sens des découvertes
faites en 1949 à Iwajuku (Gumma-ken), confirmées depuis par d’autres
trouvailles du même ordre ainsi que par l’étude géologique des stratifications
culturelles. Dans les couches de cendres, dans les laves durcies ou parfois
juste au-dessous, gisent des outils de pierre taillée apparentés,
typologiquement, à ceux du paléolithique supérieur et parfois peut-être - la
question est controversée
Ce que laissent
supposer les nouvelles découvertes en paléoanthropologie japonaise est cette
particularité qu’on semble ne retrouver nulle part ailleurs : c’est que les Japonais vécurent la création de leur terre : «C’est un lieu commun de rappeler que
le Japon est couvert de volcans encore bien actifs ou dont les méfaits datent
d’une époque relativement récente, et que des tremblements de terre le secouent
perpétuellement. Il est plus émouvant de penser que des hommes vécurent
véritablement la création de l’archipel. Tel est néanmoins le sens des découvertes
faites en 1949 à Iwajuku (Gumma-ken), confirmées depuis par d’autres
trouvailles du même ordre ainsi que par l’étude géologique des stratifications
culturelles. Dans les couches de cendres, dans les laves durcies ou parfois
juste au-dessous, gisent des outils de pierre taillée apparentés,
typologiquement, à ceux du paléolithique supérieur et parfois peut-être - la
question est controversée  - du paléolithique inférieur. Au fil des années de
nouvelles découvertes apportent les jalons manquants dans la longue séquence
humaine du Japon initial, celui "d’avant la poterie" (sendoki
jidai) : ainsi nomme-t-on cette époque encore trop mal connue pour pouvoir
l’étiqueter de l’une quelconque des définitions de la préhistoire occidentale.
La chronologie en effet n’est pas sûre car le sol archéologique, peu profond et
constamment bouleversé soit par les hommes, soit par une nature agitée, permet
rarement l’établissement d’une stratigraphie précise. Selon leur caractère,
leur conception de l’histoire, leur fierté nationale, les archéologues
définissent de façons divergentes une antiquité que l’on a périodiquement
tendance à trop rajeunir après l’avoir exagérément vieillie. Le problème est
sans doute difficile à résoudre. Les découvertes d’Iwajuku et de sites du même
type laissent supposer qu’au cours des bouleversements d’où naquit l’archipel,
à cette époque de volcanisme violent, des communautés humaines entières furent
englouties. ainsi se rompirent les liens qui auraient pu permettre d’établir
plus sûrement des parentés humaines entre le Japon et le continent. La rupture
de ces attaches terrestres ressemble fort à celle d’un cordon ombilical».
D’où la conclusion : «Le peuplement des îles ne fut donc pas, comme on le
pensait naguère, entièrement lié à l’évolution de la navigation dans les
communautés préhistoriques d’Extrême-Orient. À une époque très ancienne, mis en
marche par le mouvement général des populations de l’Eurasie, des hommes
cheminèrent sans
- du paléolithique inférieur. Au fil des années de
nouvelles découvertes apportent les jalons manquants dans la longue séquence
humaine du Japon initial, celui "d’avant la poterie" (sendoki
jidai) : ainsi nomme-t-on cette époque encore trop mal connue pour pouvoir
l’étiqueter de l’une quelconque des définitions de la préhistoire occidentale.
La chronologie en effet n’est pas sûre car le sol archéologique, peu profond et
constamment bouleversé soit par les hommes, soit par une nature agitée, permet
rarement l’établissement d’une stratigraphie précise. Selon leur caractère,
leur conception de l’histoire, leur fierté nationale, les archéologues
définissent de façons divergentes une antiquité que l’on a périodiquement
tendance à trop rajeunir après l’avoir exagérément vieillie. Le problème est
sans doute difficile à résoudre. Les découvertes d’Iwajuku et de sites du même
type laissent supposer qu’au cours des bouleversements d’où naquit l’archipel,
à cette époque de volcanisme violent, des communautés humaines entières furent
englouties. ainsi se rompirent les liens qui auraient pu permettre d’établir
plus sûrement des parentés humaines entre le Japon et le continent. La rupture
de ces attaches terrestres ressemble fort à celle d’un cordon ombilical».
D’où la conclusion : «Le peuplement des îles ne fut donc pas, comme on le
pensait naguère, entièrement lié à l’évolution de la navigation dans les
communautés préhistoriques d’Extrême-Orient. À une époque très ancienne, mis en
marche par le mouvement général des populations de l’Eurasie, des hommes
cheminèrent sans  doute sur les longues voies qui menaient aux régions bordières
du Pacifique. Des fragments d’os fossiles prouvent qu’une séquence humaine
complète se développa au Japon. L’homme d’Akashi (Hyôgo-ken) était un
pithécanthropien; ceux de Kuzu (Tochigi-ken) et d’Ushikawa (Aichi-ken) des
néanderthaliens; ceux de Hamakita et de Mikkabi (Shizuoka-ken) appartenaient
déjà aux types de l’homo sapiens. Dès le paléolithique existait donc au
Japon, avec l’homme d’Akashi ou son frère, une civilisation, parente lointaine
des centres chinois ou sibériens. Mais, implantée sur un territoire exigu, dos au continent, la société japonaise appartenait sans doute également à une autre
communauté : celle de la mer. Dès le début du IIe millénaire avant notre ère,
les îles qui, seules, de Sakhaline aux îles de la Sonde, rappellent l’ancien
tracé des rives eurasiatiques, délimitaient avec les côtes de l’Asie, de
l’Indochine aux régions de l’Amour, une sorte de "Méditerranée du
Pacifique". Cette longue chaîne de mers relativement fermées nourrissait
en effet sur ses côtes une série de petites civilisations maritimes où vivaient
des chasseurs-pêcheurs nomades, humains prédateurs tirant de leur situation
marine l’originalité de leur être et de leur mode de vie. C’est ainsi qu’au
Japon naquit l’époque dite de la "poterie cordée" (jômon jidai) qui
représente le premier jalon sûr de l’évolution locale» (D. et V. Elisseeff. op. cit.
pp. 32-33).
doute sur les longues voies qui menaient aux régions bordières
du Pacifique. Des fragments d’os fossiles prouvent qu’une séquence humaine
complète se développa au Japon. L’homme d’Akashi (Hyôgo-ken) était un
pithécanthropien; ceux de Kuzu (Tochigi-ken) et d’Ushikawa (Aichi-ken) des
néanderthaliens; ceux de Hamakita et de Mikkabi (Shizuoka-ken) appartenaient
déjà aux types de l’homo sapiens. Dès le paléolithique existait donc au
Japon, avec l’homme d’Akashi ou son frère, une civilisation, parente lointaine
des centres chinois ou sibériens. Mais, implantée sur un territoire exigu, dos au continent, la société japonaise appartenait sans doute également à une autre
communauté : celle de la mer. Dès le début du IIe millénaire avant notre ère,
les îles qui, seules, de Sakhaline aux îles de la Sonde, rappellent l’ancien
tracé des rives eurasiatiques, délimitaient avec les côtes de l’Asie, de
l’Indochine aux régions de l’Amour, une sorte de "Méditerranée du
Pacifique". Cette longue chaîne de mers relativement fermées nourrissait
en effet sur ses côtes une série de petites civilisations maritimes où vivaient
des chasseurs-pêcheurs nomades, humains prédateurs tirant de leur situation
marine l’originalité de leur être et de leur mode de vie. C’est ainsi qu’au
Japon naquit l’époque dite de la "poterie cordée" (jômon jidai) qui
représente le premier jalon sûr de l’évolution locale» (D. et V. Elisseeff. op. cit.
pp. 32-33). disparu, sauf peut-être dans quelques coins
inexplorés du Trúóng-són. Les Indonésiens qui dominent au Néolithique de la
pierre polie forment le fonds du peuplement actuel. Dans le Nord, l’alliance
avec des éléments mongoloïdes a donné naissance aux Viétnamiens dont le type
ancien est représenté, croit-on, par les Múóng de la Moyenne Région en bordure du delta. Dans le Sud,
l’influence indienne a modelé les Khmèrs et les Chams. Le type indonésien
presque pur subsiste chez les Moi des plateaux du Trung-bô» (Lé Thá Khôi.
op. cit. p. 30). Ces premiers viétnamiens ont également laissé des traces
archéologiques : «Les premiers témoignages d’une industrie humaine dans
l’Indochine orientale remontent à la fin du tertiaire, au moment où un dernier
mouvement himalayen attardé accompagne le creusement des vallées plissées selon
l’axe Nord Ouest-Sud Est. Ce sont des galets bruts ou avec éclats formant
pointes ou tranchants qu’on attribue à un Anthropien. L’ère quaternaire assiste
à un relèvement en bloc de la
disparu, sauf peut-être dans quelques coins
inexplorés du Trúóng-són. Les Indonésiens qui dominent au Néolithique de la
pierre polie forment le fonds du peuplement actuel. Dans le Nord, l’alliance
avec des éléments mongoloïdes a donné naissance aux Viétnamiens dont le type
ancien est représenté, croit-on, par les Múóng de la Moyenne Région en bordure du delta. Dans le Sud,
l’influence indienne a modelé les Khmèrs et les Chams. Le type indonésien
presque pur subsiste chez les Moi des plateaux du Trung-bô» (Lé Thá Khôi.
op. cit. p. 30). Ces premiers viétnamiens ont également laissé des traces
archéologiques : «Les premiers témoignages d’une industrie humaine dans
l’Indochine orientale remontent à la fin du tertiaire, au moment où un dernier
mouvement himalayen attardé accompagne le creusement des vallées plissées selon
l’axe Nord Ouest-Sud Est. Ce sont des galets bruts ou avec éclats formant
pointes ou tranchants qu’on attribue à un Anthropien. L’ère quaternaire assiste
à un relèvement en bloc de la  péninsule qui fait surgir abruptement la Chaîne
annamitique au-dessus de la mer, et provoque par un réveil de l’érosion
l’alluvionnement général des bassins et le début de la formation des deltas. La
vie continue à résider dans les hauteurs. C’est le Nord de la Chaîne
annamitique, sur le territoire de l’actuel Laos, qu’on a découvert à P’a Loi
les traces d’un Hominien peut-être apparenté au Sinanthropus. Il a laissé des
galets bruts ou grossièrement taillés, parfois perforés, et des os travaillés.
Cette période du pléistocène est datée par une faune de mammifères fossiles
(stégodon, hyène, orang outan), espèces maintenant disparues. Vers la fin du
paléolithique ou au début du mésolithique, tandis que les deltas continuent à
s’accroître, apparaît la civilisation hoabinhienne, caractérisée par des
instruments en pierre taillée et l’absence à peu près complète de cérémique…»
(Lé Thá Khôi. pp. 69-70)
D’autres cultures vont ainsi se développer sur le territoire émergé du Viét Nam
et permettre de rattraper les autres cultures préhistoriques du continent.
péninsule qui fait surgir abruptement la Chaîne
annamitique au-dessus de la mer, et provoque par un réveil de l’érosion
l’alluvionnement général des bassins et le début de la formation des deltas. La
vie continue à résider dans les hauteurs. C’est le Nord de la Chaîne
annamitique, sur le territoire de l’actuel Laos, qu’on a découvert à P’a Loi
les traces d’un Hominien peut-être apparenté au Sinanthropus. Il a laissé des
galets bruts ou grossièrement taillés, parfois perforés, et des os travaillés.
Cette période du pléistocène est datée par une faune de mammifères fossiles
(stégodon, hyène, orang outan), espèces maintenant disparues. Vers la fin du
paléolithique ou au début du mésolithique, tandis que les deltas continuent à
s’accroître, apparaît la civilisation hoabinhienne, caractérisée par des
instruments en pierre taillée et l’absence à peu près complète de cérémique…»
(Lé Thá Khôi. pp. 69-70)
D’autres cultures vont ainsi se développer sur le territoire émergé du Viét Nam
et permettre de rattraper les autres cultures préhistoriques du continent. «Le premier Coréen préhistorique
était un homo erectus, l’homme du paléolithique supérieur. Dans cet énorme
intervalle de temps, se sont succédé plusieurs périodes, avec des alternances
de climat froid et de climat chaud et les transformations de la faune et de la
flore qui en découlent.
«Le premier Coréen préhistorique
était un homo erectus, l’homme du paléolithique supérieur. Dans cet énorme
intervalle de temps, se sont succédé plusieurs périodes, avec des alternances
de climat froid et de climat chaud et les transformations de la faune et de la
flore qui en découlent. Ensuite, au moment de la période
glaciaire de Riss (350 000-130 00 ans) le climat s’est considérablement
refroidi. Les fouilles de Chǒmmal, près de Taech’ǒn, sur le littoral de la mer
Jaune, permettent de savoir que les latifoliés voisinaient avec les conifères
et que les ours et les cervidés faisaient partie de la faune. On a retrouvé un
outillage de type acheuléen ou abbevillien : bifaces, grattoirs d’obsidienne,
burins, choppers ainsi que des traces de charbon de bois. On a aussi récupéré
des ustensiles de cuisine, des armes de chasse telles que des lances et des
"bolas" comme en Amérique du Sud et un outillage en os» (A. Fabre. p. 9).
Ensuite, au moment de la période
glaciaire de Riss (350 000-130 00 ans) le climat s’est considérablement
refroidi. Les fouilles de Chǒmmal, près de Taech’ǒn, sur le littoral de la mer
Jaune, permettent de savoir que les latifoliés voisinaient avec les conifères
et que les ours et les cervidés faisaient partie de la faune. On a retrouvé un
outillage de type acheuléen ou abbevillien : bifaces, grattoirs d’obsidienne,
burins, choppers ainsi que des traces de charbon de bois. On a aussi récupéré
des ustensiles de cuisine, des armes de chasse telles que des lances et des
"bolas" comme en Amérique du Sud et un outillage en os» (A. Fabre. p. 9). mythistoire qui disent davantage que ces
informations éparses qui confirment la branche unique de l’espèce hominidée et
l’évolution parallèle à travers les différentes industries d’outillage. La
signification du Sinanthrope comme inventeur du feu est confirmée mais son
cannibalisme est remis en question (réalité ou censure?). Par contre, il s’avère que «l’apparition
de l’homme en Chine semble … bien remonter aux origines mêmes de l’humanité»
(D. et V. Elisseeff. La Civilisation de la Chine classique, Paris,
Arthaud, Col. Les Grandes Civilisations, 1979, p. 36), et dans l’a priori d’une
continuité multimillénaire de l’histoire chinoise, qu’il pourrait être à l’origine
des peuples qui se sont développés le long du Fleuve Jaune : «Tout se passe
comme si l’humanité paléo-chinoise, anciennement installée dans le bassin - au
sens très large - du fleuve Jaune, s’était peu à peu développée puis, au cours
du long passage du paléolithique au néolithique, lentement mongolisée sous
l’influence de foyers situés en Chine du Sud, en ces pays chauds et humides
propices à la vie sous toutes ses formes, où l’on trouve pour la première fois
de façon sûre les caractères spécifiques de la race mongoloïde. À ces
découvertes des prédécesseurs du sinanthrope s’ajoute la mise au jour des
restes de ses successeurs. Des ossements de type néanderthalien, contemporains
d’un outillage à faciès moustérien datant du paléolithique supérieur ancien (ou
paléolithique moyen) et s’échelonnant sur une période de 200 000 à 100 000 ans
avant notre ère, ont été découverts en Chine du Nord dans les Ordos, en Chine
du Sud à Ma-pa dans le Kouangtong, et au centre à Tch’ang-yang dans le Houpei.
L’homo sapiens du paléolithique supérieur était connu depuis 1923 dans
la grotte supérieure de Tcheou-k’eou-tien, mais c’est depuis une vingtaine
d’années que d’autres découvertes sont venues effacer son isolement
mythistoire qui disent davantage que ces
informations éparses qui confirment la branche unique de l’espèce hominidée et
l’évolution parallèle à travers les différentes industries d’outillage. La
signification du Sinanthrope comme inventeur du feu est confirmée mais son
cannibalisme est remis en question (réalité ou censure?). Par contre, il s’avère que «l’apparition
de l’homme en Chine semble … bien remonter aux origines mêmes de l’humanité»
(D. et V. Elisseeff. La Civilisation de la Chine classique, Paris,
Arthaud, Col. Les Grandes Civilisations, 1979, p. 36), et dans l’a priori d’une
continuité multimillénaire de l’histoire chinoise, qu’il pourrait être à l’origine
des peuples qui se sont développés le long du Fleuve Jaune : «Tout se passe
comme si l’humanité paléo-chinoise, anciennement installée dans le bassin - au
sens très large - du fleuve Jaune, s’était peu à peu développée puis, au cours
du long passage du paléolithique au néolithique, lentement mongolisée sous
l’influence de foyers situés en Chine du Sud, en ces pays chauds et humides
propices à la vie sous toutes ses formes, où l’on trouve pour la première fois
de façon sûre les caractères spécifiques de la race mongoloïde. À ces
découvertes des prédécesseurs du sinanthrope s’ajoute la mise au jour des
restes de ses successeurs. Des ossements de type néanderthalien, contemporains
d’un outillage à faciès moustérien datant du paléolithique supérieur ancien (ou
paléolithique moyen) et s’échelonnant sur une période de 200 000 à 100 000 ans
avant notre ère, ont été découverts en Chine du Nord dans les Ordos, en Chine
du Sud à Ma-pa dans le Kouangtong, et au centre à Tch’ang-yang dans le Houpei.
L’homo sapiens du paléolithique supérieur était connu depuis 1923 dans
la grotte supérieure de Tcheou-k’eou-tien, mais c’est depuis une vingtaine
d’années que d’autres découvertes sont venues effacer son isolement  primitif :
en 1951 apparut au Sseutch’ouan l’Homme de Tseu-yang, en 1954 celui de
Ting-ts’ouen au Chansi, en 1956 celui de Lai-pin au Kouangsi et en 1958, dans
la même province, celui de Lieou-kiang. Ainsi, en un quart de siècle, grâce à
une dizaine de sites pilotes, la chaîne des premiers hommes a été reconstituée,
de ces hommes dont les descendants du néolithique surent si bien exploiter les
richesses de la plaine Jaune» (pp. 36-37). Certes, du Sinanthrope au
fonctionnaire de l’État chinois actuel, il n’y a pas de filiation directe,
mais les impulsions données au développement ultérieur de la Chine, comme dans
le cas du Viét Nam, montrent que la diffusion des traits mongoloïdes part du
sud de la Chine du Sud pour venir se métisser avec les descendants des premières
populations du Fleuve Jaune. C’est ce même mouvement qui aurait repousser les
caractères négroïdes des antiques populations de l’Indochine.
primitif :
en 1951 apparut au Sseutch’ouan l’Homme de Tseu-yang, en 1954 celui de
Ting-ts’ouen au Chansi, en 1956 celui de Lai-pin au Kouangsi et en 1958, dans
la même province, celui de Lieou-kiang. Ainsi, en un quart de siècle, grâce à
une dizaine de sites pilotes, la chaîne des premiers hommes a été reconstituée,
de ces hommes dont les descendants du néolithique surent si bien exploiter les
richesses de la plaine Jaune» (pp. 36-37). Certes, du Sinanthrope au
fonctionnaire de l’État chinois actuel, il n’y a pas de filiation directe,
mais les impulsions données au développement ultérieur de la Chine, comme dans
le cas du Viét Nam, montrent que la diffusion des traits mongoloïdes part du
sud de la Chine du Sud pour venir se métisser avec les descendants des premières
populations du Fleuve Jaune. C’est ce même mouvement qui aurait repousser les
caractères négroïdes des antiques populations de l’Indochine. découvertes de la paléoanthropologie.
La raison était que cette découverte arrivait fort mal à propos au XIXe siècle. Un
siècle plus tôt, c’eût été un succès. Mais au moment où s’esquisse la lutte
entre les thèses scandaleuses de Darwin et le puritanisme victorien, au moment
où les bourgeois conquérants établissent des colonies partout dans le
monde sous le fallacieux prétexte idéologique qu’ils appartiennent à une race
supérieure, la découverte d’un ancêtre aux apparences simiesques fut vite prise
à partie. En Chine, les choses ne se passèrent pas différemment mais pour d’autres raisons. En 1937, le
sinologue américain H. G. Creel écrivait : «Il y a en Chine une antipathie
générale et profondément enracinée pour les fouilles archéologiques, et même
pour toutes sortes d’excavations importantes. Creuser la terre, c’est déranger
les influences magiques de la région où l’on entreprend ce travail. Il est
impossible de faire une certaine quantité de fouilles sans déranger une ou
plusieurs tombes. […] Ce sentiment s’étend même aux très anciennes
tombes. À présent, l’Institut National de Recherches d’Histoire et de
Philologie, institution d’État, conduit des fouilles sur différents points.
Pourtant, en avril 1934, le président du Yuan des Examens, occupant un des
postes les plus élevés du gouvernement chinois, envoya un télégramme circulaire
à différents chefs de parti, les pressant d’obtenir que le gouvernement
interdise les fouilles des tombes anciennes. Il rappelait que la profanation
des tombes exposait autrefois l’offenseur à être découpé en tranches minces.
Pourquoi, demandait-il, ceux qui commettent ce crime seraient-ils exempts de
châtiment et même recevraient-ils des salaires du gouvernement simplement parce
qu’ils se disent hommes de science?» (H. G. Creel. La naissance de la Chine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1937, pp. 26 et 27).
découvertes de la paléoanthropologie.
La raison était que cette découverte arrivait fort mal à propos au XIXe siècle. Un
siècle plus tôt, c’eût été un succès. Mais au moment où s’esquisse la lutte
entre les thèses scandaleuses de Darwin et le puritanisme victorien, au moment
où les bourgeois conquérants établissent des colonies partout dans le
monde sous le fallacieux prétexte idéologique qu’ils appartiennent à une race
supérieure, la découverte d’un ancêtre aux apparences simiesques fut vite prise
à partie. En Chine, les choses ne se passèrent pas différemment mais pour d’autres raisons. En 1937, le
sinologue américain H. G. Creel écrivait : «Il y a en Chine une antipathie
générale et profondément enracinée pour les fouilles archéologiques, et même
pour toutes sortes d’excavations importantes. Creuser la terre, c’est déranger
les influences magiques de la région où l’on entreprend ce travail. Il est
impossible de faire une certaine quantité de fouilles sans déranger une ou
plusieurs tombes. […] Ce sentiment s’étend même aux très anciennes
tombes. À présent, l’Institut National de Recherches d’Histoire et de
Philologie, institution d’État, conduit des fouilles sur différents points.
Pourtant, en avril 1934, le président du Yuan des Examens, occupant un des
postes les plus élevés du gouvernement chinois, envoya un télégramme circulaire
à différents chefs de parti, les pressant d’obtenir que le gouvernement
interdise les fouilles des tombes anciennes. Il rappelait que la profanation
des tombes exposait autrefois l’offenseur à être découpé en tranches minces.
Pourquoi, demandait-il, ceux qui commettent ce crime seraient-ils exempts de
châtiment et même recevraient-ils des salaires du gouvernement simplement parce
qu’ils se disent hommes de science?» (H. G. Creel. La naissance de la Chine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1937, pp. 26 et 27).  objets qu’ils vendent et le marchand qui ne voit habituellement en
eux que l’intérêt pécuniaire leur attribue souvent l’origine qu’il juge propre
à augmenter leur valeur» (p. 28). C’est la propre de la spiritualité
chinoise : le yin confucéen et son respect profond du culte des ancêtres
entraîne la collection des artefacts les plus variés et les plus anciens, afin
d’être le plus près possible des origines du monde, mais les superstitions
locales interdisent de commettre le viol des sépultures, même les plus
anciennes. Voilà pourquoi la paléoanthropologie fut d’abord une affaire
occidentale en Chine et contribua sans doute à cultiver les animosités
populaires que même le gouvernement de Tchang Kai Tchek dut respecter.
Finalement, la tombe du célèbre Empereur Houang-ti ne sera découverte, avec tous
ses trésors et son armée en terre cuite, que sous le régime communiste, en 1974. La diffusion du
confucianisme et la répétition de ces superstitions répandues dans l’ensemble
du monde asiatique ont contribué à créer un obstacle non seulement aux
recherches paléoanthropologiques, mais également aux recherches archéologiques. La modernisation récente des États asiatiques ouvrent maintenant la
possibilité d’élargir les champs de recherches et peupler ces siècles
obscurs. La volonté de connaître le passé préhistorique est non seulement une
occasion d’enrichir d’artefacts les musées et la vente d’objets fétiches, mais aussi
d’apparaître idéologiquement moderne et de lutter contre les
superstitions tout en respectant le très vieil enseignement de maître Kong.
objets qu’ils vendent et le marchand qui ne voit habituellement en
eux que l’intérêt pécuniaire leur attribue souvent l’origine qu’il juge propre
à augmenter leur valeur» (p. 28). C’est la propre de la spiritualité
chinoise : le yin confucéen et son respect profond du culte des ancêtres
entraîne la collection des artefacts les plus variés et les plus anciens, afin
d’être le plus près possible des origines du monde, mais les superstitions
locales interdisent de commettre le viol des sépultures, même les plus
anciennes. Voilà pourquoi la paléoanthropologie fut d’abord une affaire
occidentale en Chine et contribua sans doute à cultiver les animosités
populaires que même le gouvernement de Tchang Kai Tchek dut respecter.
Finalement, la tombe du célèbre Empereur Houang-ti ne sera découverte, avec tous
ses trésors et son armée en terre cuite, que sous le régime communiste, en 1974. La diffusion du
confucianisme et la répétition de ces superstitions répandues dans l’ensemble
du monde asiatique ont contribué à créer un obstacle non seulement aux
recherches paléoanthropologiques, mais également aux recherches archéologiques. La modernisation récente des États asiatiques ouvrent maintenant la
possibilité d’élargir les champs de recherches et peupler ces siècles
obscurs. La volonté de connaître le passé préhistorique est non seulement une
occasion d’enrichir d’artefacts les musées et la vente d’objets fétiches, mais aussi
d’apparaître idéologiquement moderne et de lutter contre les
superstitions tout en respectant le très vieil enseignement de maître Kong. idéologiques. Il en va ainsi de l'attitude négative des autorités nippones à
encourager le développement de l'archéologie en Corée. Ce territoire convoité
par le gouvernement de Tokyo avait servi de pont au moment du peuplement de
l'archipel. Dans l'optique d'un racisme fort, le peuple japonais était
éduqué avec l'idée qu'il était né avec les îles mêmes qui constituaient
l'archipel, dans le déchaînement des éléments naturels, volcaniques et
maritimes. Tout ceux qui avaient vécu sur la presqu'île japonaise du temps où
elle restait attachée par la Corée au continent asiatique, tous ces Aïnous,
tous ces Coréens, tous ces Chinois appartenaient à une période antédéluvienne.
La séparation de l'archipel du continent marquait une césure qui redoublait la
fierté du peuple nippon d'être né avec son propre territoire. Le mythe de la
déesse Amaterasu prend alors un tout nouveau sens. Déesse dont les fils sont
les empereurs, et pour beaucoup encore aujourd'hui, jusqu'à l'empereur actuel.
idéologiques. Il en va ainsi de l'attitude négative des autorités nippones à
encourager le développement de l'archéologie en Corée. Ce territoire convoité
par le gouvernement de Tokyo avait servi de pont au moment du peuplement de
l'archipel. Dans l'optique d'un racisme fort, le peuple japonais était
éduqué avec l'idée qu'il était né avec les îles mêmes qui constituaient
l'archipel, dans le déchaînement des éléments naturels, volcaniques et
maritimes. Tout ceux qui avaient vécu sur la presqu'île japonaise du temps où
elle restait attachée par la Corée au continent asiatique, tous ces Aïnous,
tous ces Coréens, tous ces Chinois appartenaient à une période antédéluvienne.
La séparation de l'archipel du continent marquait une césure qui redoublait la
fierté du peuple nippon d'être né avec son propre territoire. Le mythe de la
déesse Amaterasu prend alors un tout nouveau sens. Déesse dont les fils sont
les empereurs, et pour beaucoup encore aujourd'hui, jusqu'à l'empereur actuel. La découverte, au début du XXe siècle,
de l'histoire hors-normes du pharaon Aménophis IV et de son hérésie du culte au
dieu Aton pour devenir Akhenaton, déménager la capitale de Thèbes vers une
cité-modèle dans le désert, cultiver la poésie et les arts plutôt que de faire
la guerre et se préoccuper d'étendre les frontières de son empire, a marqué
l'imagination des Occidentaux du XXe siècle. Au moment où triomphait l'individualisme
libéral, la re-naissance d'une individualité particulière dans le lointain
passé égyptien trouva ses échos soutenus jusque dans des thèses douteuses. Ainsi le culte
atonien, ayant survécu sous forme de société secrète, serait à l'origine du monothéisme repris beaucoup plus tard par les Hébreux sous la conduite de Moïse. Ou encore la filiation
psychanalytique, anticipée par Karl Abraham puis Sigmund Freud, jusqu'à retrouver le complexe d'Œdipe dans les liens entre le pharaon Akhenaton
et sa mère, la reine Tii, et la haine de son père Aménophis III, dont il
fit effacer le nom des cartouches, espérant le renvoyer au néant et à l'oubli dans lesquels, lui-même, sera
plongé après son règne éphémère et sa mort tragique. Or, nous ne retrouvons
pas d’hérésie semblable dans le passé asiatique.
La découverte, au début du XXe siècle,
de l'histoire hors-normes du pharaon Aménophis IV et de son hérésie du culte au
dieu Aton pour devenir Akhenaton, déménager la capitale de Thèbes vers une
cité-modèle dans le désert, cultiver la poésie et les arts plutôt que de faire
la guerre et se préoccuper d'étendre les frontières de son empire, a marqué
l'imagination des Occidentaux du XXe siècle. Au moment où triomphait l'individualisme
libéral, la re-naissance d'une individualité particulière dans le lointain
passé égyptien trouva ses échos soutenus jusque dans des thèses douteuses. Ainsi le culte
atonien, ayant survécu sous forme de société secrète, serait à l'origine du monothéisme repris beaucoup plus tard par les Hébreux sous la conduite de Moïse. Ou encore la filiation
psychanalytique, anticipée par Karl Abraham puis Sigmund Freud, jusqu'à retrouver le complexe d'Œdipe dans les liens entre le pharaon Akhenaton
et sa mère, la reine Tii, et la haine de son père Aménophis III, dont il
fit effacer le nom des cartouches, espérant le renvoyer au néant et à l'oubli dans lesquels, lui-même, sera
plongé après son règne éphémère et sa mort tragique. Or, nous ne retrouvons
pas d’hérésie semblable dans le passé asiatique. |
| Temple du Ciel à Pékin |
 l'apparition d'un humanisme,
à peu près à la même période où Socrate à Athènes et le Bouddha en Inde
enseignaient également la dignité propre à l'espèce des hommes (± Ve
siècle av. J.-C.). La force du confucianisme provient du fait qu'il apparut
très tôt dans l'élaboration de la civilisation chinoise et qu'il fut diffusé à
la largeur des peuples de l'Extrême-Orient. Tous l'adoptèrent et opérèrent des
syncrétismes avec des superstitions ou d'autres traditions locales : en Corée,
au Japon, au Viét Nam, etc. Confucius (-551 à - 479 av. J.-C.) appartient à la
bureaucratie céleste, c'est un fonctionnaire d'un des petits États qui se
partagent l'immense territoire chinois. Les Occidentaux ont toujours reconnu en
Confucius l'alter ego de la pensée socratique, mais Maitre Kong, comme on
l'appelait, était un esprit universel dans le plus pur sens du terme. Il serait
le premier à avoir enseigné «la littérature, les principes de conduite, la
loyauté et la fidélité» ainsi que «la poésie, l'histoire et le droit»,
c'est-à-dire «une culture générale, humaine, éthique, au lieu de matières
purement professionnelles», ce qu'on a vu à quel point Ohsawa le condamnait
pour son manque de «pragmatisme»! Sans être démocrate, Confucius «est le
premier à avoir ouvert à tous les portes du savoir, en déclarant que "dans
l'éducation, il ne doit pas exister de distinction de classes". Pour ses
élèves, et plus tard pour tous les Chinois, il est "le Maître"; au
XVIIe siècle, les jésuites latiniseront ce titre en Confucius et ne
s'occuperont pas de son nom» (Wing-Tsit Chan, in A. Toynbee (éd.). op. cit. p. 125). Mais une différence marquée s'établit entre
l'humanisme de Confucius et celui de la tradition socratique : il s'agit
essentiellement d'une affaire morale qui engage peu les affections profondes
que supposent la variété des termes grecs utilisés pour désigner l'amour. Piété
filiale et respect fraternel sont les deux pôles de la notion d'amour chez
Confucius, et en ce sens, il est plus proche de l'agapè du christianisme que de l'éros des
Hellènes.
l'apparition d'un humanisme,
à peu près à la même période où Socrate à Athènes et le Bouddha en Inde
enseignaient également la dignité propre à l'espèce des hommes (± Ve
siècle av. J.-C.). La force du confucianisme provient du fait qu'il apparut
très tôt dans l'élaboration de la civilisation chinoise et qu'il fut diffusé à
la largeur des peuples de l'Extrême-Orient. Tous l'adoptèrent et opérèrent des
syncrétismes avec des superstitions ou d'autres traditions locales : en Corée,
au Japon, au Viét Nam, etc. Confucius (-551 à - 479 av. J.-C.) appartient à la
bureaucratie céleste, c'est un fonctionnaire d'un des petits États qui se
partagent l'immense territoire chinois. Les Occidentaux ont toujours reconnu en
Confucius l'alter ego de la pensée socratique, mais Maitre Kong, comme on
l'appelait, était un esprit universel dans le plus pur sens du terme. Il serait
le premier à avoir enseigné «la littérature, les principes de conduite, la
loyauté et la fidélité» ainsi que «la poésie, l'histoire et le droit»,
c'est-à-dire «une culture générale, humaine, éthique, au lieu de matières
purement professionnelles», ce qu'on a vu à quel point Ohsawa le condamnait
pour son manque de «pragmatisme»! Sans être démocrate, Confucius «est le
premier à avoir ouvert à tous les portes du savoir, en déclarant que "dans
l'éducation, il ne doit pas exister de distinction de classes". Pour ses
élèves, et plus tard pour tous les Chinois, il est "le Maître"; au
XVIIe siècle, les jésuites latiniseront ce titre en Confucius et ne
s'occuperont pas de son nom» (Wing-Tsit Chan, in A. Toynbee (éd.). op. cit. p. 125). Mais une différence marquée s'établit entre
l'humanisme de Confucius et celui de la tradition socratique : il s'agit
essentiellement d'une affaire morale qui engage peu les affections profondes
que supposent la variété des termes grecs utilisés pour désigner l'amour. Piété
filiale et respect fraternel sont les deux pôles de la notion d'amour chez
Confucius, et en ce sens, il est plus proche de l'agapè du christianisme que de l'éros des
Hellènes. là une conception toute nouvelle de l'égalité : elle finira par
ébranler la féodalité dont les fondements reposent sur la distinction des
classes liée à la naissance» (p. 125). Et la chose se comprend si l'on
suppose, avec Confucius, que «la perfection personnelle est impossible si la
société n'est pas bonne. Et c'est pourquoi Confucius a toujours soin de
souligner cette interdépendance». La sociologie de Confucius est simple
(pour ne pas dire simpliste) : la société n'est que la reproduction de la
cellule familiale sur une échelle plus grande. Il ne voit pas les interférences
qui déforment entre les liens interpersonnels et les relations sociales, précisément
parce que la notion d'individualité n'a pas fait sa trace dans la civilisation
extrême-orientale. L'humain est à la fois nominalisme et réalisme; la qualité
dans et la quantité du groupe. «La première communauté de chaque être humain
étant sa famille, où il prend conscience de sa personne par rapport aux autres,
Confucius met fortement l'accent sur cette structure fondamentale. Et comme la
relation primordiale de tout homme est celle qu'il a avec ses parents, il
insiste avec vigueur sur la piété filiale. Pour Confucius, l'État est une
famille élargie, et le souverain
là une conception toute nouvelle de l'égalité : elle finira par
ébranler la féodalité dont les fondements reposent sur la distinction des
classes liée à la naissance» (p. 125). Et la chose se comprend si l'on
suppose, avec Confucius, que «la perfection personnelle est impossible si la
société n'est pas bonne. Et c'est pourquoi Confucius a toujours soin de
souligner cette interdépendance». La sociologie de Confucius est simple
(pour ne pas dire simpliste) : la société n'est que la reproduction de la
cellule familiale sur une échelle plus grande. Il ne voit pas les interférences
qui déforment entre les liens interpersonnels et les relations sociales, précisément
parce que la notion d'individualité n'a pas fait sa trace dans la civilisation
extrême-orientale. L'humain est à la fois nominalisme et réalisme; la qualité
dans et la quantité du groupe. «La première communauté de chaque être humain
étant sa famille, où il prend conscience de sa personne par rapport aux autres,
Confucius met fortement l'accent sur cette structure fondamentale. Et comme la
relation primordiale de tout homme est celle qu'il a avec ses parents, il
insiste avec vigueur sur la piété filiale. Pour Confucius, l'État est une
famille élargie, et le souverain  |
| L'empereur Kien-Long reçoit les hommages des peuples vaincus en 1760 |
 l'homme qui magnifie la Voie, et non la Voie
qui magnifie l'homme". Son humanisme intransigeant n'en est pas moins
profondément religieux. Il est vrai qu'il ne se soucie pas de discuter des
esprits ou des problèmes de la vie et de la mort, mais il célèbre le Ciel
(Tan), témoigne de sa grandeur et déclare qu'à l'âge de cinquante ans il a
reconnu le "mandat du Ciel" à son égard, sa vocation d'enseignant.
Chaque fois qu'il court un danger il affirme que sa nature morale appartient au
Ciel et qu'aucun ennemi politique ne peut lui faire du mal. Mais il ajoute que
le Ciel ne parle pas et que tous les êtres n'en prospèrent pas moins. Le Ciel
cesse ainsi d'être un dieu anthropomorphique et devient l'Être Suprême,
spirituel et moral, qui règne mais ne gouverne pas, laissant la loi morale agir
d'elle-même et permettant à l'homme d'assumer ses responsabilités dans toutes
ses affaires. C'est là une nouvelle entorse à la tradition. Lorsque Confucius
cite l'ancien dicton : "Respectez les esprits mais tenez-les àdistance", il veut simplement dire que l'homme, tout en les entourant de
respect, ne doit pas compter sur eux pour le guider ou l'aider» (pp.
125-126).
l'homme qui magnifie la Voie, et non la Voie
qui magnifie l'homme". Son humanisme intransigeant n'en est pas moins
profondément religieux. Il est vrai qu'il ne se soucie pas de discuter des
esprits ou des problèmes de la vie et de la mort, mais il célèbre le Ciel
(Tan), témoigne de sa grandeur et déclare qu'à l'âge de cinquante ans il a
reconnu le "mandat du Ciel" à son égard, sa vocation d'enseignant.
Chaque fois qu'il court un danger il affirme que sa nature morale appartient au
Ciel et qu'aucun ennemi politique ne peut lui faire du mal. Mais il ajoute que
le Ciel ne parle pas et que tous les êtres n'en prospèrent pas moins. Le Ciel
cesse ainsi d'être un dieu anthropomorphique et devient l'Être Suprême,
spirituel et moral, qui règne mais ne gouverne pas, laissant la loi morale agir
d'elle-même et permettant à l'homme d'assumer ses responsabilités dans toutes
ses affaires. C'est là une nouvelle entorse à la tradition. Lorsque Confucius
cite l'ancien dicton : "Respectez les esprits mais tenez-les àdistance", il veut simplement dire que l'homme, tout en les entourant de
respect, ne doit pas compter sur eux pour le guider ou l'aider» (pp.
125-126). |
| Qi Gong, taoïste |
 Zhong (né vers 64 av J.C.), premier ministre du
royaume de Qi, un philosophe tenu par Confucius en haute estime. Mais le Guanzi,
l'ouvrage où la loi est présentée comme le principal instrument du pouvoir,
est apocryphe. De façon générale, trois tendances se font jour dans l'école
celle de la loi (fa) où le souverain édicte des lois auxquelles le
peuple est tenu d'obéir; celle de la technique (shu), c'est-à-dire l'art
de gouverner et les méthodes utilisées par le souverain pour maintenir les
ministres et le peuple, préconisée par Shang Yang ou Gongsun Yang († 338 av.
J.-C.), celle du pouvoir (shi) préconisée par Shen Dao (vers 350-275 av.
J.-C.), qui étudie la façon dont le souverain doit s'emparer du pouvoir,
profiter des circonstances et mettre à profit certaines tendances naturelles.
Han Fei (vers 300-233 av. J.C.), en amalgamant tous ces facteurs, s'affirme
comme la personnalité la plus en vue de cette école» (p. 131). Ce n'est
donc pas tant au Principe Unique que Shi Houang-ti doit d'avoir agit selon le
prinicpe yang, mais bien dans le contexte d'une technè machiavélique du pouvoir. En ce
sens, la pensée des Légistes se montrait plus pragmatique que le I-King.
Zhong (né vers 64 av J.C.), premier ministre du
royaume de Qi, un philosophe tenu par Confucius en haute estime. Mais le Guanzi,
l'ouvrage où la loi est présentée comme le principal instrument du pouvoir,
est apocryphe. De façon générale, trois tendances se font jour dans l'école
celle de la loi (fa) où le souverain édicte des lois auxquelles le
peuple est tenu d'obéir; celle de la technique (shu), c'est-à-dire l'art
de gouverner et les méthodes utilisées par le souverain pour maintenir les
ministres et le peuple, préconisée par Shang Yang ou Gongsun Yang († 338 av.
J.-C.), celle du pouvoir (shi) préconisée par Shen Dao (vers 350-275 av.
J.-C.), qui étudie la façon dont le souverain doit s'emparer du pouvoir,
profiter des circonstances et mettre à profit certaines tendances naturelles.
Han Fei (vers 300-233 av. J.C.), en amalgamant tous ces facteurs, s'affirme
comme la personnalité la plus en vue de cette école» (p. 131). Ce n'est
donc pas tant au Principe Unique que Shi Houang-ti doit d'avoir agit selon le
prinicpe yang, mais bien dans le contexte d'une technè machiavélique du pouvoir. En ce
sens, la pensée des Légistes se montrait plus pragmatique que le I-King. philosophique, mais elle est
radicale et nouvelle dans son esprit. Elle n'accepte aucune autorité si ce n'est celle du souverain, ne vénère aucun héros historique, ne s'appuie sur
aucun précédent, a leurs yeux fixés sur le présent plus que sur le passé,
dénonce les platitudes morales confucéennes comme étant des bavardages, insiste
sur les critères objectifs, et exige des résultats. Elle agit en fonction des
circonstances changeantes et insiste sur une étroite correspondance entre le
discours et l'action. Les lois doivent être écrites, uniformes et publiquement
proclamées, applicables à tous et accompagnées de récompenses généreuses et de
châtiments sévères. La guerre et la conscription sont considérées comme des
instruments nécessaires. L'individu est totalement soumis à l'État.
L'application de la loi à tous les hommes suggère l'idée de l'égalité de tous
les hommes, mais la doctrine confucéenne selon laquelle il faut faire accéder
aux postes élevés du gouvernement des hommes vertueux est visiblement regardée
comme dangereuse. L'école des Légistes ne comporte aucune théorie de la nature
humaine, mais part implicitement de l'hypothèse qu'elle est mauvaise [contrairement
au taoisme qui la considère comme intrinsèquement bonne]. D'où la nécessité
de l'autorité du gouvernement et le rejet de la théorie de l'influence morale
et des rites. Han Fei et Li Si († 208 av. J.-C.), premier ministre de l'Empire
Qin (221-206 av. J.-C.), ont tous deux été les élèves de Xunzi. Il est possible
que l'insistance de ce dernier sur la loi les ait influencés, mais le cynisme
des Légistes aurait choaqué Xunzi tout comme Guan Zhong. Han Fei a offert ses
services aux Qin, mais les intrigues de Li Si l'acculent au suicide» (p.
131).
philosophique, mais elle est
radicale et nouvelle dans son esprit. Elle n'accepte aucune autorité si ce n'est celle du souverain, ne vénère aucun héros historique, ne s'appuie sur
aucun précédent, a leurs yeux fixés sur le présent plus que sur le passé,
dénonce les platitudes morales confucéennes comme étant des bavardages, insiste
sur les critères objectifs, et exige des résultats. Elle agit en fonction des
circonstances changeantes et insiste sur une étroite correspondance entre le
discours et l'action. Les lois doivent être écrites, uniformes et publiquement
proclamées, applicables à tous et accompagnées de récompenses généreuses et de
châtiments sévères. La guerre et la conscription sont considérées comme des
instruments nécessaires. L'individu est totalement soumis à l'État.
L'application de la loi à tous les hommes suggère l'idée de l'égalité de tous
les hommes, mais la doctrine confucéenne selon laquelle il faut faire accéder
aux postes élevés du gouvernement des hommes vertueux est visiblement regardée
comme dangereuse. L'école des Légistes ne comporte aucune théorie de la nature
humaine, mais part implicitement de l'hypothèse qu'elle est mauvaise [contrairement
au taoisme qui la considère comme intrinsèquement bonne]. D'où la nécessité
de l'autorité du gouvernement et le rejet de la théorie de l'influence morale
et des rites. Han Fei et Li Si († 208 av. J.-C.), premier ministre de l'Empire
Qin (221-206 av. J.-C.), ont tous deux été les élèves de Xunzi. Il est possible
que l'insistance de ce dernier sur la loi les ait influencés, mais le cynisme
des Légistes aurait choaqué Xunzi tout comme Guan Zhong. Han Fei a offert ses
services aux Qin, mais les intrigues de Li Si l'acculent au suicide» (p.
131). Ce règne de la terreur allait durer
quinze ans, comme on l'a vu. Après les siècles de philosophie morale et
spéculative des confucéens et des taoïstes, que l'on pourrait comparer à la
contribution grecque à la civilisation hellénique, le temps des Légistes sous
la domination de Qin Shi Houang-ti évoque davantage la contribution
institutionnelle romaine qui développa la logique du droit, de l'administration
civile et publique, des corps d'armée et le pragmatisme des institutions
politiques en quête d'une nouvelle royauté après que la république eut versé
dans les guerres civiles. Wing-Tsit Chan conclut ainsi : «Les Légistes ont
aidé le royaume de Qin à unifier la Chine en un Empire. en 221, Shi Hunagdi
instaure l'État le plus totalitaire de toute l'histoire du pays. La pensée,
comme tout le reste, est l'objet d'une étroite surveillance. L'infâme autodafé
des livres en 213 av. J.-C. contraint toutes les écoles philosophiques à se
terrer, et beaucoup d'entre elles - y compris celle des moïstes - sombrent
alors dans l'oubli. Le caractère impitoyable des Qin finit par entraîner leur
chute. De toute l'histoire de la Chine c'est la dynastie qui a connu la plus
brève destinée» (p. 131). L'héritier sera Han Lieou Pang qui, après
l'effondrement du pouvoir établi par Shi Houang-ti, s'octroya à son tour le
Mandat du Ciel et commença par rétablir, sans abolir les Légistes, restaurera
les anciennes écoles de sagesse chinoise.
Ce règne de la terreur allait durer
quinze ans, comme on l'a vu. Après les siècles de philosophie morale et
spéculative des confucéens et des taoïstes, que l'on pourrait comparer à la
contribution grecque à la civilisation hellénique, le temps des Légistes sous
la domination de Qin Shi Houang-ti évoque davantage la contribution
institutionnelle romaine qui développa la logique du droit, de l'administration
civile et publique, des corps d'armée et le pragmatisme des institutions
politiques en quête d'une nouvelle royauté après que la république eut versé
dans les guerres civiles. Wing-Tsit Chan conclut ainsi : «Les Légistes ont
aidé le royaume de Qin à unifier la Chine en un Empire. en 221, Shi Hunagdi
instaure l'État le plus totalitaire de toute l'histoire du pays. La pensée,
comme tout le reste, est l'objet d'une étroite surveillance. L'infâme autodafé
des livres en 213 av. J.-C. contraint toutes les écoles philosophiques à se
terrer, et beaucoup d'entre elles - y compris celle des moïstes - sombrent
alors dans l'oubli. Le caractère impitoyable des Qin finit par entraîner leur
chute. De toute l'histoire de la Chine c'est la dynastie qui a connu la plus
brève destinée» (p. 131). L'héritier sera Han Lieou Pang qui, après
l'effondrement du pouvoir établi par Shi Houang-ti, s'octroya à son tour le
Mandat du Ciel et commença par rétablir, sans abolir les Légistes, restaurera
les anciennes écoles de sagesse chinoise. Comme chacun sait, le bouddhisme est né en Inde
où il s'est diffusé sous le règne de l'Empereur Ashoka de la dynastie Maurya au IIIe
siècle av. J.-C. qui fut son missionnaire. Mais après la chute de la dynastie,
une réaction hindouiste a réussi à le balayer progressivement hors de ses frontières, le
repoussant, vers le nord, en direction du Tibet et du Népal, et vers le sud,
dans le Sri Lanka actuel et la Birmanie. Le bouddhisme entre en
Chine autour du Ier siècle de notre ère, mais ce n'est que trois siècles plus
tard, au moment où s'effondre la dynastie Han et l'État unifié de
Qin qu'il va jouer un rôle déterminant pour l'avenir de l'Extrême-Orient.
Comme chacun sait, le bouddhisme est né en Inde
où il s'est diffusé sous le règne de l'Empereur Ashoka de la dynastie Maurya au IIIe
siècle av. J.-C. qui fut son missionnaire. Mais après la chute de la dynastie,
une réaction hindouiste a réussi à le balayer progressivement hors de ses frontières, le
repoussant, vers le nord, en direction du Tibet et du Népal, et vers le sud,
dans le Sri Lanka actuel et la Birmanie. Le bouddhisme entre en
Chine autour du Ier siècle de notre ère, mais ce n'est que trois siècles plus
tard, au moment où s'effondre la dynastie Han et l'État unifié de
Qin qu'il va jouer un rôle déterminant pour l'avenir de l'Extrême-Orient. dynastie Tcheou occidentale avait vu naître la féodalité tandis que la
dynastie Tcheou orientale, à partir de 750, commença à voir l'ordre intérieur
se désagréger. Le pouvoir royal se désagrègea devant la montée du pouvoir des féodaux et
l'enrichissement des commerçants et même des paysans. Tout éclata dans un temps
de troubles qu'on appelle les Royaumes combattants, période qui va de 403 à
221. Cette période de conflits sanglants opposants aussi bien des royautés pour
la domination du territoire que des classes d'intérêts qui mènent une guerre
civile va trouver sa résolution dans la victoire de Qin Shi Houang-ti qui échafaude son État centralisé et despotique qui donne à la Chine son
premier sens de l'unité. Après un
premier vacillement, Han Lieou Pang prend la relève et c'est cet empire Han
qui va s'effondrer sous le coup de la discorde intérieure et des invasions
barbares, les Xiongnu. C'est au moment de cet effondrement que le bouddhisme va se
répandre dans toute la Chine.
dynastie Tcheou occidentale avait vu naître la féodalité tandis que la
dynastie Tcheou orientale, à partir de 750, commença à voir l'ordre intérieur
se désagréger. Le pouvoir royal se désagrègea devant la montée du pouvoir des féodaux et
l'enrichissement des commerçants et même des paysans. Tout éclata dans un temps
de troubles qu'on appelle les Royaumes combattants, période qui va de 403 à
221. Cette période de conflits sanglants opposants aussi bien des royautés pour
la domination du territoire que des classes d'intérêts qui mènent une guerre
civile va trouver sa résolution dans la victoire de Qin Shi Houang-ti qui échafaude son État centralisé et despotique qui donne à la Chine son
premier sens de l'unité. Après un
premier vacillement, Han Lieou Pang prend la relève et c'est cet empire Han
qui va s'effondrer sous le coup de la discorde intérieure et des invasions
barbares, les Xiongnu. C'est au moment de cet effondrement que le bouddhisme va se
répandre dans toute la Chine. On prête à l'irruption du bouddhisme en Chine
des effets aussi merveilleux qu'à la pénétration du christianisme dans
l'Occident romain. L'empereur Han Mingdi (58-75 de notre ère) aurait vu «en
songe une divinité d'or voler devant son palais. Celle-ci ayant été identifiée
comme le Boudda, des émissaires furent dépêchés vers l'ouest pour en savoir
davantage et c'est à leur retour qu'aurait été construit à la capitale,
Luoyang, le monastère du Cheval blanc» (A. Cheng. Histoire de la pensée
chinoise, Paris, Seuil, Col. Points essais, # 488, 1997, p. 357). Pour peu
on y reconnaîtrait l'apparition à l'Empereur Constantin du fameux In
hoc signo vinces par lequel il aurait autorisé l'établissement du christianisme dans l'Empire romain. Le
bouddhisme sera l'un des héritages laissés par la dynastie Han avant de périr
sous le coup des envahisseurs.
On prête à l'irruption du bouddhisme en Chine
des effets aussi merveilleux qu'à la pénétration du christianisme dans
l'Occident romain. L'empereur Han Mingdi (58-75 de notre ère) aurait vu «en
songe une divinité d'or voler devant son palais. Celle-ci ayant été identifiée
comme le Boudda, des émissaires furent dépêchés vers l'ouest pour en savoir
davantage et c'est à leur retour qu'aurait été construit à la capitale,
Luoyang, le monastère du Cheval blanc» (A. Cheng. Histoire de la pensée
chinoise, Paris, Seuil, Col. Points essais, # 488, 1997, p. 357). Pour peu
on y reconnaîtrait l'apparition à l'Empereur Constantin du fameux In
hoc signo vinces par lequel il aurait autorisé l'établissement du christianisme dans l'Empire romain. Le
bouddhisme sera l'un des héritages laissés par la dynastie Han avant de périr
sous le coup des envahisseurs. en opérant des
syncrétismes avec les divinités locales et l'humanisme confucéen. «Sous
les Han, reprend Anne Cheng, l'intérêt
pour le bouddhisme se concentre de prime abord sur l'immortalité de l'âme ainsi
que sur le cycle des renaissances et le karma.
Ces notions sont d'abord comprises dans le contexte de la mentalité
religieuse taoïste en termes de "transmission du fardeau" : le bien
ou le mal commis par les ancêtres étant susceptible d'influencer la destinée
des descendants, l'individu est passible de sanctions pour des fautes commises
par ses ascendants. Mais alors que les taoïstes s'attachent au caractère
collectif de la sanction, la responsabilité individuelle introduite par la
conception bouddhique du karma apparaît
comme une nouveauté» (p. 357). Et sans
doute est-ce là l'un des apports les plus importants de l'irruption du Bouddhisme dans la civilisation chinoise : la prise de conscience de
l'importance du destin individuel. Ceci dit, une certaine fatalité accompagne
cette prise de conscience de l'individu, non pas en tant qu'«individualité»,
mais en tant que cellule de la molécule sociale et nationale. Comme disent les
Évangiles : les pépins des raisins mangés par les pères agacent les dents des
enfants. Les mutations taoïstes revêtent un accent personnel qui accroît certes
l'espérance d'une vie après la mort, mais cette vie risque d'être le résultat
des erreurs commises par les parents. On voit quel syncrétisme le bouddhisme
opère avec le confucianisme.
en opérant des
syncrétismes avec les divinités locales et l'humanisme confucéen. «Sous
les Han, reprend Anne Cheng, l'intérêt
pour le bouddhisme se concentre de prime abord sur l'immortalité de l'âme ainsi
que sur le cycle des renaissances et le karma.
Ces notions sont d'abord comprises dans le contexte de la mentalité
religieuse taoïste en termes de "transmission du fardeau" : le bien
ou le mal commis par les ancêtres étant susceptible d'influencer la destinée
des descendants, l'individu est passible de sanctions pour des fautes commises
par ses ascendants. Mais alors que les taoïstes s'attachent au caractère
collectif de la sanction, la responsabilité individuelle introduite par la
conception bouddhique du karma apparaît
comme une nouveauté» (p. 357). Et sans
doute est-ce là l'un des apports les plus importants de l'irruption du Bouddhisme dans la civilisation chinoise : la prise de conscience de
l'importance du destin individuel. Ceci dit, une certaine fatalité accompagne
cette prise de conscience de l'individu, non pas en tant qu'«individualité»,
mais en tant que cellule de la molécule sociale et nationale. Comme disent les
Évangiles : les pépins des raisins mangés par les pères agacent les dents des
enfants. Les mutations taoïstes revêtent un accent personnel qui accroît certes
l'espérance d'une vie après la mort, mais cette vie risque d'être le résultat
des erreurs commises par les parents. On voit quel syncrétisme le bouddhisme
opère avec le confucianisme. authentique. En 311,
Luoyang, capitale dynastique des Jin (265-420) du Nord, tombe aux mains des
envahisseurs Xiongnu, suivie de Chang'an en 316. À partir de ce
moment, les barbares vont contrôler la Chine du Nord jusqu'à la réunification
par la dynastie Sui en 589. Le pouvoir impérial réside alors à Nankin où se
forme un bouddhisme intellectuel propre à la classe lettrée en se penchant sur
l'étude du Mystère : «Ce
bouddhisme du Sud diffère radicalement de celui qui se développe au Nord, sous
l'égide de règnes non chinois qui font du bouddhisme une religion d'État. Moins
portés sur la littérature et la philosophie, les moines y sont utilisés comme
conseillers politiques, voire militaires, et appréciés pour leurs pouvoirs
occultes. Dans la Chine du Nord, placée sous la férule "barbare" et
lacérée par la guerre, prédomine un bouddhisme dévotionnel, surtout préoccupé
de moralité, de méditation et de pratique religieuse. En comparaison, le Sud
apparaît plus privilégié matériellement, mais au plan intellectuel et spirituel
il hérite de l'esprit blasé et désabusé des "causeries pures",
désormais dégénéré en hédonisme décadent. La classe lettrée, qui se mobilisait
traditionnellement autour de sa mission morale et politique de sauvegarde du
Dao [Taö], se laisse désormais
gagner par un scepticisme qui trouve des échos dans le thème bouddhique du
"tout est transitoire" (pp.
359-360). Lorsqu'on regarde d'un œil superficiel cette
division territoriale et politique qui ne déchire pourtant pas la robe du
bouddhisme, on pourrait facilement reconnaître le destin du christianisme
occidental dans le bouddhisme des barbares du Nord et le christianisme byzantin
dans le bouddhisme de la civilisation raffinée et blasée du Sud. Mais cette
comparaison n’est que superficielle.
authentique. En 311,
Luoyang, capitale dynastique des Jin (265-420) du Nord, tombe aux mains des
envahisseurs Xiongnu, suivie de Chang'an en 316. À partir de ce
moment, les barbares vont contrôler la Chine du Nord jusqu'à la réunification
par la dynastie Sui en 589. Le pouvoir impérial réside alors à Nankin où se
forme un bouddhisme intellectuel propre à la classe lettrée en se penchant sur
l'étude du Mystère : «Ce
bouddhisme du Sud diffère radicalement de celui qui se développe au Nord, sous
l'égide de règnes non chinois qui font du bouddhisme une religion d'État. Moins
portés sur la littérature et la philosophie, les moines y sont utilisés comme
conseillers politiques, voire militaires, et appréciés pour leurs pouvoirs
occultes. Dans la Chine du Nord, placée sous la férule "barbare" et
lacérée par la guerre, prédomine un bouddhisme dévotionnel, surtout préoccupé
de moralité, de méditation et de pratique religieuse. En comparaison, le Sud
apparaît plus privilégié matériellement, mais au plan intellectuel et spirituel
il hérite de l'esprit blasé et désabusé des "causeries pures",
désormais dégénéré en hédonisme décadent. La classe lettrée, qui se mobilisait
traditionnellement autour de sa mission morale et politique de sauvegarde du
Dao [Taö], se laisse désormais
gagner par un scepticisme qui trouve des échos dans le thème bouddhique du
"tout est transitoire" (pp.
359-360). Lorsqu'on regarde d'un œil superficiel cette
division territoriale et politique qui ne déchire pourtant pas la robe du
bouddhisme, on pourrait facilement reconnaître le destin du christianisme
occidental dans le bouddhisme des barbares du Nord et le christianisme byzantin
dans le bouddhisme de la civilisation raffinée et blasée du Sud. Mais cette
comparaison n’est que superficielle. Car le Bouddhisme lui-même
apparaît sous deux formes : «le Bouddhisme ancien était quelquefois désigné sous l’appellation du
"Bouddhisme Hinayana". Ce nom lui était donné par l’école rivale, qui
devait apparaître par la suite, et qui se désignait sous le nom de "Bouddhisme
Mahayana", Mahayana signifiant "Grand Véhicule" par opposition à Hinayana, "Petit Véhicule". Le
Mahayana se développa dans l’Inde, sans doute vers le début de l’ère
chrétienne. Il diffère essentiellement du Hinayana en ce qu’il fait place au
"bodhisattva", littéralement "Illuminé en puissance". Un
bodhisattva est un être qui a mérité d’obtenir le nirvana et de devenir un
Bouddha, mais qui renonce volontairement à ce privilège pour demeurer parmi les
créatures de ce monde qui n’ont pas encore atteint l’illumination et pour
travailler à leur salut. C’est une figure héroïque, objet de vénération et même
d’adoration pour ses souffrances et son universelle compassion. Les Bouddhistes
Mahayana jugent égoïste la lutte individuelle pour l’obtention du nirvana qui
caractérise le bouddhisme hinayana». On comprend que cette
forme de bouddhisme allait obtenir la faveur des Chinois soudain préoccupés par
le sort de leur âme défunte : «En général, le Bouddhisme Mahayana pourvoit aux
goûts du peuple, car il développe au plus haut degré ces éléments superstitieux
et mythologiques que le Bouddhisme primitif avait négligé. Le Bouddhisme
Mahayana laisse également une grande place à la dialectique métaphysique et
traite de sujets que le Bouddha considérait comme indignes d’intérêt» (H. G. Creel. La pensée chinoise, Paris, Payot, Col.
Bibliothèque historique, 1955. pp. 198-199).
Car le Bouddhisme lui-même
apparaît sous deux formes : «le Bouddhisme ancien était quelquefois désigné sous l’appellation du
"Bouddhisme Hinayana". Ce nom lui était donné par l’école rivale, qui
devait apparaître par la suite, et qui se désignait sous le nom de "Bouddhisme
Mahayana", Mahayana signifiant "Grand Véhicule" par opposition à Hinayana, "Petit Véhicule". Le
Mahayana se développa dans l’Inde, sans doute vers le début de l’ère
chrétienne. Il diffère essentiellement du Hinayana en ce qu’il fait place au
"bodhisattva", littéralement "Illuminé en puissance". Un
bodhisattva est un être qui a mérité d’obtenir le nirvana et de devenir un
Bouddha, mais qui renonce volontairement à ce privilège pour demeurer parmi les
créatures de ce monde qui n’ont pas encore atteint l’illumination et pour
travailler à leur salut. C’est une figure héroïque, objet de vénération et même
d’adoration pour ses souffrances et son universelle compassion. Les Bouddhistes
Mahayana jugent égoïste la lutte individuelle pour l’obtention du nirvana qui
caractérise le bouddhisme hinayana». On comprend que cette
forme de bouddhisme allait obtenir la faveur des Chinois soudain préoccupés par
le sort de leur âme défunte : «En général, le Bouddhisme Mahayana pourvoit aux
goûts du peuple, car il développe au plus haut degré ces éléments superstitieux
et mythologiques que le Bouddhisme primitif avait négligé. Le Bouddhisme
Mahayana laisse également une grande place à la dialectique métaphysique et
traite de sujets que le Bouddha considérait comme indignes d’intérêt» (H. G. Creel. La pensée chinoise, Paris, Payot, Col.
Bibliothèque historique, 1955. pp. 198-199). Au cours de telles époques, les monastères bouddhiques doivent avoir été considérés par beaucoup comme des havres de
grâce. Là, on pouvait cesser de se préoccuper des problèmes insolubles de ce
monde pour lire les écritures sacrées, se plier aux règles et méditer. On
pouvait même se dispenser de travailler, étant donné que les laïcs pourvoyaient
aux besoins des monastères. Un homme sincère était certain de trouver au
monastère la paix de l’esprit tandis que la guerre faisait rage à l’extérieur.
Au cours de telles époques, les monastères bouddhiques doivent avoir été considérés par beaucoup comme des havres de
grâce. Là, on pouvait cesser de se préoccuper des problèmes insolubles de ce
monde pour lire les écritures sacrées, se plier aux règles et méditer. On
pouvait même se dispenser de travailler, étant donné que les laïcs pourvoyaient
aux besoins des monastères. Un homme sincère était certain de trouver au
monastère la paix de l’esprit tandis que la guerre faisait rage à l’extérieur. Ceux qui pouvaient se faire moines ou nonnes étaient rares mais tout le monde pouvait être un Bouddhiste laïc. Voilà quelque chose de nouveau. Le Confucianisme demandait à ses adeptes un niveau d’instruction assez élevé. Le Taoïsme proposait l’immortalité du corps, mais rares étaient les fidèles capables d’y parvenir. Dans le Bouddhisme, par contre, et particulièrement dans le Bouddhisme Mahayana, tout le monde sans exception pouvait espérer trouver le salut, à des degrés divers. Le Bouddhisme offrait à ceux dont la vie sur la terre était un enfer l’espoir d’un paradis après leur mort; le plus humble avait ainsi le sentiment de travailler à son salut personnel» (pp. 201-202).
 position du
Giao-chi en faisait l’intermédiaire entre la Chine et l’Inde, surtout après que
la décadence des Han eut amené la perte de l’Asie centrale. Du IIIe au IVe
siècle, ce pays devait rester un foyer d’expansion du bouddhisme, escale des
pèlerins qui s’en allaient porter en Chine le lotus de la bonne foi» (Lê Thá Khôi. op. cit. pp. 111-112).
Pourtant, si la Chine reçut le Bouddhisme sous sa version du Mahayana, Ceylan,
la Birmanie, le Cambodge et le Siam le reçurent sous sa forme du Hinayana.
C’est ainsi que les pèlerins le ramenèrent de Ceylan, ce qui n’empêcha pas le Bouddhisme viétnamien d’avoir sa propre originalité, ainsi avec l’école du dhyâna
(thiên), à laquelle se rattachent la plupart des sectes, avec plus ou moins
d’orthodoxie : «Selon la tradition, elle avait été introduite par
Bodhidharma (Bô-dê-dat-ma), arrivé par mer à Nankin vers 520-525. Sa doctrine
rejette la recherche de la vérité dans les textes pour y substituer la
contemplation intérieure, la "contemplation murale" (bich quan)
: "l’homme reconnaît dans son propre cœur le vrai cœur du Bouddha",
le principe de toute bouddhéité, l’essence unique du samsâra et du nirvâna.
Pour celui qui, abimé ainsi en lui-même, prend conscience de son unité avec le
Bouddha, pour celui qui est arrivé à comprendre que la nature de l’homme est
originellement pure, libre de la confusion du monde et ornée de la sagesse parfaite du Bouddha, toutes les distinctions de bien et de mal disparaissent.
Par la complète absorption de la pensée, l’adepte du thiên jouit d’une absolue
tranquillité d’esprit. Il y parvient par une succession d’états d’âme :
l’attention (il concentre l’esprit sur une pensée), la joie (il s’élève à une
intuition directrice), le bonheur (il obtient un calme parfait), l’indifférence
enfin. C’est un acheminement progressif vers la béatitude absolue. On constate
combien l’extase thiên se rapproche du mysticisme taoïque» (pp. 127-128).
L’Annam devient un lieu où les pèlerins venus de l’Inde et du Ceylan s’arrêtent
pour diffuser leur message. Le Hinaya y reprend de la vitalité tout en se
chargeant des caractères nationaux des peuples Viêt, en particulier au niveau
de la poésie. Deux moines : Duy-giâm et Phung-dinh viennent prêcher à la Cour
de Tch’ang-ngan. Au moment du retour de Phung-dinh, Ynak Kiu-yuan lui dédie ces
vers qui sont parmi les premiers, sans doute, à affirmer la spécifité du Viét
Nam:
position du
Giao-chi en faisait l’intermédiaire entre la Chine et l’Inde, surtout après que
la décadence des Han eut amené la perte de l’Asie centrale. Du IIIe au IVe
siècle, ce pays devait rester un foyer d’expansion du bouddhisme, escale des
pèlerins qui s’en allaient porter en Chine le lotus de la bonne foi» (Lê Thá Khôi. op. cit. pp. 111-112).
Pourtant, si la Chine reçut le Bouddhisme sous sa version du Mahayana, Ceylan,
la Birmanie, le Cambodge et le Siam le reçurent sous sa forme du Hinayana.
C’est ainsi que les pèlerins le ramenèrent de Ceylan, ce qui n’empêcha pas le Bouddhisme viétnamien d’avoir sa propre originalité, ainsi avec l’école du dhyâna
(thiên), à laquelle se rattachent la plupart des sectes, avec plus ou moins
d’orthodoxie : «Selon la tradition, elle avait été introduite par
Bodhidharma (Bô-dê-dat-ma), arrivé par mer à Nankin vers 520-525. Sa doctrine
rejette la recherche de la vérité dans les textes pour y substituer la
contemplation intérieure, la "contemplation murale" (bich quan)
: "l’homme reconnaît dans son propre cœur le vrai cœur du Bouddha",
le principe de toute bouddhéité, l’essence unique du samsâra et du nirvâna.
Pour celui qui, abimé ainsi en lui-même, prend conscience de son unité avec le
Bouddha, pour celui qui est arrivé à comprendre que la nature de l’homme est
originellement pure, libre de la confusion du monde et ornée de la sagesse parfaite du Bouddha, toutes les distinctions de bien et de mal disparaissent.
Par la complète absorption de la pensée, l’adepte du thiên jouit d’une absolue
tranquillité d’esprit. Il y parvient par une succession d’états d’âme :
l’attention (il concentre l’esprit sur une pensée), la joie (il s’élève à une
intuition directrice), le bonheur (il obtient un calme parfait), l’indifférence
enfin. C’est un acheminement progressif vers la béatitude absolue. On constate
combien l’extase thiên se rapproche du mysticisme taoïque» (pp. 127-128).
L’Annam devient un lieu où les pèlerins venus de l’Inde et du Ceylan s’arrêtent
pour diffuser leur message. Le Hinaya y reprend de la vitalité tout en se
chargeant des caractères nationaux des peuples Viêt, en particulier au niveau
de la poésie. Deux moines : Duy-giâm et Phung-dinh viennent prêcher à la Cour
de Tch’ang-ngan. Au moment du retour de Phung-dinh, Ynak Kiu-yuan lui dédie ces
vers qui sont parmi les premiers, sans doute, à affirmer la spécifité du Viét
Nam: La chrysalide bouddhiste va enfin s’étendre sur
le Japon, et ce n’est pas là où elle aura la moindre influence. En Corée, le
bouddhisme fut introduit en 372 au moment où les Trois Royaumes se faisaient
concurrence dans la péninsule. Mais partout, les classes dirigeantes adoptèrent
la religion venue de Chine comme une alternative à un confucianisme qui ne
s’était pas encore véritablement implanté. Comme le dit Fabre : «Ce qui
caractérise l’adoption du bouddhisme en Corée, c’est qu’elle a été le fait des
dynasties régnantes, dans le cadre de relations diplomatiques avec la Chine et,
ce qui est encore plus frappant, qu’elle a été pratiquement imposée à la
noblesse du pays par la famille royale de Silla. Une telle attitude laisse indiquer
que les familles régnantes devaient trouver leur avantage à l’adoption de cette
religion nouvelle. Une seule religion commune à tout le peuple ne pouvait en
effet que servir les tendances centralisatrices des États. En outre, la notion
de "karma" et l’idée de réincarnation en fonction de ses mérites dans
les vies antérieures ne pouvaient que justifier les stratifications de la
société. Enfin, les notions de paradis et d’enfer, de bonnes actions et de
péchés, de récompenses et de punitions ne pouvaient qu’inciter le peuple à
respecter les lois et à respecter l’autorité. Comme on le voit, une bonne
quantité des politiques entra dans la favorisation du bouddhisme par les élites
dirigeantes. En outre, l’organisation du clergé en une hiérarchie qui est allée
des plus hautes sphères de l’État jusqu’aux plus petits temples de campagne
permit un quadrillage moral de la population» (A. Fabre. op. cit. pp.
75-76). Encore une fois, le Bouddhisme servi de chrysalide idéologique à la
préparation de l’unification politique de la Corée précisant l’identité nationale
coréenne.
La chrysalide bouddhiste va enfin s’étendre sur
le Japon, et ce n’est pas là où elle aura la moindre influence. En Corée, le
bouddhisme fut introduit en 372 au moment où les Trois Royaumes se faisaient
concurrence dans la péninsule. Mais partout, les classes dirigeantes adoptèrent
la religion venue de Chine comme une alternative à un confucianisme qui ne
s’était pas encore véritablement implanté. Comme le dit Fabre : «Ce qui
caractérise l’adoption du bouddhisme en Corée, c’est qu’elle a été le fait des
dynasties régnantes, dans le cadre de relations diplomatiques avec la Chine et,
ce qui est encore plus frappant, qu’elle a été pratiquement imposée à la
noblesse du pays par la famille royale de Silla. Une telle attitude laisse indiquer
que les familles régnantes devaient trouver leur avantage à l’adoption de cette
religion nouvelle. Une seule religion commune à tout le peuple ne pouvait en
effet que servir les tendances centralisatrices des États. En outre, la notion
de "karma" et l’idée de réincarnation en fonction de ses mérites dans
les vies antérieures ne pouvaient que justifier les stratifications de la
société. Enfin, les notions de paradis et d’enfer, de bonnes actions et de
péchés, de récompenses et de punitions ne pouvaient qu’inciter le peuple à
respecter les lois et à respecter l’autorité. Comme on le voit, une bonne
quantité des politiques entra dans la favorisation du bouddhisme par les élites
dirigeantes. En outre, l’organisation du clergé en une hiérarchie qui est allée
des plus hautes sphères de l’État jusqu’aux plus petits temples de campagne
permit un quadrillage moral de la population» (A. Fabre. op. cit. pp.
75-76). Encore une fois, le Bouddhisme servi de chrysalide idéologique à la
préparation de l’unification politique de la Corée précisant l’identité nationale
coréenne. le Bouddhisme
japonais est un don de la Corée. Lorsque «le prince du Kudara (royaume de
Paekche en Corée) présenta en 552 (ou peut-être dès 538?) la religion
bouddhique […] au souverain du Yamato (Kimmei?) alors établi à Asuka
(dans l’actuelle préfecture de Shiga) à qui il demandait de l’aide contre son
trop entreprenant voisin, le royaume de Silla. […] Ainsi le bouddhisme
pénétra-t-il, officiellement du moins, dans les îles japonaises. En fait, il
est probable que cette religion et des bribes de sa doctrine philosophique
avaient apparu bien avant cette date, apportées par des réfugiés coréens et des
Japonais revenus de l’État du Mimama. Mais manquant de soutien officiel, cette
nouvelle religion n’avait pu se propager et il comptait probablement en 552 que
très peu de fidèles. Cette même année, le souverain du Yamato envoya une armée
pour secourir le Paekche, armée qui ne peut empêcher, malgré la bravoure des
soldats japonais, le royaume de Silla de vaincre celui de Paecke» (L.
Frédéric. Japon L’empire éternel, Paris, Éditions du Félin, 1985, p.
84). Roger Bersihand raconte que l’introduction du Bouddhisme coïncida avec une
grave crise sociale au Japon : «En 552, Seimei, roi de Kudara, envoya en
présent à l’empereur Kimmei des sutra et des images bouddhiques, ainsi qu’une
statue dorée de Bouddha. Kimmei-tennô fit bon accueil aux messagers coréens;
mais sur la question de l’adoration de la statue, il consulta ses minnistres.
Or deux partis se disputaient la prééminence : d’un côté, les Nakatomi, chefs
des prêtres du shintô, clan sacerdotal, descendant de kami, et les Mononobe,
clan
le Bouddhisme
japonais est un don de la Corée. Lorsque «le prince du Kudara (royaume de
Paekche en Corée) présenta en 552 (ou peut-être dès 538?) la religion
bouddhique […] au souverain du Yamato (Kimmei?) alors établi à Asuka
(dans l’actuelle préfecture de Shiga) à qui il demandait de l’aide contre son
trop entreprenant voisin, le royaume de Silla. […] Ainsi le bouddhisme
pénétra-t-il, officiellement du moins, dans les îles japonaises. En fait, il
est probable que cette religion et des bribes de sa doctrine philosophique
avaient apparu bien avant cette date, apportées par des réfugiés coréens et des
Japonais revenus de l’État du Mimama. Mais manquant de soutien officiel, cette
nouvelle religion n’avait pu se propager et il comptait probablement en 552 que
très peu de fidèles. Cette même année, le souverain du Yamato envoya une armée
pour secourir le Paekche, armée qui ne peut empêcher, malgré la bravoure des
soldats japonais, le royaume de Silla de vaincre celui de Paecke» (L.
Frédéric. Japon L’empire éternel, Paris, Éditions du Félin, 1985, p.
84). Roger Bersihand raconte que l’introduction du Bouddhisme coïncida avec une
grave crise sociale au Japon : «En 552, Seimei, roi de Kudara, envoya en
présent à l’empereur Kimmei des sutra et des images bouddhiques, ainsi qu’une
statue dorée de Bouddha. Kimmei-tennô fit bon accueil aux messagers coréens;
mais sur la question de l’adoration de la statue, il consulta ses minnistres.
Or deux partis se disputaient la prééminence : d’un côté, les Nakatomi, chefs
des prêtres du shintô, clan sacerdotal, descendant de kami, et les Mononobe,
clan  militaire, descendant d’un souverain du Yamato rallié à Jimmu-tennô,
représentaient les partisans de l’ancien régime, les conservateurs; de l’autre
côté, les Soga, clan civil, de lignée impériale, prirent la tête des
réformateurs et des innovateurs. Ceux-ci virent dans le bouddhisme un moyen de
faire perdre au shintoïsme sa toute-puissance et, en même temps, aux Nakatomi
liés aux Mononobe leur crédit; ils se firent donc les défenseurs de la religion
nouvelle, et Soga Iname fut d’avis qu’il n’y avait pas de raison de ne pas
adorer le Bouddha, comme dans tous les pays de l’est asiatique Nataomi Kamako
et Mononobe Okoshi prétendirent que ce serait faire injure aux kami du pays et
attirer leur colère. L’empereur Kimmei remit la statue à Soga Iname, qui lui
éleva un temple dans sa demeure. L’année suivante, une épidémie ravagea le pays
: Nakatomi et Mononobe l’attribuèrent à une vengeance des dieux, et
Kimmei-tennnô fit jeter la statue dans le canal de Naniwa et brûler le temps.
Un peu plus tard, les bonzes Tonei et Dôshin vinrent de Kudara prêcher leur
religion : ce sont les deux premiers bonzes que vit le japon» (R.
Bersihand. Histoire du Japon, Paris, Payot, Col. Bibliothèque
historique, 1959, p. 54).
militaire, descendant d’un souverain du Yamato rallié à Jimmu-tennô,
représentaient les partisans de l’ancien régime, les conservateurs; de l’autre
côté, les Soga, clan civil, de lignée impériale, prirent la tête des
réformateurs et des innovateurs. Ceux-ci virent dans le bouddhisme un moyen de
faire perdre au shintoïsme sa toute-puissance et, en même temps, aux Nakatomi
liés aux Mononobe leur crédit; ils se firent donc les défenseurs de la religion
nouvelle, et Soga Iname fut d’avis qu’il n’y avait pas de raison de ne pas
adorer le Bouddha, comme dans tous les pays de l’est asiatique Nataomi Kamako
et Mononobe Okoshi prétendirent que ce serait faire injure aux kami du pays et
attirer leur colère. L’empereur Kimmei remit la statue à Soga Iname, qui lui
éleva un temple dans sa demeure. L’année suivante, une épidémie ravagea le pays
: Nakatomi et Mononobe l’attribuèrent à une vengeance des dieux, et
Kimmei-tennnô fit jeter la statue dans le canal de Naniwa et brûler le temps.
Un peu plus tard, les bonzes Tonei et Dôshin vinrent de Kudara prêcher leur
religion : ce sont les deux premiers bonzes que vit le japon» (R.
Bersihand. Histoire du Japon, Paris, Payot, Col. Bibliothèque
historique, 1959, p. 54). étrangère consiste, pour le Japon, à entrer en relations
directes avec la Chine et à élever le niveau culturel de son pays à celui de
l'Empire, en assimilant sa civilisation, et d'abord le bouddhisme. En
conséquence, il dépêche en Chine une ambassade plénipotentiaire (kenzuishi),
mais aussi des lettrés, tant clercs que laïcs. Ceux-ci poursuivent leurs études
dans la ville cosmopolite de Chang'an, certains pendant trente ans ou plus,
s'assimilant totalement la civilisation mère avant de regagner leur pays.
Parfois ayant passé les concours de l'administration impériale, ils font des
stages comme fonctionnaires pour les Tang. Certains même se fixent en Chine
pour le restant de leurs jours. De 630 à 894, ce sont dix-neuf légations
japonaises (kentoshi) qui sont ainsi envoyés à la cour des Tang; seize
d'entre elles mènent à bonne fin leur délicate mission. Grâce à son élite
formée en Chine, le Japon modèle ses institutions sur celles de l'Empire, des
rôles d'impôts sont établis, et un État centralisé finit par prendre corps.
Puis - sur le plan de Chang'an - se construit à Nara une vraie capitale, avec
palais et bureaux du gouvernement, monatères bouddhistes et demeures
aristocratiques, le tout selon le modèle Tang. La vie officielle à la cour est
devenue hautement raffinée, entièrement calquée sur ce que font les Chinois. Le
bagage doctrinal ramené au Japon par les moines savants formés en Chine est
systématisé dans l'enseignement des Six Écoles de Nara, les premières écoles
bouddhistes sur le sol japonais; toutes les six ont commencé à fleurir à
Chang'an, sous les Tang» (Zenryu Tsukamoto, in A. Toynbee (éd.). op. cit. p. 205).
étrangère consiste, pour le Japon, à entrer en relations
directes avec la Chine et à élever le niveau culturel de son pays à celui de
l'Empire, en assimilant sa civilisation, et d'abord le bouddhisme. En
conséquence, il dépêche en Chine une ambassade plénipotentiaire (kenzuishi),
mais aussi des lettrés, tant clercs que laïcs. Ceux-ci poursuivent leurs études
dans la ville cosmopolite de Chang'an, certains pendant trente ans ou plus,
s'assimilant totalement la civilisation mère avant de regagner leur pays.
Parfois ayant passé les concours de l'administration impériale, ils font des
stages comme fonctionnaires pour les Tang. Certains même se fixent en Chine
pour le restant de leurs jours. De 630 à 894, ce sont dix-neuf légations
japonaises (kentoshi) qui sont ainsi envoyés à la cour des Tang; seize
d'entre elles mènent à bonne fin leur délicate mission. Grâce à son élite
formée en Chine, le Japon modèle ses institutions sur celles de l'Empire, des
rôles d'impôts sont établis, et un État centralisé finit par prendre corps.
Puis - sur le plan de Chang'an - se construit à Nara une vraie capitale, avec
palais et bureaux du gouvernement, monatères bouddhistes et demeures
aristocratiques, le tout selon le modèle Tang. La vie officielle à la cour est
devenue hautement raffinée, entièrement calquée sur ce que font les Chinois. Le
bagage doctrinal ramené au Japon par les moines savants formés en Chine est
systématisé dans l'enseignement des Six Écoles de Nara, les premières écoles
bouddhistes sur le sol japonais; toutes les six ont commencé à fleurir à
Chang'an, sous les Tang» (Zenryu Tsukamoto, in A. Toynbee (éd.). op. cit. p. 205).Le Bouddhisme nippon trouva son protecteur en la personne du prince Shôtoku-taishi, nourri de culture chinoise, il voulut que son pays soit traité en égal par la Chine et non en vassal. Shôtoku-taishi est sans conteste l’un des fondateurs de la culture japonaise, celui qui lui fournit la nécessité de l’auto-détermination propre à faire de celle-ci un fleuron de la civilisation extrême-orientale :
 l’Asie Antérieure.
l’Asie Antérieure.  deux
importantes réalisations littéraires. La première est la compilation des deux
chroniques nationales […] décrites comme des œuvres remarquables,
inspirées de l’exemple chinois, et auxquelles nous pouvons associer
l’importante Fudoki, une étude des provinces et de leur production. Le
deuxième monument littéraire est la grande anthologie de poésie connue sous le
nom de Manyposhû, qui regroupe des vers des temps les plus anciens
jusqu’en 760. Elle renferme quelque quatre mille poèmes, courts ou longs, et
peut être considérée comme le reflet du sentiment japonais aux VIIe et VIIIe
siècles, avec, peut-être, les traces d’une vie plus primitive ou en tout cas
plus simple dans les "Chants de l’Orient" ou "Azuma-uta".
deux
importantes réalisations littéraires. La première est la compilation des deux
chroniques nationales […] décrites comme des œuvres remarquables,
inspirées de l’exemple chinois, et auxquelles nous pouvons associer
l’importante Fudoki, une étude des provinces et de leur production. Le
deuxième monument littéraire est la grande anthologie de poésie connue sous le
nom de Manyposhû, qui regroupe des vers des temps les plus anciens
jusqu’en 760. Elle renferme quelque quatre mille poèmes, courts ou longs, et
peut être considérée comme le reflet du sentiment japonais aux VIIe et VIIIe
siècles, avec, peut-être, les traces d’une vie plus primitive ou en tout cas
plus simple dans les "Chants de l’Orient" ou "Azuma-uta". La voix qui parle ici est la voix authentique
de la poésie japonaise. Elle porte certaines traces d’influence étrangère, mais
pour l’essentiel (notamment les œuvres d’aussi grands poètes que Hitomaro) elle
relève de l’inspiration spontanée de l’esprit national, sans doute stimulé par
l’atmosphère vivifiante de la période de réforme qui suivit les édits de Taika.
La poésie japonaise n’a jamais retrouvé la qualité de ces premiers
chefs-d’œuvre» (G.
Sansom. Histoire du Japon, Paris, Fayard, 1988, p. 83).
La voix qui parle ici est la voix authentique
de la poésie japonaise. Elle porte certaines traces d’influence étrangère, mais
pour l’essentiel (notamment les œuvres d’aussi grands poètes que Hitomaro) elle
relève de l’inspiration spontanée de l’esprit national, sans doute stimulé par
l’atmosphère vivifiante de la période de réforme qui suivit les édits de Taika.
La poésie japonaise n’a jamais retrouvé la qualité de ces premiers
chefs-d’œuvre» (G.
Sansom. Histoire du Japon, Paris, Fayard, 1988, p. 83).L’ARS EROTICA
 occidentale, l’ars
erotica des civilisations orientales. Il en va, en effet, de même de la
civilisation syrienne et de l’Islam, de la civilisation indienne et de la
civilisation extrême-orientale. Si une pharmakopé peut être associée à la
science du plaisir, l’Extrême-Orient ne regarde pas la sexualité sous un angle
médical, avec des normes hygiéniques moralisatrices. Le plaisir sexuel est un art de jouir de
la vie, de même que le raffinement dans le sadisme et les cruautés témoigneront
d’un goût délicat et subtil pour les sensations physiologiques. Il est vrai qu’en Occident,
les autorités ecclésiastiques en étaient venues à opposer l’amour et le sexe,
la dot et l’héritage des patrimoines demeurant la mesure de tous liens entre les sexes. Sur ce point, la Civilisation extrême-orientale ne diverge
pas. La contradiction occidentale occasionna l’émergence de la poésie des
troubadours, du roman courtois et de la passion amoureuse portée au plus haut
degré avec Tristan et Iseult. Ce roman qui accepte l’adultère et exalte le désir féminin fut pourchassé par les clercs qui exigèrent des récits
courtois, opposés à l'esprit Tristan et Iseult et surchargés de symboles religieux.
Par contre, le thème de la passion amoureuse, tel que traité dans ce roman, se diffusa dans toutes les couches de la société, et cela à travers de
nombreuses relectures selon les styles littéraires ou cinématographiques. C’est ainsi qu’on produisit des romans d’amour-passion
dont certains sont d’amour-volage, d’autres d’amour-tendre, d’amour-folie,
enfin d’amour-tragique dont Tristan est un modèle exemplaire que rattrappe certains drames
comme La Célestine ou Roméo et Juliette. Dans tous les cas, la
mélancolie finit par l’emporter sur le plaisir, la phase hystérique recouvrant
la phase euphorique de sa tristesse et de sa déconvenue. Qu’en est-il
maintenant de la Civilisation extrême-orientale?
occidentale, l’ars
erotica des civilisations orientales. Il en va, en effet, de même de la
civilisation syrienne et de l’Islam, de la civilisation indienne et de la
civilisation extrême-orientale. Si une pharmakopé peut être associée à la
science du plaisir, l’Extrême-Orient ne regarde pas la sexualité sous un angle
médical, avec des normes hygiéniques moralisatrices. Le plaisir sexuel est un art de jouir de
la vie, de même que le raffinement dans le sadisme et les cruautés témoigneront
d’un goût délicat et subtil pour les sensations physiologiques. Il est vrai qu’en Occident,
les autorités ecclésiastiques en étaient venues à opposer l’amour et le sexe,
la dot et l’héritage des patrimoines demeurant la mesure de tous liens entre les sexes. Sur ce point, la Civilisation extrême-orientale ne diverge
pas. La contradiction occidentale occasionna l’émergence de la poésie des
troubadours, du roman courtois et de la passion amoureuse portée au plus haut
degré avec Tristan et Iseult. Ce roman qui accepte l’adultère et exalte le désir féminin fut pourchassé par les clercs qui exigèrent des récits
courtois, opposés à l'esprit Tristan et Iseult et surchargés de symboles religieux.
Par contre, le thème de la passion amoureuse, tel que traité dans ce roman, se diffusa dans toutes les couches de la société, et cela à travers de
nombreuses relectures selon les styles littéraires ou cinématographiques. C’est ainsi qu’on produisit des romans d’amour-passion
dont certains sont d’amour-volage, d’autres d’amour-tendre, d’amour-folie,
enfin d’amour-tragique dont Tristan est un modèle exemplaire que rattrappe certains drames
comme La Célestine ou Roméo et Juliette. Dans tous les cas, la
mélancolie finit par l’emporter sur le plaisir, la phase hystérique recouvrant
la phase euphorique de sa tristesse et de sa déconvenue. Qu’en est-il
maintenant de la Civilisation extrême-orientale? l'homme et la femme vivent côte à côte et non
ensemble? Où, de plus, le mariage relève d'abord du culte des ancêtres? Le pli
resta si bien marqué que, pendant des siècles, les poètes eux-mêmes ne
reconnurent dans l'amour qu'une folie d'adolescents» (D. Elisseeff. La
Femme au temps des Empereurs de Chine, Paris, Stock, rééd. Livre de poche,
# 6761, 1988, pp. 172-173). Danielle Elisseeff nous donne un exemple d'un récit qui aurait pu se transformer en roman chinois de Tristan et Iseult : «Yuan Zhen (779-831), l'un des réformateurs de la poésie Tang, qu'il infléchit vers
la simplicité et l'expression de problèmes quotidiens, raconte sur ce sujet une
histoire riche de signification. Il y est question d'un jeune lettré, nommé
Huizhen, à qui tout réussissait. Tout, aussi, le passionnait. Les longues nuits
de conversation avec ses amis, ses études, le mystère des femmes et, plus
encore, la brillante carrière qui semblait s'ouvrir devant lui. C'était elle,
en fait, sa vraie passion, une passion raisonnable que ses parents encourageaient.
De l'amour, il ne connaissait que les satisfactions offertes, par les
servantes, aux fils des maîtres dans une maisonnée traditionnelle. Des
histoires sans conséquences, en attendant le mariage que son père, cherchant
l'oiseau rare, espérait pouvoir arranger avec la fille d'un haut fonctionnaire»
(p. 173). Ici rien que d'ordinaire. Les rêves des jeunes gens sont partout les
mêmes. On pourrait dire que Huizhen vit des histoires d'amour-volage avec des
filles habituées à ce genre de rencontre. Mais la passion n'a de sens positif
que lorsqu'il s'agit de la carrière qui s'ouvre devant lui et les bons moments
passés entre amis du même sexe. Mais le
mystère de la femme se présente un jour à lui :
l'homme et la femme vivent côte à côte et non
ensemble? Où, de plus, le mariage relève d'abord du culte des ancêtres? Le pli
resta si bien marqué que, pendant des siècles, les poètes eux-mêmes ne
reconnurent dans l'amour qu'une folie d'adolescents» (D. Elisseeff. La
Femme au temps des Empereurs de Chine, Paris, Stock, rééd. Livre de poche,
# 6761, 1988, pp. 172-173). Danielle Elisseeff nous donne un exemple d'un récit qui aurait pu se transformer en roman chinois de Tristan et Iseult : «Yuan Zhen (779-831), l'un des réformateurs de la poésie Tang, qu'il infléchit vers
la simplicité et l'expression de problèmes quotidiens, raconte sur ce sujet une
histoire riche de signification. Il y est question d'un jeune lettré, nommé
Huizhen, à qui tout réussissait. Tout, aussi, le passionnait. Les longues nuits
de conversation avec ses amis, ses études, le mystère des femmes et, plus
encore, la brillante carrière qui semblait s'ouvrir devant lui. C'était elle,
en fait, sa vraie passion, une passion raisonnable que ses parents encourageaient.
De l'amour, il ne connaissait que les satisfactions offertes, par les
servantes, aux fils des maîtres dans une maisonnée traditionnelle. Des
histoires sans conséquences, en attendant le mariage que son père, cherchant
l'oiseau rare, espérait pouvoir arranger avec la fille d'un haut fonctionnaire»
(p. 173). Ici rien que d'ordinaire. Les rêves des jeunes gens sont partout les
mêmes. On pourrait dire que Huizhen vit des histoires d'amour-volage avec des
filles habituées à ce genre de rencontre. Mais la passion n'a de sens positif
que lorsqu'il s'agit de la carrière qui s'ouvre devant lui et les bons moments
passés entre amis du même sexe. Mais le
mystère de la femme se présente un jour à lui : cette passionnante aventure un peu comme nous vivons
celles de nos héros de cinéma. Histoire d’amour bien menée, avec billets
secrets - que tout le monde lit au passage -, petites servantes messagères,
jardiniers fripons qui ouvrent à la fraîche les clôtures qu’ils ont pour
mission de tenir fermées, femmes de chambre qui ferment les yeux pour mieux
entendre, portières soulevées et refermées aussitôt, déguisements, connivences
de part et d’autre du mur séparant les propriétés mitoyennes. Une histoire
d’amour enfin qui se termine le mieux du monde par la séparation consentie des
deux amants. Ils se marient chacun de leur côté : c’est à cette condition
seulement que l’amour peut rester un passe-temps agréable. Pour qu’une passion
ne devienne pas maléfique, elle doit demeurer un jeu, ce qui est sans doute le
contraire même de la passion. Mais ainsi parla Yuan Zhen, l’homme du réalisme
poétique, qui relate complaisamment la fin "normale", et
vraisemblable, de son histoire : le jeune lettré accepta du jour au lendemain,
et avec joie, le mariage glorieux que son père avait enfin pu conclure. Et la
belle - dont nul ne sut jamais jusqu’où elle était allée trop loin avec son
amoureux - versa trois larmes de circonstance, mais sans songer vraiment à
s’attrister ni encore moins à protester. Puis elle s’en fut, tranquille,
épouser l’homme qui lui était destiné. Il lui resterait un délicieux souvenir
qui éclairerait ses heures de tristesse et l’aiderait plus tard à mieux
comprendre, pour s’en amuser ou pour y faire obstacle, les amours des filles de
sa maison» (pp. 173-174),
cette passionnante aventure un peu comme nous vivons
celles de nos héros de cinéma. Histoire d’amour bien menée, avec billets
secrets - que tout le monde lit au passage -, petites servantes messagères,
jardiniers fripons qui ouvrent à la fraîche les clôtures qu’ils ont pour
mission de tenir fermées, femmes de chambre qui ferment les yeux pour mieux
entendre, portières soulevées et refermées aussitôt, déguisements, connivences
de part et d’autre du mur séparant les propriétés mitoyennes. Une histoire
d’amour enfin qui se termine le mieux du monde par la séparation consentie des
deux amants. Ils se marient chacun de leur côté : c’est à cette condition
seulement que l’amour peut rester un passe-temps agréable. Pour qu’une passion
ne devienne pas maléfique, elle doit demeurer un jeu, ce qui est sans doute le
contraire même de la passion. Mais ainsi parla Yuan Zhen, l’homme du réalisme
poétique, qui relate complaisamment la fin "normale", et
vraisemblable, de son histoire : le jeune lettré accepta du jour au lendemain,
et avec joie, le mariage glorieux que son père avait enfin pu conclure. Et la
belle - dont nul ne sut jamais jusqu’où elle était allée trop loin avec son
amoureux - versa trois larmes de circonstance, mais sans songer vraiment à
s’attrister ni encore moins à protester. Puis elle s’en fut, tranquille,
épouser l’homme qui lui était destiné. Il lui resterait un délicieux souvenir
qui éclairerait ses heures de tristesse et l’aiderait plus tard à mieux
comprendre, pour s’en amuser ou pour y faire obstacle, les amours des filles de
sa maison» (pp. 173-174), de familles,
secret (de Polichinelle) d’amour, complicité de la domesticité… Un seul manque
à l’ensemble. La mort. Sans doute que des histoires d’amour-passion eurent lieu
dans la vie comme dans l’imaginaire romanesque des chinois. Danielle Elisseeff parle des
bâtards, enfants naturels que l’on faisait disparaître comme la famille évitait
de révéler la grossesse de leur fille. Mais les convenances, la politesse
sociale et surtout le puritanisme du confucianisme et du taoïsme réunis,
confinant les poésies d’amour bouddhistes à la nature et aux paysages, ont
réussi, mieux qu’en Occident, à éviter que la passion amoureuse s’élève
au-dessus des autres passions jugées saines et normales. De même, les liens
homosexuels, mieux acceptés chez les femmes que chez les hommes, ne causaient
pas de troubles majeurs à la famille. L’ars erotica pas moins que la sciencia
sexualis servait à dissimuler des liens interpersonnels plus lourds de
conséquences. Il compile dans de précieux livres, à l’exemple du Jin Ping Mei (chinois : 金瓶梅; pinyin : ), traduit parfois Fleur en fiole d'or) un langage poétique illustrés d'images raffinées qui nous disent le comment
de l’amour, de la relation sexuelle. Les Orientaux contemplent et les
Occidentaux mesurent, ainsi le pourquoi s’efface devant deux formes de voyeurisme qui nous
laissent avec l’impression qu’il n’y a pas d’histoires à raconter. Mais l’amour
existe puisque nous en percevons la trace à travers la mélancolie, aussi bien dans
la poésie japonaise que dans la poésie chinoise. Il s’exprime autrement, ce sur
quoi il faudrait de minutieuses enquêtes pour nous y initier. Pour le moment,
tout ce que l’on sait, comme dans le Satyricon de Pétrone, c'est que l'amour-passion fait rire.
Si l’on relit le récit de Yuan Zhen, on s’aperçoit que nous sommes là devant un
récit fort bourgeois, où le marivaudage tient la place de la gravité tragique
des Liaisons dangereuses de Laclos.
de familles,
secret (de Polichinelle) d’amour, complicité de la domesticité… Un seul manque
à l’ensemble. La mort. Sans doute que des histoires d’amour-passion eurent lieu
dans la vie comme dans l’imaginaire romanesque des chinois. Danielle Elisseeff parle des
bâtards, enfants naturels que l’on faisait disparaître comme la famille évitait
de révéler la grossesse de leur fille. Mais les convenances, la politesse
sociale et surtout le puritanisme du confucianisme et du taoïsme réunis,
confinant les poésies d’amour bouddhistes à la nature et aux paysages, ont
réussi, mieux qu’en Occident, à éviter que la passion amoureuse s’élève
au-dessus des autres passions jugées saines et normales. De même, les liens
homosexuels, mieux acceptés chez les femmes que chez les hommes, ne causaient
pas de troubles majeurs à la famille. L’ars erotica pas moins que la sciencia
sexualis servait à dissimuler des liens interpersonnels plus lourds de
conséquences. Il compile dans de précieux livres, à l’exemple du Jin Ping Mei (chinois : 金瓶梅; pinyin : ), traduit parfois Fleur en fiole d'or) un langage poétique illustrés d'images raffinées qui nous disent le comment
de l’amour, de la relation sexuelle. Les Orientaux contemplent et les
Occidentaux mesurent, ainsi le pourquoi s’efface devant deux formes de voyeurisme qui nous
laissent avec l’impression qu’il n’y a pas d’histoires à raconter. Mais l’amour
existe puisque nous en percevons la trace à travers la mélancolie, aussi bien dans
la poésie japonaise que dans la poésie chinoise. Il s’exprime autrement, ce sur
quoi il faudrait de minutieuses enquêtes pour nous y initier. Pour le moment,
tout ce que l’on sait, comme dans le Satyricon de Pétrone, c'est que l'amour-passion fait rire.
Si l’on relit le récit de Yuan Zhen, on s’aperçoit que nous sommes là devant un
récit fort bourgeois, où le marivaudage tient la place de la gravité tragique
des Liaisons dangereuses de Laclos. «Le plus célèbre des poètes de tanka est
alors Ariwara no Narihira (825-880), parangon des amants de Heian. Sa poésie
est mélancolique plutôt que passionnée; elle manque étrangement d’une mâle assurance, mais apparemment c’est ce ton qui convient pour séduire une dame de
Heian. […] Le Kokinshu [école de poètes nippons] crée… un style
auquel la plupart des poètes de tanka restent fidèles durant un millier
d’années. Il détermine les tendances dominantes et le contenu thématique de la
poésie future. Comme le Manyoshu, il est divisé en vingt livres
«Le plus célèbre des poètes de tanka est
alors Ariwara no Narihira (825-880), parangon des amants de Heian. Sa poésie
est mélancolique plutôt que passionnée; elle manque étrangement d’une mâle assurance, mais apparemment c’est ce ton qui convient pour séduire une dame de
Heian. […] Le Kokinshu [école de poètes nippons] crée… un style
auquel la plupart des poètes de tanka restent fidèles durant un millier
d’années. Il détermine les tendances dominantes et le contenu thématique de la
poésie future. Comme le Manyoshu, il est divisé en vingt livres  : les
saisons (six livres), des félicitations, la séparation, le voyage et l’amour (cinq
livres), les funérailles et enfin des sujets divers. Le nombre des poèmes
consacrés à l’amour et aux saisons - onze livres sur vingt - témoigne bien de
ce que les courtisans de Heian considèrent être les fonctions principales de la
poésie. L’exubérance des saisons, surtout telle qu’on la voit dans la capitale,
donne naissance au culte des fleurs de cerisier et à celui des feuilles
d’érable virant au rouge; ils inspirent d’innombrables poèmes. Contrairement à
l’usage poétique chinois, l’amour devient le sujet principal du tanka, mais
il en décrit rarement le plaisir. Au contraire, les émotions exprimées sont
surtout l’incertitude précédant la rencontre, l’angoisse de la séparation et le
désespoir à la fin d’une liaison. Le peu d’empressement à traiter de l’amour
comme tel au profit des préliminaires et des dénouements prive la poésie
japonaise d’une partie de la vigueur de la poésie amoureuse de l’Occident; mais
la condition du tanka et son caractère "féminin" expliquent et
justifient ce choix des poètes du Kohinshu. Il ne faut pas s’imaginer,
toutefois, que les poèmes de cette anthologie soient fades ou insipides. Ainsi,
les poèmes de Narihira ou Tsurayuki, ou de femmes comme Ono no Komachi (IXe
siècle) et Ise (vers 877-939) témoignent d’une intensité poétique profonde et
parfois éclatante…» (D.
Keene, in A. Toynbee (éd.). op. cit. pp. 274 et 275).
: les
saisons (six livres), des félicitations, la séparation, le voyage et l’amour (cinq
livres), les funérailles et enfin des sujets divers. Le nombre des poèmes
consacrés à l’amour et aux saisons - onze livres sur vingt - témoigne bien de
ce que les courtisans de Heian considèrent être les fonctions principales de la
poésie. L’exubérance des saisons, surtout telle qu’on la voit dans la capitale,
donne naissance au culte des fleurs de cerisier et à celui des feuilles
d’érable virant au rouge; ils inspirent d’innombrables poèmes. Contrairement à
l’usage poétique chinois, l’amour devient le sujet principal du tanka, mais
il en décrit rarement le plaisir. Au contraire, les émotions exprimées sont
surtout l’incertitude précédant la rencontre, l’angoisse de la séparation et le
désespoir à la fin d’une liaison. Le peu d’empressement à traiter de l’amour
comme tel au profit des préliminaires et des dénouements prive la poésie
japonaise d’une partie de la vigueur de la poésie amoureuse de l’Occident; mais
la condition du tanka et son caractère "féminin" expliquent et
justifient ce choix des poètes du Kohinshu. Il ne faut pas s’imaginer,
toutefois, que les poèmes de cette anthologie soient fades ou insipides. Ainsi,
les poèmes de Narihira ou Tsurayuki, ou de femmes comme Ono no Komachi (IXe
siècle) et Ise (vers 877-939) témoignent d’une intensité poétique profonde et
parfois éclatante…» (D.
Keene, in A. Toynbee (éd.). op. cit. pp. 274 et 275). collective. C’est bien avant la dynastie Qin, du temps même des
Royaumes Combattants, qu’on commença à ériger des segments de la Grande Muraille, l’empereur Qin se chargeant de la faire compléter. À défaut d’être
tangiblement protectrice, la Grande Muraille exerce une fonction symbolique
incontestable. Elle est l’image de la Chine, ou plus exactement, l’image de son
unité géographique et historique. Monstre ou merveille, la
Grande Muraille court des rivages du Pacifique aux déserts d’Asie centrale : «tout
s’amalgame, écrit Michel Jan : la longue succession des dynasties, les
récits des annales et les légendes, les animaux fantastiques et les courses des
conquérants. La Muraille est d’abord celle que nous imaginons. Qu’importe sa
réalité et le vide qu’elle cache, le passé qu’on lui a créé ou le futur qui
l’attend. La vision effrayante englobe tous les pans de l’histoire de la Chine,
la froide et implacable autorité de l’empire, la cohorte des bannis des
frontières, l’exil aux portes des déserts, le choc des armes sur tous les
champs de bataille, en une suite de tableaux aux scènes démentes sur fond de
Muraille» (M. Jan. La Grande Muraille de Chine, Paris, Payot, Col.
P.B.P. # 472, 2003, p. 17). Au niveau de la raison raisonnante, la
Grande Muraille était là pour empêcher les barbares du Nord d’envahir l’Empire
du Milieu : Niongnu, Nianheï, Turcs, Nuzhen (Djurchet), Mongols ou Mandchous.
Mais les barbares ne sont pas gens à se laisser arrêter par une muraille, si épaisse, si haute ou si longue soit-elle. Ils ont creusé des brèches dans le
formidable instrument.
collective. C’est bien avant la dynastie Qin, du temps même des
Royaumes Combattants, qu’on commença à ériger des segments de la Grande Muraille, l’empereur Qin se chargeant de la faire compléter. À défaut d’être
tangiblement protectrice, la Grande Muraille exerce une fonction symbolique
incontestable. Elle est l’image de la Chine, ou plus exactement, l’image de son
unité géographique et historique. Monstre ou merveille, la
Grande Muraille court des rivages du Pacifique aux déserts d’Asie centrale : «tout
s’amalgame, écrit Michel Jan : la longue succession des dynasties, les
récits des annales et les légendes, les animaux fantastiques et les courses des
conquérants. La Muraille est d’abord celle que nous imaginons. Qu’importe sa
réalité et le vide qu’elle cache, le passé qu’on lui a créé ou le futur qui
l’attend. La vision effrayante englobe tous les pans de l’histoire de la Chine,
la froide et implacable autorité de l’empire, la cohorte des bannis des
frontières, l’exil aux portes des déserts, le choc des armes sur tous les
champs de bataille, en une suite de tableaux aux scènes démentes sur fond de
Muraille» (M. Jan. La Grande Muraille de Chine, Paris, Payot, Col.
P.B.P. # 472, 2003, p. 17). Au niveau de la raison raisonnante, la
Grande Muraille était là pour empêcher les barbares du Nord d’envahir l’Empire
du Milieu : Niongnu, Nianheï, Turcs, Nuzhen (Djurchet), Mongols ou Mandchous.
Mais les barbares ne sont pas gens à se laisser arrêter par une muraille, si épaisse, si haute ou si longue soit-elle. Ils ont creusé des brèches dans le
formidable instrument.  La Grande Muraille sépare en fait deux mondes, celui des nomades de
la steppe et de l’élevage, et celui de la sédentarité et des agricultures : «Aux
confins des terres des agriculteurs et des éleveurs s’abouchent plaines et
plateaux, cultures et steppes. L’histoire du Nord est une suite de pulsions, de
conquêtes et de replis. Une dynastie se fonde sur la frontière ou au-delà, et
elle prend possession de la Chine, ou bien elle naît en Chine et, pour
s’affirmer, doit se déplacer vers la frontière ou à l’extérieur pour la
contrôler» (p. 20) «De la steppe mandchoue aux portes du Turkestan, le
limes s’étend comme un arc tendu vers la Chine traditionnelle», ajoute Jan.
Parlant de la décision de l’empereur Wudi de lancer ses armées à la conquête du corridor du Hexi (le Gansu actuel), contrôlé par les Xiongnu (les Huns), afin
de s’assurer des relations commerciales avec l’Asie centrale, Jan écrit : «La
Grande Muraille ne fut pas construite ici dans un but strictement défensif. Ce
fut au contraire un des éléments d’une politique résolument offensive de
progression vers les contrées occidentales. Au-delà, dans l’actuel Xinjang, des
tours de guet et des forteresses furent édifiées pour protéger les premières
étapes de la route menant au Turkestan et jusqu’aux
La Grande Muraille sépare en fait deux mondes, celui des nomades de
la steppe et de l’élevage, et celui de la sédentarité et des agricultures : «Aux
confins des terres des agriculteurs et des éleveurs s’abouchent plaines et
plateaux, cultures et steppes. L’histoire du Nord est une suite de pulsions, de
conquêtes et de replis. Une dynastie se fonde sur la frontière ou au-delà, et
elle prend possession de la Chine, ou bien elle naît en Chine et, pour
s’affirmer, doit se déplacer vers la frontière ou à l’extérieur pour la
contrôler» (p. 20) «De la steppe mandchoue aux portes du Turkestan, le
limes s’étend comme un arc tendu vers la Chine traditionnelle», ajoute Jan.
Parlant de la décision de l’empereur Wudi de lancer ses armées à la conquête du corridor du Hexi (le Gansu actuel), contrôlé par les Xiongnu (les Huns), afin
de s’assurer des relations commerciales avec l’Asie centrale, Jan écrit : «La
Grande Muraille ne fut pas construite ici dans un but strictement défensif. Ce
fut au contraire un des éléments d’une politique résolument offensive de
progression vers les contrées occidentales. Au-delà, dans l’actuel Xinjang, des
tours de guet et des forteresses furent édifiées pour protéger les premières
étapes de la route menant au Turkestan et jusqu’aux  rivages méditerranéens, la
route de la soie. Dans cet-
rivages méditerranéens, la
route de la soie. Dans cet-te
di-
rection, la Grande Muraille et ses prolongements de garnisons fortifiées jusqu’au Pamir étaient le bras tendu du pouvoir impérial chinois vers les limites du monde connux (p. 50). La figure de l’arc tendu n’est donc pas innocente. Mieux qu’un vaste système de protection, passif, comme les forteresses occidentales, la Grande Muraille a un aspect offensif. Elle est un défi lancé à l’étranger. La facile conquête de l’Indochine sous les Han n’a pas nécessité la construction de ce symbole, par contre la résistance des barbares nordiques s'est montrée plus coriace.
 complètement
pourri. L’État universel qui s’était construit derrière la Grande Muraille ne
tenait plus debout. La Chine du Nord se retrouva dans un amas de royaumes
divisés, laissant seize royaumes végéter, tandis que
la Chine du Sud voyait le Bouddhisme Mahayana fleurir la civilisation. La
restauration de l’unité passa par la dynastie T’ang (618-907) dont l’intriguant
Li Che-min devint empereur (626-649). Il recevra le nom posthume de T’ai-tsong.
Cet empereur qui parvint à repousser et à contenir les barbares hors des
frontières de la Chine fut à l’origine de cette époque qui vit la Chine se
reconstituer après la séparation. Mais les Turcs Mongols, ceux du Turkestan, le
Tibet et l’État du Miao à la frontière du Viét Nam restaient campés aux
frontières de l’Empire. La restauration établie par Li Che-min dura jusqu’à ce
que reprennent les pressions sur les frontières occidentales de la Chine et
que, de nouveaux, l’Empire se scinde en deux parties; les Song du Nord
(960-1127) bientôt submergés par les Jouchen qui établissent la dynastie des
Kin, et les Song du Sud (1127-1279) qui survivra jusqu’à ce que les hordes
mongoles déferlent sur l’ensemble de la Chine. Les crises constantes qui
surgirent sous la dynastie T’ang, malgré les réformes administratives
entreprises pour consolider le pouvoir chinois, et l’esprit de «décadence» qui
anima les Song, là encore, travaillèrent pour que Genghis Khan franchissent la
muraille fantasmatique sensée protéger l’unité impériale.
complètement
pourri. L’État universel qui s’était construit derrière la Grande Muraille ne
tenait plus debout. La Chine du Nord se retrouva dans un amas de royaumes
divisés, laissant seize royaumes végéter, tandis que
la Chine du Sud voyait le Bouddhisme Mahayana fleurir la civilisation. La
restauration de l’unité passa par la dynastie T’ang (618-907) dont l’intriguant
Li Che-min devint empereur (626-649). Il recevra le nom posthume de T’ai-tsong.
Cet empereur qui parvint à repousser et à contenir les barbares hors des
frontières de la Chine fut à l’origine de cette époque qui vit la Chine se
reconstituer après la séparation. Mais les Turcs Mongols, ceux du Turkestan, le
Tibet et l’État du Miao à la frontière du Viét Nam restaient campés aux
frontières de l’Empire. La restauration établie par Li Che-min dura jusqu’à ce
que reprennent les pressions sur les frontières occidentales de la Chine et
que, de nouveaux, l’Empire se scinde en deux parties; les Song du Nord
(960-1127) bientôt submergés par les Jouchen qui établissent la dynastie des
Kin, et les Song du Sud (1127-1279) qui survivra jusqu’à ce que les hordes
mongoles déferlent sur l’ensemble de la Chine. Les crises constantes qui
surgirent sous la dynastie T’ang, malgré les réformes administratives
entreprises pour consolider le pouvoir chinois, et l’esprit de «décadence» qui
anima les Song, là encore, travaillèrent pour que Genghis Khan franchissent la
muraille fantasmatique sensée protéger l’unité impériale. formaient une centurie, dont dix composaient une unité de
mille. Une unité de dix mille enfin, appelée tumen, se présentait comme
formation tactique indépendante sous les ordres d'un général; le simple soldat
appartenait pour toujours au tumen dans lequel il avait été incorporé. Ces
tumens se groupaient autour de l'aile gauche, de l'aile droite ou du centre,
qui étaient des formations permanentes de l'armée et dont le nom demeurait
indépendant de leur position accidentelle sur le champ de bataille. Cette
nouvelle armée était strictement disciplinée. […] Quoique sa division
suivit le modèle chinois, l’organisation de cette armée fut l’œuvre personnelle
du génie militaire du Grand Khan. Mais le caractère exceptionnel de sa
personnalité n’apparaît pas seulement dans ses succès militaires. Son activité
de législateur est au moins aussi importante, et ce fut lui le véritable organisateur
de l’Empire mongol. Il rassembla les lois de son peuple qui existaient déjà, il
les arrangea et les compléta, donnant ainsi vie à la constitution de l’Empire,
le Yasa, qui resta le fondement de l’ordre public des Mongols longtemps après
la mort de Genghis Khan. Le Yasa contenait des prescriptions militaires ainsi
que des instructions pour la vie journalière. Il soulignait le principe de la
propriété personnelle; c’est ainsi qu’il punissait très sévèrement le vol et la
rapine, prescrivant la mort même dans des cas relativement bénins. La vie
familiale était réglée de la même manière : la femme possédait une large
autonomie et jouissait d’une grande autorité, contrairement à la position que
lui accordait la loi musulmane. La femme participait aussi aux expéditions
militaires; elle n’assurait pas seulement le ménage et l’éducation des enfants,
mais accompagnait souvent l’armée en campagne. Pendant les batailles, les
femmes étaient mises à l’abri, derrière les formations de chariots; cependant
elles se mêlaient quelquefois aux combats. l’autorité des femmes mongoles dans
la vie publique apparaît dans le fait que l’on ne trouve, dans le monde
musulman, de portraits de femmes que depuis la période mongole.
formaient une centurie, dont dix composaient une unité de
mille. Une unité de dix mille enfin, appelée tumen, se présentait comme
formation tactique indépendante sous les ordres d'un général; le simple soldat
appartenait pour toujours au tumen dans lequel il avait été incorporé. Ces
tumens se groupaient autour de l'aile gauche, de l'aile droite ou du centre,
qui étaient des formations permanentes de l'armée et dont le nom demeurait
indépendant de leur position accidentelle sur le champ de bataille. Cette
nouvelle armée était strictement disciplinée. […] Quoique sa division
suivit le modèle chinois, l’organisation de cette armée fut l’œuvre personnelle
du génie militaire du Grand Khan. Mais le caractère exceptionnel de sa
personnalité n’apparaît pas seulement dans ses succès militaires. Son activité
de législateur est au moins aussi importante, et ce fut lui le véritable organisateur
de l’Empire mongol. Il rassembla les lois de son peuple qui existaient déjà, il
les arrangea et les compléta, donnant ainsi vie à la constitution de l’Empire,
le Yasa, qui resta le fondement de l’ordre public des Mongols longtemps après
la mort de Genghis Khan. Le Yasa contenait des prescriptions militaires ainsi
que des instructions pour la vie journalière. Il soulignait le principe de la
propriété personnelle; c’est ainsi qu’il punissait très sévèrement le vol et la
rapine, prescrivant la mort même dans des cas relativement bénins. La vie
familiale était réglée de la même manière : la femme possédait une large
autonomie et jouissait d’une grande autorité, contrairement à la position que
lui accordait la loi musulmane. La femme participait aussi aux expéditions
militaires; elle n’assurait pas seulement le ménage et l’éducation des enfants,
mais accompagnait souvent l’armée en campagne. Pendant les batailles, les
femmes étaient mises à l’abri, derrière les formations de chariots; cependant
elles se mêlaient quelquefois aux combats. l’autorité des femmes mongoles dans
la vie publique apparaît dans le fait que l’on ne trouve, dans le monde
musulman, de portraits de femmes que depuis la période mongole. décisives, il se trouva en 1215 devant
les portes de la capitale de l’Empire des Kin, incapable de repousser son
attaque. L’Empire chinois septentrional s’écroula et les Mongols commencèrent à
s’installer dans cette partie du vaste pays. L’Empire des Song dans le sud de
la Chine ne fut pas mis à mal pendant cette période. Cette victoire rapide à
l’est rendit les armées mongoles disponibles pour d’autres expéditions, et leur
donna confiance en leur propre force. La défaite de l’Empire des Kin, qui,
malgré ses défauts, constituait un des États les plus redoutables aux yeux d’un
habitant des steppes, démontra aux Mongols que Dieu voulait leur accorder
l’Empire du Monde» (pp. 20-21). Les Kin, comme nous l’avons dit, étaient
déjà semi-barbares lorsqu’ils démantelèrent l’empire T’ang, mais la Chine
méridionale au sud du fleuve Houaï-Ho, celle des Song, riche, prospère,
densément peuplé, mais militairement faible et qui n’avait encore jamais été
conquis par les barbares du Nord et de l’Est allait opposer une résistance farouches aux armées mongoles qui dura quarante-cinq ans.
décisives, il se trouva en 1215 devant
les portes de la capitale de l’Empire des Kin, incapable de repousser son
attaque. L’Empire chinois septentrional s’écroula et les Mongols commencèrent à
s’installer dans cette partie du vaste pays. L’Empire des Song dans le sud de
la Chine ne fut pas mis à mal pendant cette période. Cette victoire rapide à
l’est rendit les armées mongoles disponibles pour d’autres expéditions, et leur
donna confiance en leur propre force. La défaite de l’Empire des Kin, qui,
malgré ses défauts, constituait un des États les plus redoutables aux yeux d’un
habitant des steppes, démontra aux Mongols que Dieu voulait leur accorder
l’Empire du Monde» (pp. 20-21). Les Kin, comme nous l’avons dit, étaient
déjà semi-barbares lorsqu’ils démantelèrent l’empire T’ang, mais la Chine
méridionale au sud du fleuve Houaï-Ho, celle des Song, riche, prospère,
densément peuplé, mais militairement faible et qui n’avait encore jamais été
conquis par les barbares du Nord et de l’Est allait opposer une résistance farouches aux armées mongoles qui dura quarante-cinq ans. «Les Mongols n’eurent aucune difficulté à
percer la Grande Muraille gardée par le peuple turc des Ougürs, qui se
reconnaut vassal de Gengis-Khan. Ils se répandirent en Chine du Nord, ravageant
méthodiquement le pays, sans pouvoir cependant s’emparer des villes car ils
manquaient encore d’ingénieurs militaires. Mais en 1212 les Rhitaïs, Mongols
sinisés, habitant la Mandchourie méridionale, jadis maîtres de toute la Chine
du Nord se soulevèrent contre les Djürdjats et se rallièrent aux Mongols,
auxquels ils fournirent désormais des fonctionnaires et des ingénieurs civils
et militaires. Les Kins continuaient cependant à défendre farouchement leur
empire. En 1214, un armistice fut conclu et Gengis-Khan épousa la fille de
l’empereur Kin. Les Kins commirent alors l’erreur stratégique majeure d’évacuer
leur capitale Pékin, pour s’établir plus au sud à Kai-feng. Aussitôt les
Mongols en profitèrent et en 1215 emportèrent la ville d’assaut. Ce fut un
désastre sans nom, le premier d’une liste qui sera longue. Pékin fut pillée de
fond en comble pendant un mois et sa population massacrée. Les Djürdjäts
poursuivaient pendant ce temps leur résistance et en 1216 Gengis-Khan s’en
retourna en Mongolie, la conquête de la Chine du Nord inachevée. Il y laissa
son général, Muquli avec une armée de 23.000 Mongols à laquelle vinrent
s’adjoindre des auxiliaires Khitaïs, des Tanguts et même des transfuges Kins,
Muquli continua la progression au ralenti et ce n’est qu’en 1223 que toute la
Chine au nord du Houai-Ho, ruinée et décimée fut solidement rattachée à
l’Empire gengiskhanide» (C. Lemercier-Quelquejay. La paix mongole, Paris,
Flammarion, Col. Questions d’histoire, # 13, 1970, p. 23).
«Les Mongols n’eurent aucune difficulté à
percer la Grande Muraille gardée par le peuple turc des Ougürs, qui se
reconnaut vassal de Gengis-Khan. Ils se répandirent en Chine du Nord, ravageant
méthodiquement le pays, sans pouvoir cependant s’emparer des villes car ils
manquaient encore d’ingénieurs militaires. Mais en 1212 les Rhitaïs, Mongols
sinisés, habitant la Mandchourie méridionale, jadis maîtres de toute la Chine
du Nord se soulevèrent contre les Djürdjats et se rallièrent aux Mongols,
auxquels ils fournirent désormais des fonctionnaires et des ingénieurs civils
et militaires. Les Kins continuaient cependant à défendre farouchement leur
empire. En 1214, un armistice fut conclu et Gengis-Khan épousa la fille de
l’empereur Kin. Les Kins commirent alors l’erreur stratégique majeure d’évacuer
leur capitale Pékin, pour s’établir plus au sud à Kai-feng. Aussitôt les
Mongols en profitèrent et en 1215 emportèrent la ville d’assaut. Ce fut un
désastre sans nom, le premier d’une liste qui sera longue. Pékin fut pillée de
fond en comble pendant un mois et sa population massacrée. Les Djürdjäts
poursuivaient pendant ce temps leur résistance et en 1216 Gengis-Khan s’en
retourna en Mongolie, la conquête de la Chine du Nord inachevée. Il y laissa
son général, Muquli avec une armée de 23.000 Mongols à laquelle vinrent
s’adjoindre des auxiliaires Khitaïs, des Tanguts et même des transfuges Kins,
Muquli continua la progression au ralenti et ce n’est qu’en 1223 que toute la
Chine au nord du Houai-Ho, ruinée et décimée fut solidement rattachée à
l’Empire gengiskhanide» (C. Lemercier-Quelquejay. La paix mongole, Paris,
Flammarion, Col. Questions d’histoire, # 13, 1970, p. 23). Ögöday et son frère Tuluy
conduisant personnellement la grande armée entreprirent la reconquête de
l’Empire des Kins. Elle dura trois ans. En 1232 malgré l’héroïque résistance
des Djürdjäts, les Mongols emportaient et détruisaient leur capitale, Kai-fong.
Deux ans plus tard, ils écrasaient définitivement toute résistance. La dernière
ville des Kin, Tsai-tchen fut prise en mars 1234 et le dernier empereur Kin se
suicida. L’Empire des Soong, aveuglé par la haine envers ses voisins et
ennemis, avait fourni aux Mongols des contingents d’infanterie pour les aider à
prendre les villes fortifiées des Kin. Ce fut bientôt leur tour de subir
l’assaut des conquérants» (pp. 28-29). Comme souvent en pareils cas,
l’effondrement intérieur, effondrement aussi bien psychologique et moral et que
social, était la véritable cause de la suite des malheurs qui s’abattaient sur
l’Empire du Milieu. «En Corée, l’offensive commencée en 1236 se termina en
1241 par la conquête définitive du pays. Seul un îlot au large de Séoul, refuge
de la cour coréenne échappait à l’emprise mongole. L’Empire atteignait
maintenant les rives de l’océan Pacifique» (p. 29). Comme le roi de Corée
refusait de quitter son île où il se protégeait de l’occupant mongol, ce
dernier décida d’envahir le pays : «Ce fut cette invasion qui fut la plus
dévastatrice. Les Mongols emmenèrent avec eux 200 000 captifs. Les cadavres
étaient trop nombreux pour être dénombrés. Les Mongols utilisaient la tactique
de la terre brûlée, la population fut considérablement
Ögöday et son frère Tuluy
conduisant personnellement la grande armée entreprirent la reconquête de
l’Empire des Kins. Elle dura trois ans. En 1232 malgré l’héroïque résistance
des Djürdjäts, les Mongols emportaient et détruisaient leur capitale, Kai-fong.
Deux ans plus tard, ils écrasaient définitivement toute résistance. La dernière
ville des Kin, Tsai-tchen fut prise en mars 1234 et le dernier empereur Kin se
suicida. L’Empire des Soong, aveuglé par la haine envers ses voisins et
ennemis, avait fourni aux Mongols des contingents d’infanterie pour les aider à
prendre les villes fortifiées des Kin. Ce fut bientôt leur tour de subir
l’assaut des conquérants» (pp. 28-29). Comme souvent en pareils cas,
l’effondrement intérieur, effondrement aussi bien psychologique et moral et que
social, était la véritable cause de la suite des malheurs qui s’abattaient sur
l’Empire du Milieu. «En Corée, l’offensive commencée en 1236 se termina en
1241 par la conquête définitive du pays. Seul un îlot au large de Séoul, refuge
de la cour coréenne échappait à l’emprise mongole. L’Empire atteignait
maintenant les rives de l’océan Pacifique» (p. 29). Comme le roi de Corée
refusait de quitter son île où il se protégeait de l’occupant mongol, ce
dernier décida d’envahir le pays : «Ce fut cette invasion qui fut la plus
dévastatrice. Les Mongols emmenèrent avec eux 200 000 captifs. Les cadavres
étaient trop nombreux pour être dénombrés. Les Mongols utilisaient la tactique
de la terre brûlée, la population fut considérablement  réduite, des villages
entiers furent rayés de la carte. C’est aussi pendant cette invasion que
périrent des trésors nationaux tels que la pagode en bois à neuf étages du
temple de Hwangnyongna à Kyongju et la Tripitaka gravée sur planches de bois et
qui était conservée au temple de Puinsa près de Taegu» (Fabre op. cit. pp.
178-179). Enfin, «la Chine méridionale fut envahie pour la première fois en
1236, mais dans ce pays surpeuplé, le plus évolué du monde, aux villes
nombreuses et bien fortifiées, l’avance mongole fut excessivement lente,
marquée par de nombreux retours offensifs des Soong. Ögöday ne vit que le début
de la conquête qui dura quatrante-trois ans et ne s’acheva que sous le règne de
Kubilay en 1279» (C. Lemercier-Quelquejay. op. cit. p. 29). «La conquête
de la Chine méridionale fut poursuivie méthodiquement sous le règne de Möngka à
partir de 1253. Le haut commandement en était confié à un autre frère du grand
Khan, Kubilay. Elle prograssait lentement, mais dès 1257, les Mongols opérant
un vaste mouvement tournant par l’ouest avaient déjà atteint les frontières du
Tonkin et remontaient vers le nord-est. Momentanément arrêtée en 1259 par la
mort de Möngka, la conquête fut reprise en 1275 sous le règne de Kubilay avec
des contingents venus de tous les coins de l’univers - russes, géorgiens, turcs
et arméniens, mais cette fois sans les horreurs des chevauchées gengiskhanides.
En 1276, tomba Hong-tchow dans le Tche-Kang dernier refuge de l’impératrice
douairière et de l’enfant-empereur Soong. Enfin en 1279, les derniers Soong qui
résistaient encore déposaient les armes. Pour la première fois de son histoire
toute la Chine, de la Mandchourie au Tonkin avait été conquise par les Barbares
du Nord» (p. 40).
réduite, des villages
entiers furent rayés de la carte. C’est aussi pendant cette invasion que
périrent des trésors nationaux tels que la pagode en bois à neuf étages du
temple de Hwangnyongna à Kyongju et la Tripitaka gravée sur planches de bois et
qui était conservée au temple de Puinsa près de Taegu» (Fabre op. cit. pp.
178-179). Enfin, «la Chine méridionale fut envahie pour la première fois en
1236, mais dans ce pays surpeuplé, le plus évolué du monde, aux villes
nombreuses et bien fortifiées, l’avance mongole fut excessivement lente,
marquée par de nombreux retours offensifs des Soong. Ögöday ne vit que le début
de la conquête qui dura quatrante-trois ans et ne s’acheva que sous le règne de
Kubilay en 1279» (C. Lemercier-Quelquejay. op. cit. p. 29). «La conquête
de la Chine méridionale fut poursuivie méthodiquement sous le règne de Möngka à
partir de 1253. Le haut commandement en était confié à un autre frère du grand
Khan, Kubilay. Elle prograssait lentement, mais dès 1257, les Mongols opérant
un vaste mouvement tournant par l’ouest avaient déjà atteint les frontières du
Tonkin et remontaient vers le nord-est. Momentanément arrêtée en 1259 par la
mort de Möngka, la conquête fut reprise en 1275 sous le règne de Kubilay avec
des contingents venus de tous les coins de l’univers - russes, géorgiens, turcs
et arméniens, mais cette fois sans les horreurs des chevauchées gengiskhanides.
En 1276, tomba Hong-tchow dans le Tche-Kang dernier refuge de l’impératrice
douairière et de l’enfant-empereur Soong. Enfin en 1279, les derniers Soong qui
résistaient encore déposaient les armes. Pour la première fois de son histoire
toute la Chine, de la Mandchourie au Tonkin avait été conquise par les Barbares
du Nord» (p. 40).  Chose impensable depuis ses origines, la Chine
était disparue de la carte, avalée par l’immense empire mongol. Certes, on peut
dire que, comme dans la plupart des cas de grandes invasions : «Les Chinois
se comportèrent envers les conquérants comme ils l’avaient toujours fait au
cours de leur longue histoire. Ils supportaient leur souveraineté mais
exerçaient pourtant une influence sur eux par la force intacte de leur
civilisation (qui devint vite familière aux étrangers). Cependant, ils
n’oubliaient pas que les envahisseurs étaient des étrangers, dont la domination
n’était pas compatible avec l’amour-propre de l’Empire du Centre. Quoi qu’il en
soit, les Chinois se mirent au service des conquérants, surtout dans la
capitale Qara-Qoroum qui fut construite à cette époque sur le cours supérieur
de l’Orkhon. Un rejeton de la dynastie vaincue des Khitaï, Yé-Liou tchou-tsaï,
devint ministre des Khans
Chose impensable depuis ses origines, la Chine
était disparue de la carte, avalée par l’immense empire mongol. Certes, on peut
dire que, comme dans la plupart des cas de grandes invasions : «Les Chinois
se comportèrent envers les conquérants comme ils l’avaient toujours fait au
cours de leur longue histoire. Ils supportaient leur souveraineté mais
exerçaient pourtant une influence sur eux par la force intacte de leur
civilisation (qui devint vite familière aux étrangers). Cependant, ils
n’oubliaient pas que les envahisseurs étaient des étrangers, dont la domination
n’était pas compatible avec l’amour-propre de l’Empire du Centre. Quoi qu’il en
soit, les Chinois se mirent au service des conquérants, surtout dans la
capitale Qara-Qoroum qui fut construite à cette époque sur le cours supérieur
de l’Orkhon. Un rejeton de la dynastie vaincue des Khitaï, Yé-Liou tchou-tsaï,
devint ministre des Khans  et rendit des services incomparables pour
l’organisation de l’Empire mongol. Il ne fut pas le seul à agir ainsi; bien des
Chinois (authentiques ou assimilés) travaillèrent dans l’administration ou dans
le commerce. La civilisation chinoise enrichissait la Mongolie, des points de
vue chinois furent inclus dans le Yasa et devinrent courants chez les Mongols.
Les Mongols se servirent de la méthode militaire chinoise, et surtout des armes
chinoises (poudre, etc.)» (B. Spuler. op. cit. p. 21). Le plus fort symbole de cette assimilation des vainqueurs par les
vaincus fut le fait que le Khan prit le nom de Yuan comme dynastie chinoise.
et rendit des services incomparables pour
l’organisation de l’Empire mongol. Il ne fut pas le seul à agir ainsi; bien des
Chinois (authentiques ou assimilés) travaillèrent dans l’administration ou dans
le commerce. La civilisation chinoise enrichissait la Mongolie, des points de
vue chinois furent inclus dans le Yasa et devinrent courants chez les Mongols.
Les Mongols se servirent de la méthode militaire chinoise, et surtout des armes
chinoises (poudre, etc.)» (B. Spuler. op. cit. p. 21). Le plus fort symbole de cette assimilation des vainqueurs par les
vaincus fut le fait que le Khan prit le nom de Yuan comme dynastie chinoise. Il est vrai que la richesse tant économique que
culturelle que représentait la Chine méridionale des Song suffisait à elle
seule pour s’imposer à des conquérants qui, si habiles fussent-ils au combat,
si terribles dans la répression, n’égalaient pas, venant même à envier la stature
de l’ennemi vaincu. Kubilay fut le premier prince mongol à gouverner la Chine
de Pékin, qu’il avait fait sa capitale. Après sa mort, l’empire mongol, qui
avait atteint son expansion maxima, commença à s’effriter. Des troubles suivis
de soulèvements achevèrent d’abattre la dynastie Yuan et personne ne la
regrettait :
Il est vrai que la richesse tant économique que
culturelle que représentait la Chine méridionale des Song suffisait à elle
seule pour s’imposer à des conquérants qui, si habiles fussent-ils au combat,
si terribles dans la répression, n’égalaient pas, venant même à envier la stature
de l’ennemi vaincu. Kubilay fut le premier prince mongol à gouverner la Chine
de Pékin, qu’il avait fait sa capitale. Après sa mort, l’empire mongol, qui
avait atteint son expansion maxima, commença à s’effriter. Des troubles suivis
de soulèvements achevèrent d’abattre la dynastie Yuan et personne ne la
regrettait :  savons que les Mongols traitaient ceux-ci comme une race
inférieure et poursuivaient une politique d’extermination plus encore que
d’exploitation. Deux documents sont parvenus jusqu’à nous qui en apportent la
preuve. Dans l’un de ces documents, c’est un ministre mongol qui conseille au
successeur de Gengis-Khan, le premier souverain de la Chine du nord :
"Tous ces Chinois ne peuvent nous servir à rien. Qu’on les chasse donc et
que le sol qu’ils cultivent soit mis en pâturages". Le second contient une
proposition faite par un autre ministre et tendant à ce que les membres des
cinq plus grandes familles de Chine soient arrêtés et exécutés. Ceci en vue de
supprimer toute chance de révolte de la part des Chinois, en les privant de
personnalités susceptibles de se mettre à la tête d’un mouvement de résistance.
savons que les Mongols traitaient ceux-ci comme une race
inférieure et poursuivaient une politique d’extermination plus encore que
d’exploitation. Deux documents sont parvenus jusqu’à nous qui en apportent la
preuve. Dans l’un de ces documents, c’est un ministre mongol qui conseille au
successeur de Gengis-Khan, le premier souverain de la Chine du nord :
"Tous ces Chinois ne peuvent nous servir à rien. Qu’on les chasse donc et
que le sol qu’ils cultivent soit mis en pâturages". Le second contient une
proposition faite par un autre ministre et tendant à ce que les membres des
cinq plus grandes familles de Chine soient arrêtés et exécutés. Ceci en vue de
supprimer toute chance de révolte de la part des Chinois, en les privant de
personnalités susceptibles de se mettre à la tête d’un mouvement de résistance. La plus marquante de toutes les institutions
mongoles fut la hiérarchie nouvelle des différentes classes de la société. Sous
l’administration chinoise, les lettrés confucéens venaient immédiatement après
les membres de la Cour, cependant que soldats, marchands et artisans étaient
l’objet d’un certain dédain. Sous les Mongols, au contraire, les confucéens -
en tant que dépositaires de la science et de l’ancienne culture chinoise -
furent ravalés au rang qui précédait immédiatement les mendiants. Les marchands
et les artisans, dont les professions avaient été négligées pendant des
siècles, connurent les faveurs de la Cour…» (Tsui Chi. Histoire de la Chine et de la
civilisation chinoise, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1949,
pp. 166-167 et 167-168).
La plus marquante de toutes les institutions
mongoles fut la hiérarchie nouvelle des différentes classes de la société. Sous
l’administration chinoise, les lettrés confucéens venaient immédiatement après
les membres de la Cour, cependant que soldats, marchands et artisans étaient
l’objet d’un certain dédain. Sous les Mongols, au contraire, les confucéens -
en tant que dépositaires de la science et de l’ancienne culture chinoise -
furent ravalés au rang qui précédait immédiatement les mendiants. Les marchands
et les artisans, dont les professions avaient été négligées pendant des
siècles, connurent les faveurs de la Cour…» (Tsui Chi. Histoire de la Chine et de la
civilisation chinoise, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1949,
pp. 166-167 et 167-168). la frontière viét-namienne
et demande à Thang-long le passage sur son territoire afin de tourner les Song
par le Sud. Thái-tông refuse avec hauteur : non seulement il retient
prisonniers les envoyés mongols, mais il envoie son neveu Quôc Tuân à la tête
d’une forte armée garder la frontière. Les Mongols se lancent en avant le long
des vallées du Sông Tháo et de la Rivière Claire, et bousculent les troupes
viétnamiennes qui doivent reculer jusqu’au Sông Thiên-mac. La capitale
abandonnée est mise à feu et à sang (décembre 1257). Bientôt les Mongols
accablés par le climat montrent des signes de lassitude. Thái-tông prend
l’offensive et les bat à Dông-bô-dâu. Ils refluent vers le Yun-nan après avoir
essuyé à Qui-bôa une attaque des milices locales» (Lê Thá Khôi. op. cit. p.
180). Kubilay ne négligea pas, une fois devenu empereur de Chine, de réclamer
l’hommage de ses vassaux de la péninsule indochinoise. Son regard conquérant se
tournait maintenant vers cette région, hanté par «la recherche de la route
des épices, l’établissement de relations maritimes avec le monde musulman de
l’Océan Indien et de la Méditerranée, et avec le Khanat mongol de Perse où
régnait depuis 1256 la maison de Hulègu. L’unification de l’Asie par la
conquête mongole rouvrait les grandes routes du commerce universel : la voie
transcontinentale, correspondant à l’antique Route de la Soie et du pèlerinage
bouddhique, qui, par le Pamir, unit la Chine à l’Iran et à l’Europe, fermée
depuis le XIe siècle par l’expansion des Turcs, et la voie maritime, suivie
également par des religieux, mais qui fut essentiellement la route des épices,
apportés par les navires arabes, indiens et malais aux ports de Chine
méridionale» (p. 181). On comprend que la Chine du Sud et son appanage
indochinois étaient la poule aux œufs d’or de l’empire Yuan. Le Champa et par
le fait même le Dai Viêt tombèrent sous la lorgnette des mongols. Une guerre de
conquête commença en 1284.
la frontière viét-namienne
et demande à Thang-long le passage sur son territoire afin de tourner les Song
par le Sud. Thái-tông refuse avec hauteur : non seulement il retient
prisonniers les envoyés mongols, mais il envoie son neveu Quôc Tuân à la tête
d’une forte armée garder la frontière. Les Mongols se lancent en avant le long
des vallées du Sông Tháo et de la Rivière Claire, et bousculent les troupes
viétnamiennes qui doivent reculer jusqu’au Sông Thiên-mac. La capitale
abandonnée est mise à feu et à sang (décembre 1257). Bientôt les Mongols
accablés par le climat montrent des signes de lassitude. Thái-tông prend
l’offensive et les bat à Dông-bô-dâu. Ils refluent vers le Yun-nan après avoir
essuyé à Qui-bôa une attaque des milices locales» (Lê Thá Khôi. op. cit. p.
180). Kubilay ne négligea pas, une fois devenu empereur de Chine, de réclamer
l’hommage de ses vassaux de la péninsule indochinoise. Son regard conquérant se
tournait maintenant vers cette région, hanté par «la recherche de la route
des épices, l’établissement de relations maritimes avec le monde musulman de
l’Océan Indien et de la Méditerranée, et avec le Khanat mongol de Perse où
régnait depuis 1256 la maison de Hulègu. L’unification de l’Asie par la
conquête mongole rouvrait les grandes routes du commerce universel : la voie
transcontinentale, correspondant à l’antique Route de la Soie et du pèlerinage
bouddhique, qui, par le Pamir, unit la Chine à l’Iran et à l’Europe, fermée
depuis le XIe siècle par l’expansion des Turcs, et la voie maritime, suivie
également par des religieux, mais qui fut essentiellement la route des épices,
apportés par les navires arabes, indiens et malais aux ports de Chine
méridionale» (p. 181). On comprend que la Chine du Sud et son appanage
indochinois étaient la poule aux œufs d’or de l’empire Yuan. Le Champa et par
le fait même le Dai Viêt tombèrent sous la lorgnette des mongols. Une guerre de
conquête commença en 1284. Il arriva au Viét Nam ce qu'on a vu qui était
arrivé en Corée. Les Mongols franchirent «la frontière à Lang-són, après un
nouveau refus du Dai Viêt de leur livrer passage. Successivement tombent les
postes de Kha lól, Nôi-bàet Chi-lang. Incapable de soutenir le choc de la
cavalerie mongole, Hung-dao abandonne la capitale où tous les documents
importants sont brûlés, et se replie sur Van-kiêp. Le riz des familles riches
est réquisitionné pour la troupe. Une proclamation du généralissime, affichée
dans tous les villages, ordonne à la population de lutter jusqu'à la mort
contre l'envahisseur, ou, si elle ne pouvait résister, de se réfugier dans les
forêts et les montagnes, sans jamais se rendre» (p. 183). Cette attitude
n'est pas sans rappeler celle qui prévaudra lors de la guerre du Viêt Nam au
milieu du XXe siècle.
Il arriva au Viét Nam ce qu'on a vu qui était
arrivé en Corée. Les Mongols franchirent «la frontière à Lang-són, après un
nouveau refus du Dai Viêt de leur livrer passage. Successivement tombent les
postes de Kha lól, Nôi-bàet Chi-lang. Incapable de soutenir le choc de la
cavalerie mongole, Hung-dao abandonne la capitale où tous les documents
importants sont brûlés, et se replie sur Van-kiêp. Le riz des familles riches
est réquisitionné pour la troupe. Une proclamation du généralissime, affichée
dans tous les villages, ordonne à la population de lutter jusqu'à la mort
contre l'envahisseur, ou, si elle ne pouvait résister, de se réfugier dans les
forêts et les montagnes, sans jamais se rendre» (p. 183). Cette attitude
n'est pas sans rappeler celle qui prévaudra lors de la guerre du Viêt Nam au
milieu du XXe siècle. Thánh-tông, qui ambitieux du trône, entretenait depuis longtemps une
correspondance secrète avec les Mongols, et reçut d'eux le titre d'An-nam quôc-vúóng.
Trân Kiên fut tué au passage de la frontière, Ich Tac et Lê Tac mourront en
Chine, après la défaite de leurs alliés. Les deux empereurs (Thânh-tông
Thúóng-hoàng et Nhân-tông) s'étaient transportés à Quang-yên. À la bouche
Tam-tri, leur jonque faillit être capturée par les Mongols. Grâce à un
stratagème, ils purent forcer le blocus et par mer gagner le Thanh-hóa. Malgré
la perte de presque tout le territoire et l'avance constante de l'ennemi, la
détermination de Húng-dao ne faiblit pas un jour. La population l'appuyait tout
entière et derrière les lignes s'organisait spontanément en groupes de
partisans qui harcelaient les unités mongoles. Dans ces circonstances
tragiques, la foi et la vaillance du peuple triomphèrent finalement de la
supériorité militaire des Mongols, et en dépit de la trahison d'une partie de
ses dirigeants»
(pp. 184-185).
Thánh-tông, qui ambitieux du trône, entretenait depuis longtemps une
correspondance secrète avec les Mongols, et reçut d'eux le titre d'An-nam quôc-vúóng.
Trân Kiên fut tué au passage de la frontière, Ich Tac et Lê Tac mourront en
Chine, après la défaite de leurs alliés. Les deux empereurs (Thânh-tông
Thúóng-hoàng et Nhân-tông) s'étaient transportés à Quang-yên. À la bouche
Tam-tri, leur jonque faillit être capturée par les Mongols. Grâce à un
stratagème, ils purent forcer le blocus et par mer gagner le Thanh-hóa. Malgré
la perte de presque tout le territoire et l'avance constante de l'ennemi, la
détermination de Húng-dao ne faiblit pas un jour. La population l'appuyait tout
entière et derrière les lignes s'organisait spontanément en groupes de
partisans qui harcelaient les unités mongoles. Dans ces circonstances
tragiques, la foi et la vaillance du peuple triomphèrent finalement de la
supériorité militaire des Mongols, et en dépit de la trahison d'une partie de
ses dirigeants»
(pp. 184-185).Cet épisode encouragea les Mongols à poursuivre les troupes du Đại Việt pensant que celle-ci n'était plus qu'un débris d'armée. Ainsi les deux armées arrivèrent-elles au champ de bataille préarrangé par les Vietnamiens. La flotte mongole s'engagea dans sa totalité, profitant de la largeur du fleuve. C'est à ce moment précis que des milliers de petites embarcations apparurent depuis les marais des 2 côtés, transpercèrent la première ligne de navires avant de briser complètement sa formation de combat initiale. La violence de l'affrontement fut telle que les Mongols regagnèrent la mer de façon désorganisée, jusqu'à ce que leurs navires s'empalèrent sur les pieux installés par les troupes du Đại Việt : la plupart se brisèrent et coulèrent sous le choc, les autres furent incendiés par les occupants des petites embarcations qui regagnaient aussitôt les marais. Les soutiens d'infanterie furent dans le même temps surprises et massacrées par les troupes du roi Trần et du général Trần Hưng Đạo. La flotte mongole fut entièrement détruite et Omar capturé. Au même moment, l'armée du Đại Việt, après d'incessantes attaques, mettait en pièces l'armée de Toghan en retraite qui traversait Lạng Sơn.
 Restait le Japon. Par deux fois, en 1268 et
1271, avant même la fin de la conquête de la Chine, les Mongols s'étaient
adressé à l'Empereur du Japon un ultimatum pour exiger sa soumission. Depuis
1200, le Japon était dirigé par la dynastie Hôjô avec qui le Bouddhisme zen
avait pris son élan dans l'ensemble de l'archipel. Le zen était une école de
stoïcisme militaire à l'usage des samuraï, la classe ou caste des
guerriers, notamment avec la secte des hokkashu, fondée par Nichiren
(1222-1280), sorte de mysticisme nationaliste galvanisant les énergies. Le
Japon était donc préparé à l'assaut des barbares tant au niveau spirituel qu'au
niveau militaire. Le régent Hôjô Takimune, outré d'un tel affront, avait rejeté
l'ultimatum de Khubilaï et Khubilaï fit comme avec la Corée, lança l'ordre
de débarquer sur l'archipel : «Jamais encore le Japon n'avait été exposé à
un tel danger. Il paraissait insensé de vouloir s'opposer aux invincibles
conquérants. Quoi! le petit Japon contre la grande Chine! le tout petit Japon
contre l'immense Empire! C'était dérisoire. Mais jamais le Japon n'avait été
conquis depuis qu'il existait, et jamais il ne le serait avant le XXe siècle et
la bombe atomique.
Restait le Japon. Par deux fois, en 1268 et
1271, avant même la fin de la conquête de la Chine, les Mongols s'étaient
adressé à l'Empereur du Japon un ultimatum pour exiger sa soumission. Depuis
1200, le Japon était dirigé par la dynastie Hôjô avec qui le Bouddhisme zen
avait pris son élan dans l'ensemble de l'archipel. Le zen était une école de
stoïcisme militaire à l'usage des samuraï, la classe ou caste des
guerriers, notamment avec la secte des hokkashu, fondée par Nichiren
(1222-1280), sorte de mysticisme nationaliste galvanisant les énergies. Le
Japon était donc préparé à l'assaut des barbares tant au niveau spirituel qu'au
niveau militaire. Le régent Hôjô Takimune, outré d'un tel affront, avait rejeté
l'ultimatum de Khubilaï et Khubilaï fit comme avec la Corée, lança l'ordre
de débarquer sur l'archipel : «Jamais encore le Japon n'avait été exposé à
un tel danger. Il paraissait insensé de vouloir s'opposer aux invincibles
conquérants. Quoi! le petit Japon contre la grande Chine! le tout petit Japon
contre l'immense Empire! C'était dérisoire. Mais jamais le Japon n'avait été
conquis depuis qu'il existait, et jamais il ne le serait avant le XXe siècle et
la bombe atomique.Le gouvernement militaire, qu'on nommait bakufu, s'alarma. Il fit renforcer les défenses dans le nord de l'île de Kyushu et mobiliser tous les samuraï. Pendant ce temps, Khubilaï préparait son expédition avec le soin que les Mongols prenaient avant toutes leurs campagnes, et concentrait sur la côte sud-est de la Corée une flotte de 150 navires coréens et chinois - de grands navires, d'un tonnage supérieur à celui des bateaux européens de ce temps-là -, et un corps expéditionnaire de quelque 30 000 hommes. Les marins, reprenant la tactique des armées terrestres, commencèrent par ravager les côtes des îles de Tsushima et d'Ikishima, puis débarquèrent leur contingent dans l'île de Kyushu, à la baie de Kakozaki (1274). N'attendaient-ils aucune résistance? Furent-ils surpris de la pugnacité des Japonais? De façon inexplicable, ils rembarquèrent dès la première nuit» (J.-P. Roux. Histoire de l'Empire mongol, Paris, Fayard, 1993, pp. 374-375).
 En 1276, Khubilaï Khan envoya une troisième missive
au bakufu qui répondit en faisant exécuter les ambassadeurs. Le
«miracle» de 1274, qui avait vu le corps expéditionnaire mongol repartir le
soir même de son arrivée, ne pouvait se répéter une seconde fois. Mais la
flotte nippone était prête et à la marine puissante s'était ajouté un long mur
sur les côtes septentrionales de Kyushu. Khubilaï attendit cinq ans, espérant venir
à bout de la conquête de la Chine avant de s'engager, avec une force plus
grande qu'en 1274, dans la conquête du Japon : «En 1281, le qahan fit partir
quelque 45 000 Mongols et 120 000 Sino-Coréens, une armée d'invasion équivalant
à celles que Gengis Khan avait mises en ligne contre la Chine ou contre
l'empire du Kharezm. Elle toucha terre en deux points de Kyushu pour prendre en
tenailles les forces nippones et elle était sur le point de vaincre quand, le
10 août, un typhon détruisit une partie de la flotte sino-coréenne au
mouillage. Craignant de se retrouver, même en cas de victoire, prisonniers de
leur conquête, les soldats rembarquèrent comme ils purent sur les rares bateaux
que la tempête avait épargnés. Le plus grand nombre (?) demeurèrent coincés sur
l'île et, sans ravitaillement, tombèrent sous les coups des Nippons ou durent
capituler. C'était un terrible désastre. Les Mongols se le tinrent pour dit.
Ils ne retournèrent plus au Japon» (p. 375).
En 1276, Khubilaï Khan envoya une troisième missive
au bakufu qui répondit en faisant exécuter les ambassadeurs. Le
«miracle» de 1274, qui avait vu le corps expéditionnaire mongol repartir le
soir même de son arrivée, ne pouvait se répéter une seconde fois. Mais la
flotte nippone était prête et à la marine puissante s'était ajouté un long mur
sur les côtes septentrionales de Kyushu. Khubilaï attendit cinq ans, espérant venir
à bout de la conquête de la Chine avant de s'engager, avec une force plus
grande qu'en 1274, dans la conquête du Japon : «En 1281, le qahan fit partir
quelque 45 000 Mongols et 120 000 Sino-Coréens, une armée d'invasion équivalant
à celles que Gengis Khan avait mises en ligne contre la Chine ou contre
l'empire du Kharezm. Elle toucha terre en deux points de Kyushu pour prendre en
tenailles les forces nippones et elle était sur le point de vaincre quand, le
10 août, un typhon détruisit une partie de la flotte sino-coréenne au
mouillage. Craignant de se retrouver, même en cas de victoire, prisonniers de
leur conquête, les soldats rembarquèrent comme ils purent sur les rares bateaux
que la tempête avait épargnés. Le plus grand nombre (?) demeurèrent coincés sur
l'île et, sans ravitaillement, tombèrent sous les coups des Nippons ou durent
capituler. C'était un terrible désastre. Les Mongols se le tinrent pour dit.
Ils ne retournèrent plus au Japon» (p. 375). S'il est vrai que le Ciel aida le bakufu à
vaincre par deux fois les troupes de débarquement mongoles, les combats furent
toutefois des plus sanglants. En 1274, tous les guerriers de Kyûshû s'étaient
portés à la défense de l'île, «sous les ordres du commandant de Dazaifu,
alors Shôni Tsunetsugu. Les mongols attaquèrent en rangs serrés et avec des
armes puissantes, arbalètes et machines de guerre, les Japonais habitués aux
combats singuliers et seulement armés d'arc, de lances et de sabres.
Heureusement pour le Japon ce n'était qu'une attaque surprise probablement
destinée à tester la force de résistance des armées japonaises» (L.
Frédéric. op. cit. pp. 184-185). «Dès que son approche fut connue, Tokimune
ordonna de lever les samuraï de Kyûshû et de l'ouest de Hondo, et en même temps
il envoya des troupes du Kantô; mais déjà les daimyô de Kyûshû, retranchés à
Hakozaki, opposaient une vigoureuse résistance aux assaillants; les armes à feu
des Mongols leur infligèrent des pertes sérieuses; mais ils étaient bien
supérieurs en nombre aux envahisseurs; ceux-ci perdirent leur général au cours
des combats; d'autre part le pilote annonça les signes avant-coureurs d'une
tempête; pour ne pas courir les risques d'un engagement de nuit, où les
Japonais auraient retrouvé tout l'avantage, et pour fuir le mauvais temps, les
attaquants se rembarquèrent le soir même et la flotte sortit de la baie; un
navire chargé de troupes, s'échoua sur la pointe de Shiga : les hommes furent
capturés et mis à mort» (R. Bersihand. op. cit. p. 122).
S'il est vrai que le Ciel aida le bakufu à
vaincre par deux fois les troupes de débarquement mongoles, les combats furent
toutefois des plus sanglants. En 1274, tous les guerriers de Kyûshû s'étaient
portés à la défense de l'île, «sous les ordres du commandant de Dazaifu,
alors Shôni Tsunetsugu. Les mongols attaquèrent en rangs serrés et avec des
armes puissantes, arbalètes et machines de guerre, les Japonais habitués aux
combats singuliers et seulement armés d'arc, de lances et de sabres.
Heureusement pour le Japon ce n'était qu'une attaque surprise probablement
destinée à tester la force de résistance des armées japonaises» (L.
Frédéric. op. cit. pp. 184-185). «Dès que son approche fut connue, Tokimune
ordonna de lever les samuraï de Kyûshû et de l'ouest de Hondo, et en même temps
il envoya des troupes du Kantô; mais déjà les daimyô de Kyûshû, retranchés à
Hakozaki, opposaient une vigoureuse résistance aux assaillants; les armes à feu
des Mongols leur infligèrent des pertes sérieuses; mais ils étaient bien
supérieurs en nombre aux envahisseurs; ceux-ci perdirent leur général au cours
des combats; d'autre part le pilote annonça les signes avant-coureurs d'une
tempête; pour ne pas courir les risques d'un engagement de nuit, où les
Japonais auraient retrouvé tout l'avantage, et pour fuir le mauvais temps, les
attaquants se rembarquèrent le soir même et la flotte sortit de la baie; un
navire chargé de troupes, s'échoua sur la pointe de Shiga : les hommes furent
capturés et mis à mort» (R. Bersihand. op. cit. p. 122). Il en va de même pour la tentative de 1281, le
typhon ne vint que balayer ce qui restait après des semaines de combats à
l'issue incertaine : «En août 1281, une flotte de 40 000 Coréens s'empara de
l'île d'Iki et débarqua sur le promontoire de Shiga qui protège la baie de
Hakata, tandis qu'une flotte chinoise, forte de 100 000 hommes, débarquait plus
au sud, à Hirado. Les combats furent acharnés sur terre comme sur mer et
durèrent sept semaines pendant lesquelles les assaillants furent contenus.
C'est alors que providentiellement un typhon intervint qui détruisit plus de la
moitié de la flotte ennemie. Les Mongols demeurés à terre furent tués ou faits
prisonniers. La victoire restait au Japon, grâce à la valeur de ses soldats et
à l'aide miraculeuse du Kamikaze (Vent divin)» (L. Frédéric. op.
cit. p. 185). «Au mois de juin 1281, une flotte de mille navires, construits
en Corée, appareilla de Masampo, sur la côte sud de la presqu'île, transportant
cinquante mille Mongols et vingt mille Coréens; elle prit Tsushima au passage,
ravagea Ikishima, et atterrit en divers points de la côte du Chikuzen, entre
Munakata au nord et la baie de Hakozaki au sud : les jonques avançaient dans la
baie liées entre elles par des chaînes; elle fut bientôt rejointe par une force
de plus de trois mille navires - ce nombre comprenant sans doute les
embarcations des grosses jonques - qui, partie de Chinchew (le Zaiton de
Marco-Polo) sur la côte du Fukien, en face de Formose, amenait un corps de cent
mille Chinois : elle prit Hirado et débarqua ses troupes sur la côte nord du
Hizen. Les défenseurs s'étaient fortement retranchés derrière les
fortifications de pierre édifiées tout autour de la baie de Hakozaki, et ils
s'y accrochaient solidement malgré l'artillerie des Mongols; dans
Il en va de même pour la tentative de 1281, le
typhon ne vint que balayer ce qui restait après des semaines de combats à
l'issue incertaine : «En août 1281, une flotte de 40 000 Coréens s'empara de
l'île d'Iki et débarqua sur le promontoire de Shiga qui protège la baie de
Hakata, tandis qu'une flotte chinoise, forte de 100 000 hommes, débarquait plus
au sud, à Hirado. Les combats furent acharnés sur terre comme sur mer et
durèrent sept semaines pendant lesquelles les assaillants furent contenus.
C'est alors que providentiellement un typhon intervint qui détruisit plus de la
moitié de la flotte ennemie. Les Mongols demeurés à terre furent tués ou faits
prisonniers. La victoire restait au Japon, grâce à la valeur de ses soldats et
à l'aide miraculeuse du Kamikaze (Vent divin)» (L. Frédéric. op.
cit. p. 185). «Au mois de juin 1281, une flotte de mille navires, construits
en Corée, appareilla de Masampo, sur la côte sud de la presqu'île, transportant
cinquante mille Mongols et vingt mille Coréens; elle prit Tsushima au passage,
ravagea Ikishima, et atterrit en divers points de la côte du Chikuzen, entre
Munakata au nord et la baie de Hakozaki au sud : les jonques avançaient dans la
baie liées entre elles par des chaînes; elle fut bientôt rejointe par une force
de plus de trois mille navires - ce nombre comprenant sans doute les
embarcations des grosses jonques - qui, partie de Chinchew (le Zaiton de
Marco-Polo) sur la côte du Fukien, en face de Formose, amenait un corps de cent
mille Chinois : elle prit Hirado et débarqua ses troupes sur la côte nord du
Hizen. Les défenseurs s'étaient fortement retranchés derrière les
fortifications de pierre édifiées tout autour de la baie de Hakozaki, et ils
s'y accrochaient solidement malgré l'artillerie des Mongols; dans  le Hizen, ils
résistaient à l'avance des troupes chinoises qui cherchaient à les tourner. Les
Japonais tinrent ainsi les assaillants en échec, en dépit de grosses pertes,
pendant plusieurs semaines, et l'issue de la lutte restait indécise; le pays
tout entier vivait dans la terreur et l'angoisse; Tokimune envoyait des
renforts; les Japonais se battaient avec acharnement, les vents leur vinrent en
aide : le 14 août un violent typhon se leva et l'ennemi se rembarqua en hâte;
la flotte fut dispersée, une grande partie fut engloutie ou fit naufrage, des
milliers d'hommes périrent; un certain nombre de survivants - des Chinois
vraisemblablement - se réfugièrent dans l'île de Takashima, à l'entrée du golfe
d'Imari, où Shôni Kagesuke vint les attaquer : il en tua la plupart, un millier
de prisonniers furent ramenés à Hakata et mis à mort, à l'exception de trois
qui furent épargnés pour porter en Chine la nouvelle du désastre» (R.
Bersihand. op. cit. pp. 123-124).
le Hizen, ils
résistaient à l'avance des troupes chinoises qui cherchaient à les tourner. Les
Japonais tinrent ainsi les assaillants en échec, en dépit de grosses pertes,
pendant plusieurs semaines, et l'issue de la lutte restait indécise; le pays
tout entier vivait dans la terreur et l'angoisse; Tokimune envoyait des
renforts; les Japonais se battaient avec acharnement, les vents leur vinrent en
aide : le 14 août un violent typhon se leva et l'ennemi se rembarqua en hâte;
la flotte fut dispersée, une grande partie fut engloutie ou fit naufrage, des
milliers d'hommes périrent; un certain nombre de survivants - des Chinois
vraisemblablement - se réfugièrent dans l'île de Takashima, à l'entrée du golfe
d'Imari, où Shôni Kagesuke vint les attaquer : il en tua la plupart, un millier
de prisonniers furent ramenés à Hakata et mis à mort, à l'exception de trois
qui furent épargnés pour porter en Chine la nouvelle du désastre» (R.
Bersihand. op. cit. pp. 123-124).L'insistance apportée, même parmi les historiens occidentaux du Japon, sur le rôle du Kamikaze indique la forte impression que la répétition des typhons au cours des deux principaux aussauts des envahisseurs était liée aux origines mêmes du pays et du peuple japonais; comment les éléments naturels, telluriques ou maritimes, veillaient, protègeaient l'archipel d'une manière invincible contre les convoitises étrangères. Plus que jamais, les Japonais en tirèrent sans doute un sentiment de sécurité qui leur permis, à certains moments de leur histoire, de se montrer audacieux et agressifs, mais jamais le trauma subit par les invasions ne fut totalement dissipé. Si le Japon ne répondit pas immédiatement à ce repli sur soi qui sera sa politique pendant près de trois siècles, il brava ses propres réticences que bien des générations plus tard.
 pour les autres
pays, une menace angoissante de vie et de mort. Les récits des atrocités
guerrières mongoles se diffusèrent de l'Arabie, de l'Iran et de la Russie
jusqu'au Japon. Chaque population trembla devant l'approche des cavaliers
mongols et chaque pays qui, l'un après l'autre, tombait sous la férule de
Genghis Khan et de ses héritiers nombreux ajoutait à la liste des atrocités. La
rétrogradation des Chinois des classes élevées et lettrées dans la lie de la
société était l'atteinte au pouvoir social sans doute, mais aussi au narcissisme
national. Désormais, les Chinois étaient des sous-hommes devant les dirigeants
mongols dont la grossièreté et la brutalité n'échappèrent pas au commun des
mortels. Les destructions d' archives en Corée et au Viêt Nam montraient le
mépris que les nouveaux maîtres éprouvaient pour les ancêtres, si important
dans la vision confucéenne du monde. Enfin, le Japon trembla au moins à deux
reprises devant la force des troupes mongoles transportées à même des navires
coréens qu'ils apprirent à refouler avec leur propre flotte, ce qui devait enraciner une haine raciale profonde parmi le peuple
nippon pour leur proche voisin côtier. Toute une économie psychique de haines et
de répulsions s'installa dans l'ensemble de la Civilisation extrême-orientale.
Et la première, sinon la plus importante : la réaction à l'illusion qu'avait
entraînée l'élévation de la Grande Muraille.
pour les autres
pays, une menace angoissante de vie et de mort. Les récits des atrocités
guerrières mongoles se diffusèrent de l'Arabie, de l'Iran et de la Russie
jusqu'au Japon. Chaque population trembla devant l'approche des cavaliers
mongols et chaque pays qui, l'un après l'autre, tombait sous la férule de
Genghis Khan et de ses héritiers nombreux ajoutait à la liste des atrocités. La
rétrogradation des Chinois des classes élevées et lettrées dans la lie de la
société était l'atteinte au pouvoir social sans doute, mais aussi au narcissisme
national. Désormais, les Chinois étaient des sous-hommes devant les dirigeants
mongols dont la grossièreté et la brutalité n'échappèrent pas au commun des
mortels. Les destructions d' archives en Corée et au Viêt Nam montraient le
mépris que les nouveaux maîtres éprouvaient pour les ancêtres, si important
dans la vision confucéenne du monde. Enfin, le Japon trembla au moins à deux
reprises devant la force des troupes mongoles transportées à même des navires
coréens qu'ils apprirent à refouler avec leur propre flotte, ce qui devait enraciner une haine raciale profonde parmi le peuple
nippon pour leur proche voisin côtier. Toute une économie psychique de haines et
de répulsions s'installa dans l'ensemble de la Civilisation extrême-orientale.
Et la première, sinon la plus importante : la réaction à l'illusion qu'avait
entraînée l'élévation de la Grande Muraille. nouvelle
dynastie venait du Sud et malgré ses vacillements, elle affronta la reconquête
de la Chine du Nord devant la menace éternelle du retour du retour des barbares :
«Après avoir mis promptement à la porte les Mongols, précédents maîtres
des lieux, [Hongwu] semble avoir été pris de vertige devant les espaces du Nord, sans
vouloir franchement s'y engager. Le monde intermédiaire entre la Chine et la
Mongolie ne comportant pas de limite bien établie, mis à part les tracés ou
élévations tentés en vain depuis des siècles par les monarques antérieurs,
Hongwu se mit à chercher à son tour une frontière. Il n'avait pas, comme les
Tang, d'affinités barbares et n'osa pas une stratégie carrément offensive. En
implantant une ligne de huit forteresses, il posa les premiers jalons de la
muraille qui apparaîtra un siècle et demi plus tard. Les bastions et tours à
signaux, récupérés des ruines abandonnées par les Yuan ou sortis de terre,
soutenaient des unités mobiles qui opéraient très en avant contre les Mongols.
De telles constructions restaient modestes, dérisoires remparts en terre battue
dont se moquait le temps» (Jan. op.
cit. pp. 96-97). Peut-être que les forteresses sont dérisoires, mais elles sont quand même garantes d'un
minimum de sécurité. La fragilité de la civilisation repose sur la rapidité de
l'organisation de la défense. On ne pense plus en termes d'agressivité, comme
l'empereur Qin, mais en termes de résistance. Un renversement de sens pointe à travers
la réaction Ming. Le sentiment antique de sécurité cède au sentiment de
l'angoisse et à la solution idéologique du repli sur soi :
nouvelle
dynastie venait du Sud et malgré ses vacillements, elle affronta la reconquête
de la Chine du Nord devant la menace éternelle du retour du retour des barbares :
«Après avoir mis promptement à la porte les Mongols, précédents maîtres
des lieux, [Hongwu] semble avoir été pris de vertige devant les espaces du Nord, sans
vouloir franchement s'y engager. Le monde intermédiaire entre la Chine et la
Mongolie ne comportant pas de limite bien établie, mis à part les tracés ou
élévations tentés en vain depuis des siècles par les monarques antérieurs,
Hongwu se mit à chercher à son tour une frontière. Il n'avait pas, comme les
Tang, d'affinités barbares et n'osa pas une stratégie carrément offensive. En
implantant une ligne de huit forteresses, il posa les premiers jalons de la
muraille qui apparaîtra un siècle et demi plus tard. Les bastions et tours à
signaux, récupérés des ruines abandonnées par les Yuan ou sortis de terre,
soutenaient des unités mobiles qui opéraient très en avant contre les Mongols.
De telles constructions restaient modestes, dérisoires remparts en terre battue
dont se moquait le temps» (Jan. op.
cit. pp. 96-97). Peut-être que les forteresses sont dérisoires, mais elles sont quand même garantes d'un
minimum de sécurité. La fragilité de la civilisation repose sur la rapidité de
l'organisation de la défense. On ne pense plus en termes d'agressivité, comme
l'empereur Qin, mais en termes de résistance. Un renversement de sens pointe à travers
la réaction Ming. Le sentiment antique de sécurité cède au sentiment de
l'angoisse et à la solution idéologique du repli sur soi : «Deux
fortins, bornes des extrêmes, apparurent à cette époque. À l'ouest, à l'entrée
du désert, l'antique porte de Jade des Han fut délaissée en 1372 au profit de
Jiayuguan, à trois cents kilomètres plus à l'est. L'étroit passage qui ouvre la
voie vers l'Asie centrale avait été emprunté par les colonnes chinoises lancées
à la conquête du Turkestan. L'espace minéral est cerné de crêtes dénudées aux
pentes creusées de ravines. Rien n'a bougé depuis des siècles qui ont glissé
sans laisser de trace, comme les rares nuages venus du lointain Pacifique.
Complices d'un véritable guet-apens qui fait passer de l'étonnement à
l'angoisse, le vide et le silence ne manquaient pas d'étreindre le cœur des hommes et des femmes en
marche vers les terres d’exil, "où nul peuplier ne pousse, où ne souffle
jamais aucun vent printanier". Combien survécurent pour voir le jour tant
espéré du retour "à l’intérieur de la Muraille", tout en gardant
gravée dans leur mémoire une phrase d’adieu chargée d’éternité? […]
«Deux
fortins, bornes des extrêmes, apparurent à cette époque. À l'ouest, à l'entrée
du désert, l'antique porte de Jade des Han fut délaissée en 1372 au profit de
Jiayuguan, à trois cents kilomètres plus à l'est. L'étroit passage qui ouvre la
voie vers l'Asie centrale avait été emprunté par les colonnes chinoises lancées
à la conquête du Turkestan. L'espace minéral est cerné de crêtes dénudées aux
pentes creusées de ravines. Rien n'a bougé depuis des siècles qui ont glissé
sans laisser de trace, comme les rares nuages venus du lointain Pacifique.
Complices d'un véritable guet-apens qui fait passer de l'étonnement à
l'angoisse, le vide et le silence ne manquaient pas d'étreindre le cœur des hommes et des femmes en
marche vers les terres d’exil, "où nul peuplier ne pousse, où ne souffle
jamais aucun vent printanier". Combien survécurent pour voir le jour tant
espéré du retour "à l’intérieur de la Muraille", tout en gardant
gravée dans leur mémoire une phrase d’adieu chargée d’éternité? […] À l’autre extrémité orientale, "au flanc
de la montagne, inclinée vers la mer", la "passe des Ormes"
(Yuguan) ouvre la voie vers les grandes étendues du Nord-Est. De tout temps il
a fallu contenir les peuples nomades ou sédentaires, Nuzhen, Toungous ou autres
Mandchous, tentés par les richesses des plaines méridionales. "On frappe
les gongs, on bat le tambour dans la passe des ormes; et les bannières
serpentent à travers le mont de la Pierre levée". Un peu au nord de ce
passage, mais toujours sur la plaine littorale, Hongwu fit construire un autre
fortin de terre, première empreinte de Shanjaogiant, la passe entre la Montagne
et la Mer» (pp. 97-98).
À l’autre extrémité orientale, "au flanc
de la montagne, inclinée vers la mer", la "passe des Ormes"
(Yuguan) ouvre la voie vers les grandes étendues du Nord-Est. De tout temps il
a fallu contenir les peuples nomades ou sédentaires, Nuzhen, Toungous ou autres
Mandchous, tentés par les richesses des plaines méridionales. "On frappe
les gongs, on bat le tambour dans la passe des ormes; et les bannières
serpentent à travers le mont de la Pierre levée". Un peu au nord de ce
passage, mais toujours sur la plaine littorale, Hongwu fit construire un autre
fortin de terre, première empreinte de Shanjaogiant, la passe entre la Montagne
et la Mer» (pp. 97-98). autour de Pékin où avait
été transférée la capitale. Il voulait repousser définitivement les Mongols et
mena lui-même cinq expéditions jusqu’au cœur de la Mongolie. Mais peu après,
pour des raisons que les historiens ne s’expliquent pas clairement, plusieurs
garnisons avancées, basses géographiques d’une stratégie de la steppe, furent
abandonnées. Dès lors, les Mongols pouvaient prendre le contrôle des marches et
avaient accès à l’Ordros. Ainsi se trouvaient rassemblés les éléments d’un
drame en plusieurs actes conduisant à un dénouement tragique : la capitale, les
défenses les plus spectaculaires de la Muraille, esquissées sommairement dès
1368 par Hongwu, et les montagnes de Yan, antichambre des espaces barbares» (pp. 98-99).
C’est le même Yongle qui choisit le superbe site d’une vallée au nord de Pékin
pour y déposer les sépultures impériales et de là, ériger la célèbre Cité
interdite. «Les
tumulus entourés de murs et noyés dans les pins sont adossés à la montagne, non
loin de la Muraille, qui les défend contre le déferlement des hordes» (p. 99). Jamais,
durant les trois siècles que dura la dynastie Ming, ne cessa cette soif d’ériger
des murailles devant les retours épisodiques des menaces d’invasions, mais également une sorte de stupeur des bureaucrates célestes qui prenait la population par surprise . Une
nouvelle ère de relations du Moi extrême-oriental avec l’Autre commençait.
autour de Pékin où avait
été transférée la capitale. Il voulait repousser définitivement les Mongols et
mena lui-même cinq expéditions jusqu’au cœur de la Mongolie. Mais peu après,
pour des raisons que les historiens ne s’expliquent pas clairement, plusieurs
garnisons avancées, basses géographiques d’une stratégie de la steppe, furent
abandonnées. Dès lors, les Mongols pouvaient prendre le contrôle des marches et
avaient accès à l’Ordros. Ainsi se trouvaient rassemblés les éléments d’un
drame en plusieurs actes conduisant à un dénouement tragique : la capitale, les
défenses les plus spectaculaires de la Muraille, esquissées sommairement dès
1368 par Hongwu, et les montagnes de Yan, antichambre des espaces barbares» (pp. 98-99).
C’est le même Yongle qui choisit le superbe site d’une vallée au nord de Pékin
pour y déposer les sépultures impériales et de là, ériger la célèbre Cité
interdite. «Les
tumulus entourés de murs et noyés dans les pins sont adossés à la montagne, non
loin de la Muraille, qui les défend contre le déferlement des hordes» (p. 99). Jamais,
durant les trois siècles que dura la dynastie Ming, ne cessa cette soif d’ériger
des murailles devant les retours épisodiques des menaces d’invasions, mais également une sorte de stupeur des bureaucrates célestes qui prenait la population par surprise . Une
nouvelle ère de relations du Moi extrême-oriental avec l’Autre commençait. |
| Empereur Ming Yingzong |
 constructions révélaient des concepts et des techniques relevant d’une
nouvelle architecture des murailles. Ainsi, à partir de 1572, dans la région de
Datong, remplaçant la terre battue, briques et pierres commencèrent à être
utilisées systématiquement pour monter murs, tours et autres bastions.
constructions révélaient des concepts et des techniques relevant d’une
nouvelle architecture des murailles. Ainsi, à partir de 1572, dans la région de
Datong, remplaçant la terre battue, briques et pierres commencèrent à être
utilisées systématiquement pour monter murs, tours et autres bastions.  La ligne de défense au nord de la capitale,
construite surtout durant la seconde moitié du XVIe siècle, est restée la plus
spectaculaire et la plus achevée. Tours de garde et de guet, murs crénelés
percés de meurtrières, escaliers et bastions protégeant les portes
s’inscrivaient désormais dans le paysage, suivaient les crêtes ou barraient les
passes. Les principales citadelles, aux points stratégiques, qui frappent
encore les imaginations, conféraient à l’ensemble une fausse impression
d’invulnérabilité et de continuité. Bien qu’ils ne soient qu’aux deux
extrémités de la ligne de fortifications et près de la capitale, ces sites
depuis peu restaurés suffisent à donner l’illusion qu’il existe réellement une
muraille de dix mille lis et qu’ils résument son histoire» (p. 107).
La ligne de défense au nord de la capitale,
construite surtout durant la seconde moitié du XVIe siècle, est restée la plus
spectaculaire et la plus achevée. Tours de garde et de guet, murs crénelés
percés de meurtrières, escaliers et bastions protégeant les portes
s’inscrivaient désormais dans le paysage, suivaient les crêtes ou barraient les
passes. Les principales citadelles, aux points stratégiques, qui frappent
encore les imaginations, conféraient à l’ensemble une fausse impression
d’invulnérabilité et de continuité. Bien qu’ils ne soient qu’aux deux
extrémités de la ligne de fortifications et près de la capitale, ces sites
depuis peu restaurés suffisent à donner l’illusion qu’il existe réellement une
muraille de dix mille lis et qu’ils résument son histoire» (p. 107). Enserrer la Chine sur elle-même, comme son
Empereur dans la Cité interdite, devenait un réflexe lié au trauma des invasions
mongoles puisque sans précédant auparavant. Le temps était revenu de rançonné ses voisins. Le Viêt Nam fit sa soumission à la dynastie Ming. En Corée, la dynastie de
Koryŏ qui avait servi de fantoche tout au long de l’occupation mongole, crut,
elle aussi, qu’en se ralliant aux Ming, elle retrouverait son indépendance.
Comme il restait des partisans mongols à la Cour, le roi Kongmin fut assassiné
par Yi In-nim, eunuque du palais et chef d’un clan puissant de l’élite qui fit
tué un émissaire des Ming. Quand les derniers Yuan demandèrent à la Corée
d’attaquer la Chine, la politique d’appui changea soudainement et, pour faire
oublier leur maladresse, le roi de Corée paya aux Ming un tribut de 5 000
chevaux, 500 livres d’or, 500 onces d’argent et 50 000 pièces de tissu (A.
Fabre. op. cit. p. 201). La Chine retrouvait ses États satellites d’antan.
Enserrer la Chine sur elle-même, comme son
Empereur dans la Cité interdite, devenait un réflexe lié au trauma des invasions
mongoles puisque sans précédant auparavant. Le temps était revenu de rançonné ses voisins. Le Viêt Nam fit sa soumission à la dynastie Ming. En Corée, la dynastie de
Koryŏ qui avait servi de fantoche tout au long de l’occupation mongole, crut,
elle aussi, qu’en se ralliant aux Ming, elle retrouverait son indépendance.
Comme il restait des partisans mongols à la Cour, le roi Kongmin fut assassiné
par Yi In-nim, eunuque du palais et chef d’un clan puissant de l’élite qui fit
tué un émissaire des Ming. Quand les derniers Yuan demandèrent à la Corée
d’attaquer la Chine, la politique d’appui changea soudainement et, pour faire
oublier leur maladresse, le roi de Corée paya aux Ming un tribut de 5 000
chevaux, 500 livres d’or, 500 onces d’argent et 50 000 pièces de tissu (A.
Fabre. op. cit. p. 201). La Chine retrouvait ses États satellites d’antan. |
| Bouddha de bronze en position méditation de 13 mètres de haut XIII° siècle |
 C’est alors que parut un homme à poigne,
Go-Daigo (1288-1339), qui monta sur le trône en 1318. Doté d'une ambition démesurée - il voulait être l'égal de l'empereur de Chine -, mais la société japonaise reste sur sa faim depuis le lendamin du reflux mongol. Des réformes impatientes, des litiges sur la propriété de terres, des récompenses, et l'exclusion des samouraïs de la politique causent beaucoup de mécontentement, et son organisation politique commence à tomber en morceaux. S'engage un combat contre Takauji Ashikaga que le bakufu à envoyer pour raisonner Go-Daigo. La défaite de la dynastie Kamakura devant le pouvoir militaire allaît être la première esquisse
du fameux combat qui allait mener l’Empereur à se retrouver enfermé dans la
capitale, Edo, alors que le nouveau shogunat de Muromachi s’installera à Kyöto
:
C’est alors que parut un homme à poigne,
Go-Daigo (1288-1339), qui monta sur le trône en 1318. Doté d'une ambition démesurée - il voulait être l'égal de l'empereur de Chine -, mais la société japonaise reste sur sa faim depuis le lendamin du reflux mongol. Des réformes impatientes, des litiges sur la propriété de terres, des récompenses, et l'exclusion des samouraïs de la politique causent beaucoup de mécontentement, et son organisation politique commence à tomber en morceaux. S'engage un combat contre Takauji Ashikaga que le bakufu à envoyer pour raisonner Go-Daigo. La défaite de la dynastie Kamakura devant le pouvoir militaire allaît être la première esquisse
du fameux combat qui allait mener l’Empereur à se retrouver enfermé dans la
capitale, Edo, alors que le nouveau shogunat de Muromachi s’installera à Kyöto
: milieu des guerres et des atrocités une culture raffinée, brillante
avec une pointe d’austérité et empreinte de sérénité philosophique : œil du
typhon, noyau central à l’abri des combats, elle naquit, comme celle de Heian,
de la retraite d’une société vers laquelle convergeaient les richesses. Ce
monde était celui du shôgun et non plus celui de la Cour; intimiste, hors du
siècle et de ses agitations aussi cruelles que vaines, il s’en dégagea
néanmoins une pensée générale et des conceptions particulières d’esthétique qui
devaient marquer à tout jamais le Japon. Ce ne fut pas le seul paradoxe de
cette époque étrange : la puissance des Ashikaga, seuls maîtres effectifs du
pays, se révéla dès l’origine toute relative. Le seul jeu politique que
pouvaient pratiquer les Ashikaga consistait à présider aux alliances
incertaines et mouvantes des maisons militaires; de leur équilibre plus ou
moins heureux dépendait une paix précaire» (p. 93).
milieu des guerres et des atrocités une culture raffinée, brillante
avec une pointe d’austérité et empreinte de sérénité philosophique : œil du
typhon, noyau central à l’abri des combats, elle naquit, comme celle de Heian,
de la retraite d’une société vers laquelle convergeaient les richesses. Ce
monde était celui du shôgun et non plus celui de la Cour; intimiste, hors du
siècle et de ses agitations aussi cruelles que vaines, il s’en dégagea
néanmoins une pensée générale et des conceptions particulières d’esthétique qui
devaient marquer à tout jamais le Japon. Ce ne fut pas le seul paradoxe de
cette époque étrange : la puissance des Ashikaga, seuls maîtres effectifs du
pays, se révéla dès l’origine toute relative. Le seul jeu politique que
pouvaient pratiquer les Ashikaga consistait à présider aux alliances
incertaines et mouvantes des maisons militaires; de leur équilibre plus ou
moins heureux dépendait une paix précaire» (p. 93). inquiétant, dangereux. L’histoire chinoise garde en effet un pénible
souvenir des terribles wakô, les pirates japonais qui, pendant presque
deux siècles, écumèrent les côtes du continent. Il est vraisemblable, en fait,
que la fameuse "piraterie" japonaise ne fut à l’origine qu’une
manière un peu brutale de pousser au commerce et à ses profits des pays qui,
comme la Chine ou la Corée de l’époque, avaient tendance à vivre repliés sur
eux-mêmes dans le mépris de l’étranger et des marchands décriés par les
intellectuels. Il ne s’en développa pas moins une forme de banditisme qui fut
la cause de graves difficultés entre le jeune gouvernement Muromachi et
l’empire du Milieu. Malgré leur réel manque d’emprise sur tous ces éléments
incontrôlés, les Ashikaga parvinrent pourtant à établir avec la Chine des Yuan,
puis celle des Ming des échanges extrêmement fructueux pour le Japon» (pp.
97-99). Si les conflits dynastiques intérieurs ou la lutte entre
l’Empereur et le shogunat semblaient poursuivre
inquiétant, dangereux. L’histoire chinoise garde en effet un pénible
souvenir des terribles wakô, les pirates japonais qui, pendant presque
deux siècles, écumèrent les côtes du continent. Il est vraisemblable, en fait,
que la fameuse "piraterie" japonaise ne fut à l’origine qu’une
manière un peu brutale de pousser au commerce et à ses profits des pays qui,
comme la Chine ou la Corée de l’époque, avaient tendance à vivre repliés sur
eux-mêmes dans le mépris de l’étranger et des marchands décriés par les
intellectuels. Il ne s’en développa pas moins une forme de banditisme qui fut
la cause de graves difficultés entre le jeune gouvernement Muromachi et
l’empire du Milieu. Malgré leur réel manque d’emprise sur tous ces éléments
incontrôlés, les Ashikaga parvinrent pourtant à établir avec la Chine des Yuan,
puis celle des Ming des échanges extrêmement fructueux pour le Japon» (pp.
97-99). Si les conflits dynastiques intérieurs ou la lutte entre
l’Empereur et le shogunat semblaient poursuivre  les rivalités habituelles dans
les sociétés féodales, l’irruption d’étrangers inconnus suscita désormais une
crainte qui, de part et d’autre de la Mer Jaune, devait s’exprimer
différemment. La Mer Jaune, pas plus que la Grande Muraille, n'était infranchissable. On verra ainsi, au cours des prochains siècles, le Japon réagir
avec une destrudo de nature sadique, se projeter lui-même vers les
éléments menaçants tout en se repliant sur son quant à soi, dans son archipel.
Repliées également la Chine et la Corée, mais dans une attitude attentiste,
passive, soumise aux aléas de la fatalité du Ciel. Les invasions barbares qui
jetèrent la dynastie Ming au ruisseau pour lui substituer une nouvelle dynastie
étrangère en 1644 allait s’accompagner de signes d’humiliations (la toque des hommes,
le bandage des pieds chez les femmes) confinant au masochisme. À sa façon,
chaque peuple allait exprimer une réaction née du traumatisme de la conquête
mongole et de ses blessures psychologiques et sociales. C’est l’irruption des
voyageurs occidentaux qui allaient finir de galvaniser ces destrudos qui
marquent la négativité de la Civilisation extrême-orientale.
les rivalités habituelles dans
les sociétés féodales, l’irruption d’étrangers inconnus suscita désormais une
crainte qui, de part et d’autre de la Mer Jaune, devait s’exprimer
différemment. La Mer Jaune, pas plus que la Grande Muraille, n'était infranchissable. On verra ainsi, au cours des prochains siècles, le Japon réagir
avec une destrudo de nature sadique, se projeter lui-même vers les
éléments menaçants tout en se repliant sur son quant à soi, dans son archipel.
Repliées également la Chine et la Corée, mais dans une attitude attentiste,
passive, soumise aux aléas de la fatalité du Ciel. Les invasions barbares qui
jetèrent la dynastie Ming au ruisseau pour lui substituer une nouvelle dynastie
étrangère en 1644 allait s’accompagner de signes d’humiliations (la toque des hommes,
le bandage des pieds chez les femmes) confinant au masochisme. À sa façon,
chaque peuple allait exprimer une réaction née du traumatisme de la conquête
mongole et de ses blessures psychologiques et sociales. C’est l’irruption des
voyageurs occidentaux qui allaient finir de galvaniser ces destrudos qui
marquent la négativité de la Civilisation extrême-orientale. civilisations. Pour que la périodisation
temporelle prenne une importance au niveau de la représentation sociale, il lui
faut au moins deux choses : qu'elle marque une rupture dans le temps afin
d'indiquer un avant et un après; qu'elle serve également de trait d'union d'une
période à une autre afin de maintenir le sens de l'unité de temps. C'est un
problème qui a heurté les historiens occidentaux de la Chine. Par exemple,
l'historien Eberhard situe ainsi le passage de la Chine à la modernité : «Mais
de même qu'il est difficile de dire à quel moment précis la Chine a passé de
l'Antiquité au Moyen Âge, il est difficile d'assigner une date exacte au
passage du Moyen Âge aux Temps Modernes. Ce passage s'est effectué au cours de
la période de domination moongole et cette période doit pour cela être
considérée comme une période de transition» W. Eberhard. Histoire de la
Chine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, p. 239). Pour sa
part, Jacques Gernet la situe, sans l'expliquer, avec l'accession de la
dynastie mandchoue à la tête de l'Empire du Milieu (1644). D'autres la font
remonter jusqu'à l'époque Song (1280). D'aucuns, seulement lors de la
proclamation de la République, en 1911. Comme on le voit, l'imprécision désigne
bien l'incapacité à définir ce qui marque la rupture temporelle entre une Chine
médiévale et une Chine moderne. À moins d'être europocentrique et la situer
avec la mission MacCarthney!
civilisations. Pour que la périodisation
temporelle prenne une importance au niveau de la représentation sociale, il lui
faut au moins deux choses : qu'elle marque une rupture dans le temps afin
d'indiquer un avant et un après; qu'elle serve également de trait d'union d'une
période à une autre afin de maintenir le sens de l'unité de temps. C'est un
problème qui a heurté les historiens occidentaux de la Chine. Par exemple,
l'historien Eberhard situe ainsi le passage de la Chine à la modernité : «Mais
de même qu'il est difficile de dire à quel moment précis la Chine a passé de
l'Antiquité au Moyen Âge, il est difficile d'assigner une date exacte au
passage du Moyen Âge aux Temps Modernes. Ce passage s'est effectué au cours de
la période de domination moongole et cette période doit pour cela être
considérée comme une période de transition» W. Eberhard. Histoire de la
Chine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, p. 239). Pour sa
part, Jacques Gernet la situe, sans l'expliquer, avec l'accession de la
dynastie mandchoue à la tête de l'Empire du Milieu (1644). D'autres la font
remonter jusqu'à l'époque Song (1280). D'aucuns, seulement lors de la
proclamation de la République, en 1911. Comme on le voit, l'imprécision désigne
bien l'incapacité à définir ce qui marque la rupture temporelle entre une Chine
médiévale et une Chine moderne. À moins d'être europocentrique et la situer
avec la mission MacCarthney! trahissent l'ancrage qu'a
pris le bouddhisme dans la forme même de la pensée chinoise. Les rapports de
ces confucéens d'un nouveau type avec l'héritage bouddhique sont donc des plus
ambigus, mêlant violentes réactions de rejet et assimilation plus ou moins
consciente dans leur volonté de revendiquer une spécificité confucéenne sur
fond de questionnement bouddhique. Ils ne peuvent en effet s'empêcher d'être
impressionnés par une spiritualité qui culmine dans le Chan. La Chine a été
"visitée" par la figure de compassion du Bodhisattva, que l'on
retrouve en terrain confucéen dans la fameuse phrase de Fan Zhongyan :
"L'homme de bien est le premier à se soucier des tourments du monde, et le
dernier à se réjouir de ses joies". La conviction mencienne, reprise à
l'envi, que tout homme possède en lui le potentiel pour devenir un Yao ou un
Shan est maintenant rapportée à l'idée que tout être possède la
"nature-de-Bouddha". En conséquence, le débat sur la réalisation
graduelle ou instantanée de la bouddhéité se reporte sur la problématique
confucéenne de la sainteté : alors que la position bouddhique traditionnelle
est fondamentalement gradualiste, l'esprit du Mahâyâna, et tout
particulièrement celui du Chan, vient bouleverser les données du problème en
abolissant toute frontière entre cheminement et illumination, entre virtualité
et accomplissement, et en dernière instance entre connaissance et action»
(A. Cheng. op. cit. pp. 431-432). Contrairement au néo-platonisme renaissant
occidental qui ramenait un platonisme intellectuel dans la conception cosmique
entre l'âme et la forme, le néoconfucianisme confond le potentiel avec la
réalisation de la perfection. Philosophes et artistes de la Renaissance
italienne ou franco-bourguignonne pouvaient honorer tout en les détruisant les
œuvres antiques sans souffrir de la moindre complexité. Le néoconfucianisme ne
sera qu’une relecture de Confucius avec les catégories du bouddhisme
traditionnel. Plutôt que l’émulation, c’est une synthèse mystique de
traditions que représente le néo-confucianisme :
trahissent l'ancrage qu'a
pris le bouddhisme dans la forme même de la pensée chinoise. Les rapports de
ces confucéens d'un nouveau type avec l'héritage bouddhique sont donc des plus
ambigus, mêlant violentes réactions de rejet et assimilation plus ou moins
consciente dans leur volonté de revendiquer une spécificité confucéenne sur
fond de questionnement bouddhique. Ils ne peuvent en effet s'empêcher d'être
impressionnés par une spiritualité qui culmine dans le Chan. La Chine a été
"visitée" par la figure de compassion du Bodhisattva, que l'on
retrouve en terrain confucéen dans la fameuse phrase de Fan Zhongyan :
"L'homme de bien est le premier à se soucier des tourments du monde, et le
dernier à se réjouir de ses joies". La conviction mencienne, reprise à
l'envi, que tout homme possède en lui le potentiel pour devenir un Yao ou un
Shan est maintenant rapportée à l'idée que tout être possède la
"nature-de-Bouddha". En conséquence, le débat sur la réalisation
graduelle ou instantanée de la bouddhéité se reporte sur la problématique
confucéenne de la sainteté : alors que la position bouddhique traditionnelle
est fondamentalement gradualiste, l'esprit du Mahâyâna, et tout
particulièrement celui du Chan, vient bouleverser les données du problème en
abolissant toute frontière entre cheminement et illumination, entre virtualité
et accomplissement, et en dernière instance entre connaissance et action»
(A. Cheng. op. cit. pp. 431-432). Contrairement au néo-platonisme renaissant
occidental qui ramenait un platonisme intellectuel dans la conception cosmique
entre l'âme et la forme, le néoconfucianisme confond le potentiel avec la
réalisation de la perfection. Philosophes et artistes de la Renaissance
italienne ou franco-bourguignonne pouvaient honorer tout en les détruisant les
œuvres antiques sans souffrir de la moindre complexité. Le néoconfucianisme ne
sera qu’une relecture de Confucius avec les catégories du bouddhisme
traditionnel. Plutôt que l’émulation, c’est une synthèse mystique de
traditions que représente le néo-confucianisme : Sous les Song, il existait de nombreuses
variétés de sectes néo-Confucianistes, mais deux écoles étaient prédominantes.
À la tête de l’une d’elle était le plus fameux de tous les néo-Confucianistes
et le plus influent de tous les philosophes chinois qui vécurent au cours du
dernier millénaire, Tchou Hi, né en 1130 et mort en 1200.
Sous les Song, il existait de nombreuses
variétés de sectes néo-Confucianistes, mais deux écoles étaient prédominantes.
À la tête de l’une d’elle était le plus fameux de tous les néo-Confucianistes
et le plus influent de tous les philosophes chinois qui vécurent au cours du
dernier millénaire, Tchou Hi, né en 1130 et mort en 1200. |
| Jean de Plan Carpin (1182-1252) |
 |
| Empereur MIng jouant au golf. |
 «C’est au XIVe siècle qu’une nouvelle classe sociale commence
à manifester son existence, une classe qui, dans une certaine mesure,
correspond à la bourgeoisie en Europe. Après l’invention de l’imprimerie sous
les Song, le nombre des livres avait beaucoup augmenté et ces livres étaient
devenus d’un prix abordable. Autrefois, le petit commerçant qui dans le système
économique chinois était le principal agent d’échange des marchandises, n’était
capable que d’écrire les chiffres et quelques caractères. Il ne possédait pas
de livres, encore moins avait-il pu recevoir les enseignements de quelque homme
de savoir. Désormais, le livre est à sa portée. Les premiers livres qui se
répandirent ainsi dans la population furent des livres bouddhiques, et ce, pour
des raisons de propagande religieuse faciles à comrendre. Ils furent suivis par
d’autres, et chacun put ainsi s’instruire soi-même, car l’instruction
consistait surtout à apprendre des textes par cœur. Finalement, l’artisan
habile ou le fermier prospère trouvèrent l’occasion de s’instruire. Non
seulement ils pouvaient apprendre les textes par cœur, mais ils avaient aussi à
leur disposition des collections imprimées de sujets d’examen, qui leur
montraient ce qu’on demandait à ces examens et les poussaient à s’y présenter.
Ainsi donc sous les Ming, la caste des fonctionnaires devait s’augmenter de
gens qui n’appartenaient pas à l’aristocratie terrienne, mais qui étaient tous
de familles pauvres ou peu fortunées» (W. Eberhard. op. cit. pp. 257-258).
«C’est au XIVe siècle qu’une nouvelle classe sociale commence
à manifester son existence, une classe qui, dans une certaine mesure,
correspond à la bourgeoisie en Europe. Après l’invention de l’imprimerie sous
les Song, le nombre des livres avait beaucoup augmenté et ces livres étaient
devenus d’un prix abordable. Autrefois, le petit commerçant qui dans le système
économique chinois était le principal agent d’échange des marchandises, n’était
capable que d’écrire les chiffres et quelques caractères. Il ne possédait pas
de livres, encore moins avait-il pu recevoir les enseignements de quelque homme
de savoir. Désormais, le livre est à sa portée. Les premiers livres qui se
répandirent ainsi dans la population furent des livres bouddhiques, et ce, pour
des raisons de propagande religieuse faciles à comrendre. Ils furent suivis par
d’autres, et chacun put ainsi s’instruire soi-même, car l’instruction
consistait surtout à apprendre des textes par cœur. Finalement, l’artisan
habile ou le fermier prospère trouvèrent l’occasion de s’instruire. Non
seulement ils pouvaient apprendre les textes par cœur, mais ils avaient aussi à
leur disposition des collections imprimées de sujets d’examen, qui leur
montraient ce qu’on demandait à ces examens et les poussaient à s’y présenter.
Ainsi donc sous les Ming, la caste des fonctionnaires devait s’augmenter de
gens qui n’appartenaient pas à l’aristocratie terrienne, mais qui étaient tous
de familles pauvres ou peu fortunées» (W. Eberhard. op. cit. pp. 257-258). Les Ming s’opposaient au Bouddhisme et favorisaient les néo-confucéens dont la synthèse allait bien à cette nouvelle caste de bureaucrates dont l’instruction faisait le pont entre les intérêts économiques de l’Empire et son administration : «Cette nouvelle classe moyenne ne se composait pas de grandes familles comme la
 classe dirigeante qui l’avait précédée. Aussi,
lorsque des gens de cette classe voulaient jouer un rôle politique dans le
gouvernement central, devaient-ils gagner l’intimité d’une des familles
influentes ou tenter d’approcher le souverain directement» (p. 258). Dans
le premier cas, ils devenaient "clients" de ces familles; dans le
second, ils procédaient par la corruption et les pots-de-vin. Mais l’accession
de ces classes d’affaires au pouvoir entraîna avec elle un souffle que l’on
peut appeler modernité. La littérature dépassa les contes mongols pour
atteindre le niveau de l’art romanesque. Romans racontant la décadence de la
classe aristocratique, tel le Chouei Hou Tchouan (Sur les rives du
fleuve), rédigé vers 1550 sans doute par Wang Tao-k’ouen, roman de brigands au
grand cœur! Romans satiriques comme le Si Yeou Ki (Le Pèlerinage
d’Occident), de Wou Tch’eng-en (fin du XVIe s.) qui se moque des dévôts. Tous
ces romans sont en «vernaculaires», tous comme les nouvelles qui marqueront la
fin de l’ère dynastique. Par contre, la poésie se développe à travers le drame,
l’opéra; l’art musical. Les arts plastiques et la calligraphie
sont entraînés par le mouvement culturel.
classe dirigeante qui l’avait précédée. Aussi,
lorsque des gens de cette classe voulaient jouer un rôle politique dans le
gouvernement central, devaient-ils gagner l’intimité d’une des familles
influentes ou tenter d’approcher le souverain directement» (p. 258). Dans
le premier cas, ils devenaient "clients" de ces familles; dans le
second, ils procédaient par la corruption et les pots-de-vin. Mais l’accession
de ces classes d’affaires au pouvoir entraîna avec elle un souffle que l’on
peut appeler modernité. La littérature dépassa les contes mongols pour
atteindre le niveau de l’art romanesque. Romans racontant la décadence de la
classe aristocratique, tel le Chouei Hou Tchouan (Sur les rives du
fleuve), rédigé vers 1550 sans doute par Wang Tao-k’ouen, roman de brigands au
grand cœur! Romans satiriques comme le Si Yeou Ki (Le Pèlerinage
d’Occident), de Wou Tch’eng-en (fin du XVIe s.) qui se moque des dévôts. Tous
ces romans sont en «vernaculaires», tous comme les nouvelles qui marqueront la
fin de l’ère dynastique. Par contre, la poésie se développe à travers le drame,
l’opéra; l’art musical. Les arts plastiques et la calligraphie
sont entraînés par le mouvement culturel.  Sous les Ming apparaît la porcelaine à fond
blanc et décor bleu. L’architecture, cependant, a la faveur de la dynastie. Les
Ming restaurent la Grande Muraille que les Yuan avaient laissée à l’abandon.
Une muraille entourre également Pékin et une bonne partie des Palais de cette
ville dans ce qui deviendra le style classique de l’architecture chinoise.
Toute cette floraison de nouveautés n’empêchera toutefois pas la dynastie de
s’épuiser dans un pouvoir terroriste et intolérant ou les disputes de palais,
laissant ainsi la porte ouverte aux barbares mandchous au milieu du XVIIe
siècle. Jacques Gernet finit par considérer que l’époque de la dynastie Ming
marque véritablement, par ses intérêts scientifiques et littéraires, la Renaissance
de la culture chinoise : «Elle est, dans toute sa dernière partie, l’une
des plus passionnantes [époque] de l’histoire intellectuelle du monde
chinois. Elle a connu l’essor extraordinaire d’une littérature romanesque, les
débuts d’une critique scientifique en matière de philologie, de nouvelles
orientations de pensée, un nouvel intérêt pour les connaissances pratiques, des
esprits libres et originaux. Bien des nouveautés de cette dernière période
auront leurs prolongements sous les Qing aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mais
c’est un fait que pendant la majeure partie de cette longue dynastie, les
effets néfastes de l’absolutisme et de l’orthodoxie se sont conjugés pour
étouffer le libre développement de la pensée» (J. Gernet. Le monde
chinois, Paris, Armand Colin, Col. Destins du monde, 1972, p. 381).
Sous les Ming apparaît la porcelaine à fond
blanc et décor bleu. L’architecture, cependant, a la faveur de la dynastie. Les
Ming restaurent la Grande Muraille que les Yuan avaient laissée à l’abandon.
Une muraille entourre également Pékin et une bonne partie des Palais de cette
ville dans ce qui deviendra le style classique de l’architecture chinoise.
Toute cette floraison de nouveautés n’empêchera toutefois pas la dynastie de
s’épuiser dans un pouvoir terroriste et intolérant ou les disputes de palais,
laissant ainsi la porte ouverte aux barbares mandchous au milieu du XVIIe
siècle. Jacques Gernet finit par considérer que l’époque de la dynastie Ming
marque véritablement, par ses intérêts scientifiques et littéraires, la Renaissance
de la culture chinoise : «Elle est, dans toute sa dernière partie, l’une
des plus passionnantes [époque] de l’histoire intellectuelle du monde
chinois. Elle a connu l’essor extraordinaire d’une littérature romanesque, les
débuts d’une critique scientifique en matière de philologie, de nouvelles
orientations de pensée, un nouvel intérêt pour les connaissances pratiques, des
esprits libres et originaux. Bien des nouveautés de cette dernière période
auront leurs prolongements sous les Qing aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mais
c’est un fait que pendant la majeure partie de cette longue dynastie, les
effets néfastes de l’absolutisme et de l’orthodoxie se sont conjugés pour
étouffer le libre développement de la pensée» (J. Gernet. Le monde
chinois, Paris, Armand Colin, Col. Destins du monde, 1972, p. 381). «Le caractère le plus frappant du buddhisme
de la période de Kamakura est peut-être son développement comme religion
populaire. Nous avons déjà fait allusion aux raisons de ce changement. Elles
doivent être trouvées dans le déclin de la société patricienne qui avait
largement favorisé le buddhisme en tant que culte esthétique, le faste et la
corruption d’un clergé pourvu d’un bénéfice, l’élévation de la classe militaire
et en général le désordre du temps. Quand la mort et la misère dominèrent, une
doctrine de consolation fut la bienvenue dans les esprits des hommes. Sans
doute, avec le temps, certains éléments de connaissances avaient filtré de
l’aristocratie vers le peuple et il semble que l’adoption graduelle d’une
écriture indigène simple favorisa les enseignements élémentaires de Genshin et
de Ryonin. La plupart des grands évangélistes des XIIe et XIIIe siècles
écrivirent de savant traités en chinois mais aussi des ouvrages populaires en
japonais employant l’écriture "mixte kana". Shinran, par
exemple, justifie l’usage de cette écriture dans l’un de ses livres en disant :
"Le peuple des campagnes ne connaît pas la signification des caractères et
a l’esprit extrêmement lent. Aussi afin de le faire comprendre aisément, j’ai
écrit les mêmes choses en les répétant à diverses reprises. Des personnes
raffinées trouveront cela étrange et sans doute se riront de moi. Mais leurs
invectives ne me causent nul souci, car j’ai écrit avec la seule pensée de
rendre mes idées claires pour les gens simples"» (G. B. Sansom. Le
Japon, Paris, Payot, Col. Biliothèque historique, 1938, p. 391).
«Le caractère le plus frappant du buddhisme
de la période de Kamakura est peut-être son développement comme religion
populaire. Nous avons déjà fait allusion aux raisons de ce changement. Elles
doivent être trouvées dans le déclin de la société patricienne qui avait
largement favorisé le buddhisme en tant que culte esthétique, le faste et la
corruption d’un clergé pourvu d’un bénéfice, l’élévation de la classe militaire
et en général le désordre du temps. Quand la mort et la misère dominèrent, une
doctrine de consolation fut la bienvenue dans les esprits des hommes. Sans
doute, avec le temps, certains éléments de connaissances avaient filtré de
l’aristocratie vers le peuple et il semble que l’adoption graduelle d’une
écriture indigène simple favorisa les enseignements élémentaires de Genshin et
de Ryonin. La plupart des grands évangélistes des XIIe et XIIIe siècles
écrivirent de savant traités en chinois mais aussi des ouvrages populaires en
japonais employant l’écriture "mixte kana". Shinran, par
exemple, justifie l’usage de cette écriture dans l’un de ses livres en disant :
"Le peuple des campagnes ne connaît pas la signification des caractères et
a l’esprit extrêmement lent. Aussi afin de le faire comprendre aisément, j’ai
écrit les mêmes choses en les répétant à diverses reprises. Des personnes
raffinées trouveront cela étrange et sans doute se riront de moi. Mais leurs
invectives ne me causent nul souci, car j’ai écrit avec la seule pensée de
rendre mes idées claires pour les gens simples"» (G. B. Sansom. Le
Japon, Paris, Payot, Col. Biliothèque historique, 1938, p. 391). se dégagèrent des
sectes de la période Heian; et l’élévation de la secte Zen en relation étroite
avec la Chine sous la dynastie Sung» (p. 392). L’effet d’entraînement de la
nouvelle littérature vernaculaire entraînera, comme en Chine, la floraison
d’une littérature plus «populaire». Le Zen, enseigné par le moine Dögen
(1299-1253), se détacha du bouddhisme pour devenir «une méthode
d’entraînement spirituel qui, par la
pratique assidue de la "non-méditation" (sazen), permet à
l’esprit humain de transcender les limites ou les cadres de la pensée pour
atteindre à la perception intuitive des choses, laquelle abolit différences et
états transitoires des apparences. Par la suite, les activités normales de la
vie ne doivent pas être considérées comme une fin en elles-mêmes, mais plutôt comme l'expression normale de l’esprit.
Un entraînement sévère, aussi bien physique que spirituel, est indispensable.
Cette forme de philosophie (on ne peut raisonnablement qualifier le Zen de
bouddhisme, le Zen transcendant toute formulation ou doctrine), convenait à
merveille aux besoins spirituels de la classe des samurai, pour laquelle la
fermeté de la résolution était une vertu essentielle. […] Le Zen fut
d’autant plus aisément adopté qu’il prônait la simplicité, la droiture, le
courage, le mépris de la mort. Mais surtout parce qu’il convenait parfaitement
à la mentalité originelle japonaise jusque-là seulement discernable dans le
shintö : l’amour de la nature et le goût de la simplicité rustique. Ces propensions
de l’esprit s’opposant absolument aux vues efféminées des aristocrates de Kyöto
affirmaient des valeurs viriles» (L. Frédéric. op. cit. p. 193). Cette
éthique, qui s’attacha au corps d’élite de l’armée japonaise avec la lutte
contre les invasions mongoles, allait se répandre au cours l’ère des shögunats.
se dégagèrent des
sectes de la période Heian; et l’élévation de la secte Zen en relation étroite
avec la Chine sous la dynastie Sung» (p. 392). L’effet d’entraînement de la
nouvelle littérature vernaculaire entraînera, comme en Chine, la floraison
d’une littérature plus «populaire». Le Zen, enseigné par le moine Dögen
(1299-1253), se détacha du bouddhisme pour devenir «une méthode
d’entraînement spirituel qui, par la
pratique assidue de la "non-méditation" (sazen), permet à
l’esprit humain de transcender les limites ou les cadres de la pensée pour
atteindre à la perception intuitive des choses, laquelle abolit différences et
états transitoires des apparences. Par la suite, les activités normales de la
vie ne doivent pas être considérées comme une fin en elles-mêmes, mais plutôt comme l'expression normale de l’esprit.
Un entraînement sévère, aussi bien physique que spirituel, est indispensable.
Cette forme de philosophie (on ne peut raisonnablement qualifier le Zen de
bouddhisme, le Zen transcendant toute formulation ou doctrine), convenait à
merveille aux besoins spirituels de la classe des samurai, pour laquelle la
fermeté de la résolution était une vertu essentielle. […] Le Zen fut
d’autant plus aisément adopté qu’il prônait la simplicité, la droiture, le
courage, le mépris de la mort. Mais surtout parce qu’il convenait parfaitement
à la mentalité originelle japonaise jusque-là seulement discernable dans le
shintö : l’amour de la nature et le goût de la simplicité rustique. Ces propensions
de l’esprit s’opposant absolument aux vues efféminées des aristocrates de Kyöto
affirmaient des valeurs viriles» (L. Frédéric. op. cit. p. 193). Cette
éthique, qui s’attacha au corps d’élite de l’armée japonaise avec la lutte
contre les invasions mongoles, allait se répandre au cours l’ère des shögunats.  une période propice à la diffusion de la religion et des arts : «Tout
d’abord le Japonais, soit par instinct, soit par tradition, a toujours été
avide de la beauté des couleurs et des formes, et les pires désastres n’ont
jamais pu étouffer son goût naturel pour les arts. D’autre part, les conditions
sociales de ces temps troublés loin de décourager la création des belles
choses, la provoquaient, car ces belles choses étaient elles-mêmes un symbole
du succès, le moyen désiré par les hommes nouvellement arrivés au pouvoir et à
la fortune, d’étaler leurs conquêtes. Enfin, et c’est là sans doute le point le
plus important, l’Église était assez puissante pour offrir un refuge aux
artistes et aux gens de lettres. Les moines et les laïcs qui voulaient se tenir
à l’écart de la guerre et de la politique, pouvaient se consacrer aux lettres
et à la peinture dans des monastères où ils étaient en sûreté, ou s’attacher à
quelque grand baron qui agissaient à leur égard en Mécène. Nous avons déjà
signalé la crainte de la noblesse féodale d’être confondue avec les rustres des
campagnes. Elle avait été longtemps méprisée par les beaux esprits de Kyoto,
et, devenue maîtresse à son tour de la capitale, elle voulut y faire grande
figure. Un passage intéressant du Gempei-Seisuiki conte l’arrivée de
Yoshitsune à la cour et ajoute que, malgré sa peau blanche, ses gestes gracieux
et l’aisance avec laquelle il s’adapta à la vie de Kyoto, les courtisans
affirmaient qu’il était "moins qu’un rebut des Taira". Les temps,
cependant, avaient changé et c’étaient maintenant les soldats qui donnaient le
ton. Quand Nawa, connétable de Hoki, eut accompagné l’empereur à la cour en
1333, il fut de mode de l’imiter en toutes choses, et ses façons furent
célèbres sous le nom de "manière Hoki". La classe militaire ne se
contentait plus de briller sur les champs de bataille et, du Shogun au dernier
vassal, elle voulait jouir des bénéfices de la culture, telle qu’elle la
concevait. En fait, elle réussit à donner un grand élan aux arts de la paix»
(G. B. Samson. op. cit. 1938, pp. 441-442). Certes ce ne furent pas les samurai
qui écrivirent des livres ou composèrent des drames, pas plus que les bourgeois
dans la Chine des Ming. Ce sont les moines et les artistes déjà formés à
l’époque Kamakura qui relancèrent la production. La distinction est pourtant
claire, la Renaissance japonaise ne se fit pas dans l’esprit bourgeois
néo-confucéen, mais dans l’esprit militariste néo-bouddiste de caste, distinction qui devait se reproduire beaucoup plus tard, au XXe siècle.
une période propice à la diffusion de la religion et des arts : «Tout
d’abord le Japonais, soit par instinct, soit par tradition, a toujours été
avide de la beauté des couleurs et des formes, et les pires désastres n’ont
jamais pu étouffer son goût naturel pour les arts. D’autre part, les conditions
sociales de ces temps troublés loin de décourager la création des belles
choses, la provoquaient, car ces belles choses étaient elles-mêmes un symbole
du succès, le moyen désiré par les hommes nouvellement arrivés au pouvoir et à
la fortune, d’étaler leurs conquêtes. Enfin, et c’est là sans doute le point le
plus important, l’Église était assez puissante pour offrir un refuge aux
artistes et aux gens de lettres. Les moines et les laïcs qui voulaient se tenir
à l’écart de la guerre et de la politique, pouvaient se consacrer aux lettres
et à la peinture dans des monastères où ils étaient en sûreté, ou s’attacher à
quelque grand baron qui agissaient à leur égard en Mécène. Nous avons déjà
signalé la crainte de la noblesse féodale d’être confondue avec les rustres des
campagnes. Elle avait été longtemps méprisée par les beaux esprits de Kyoto,
et, devenue maîtresse à son tour de la capitale, elle voulut y faire grande
figure. Un passage intéressant du Gempei-Seisuiki conte l’arrivée de
Yoshitsune à la cour et ajoute que, malgré sa peau blanche, ses gestes gracieux
et l’aisance avec laquelle il s’adapta à la vie de Kyoto, les courtisans
affirmaient qu’il était "moins qu’un rebut des Taira". Les temps,
cependant, avaient changé et c’étaient maintenant les soldats qui donnaient le
ton. Quand Nawa, connétable de Hoki, eut accompagné l’empereur à la cour en
1333, il fut de mode de l’imiter en toutes choses, et ses façons furent
célèbres sous le nom de "manière Hoki". La classe militaire ne se
contentait plus de briller sur les champs de bataille et, du Shogun au dernier
vassal, elle voulait jouir des bénéfices de la culture, telle qu’elle la
concevait. En fait, elle réussit à donner un grand élan aux arts de la paix»
(G. B. Samson. op. cit. 1938, pp. 441-442). Certes ce ne furent pas les samurai
qui écrivirent des livres ou composèrent des drames, pas plus que les bourgeois
dans la Chine des Ming. Ce sont les moines et les artistes déjà formés à
l’époque Kamakura qui relancèrent la production. La distinction est pourtant
claire, la Renaissance japonaise ne se fit pas dans l’esprit bourgeois
néo-confucéen, mais dans l’esprit militariste néo-bouddiste de caste, distinction qui devait se reproduire beaucoup plus tard, au XXe siècle.C’est à cette période que se fit la rencontre fondamentale de la Civilisation extrême-orientale avec la Civilisation occidentale au moment de son expansion outre-mer :
 «On a beaucoup discuté sur les circonstances
et la date de la découverte du Japon par les Européens. Il semble établi
maintenant que cette découverte se situe en l’année 1542 et qu’elle est due à
des fortunes de mer et non à un dessein bien déterminé d’exploration. Fernand Mendez Pinto, échoué aux abords de Canton, à la suite d’un typhon, cherchait à
regagner Malacca; ne trouvant aucun navire qui s’y rendit, il prit du service,
avec ses deux compatriotes Diego Zeimoto et Christophe Borello, sur un corsaire
chinois; cette jonque eut à soutenir un combat contre d’autres pirates, fut
désemparée et fit route vers les Ryûkyû que connaissait bien son capitaine;
mais une tempête la poussa beaucoup plus au nord et elle atteignit l’île de
Tanegashima, proche de la pointe sud de la province d’Osumi et de la grande île
de Kyûshû. Les trois Portugais furent bien accueillis par le daimyô,
qu’intéressèrent particulièrement leurs arquebuses; il fit étudier la
constitution et le maniement de ces armes et en fit aussitôt entreprendre la
fabrication par ses armuriers. Apprenant la présence des Européens à
Tanegashima, Otomo Yoshinori, daimyô du Bungô, dans le secteur nord-est de
Kyûshû, les confia à venir jusqu’à lui; Pinto, seul, se rendit à Funai
(aujourd’hui Oita) : là aussi, il causa une vive stupéfaction en montrant
l’usage des arquebuses. Ces armes à feu furent rapidement fabriquées en grand
nombre et employées dans les guerres féodales; la tactique offensive s’en
trouva profondément modifiée, les moyens de défense et les fortifications
furent trasnformés : l’art de la guerre fut complètement rénové, et la ruine de
la féodalité fut achevée par l’introduction de ces nouveaux engins» (R.
Bersihand. op. cit. p. 149).
«On a beaucoup discuté sur les circonstances
et la date de la découverte du Japon par les Européens. Il semble établi
maintenant que cette découverte se situe en l’année 1542 et qu’elle est due à
des fortunes de mer et non à un dessein bien déterminé d’exploration. Fernand Mendez Pinto, échoué aux abords de Canton, à la suite d’un typhon, cherchait à
regagner Malacca; ne trouvant aucun navire qui s’y rendit, il prit du service,
avec ses deux compatriotes Diego Zeimoto et Christophe Borello, sur un corsaire
chinois; cette jonque eut à soutenir un combat contre d’autres pirates, fut
désemparée et fit route vers les Ryûkyû que connaissait bien son capitaine;
mais une tempête la poussa beaucoup plus au nord et elle atteignit l’île de
Tanegashima, proche de la pointe sud de la province d’Osumi et de la grande île
de Kyûshû. Les trois Portugais furent bien accueillis par le daimyô,
qu’intéressèrent particulièrement leurs arquebuses; il fit étudier la
constitution et le maniement de ces armes et en fit aussitôt entreprendre la
fabrication par ses armuriers. Apprenant la présence des Européens à
Tanegashima, Otomo Yoshinori, daimyô du Bungô, dans le secteur nord-est de
Kyûshû, les confia à venir jusqu’à lui; Pinto, seul, se rendit à Funai
(aujourd’hui Oita) : là aussi, il causa une vive stupéfaction en montrant
l’usage des arquebuses. Ces armes à feu furent rapidement fabriquées en grand
nombre et employées dans les guerres féodales; la tactique offensive s’en
trouva profondément modifiée, les moyens de défense et les fortifications
furent trasnformés : l’art de la guerre fut complètement rénové, et la ruine de
la féodalité fut achevée par l’introduction de ces nouveaux engins» (R.
Bersihand. op. cit. p. 149). à son accord avec le Japon» (G. Sansom. op. cit. 1988, pp. 637 et
635). La conséquence de cette fermeture de la Chine au commerce avec le Japon
fut l’accroissement des actes de piraterie sur les côtes de la Corée et de la
Chine. Les wako, les pirates japonais, entrèrent alors en relations
commerciales avec les Portugais de Macao qui les transformèrent en
d'honnêtes commerçants alors qu'ils demeuraient de simples contrebandiers
pour le commerce chinois. Vers 1560, «les Ming ayant permis la reprise du
commerce avec l’étranger, la piraterie disparut complètement. Les captifs
vendus comme esclaves au Japon furent, à la suite de longs pourparlers entre
les cours intéressés, rendus à leur pays. Les ports de Hirado, Hakata, Hyögo et
Sakai connurent alors une grande prospérité et de nombreux marchands s’y
enrichirent rapidement. En même temps se développait une nouvelle classe de
travailleurs citadins qui, du fait de leurs activités en rapport avec la mer,
jouissaient d’une grande liberté. Le port de Sakai surtout bénéficiait des
talents de tous les artisans de Kyöto qui avaient fui la capitale pendant la
guerre de l’ère Önin. Les navigateurs de Sakai s’étaient assuré la protection
des pirates de la mer intérieure en leur payant un tribut. Aussi ce port ne
tarda-t-il pas à devenir la ville la plus riche du Japon» (L. Frédéric. op.
cit. p. 220). C’est à cette occasion que se développèrent les missions des
Jésuites inaugurées par François-Xavier. Ce n’étaient plus les armes qui
envahissaient l’archipel, mais un esprit tout à fait différent tout en lui ressemblant étrangement, celui d’une
armée de missionnaires conquérants.
à son accord avec le Japon» (G. Sansom. op. cit. 1988, pp. 637 et
635). La conséquence de cette fermeture de la Chine au commerce avec le Japon
fut l’accroissement des actes de piraterie sur les côtes de la Corée et de la
Chine. Les wako, les pirates japonais, entrèrent alors en relations
commerciales avec les Portugais de Macao qui les transformèrent en
d'honnêtes commerçants alors qu'ils demeuraient de simples contrebandiers
pour le commerce chinois. Vers 1560, «les Ming ayant permis la reprise du
commerce avec l’étranger, la piraterie disparut complètement. Les captifs
vendus comme esclaves au Japon furent, à la suite de longs pourparlers entre
les cours intéressés, rendus à leur pays. Les ports de Hirado, Hakata, Hyögo et
Sakai connurent alors une grande prospérité et de nombreux marchands s’y
enrichirent rapidement. En même temps se développait une nouvelle classe de
travailleurs citadins qui, du fait de leurs activités en rapport avec la mer,
jouissaient d’une grande liberté. Le port de Sakai surtout bénéficiait des
talents de tous les artisans de Kyöto qui avaient fui la capitale pendant la
guerre de l’ère Önin. Les navigateurs de Sakai s’étaient assuré la protection
des pirates de la mer intérieure en leur payant un tribut. Aussi ce port ne
tarda-t-il pas à devenir la ville la plus riche du Japon» (L. Frédéric. op.
cit. p. 220). C’est à cette occasion que se développèrent les missions des
Jésuites inaugurées par François-Xavier. Ce n’étaient plus les armes qui
envahissaient l’archipel, mais un esprit tout à fait différent tout en lui ressemblant étrangement, celui d’une
armée de missionnaires conquérants.Les Ming avaient continué la construction du prolongement de la Grande Muraille jusqu’à Shanhaiguan, la
 «passe entre la Mer et la Montagne». Devant elles, ce
n’étaient plus les Mongols, mais les Mandchous qui guettaient les faiblesses de
l’Empire du Milieu et se préparaient, à leur tour, à recevoir le mandat du Ciel. «De la fin
du XVe siècle jusqu’en 1584, remplaçant le modeste camp retranché initial, des
fortifications imposantes furent édifiées pour barrer la plaine littorale : une
citadelle, précédée d’enceintes percées de portes sous voûte et flanquée de
murailles qui domine le passage principal se pare toujours de l’orgueilleuse
inscription "La première porte sous le ciel" (Tianxia diyi guan)»
(M. Jan. op. cit. pp. 110-111). Le dernier Empereur Ming, Li Tseu-tch’ang, fut
trahi par son général, Wou San-kouei qui, sur le front, était chargé de tenir
tête aux armées mandchous. À l’intérieur des murs, les révoltes paysannes, de
paysans écrasés par des impôts pour entretenir une Cour luxueuse et décadente,
convergeait avec les barbares venus de l’étranger: «Shanhaiguan est mêlé à
la fin suicidaire des Ming dans un ultime épisode baroque où tout se conjugue
pour justifier la perte du mandat céleste. Une révolte paysanne, pour
commencer, qui menaçait l’empire de l’intérieur, et
«passe entre la Mer et la Montagne». Devant elles, ce
n’étaient plus les Mongols, mais les Mandchous qui guettaient les faiblesses de
l’Empire du Milieu et se préparaient, à leur tour, à recevoir le mandat du Ciel. «De la fin
du XVe siècle jusqu’en 1584, remplaçant le modeste camp retranché initial, des
fortifications imposantes furent édifiées pour barrer la plaine littorale : une
citadelle, précédée d’enceintes percées de portes sous voûte et flanquée de
murailles qui domine le passage principal se pare toujours de l’orgueilleuse
inscription "La première porte sous le ciel" (Tianxia diyi guan)»
(M. Jan. op. cit. pp. 110-111). Le dernier Empereur Ming, Li Tseu-tch’ang, fut
trahi par son général, Wou San-kouei qui, sur le front, était chargé de tenir
tête aux armées mandchous. À l’intérieur des murs, les révoltes paysannes, de
paysans écrasés par des impôts pour entretenir une Cour luxueuse et décadente,
convergeait avec les barbares venus de l’étranger: «Shanhaiguan est mêlé à
la fin suicidaire des Ming dans un ultime épisode baroque où tout se conjugue
pour justifier la perte du mandat céleste. Une révolte paysanne, pour
commencer, qui menaçait l’empire de l’intérieur, et  des émeutiers parvenus
jusqu’au cœur de la capitale. L’empereur, ensuite, qui s’est pendu à un arbre
sur les hauteurs dominant la Cité interdite, arbre qui pour expier sa faute
sera enchaîné! Une belle, pour continuer, Chen Yuanyuan, maîtresse bien-aimée
du général Wu Sangui, défenseur de la passe de Shanhaiguan :
des émeutiers parvenus
jusqu’au cœur de la capitale. L’empereur, ensuite, qui s’est pendu à un arbre
sur les hauteurs dominant la Cité interdite, arbre qui pour expier sa faute
sera enchaîné! Une belle, pour continuer, Chen Yuanyuan, maîtresse bien-aimée
du général Wu Sangui, défenseur de la passe de Shanhaiguan : La dynastie Ming n'aura été qu'un été de la
Saint-Martin dans le parcours de l'histoire de la Chine. Les Mandchous
descendaient des Kin qui avaient déjà dominer la Chine du Nord à la chute des
T'ang et que les Mongols avaient extirpés. Comme le remarque Eberhard : «Si
les Mandchous avaient conquis la Chine, c'était moins par leur supériorité
militaire que grâce aux dissensions intérieures de la Chine. Comment se fait-il
que cette dynastie ait pu se maintenir, alors que les Mandchous n'avaient pas
l’avantage d'une supériorité numérique, alors que leur souverain Fou-lin (de
son nom de règne Chouen-tchi, 1644-1662) était un adolescent
La dynastie Ming n'aura été qu'un été de la
Saint-Martin dans le parcours de l'histoire de la Chine. Les Mandchous
descendaient des Kin qui avaient déjà dominer la Chine du Nord à la chute des
T'ang et que les Mongols avaient extirpés. Comme le remarque Eberhard : «Si
les Mandchous avaient conquis la Chine, c'était moins par leur supériorité
militaire que grâce aux dissensions intérieures de la Chine. Comment se fait-il
que cette dynastie ait pu se maintenir, alors que les Mandchous n'avaient pas
l’avantage d'une supériorité numérique, alors que leur souverain Fou-lin (de
son nom de règne Chouen-tchi, 1644-1662) était un adolescent  névropathe, alors
que dans le sud, résidaient des Princes Ming, alors que partout dans le pays,
de fort groupes de rebelles poursuivaient leurs activités? En outre les
Mandchous étaient des Étrangers, on se méfiait d'eux car le sentiment national
des Chinois se manifestait déjà à cette époque. Puis, ce fut la Loi de 1645 qui
obligea les Chinois, en signe de vassalité, à porter la natte et à s'habiller
comme les conquérants. La fierté nationale s'en trouvait blessée. Les mariages
entre Chinois et Mandchous furent interdits et une dualité de gouvernement
établie. Dans tous les postes, le Chinois était doublé d'un Mandchou dont bien
entendu l'autorité était prépondérante. Les soldats mandchous furent répartis
dans les garnisons des diverses grandes villes. Leur solde leur était payée au
moyen d'impôts levés sur la population et ils n'étaient astreints à aucun
travail, en tant qu'appartenant à la classe conquérante. Les Mandchous
n'avaient pas comme les Chinois à subir d'examens offkiciels pour accéder aux
postes de l'administration. On peut se demander comment dans de telles
conditions, la dynastie réussit à se maintenir» (W. Eberhard. op. cit. pp.
277-278). Elle se maintint, en effet, mais dans des conditions qui
multipliaient les conflits sociaux :
névropathe, alors
que dans le sud, résidaient des Princes Ming, alors que partout dans le pays,
de fort groupes de rebelles poursuivaient leurs activités? En outre les
Mandchous étaient des Étrangers, on se méfiait d'eux car le sentiment national
des Chinois se manifestait déjà à cette époque. Puis, ce fut la Loi de 1645 qui
obligea les Chinois, en signe de vassalité, à porter la natte et à s'habiller
comme les conquérants. La fierté nationale s'en trouvait blessée. Les mariages
entre Chinois et Mandchous furent interdits et une dualité de gouvernement
établie. Dans tous les postes, le Chinois était doublé d'un Mandchou dont bien
entendu l'autorité était prépondérante. Les soldats mandchous furent répartis
dans les garnisons des diverses grandes villes. Leur solde leur était payée au
moyen d'impôts levés sur la population et ils n'étaient astreints à aucun
travail, en tant qu'appartenant à la classe conquérante. Les Mandchous
n'avaient pas comme les Chinois à subir d'examens offkiciels pour accéder aux
postes de l'administration. On peut se demander comment dans de telles
conditions, la dynastie réussit à se maintenir» (W. Eberhard. op. cit. pp.
277-278). Elle se maintint, en effet, mais dans des conditions qui
multipliaient les conflits sociaux :  ville chinoise au sud. En 1645, tous les Chinois atteints de
variole - en fait tous ceux qui ont des maladies de peau - sont chassés de
Pékin. Des bruits alarmistes courent en ville où l’on croit que les occupants
vont exterminer toute la population chinoise. C’est qu’en effet la conquête est
menée avec une extrême sauvagerie. Un habitant de Yanzhou qui devait échapper
par miracle au massacre général de la population a laissé un récit des horreurs
dont il fut le témoin au moment où, en 1645, les troupes mandchoues pénétrèrent
dans cette riche cité commerçante du Bas-Yangzi. Le manuscrit de ce récit, le Journal
des dix jours de Yangzhou (Yangzhou shirji), devait être préservé au Japon.
Le changement de costume et de coiffure - le port de la natte (bianzi) -
qui est imposé sous peine de mort dès 1645 à l’ensemble de la population
chinoise provoque des émeutes dont certaines sont réprimées par des massacres
comme à Jiangyin et Jiaxing au Jiangsu. Rappelons que les Jürchen, ancêtres des
Mandchous, avaient également imposé le port de la natte à leurs sujets dans
l’empire des Jin et que la natte était une coiffure traditionnelle chez les
gens de la steppe : les Mongols faisaient plusieurs tresses et, plus
anciennement, au Ve siècle, les Tabgatch étaient qualifiés par les Chinois de
"têtes cordées" (suotou). Dès le début de leur conquête, les
Mandchous exproprient les paysans et constituent des domaines d’où les Chinois
sont exclus. Ces enclaves mandchoues (quan), créées entre 1645 et 1647,
sont nombreuses dans toute la Chine du Nord, surtout aux environs de Pékin, et
en Mongolie orientale» (J. Gernet. op. cit. pp. 407-408).
ville chinoise au sud. En 1645, tous les Chinois atteints de
variole - en fait tous ceux qui ont des maladies de peau - sont chassés de
Pékin. Des bruits alarmistes courent en ville où l’on croit que les occupants
vont exterminer toute la population chinoise. C’est qu’en effet la conquête est
menée avec une extrême sauvagerie. Un habitant de Yanzhou qui devait échapper
par miracle au massacre général de la population a laissé un récit des horreurs
dont il fut le témoin au moment où, en 1645, les troupes mandchoues pénétrèrent
dans cette riche cité commerçante du Bas-Yangzi. Le manuscrit de ce récit, le Journal
des dix jours de Yangzhou (Yangzhou shirji), devait être préservé au Japon.
Le changement de costume et de coiffure - le port de la natte (bianzi) -
qui est imposé sous peine de mort dès 1645 à l’ensemble de la population
chinoise provoque des émeutes dont certaines sont réprimées par des massacres
comme à Jiangyin et Jiaxing au Jiangsu. Rappelons que les Jürchen, ancêtres des
Mandchous, avaient également imposé le port de la natte à leurs sujets dans
l’empire des Jin et que la natte était une coiffure traditionnelle chez les
gens de la steppe : les Mongols faisaient plusieurs tresses et, plus
anciennement, au Ve siècle, les Tabgatch étaient qualifiés par les Chinois de
"têtes cordées" (suotou). Dès le début de leur conquête, les
Mandchous exproprient les paysans et constituent des domaines d’où les Chinois
sont exclus. Ces enclaves mandchoues (quan), créées entre 1645 et 1647,
sont nombreuses dans toute la Chine du Nord, surtout aux environs de Pékin, et
en Mongolie orientale» (J. Gernet. op. cit. pp. 407-408).Il est vrai que les marques extérieures de l'occupation mandchoue furent encore plus visibles que du temps
 |
| Dorgon, régent à l’origine de l’édit sur les nattes |
 L’empereur Shunzi n’était pas
seulement un chef guerrier impitoyable, il était aussi bon administrateur. En 7
ans, il compléta la conquête de toute la Chine, y compris la partie Sud
(capitale Nankin) dirigée par les derniers empereurs Ming. Shunzi mourut
prématurément, laissant un enfant mineur à la succession. La Régence devint
l’occasion de conflits de palais. Le nouvel empereur, Kangxi atteignit sa
majorité en 1669 et, comme son aîné Louis XIV, avait appris à se méfier des
ministres et des courtisans. Grand guerrier, administrateur pointilleux,
recevant les Jésuites occidentaux aussi bien que les imams musulmans afin de
discuter théologie, il représente ce que la dynastie a produit de mieux, se faisant le protecteur des lettrés
académiciens que la fin du règne des Ming avait sévèrement persécuté :
L’empereur Shunzi n’était pas
seulement un chef guerrier impitoyable, il était aussi bon administrateur. En 7
ans, il compléta la conquête de toute la Chine, y compris la partie Sud
(capitale Nankin) dirigée par les derniers empereurs Ming. Shunzi mourut
prématurément, laissant un enfant mineur à la succession. La Régence devint
l’occasion de conflits de palais. Le nouvel empereur, Kangxi atteignit sa
majorité en 1669 et, comme son aîné Louis XIV, avait appris à se méfier des
ministres et des courtisans. Grand guerrier, administrateur pointilleux,
recevant les Jésuites occidentaux aussi bien que les imams musulmans afin de
discuter théologie, il représente ce que la dynastie a produit de mieux, se faisant le protecteur des lettrés
académiciens que la fin du règne des Ming avait sévèrement persécuté : pour l’étude et possédant
lui-même une bonne connaissance de la littérature chinoise, K’ang Hi avait
gagné la sympathie des intellectuels en réorganisant les examens officiels. Le
talent et le savoir se trouvaient récompensés par des postes officiels à la
Cour. L’Empereur K’ien Long, le petit-fils de K’ang Hi est peut-être le
meilleur exemple de ces empereurs "lettrés". Poète de talent et
expert en peinture chinoise, K’ien Long a également attaché son nom à un
ouvrage de la plus haute importance littéraire. Il assembla les lettrés de
premier rang et leur exposa le plan qu’il avait formé de réunir, en une
anthologie (en fait, la plus grande qu’on ait jamais vue), tous les ouvrages de
valeur écrits en chinois. Dans tout le pays, des livres et des manuscrits
furent achetés ou empruntés à des collections publiques ou privées; l’ensemble,
qui ne comportait pas moins de 36.000 volumes, fut, après avoir été
collationné, copié à la main en sept exemplaires. C’est ce qu’on a appelé le
"Sseu-kou tsiuan-chou", ou Encyclopédie des Quatre Trésors, par
allusion aux quatre divisions de l’ouvrage : 1° Classiques confucéens et leurs
commentaires; 2° Philosophie et sciences; 3° Histoire; 4° Littérature. Les sept
copies, dont chacune constituait une véritable bibliothèque, furent réparties dans
tout l’empire et déposées en des lieux particulièrement renommés ou dont le
site était connu pour sa beauté : le palais impérial de Pékin; le "Parc
Circulaire et Brillant", "Yuan-Ming-Yuan", résidence d’été près
de Pékin; les bibliothèques de Moukden, de Jehol, de Yant-tcheou; le Temple de
la Colline d’Or, à Tchen-Kiang et le Temple de Cheng-Ying, sur les rives du Lac
de l’ouest, à Hang-tcheou» (Tsui Chi. op. cit. p. 209).
pour l’étude et possédant
lui-même une bonne connaissance de la littérature chinoise, K’ang Hi avait
gagné la sympathie des intellectuels en réorganisant les examens officiels. Le
talent et le savoir se trouvaient récompensés par des postes officiels à la
Cour. L’Empereur K’ien Long, le petit-fils de K’ang Hi est peut-être le
meilleur exemple de ces empereurs "lettrés". Poète de talent et
expert en peinture chinoise, K’ien Long a également attaché son nom à un
ouvrage de la plus haute importance littéraire. Il assembla les lettrés de
premier rang et leur exposa le plan qu’il avait formé de réunir, en une
anthologie (en fait, la plus grande qu’on ait jamais vue), tous les ouvrages de
valeur écrits en chinois. Dans tout le pays, des livres et des manuscrits
furent achetés ou empruntés à des collections publiques ou privées; l’ensemble,
qui ne comportait pas moins de 36.000 volumes, fut, après avoir été
collationné, copié à la main en sept exemplaires. C’est ce qu’on a appelé le
"Sseu-kou tsiuan-chou", ou Encyclopédie des Quatre Trésors, par
allusion aux quatre divisions de l’ouvrage : 1° Classiques confucéens et leurs
commentaires; 2° Philosophie et sciences; 3° Histoire; 4° Littérature. Les sept
copies, dont chacune constituait une véritable bibliothèque, furent réparties dans
tout l’empire et déposées en des lieux particulièrement renommés ou dont le
site était connu pour sa beauté : le palais impérial de Pékin; le "Parc
Circulaire et Brillant", "Yuan-Ming-Yuan", résidence d’été près
de Pékin; les bibliothèques de Moukden, de Jehol, de Yant-tcheou; le Temple de
la Colline d’Or, à Tchen-Kiang et le Temple de Cheng-Ying, sur les rives du Lac
de l’ouest, à Hang-tcheou» (Tsui Chi. op. cit. p. 209). |
| Banquet à la cour des Qing |
O pure brise, vous ne savez pas bien lire…Il y avait là un jeu de mots (l’adjectif "pur" étant celui qui désigne la dynastie mandchoue) dont le sens fut rapidement compris» (pp. 209-210).
Pourquoi semer le désordre dans mes pages?
 Plutôt qu’à une encyclopédie,
l’entreprise de K’ien Lang pour sauver l’héritage chinois ressemble davantage à
celle de la Bible par les Hébreux, au moment de l’exil à Babylone. Les sept
copies visaient non à diffuser le patrimoine, mais à le protéger dans des lieux
jugés imprenables par d’autres envahisseurs. D’ailleurs, la copie placée à
Yuan-Ming-Yuan, le Palais d’Été près de Pékin, allait être détruite lors de la
seconde guerre de l’opium par l’armée anglo-française en 1860. L’entreprise est
tout sauf optimiste. Elle apparaît encyclopédique pour les Occidentaux,
mais l’état de la Chine sous les Mandchous ne cessa de dépérir malgré tous
leurs efforts de redresser la situation. Après la Renaissance Ming, les Qing accéléraient le processus de perte de l’auto-détermination de l’ensemble de l’État chinois. Des ministres
profitèrent de la somnolence de la bureaucratie pour commettre des crimes financiers.
Une révolte
Plutôt qu’à une encyclopédie,
l’entreprise de K’ien Lang pour sauver l’héritage chinois ressemble davantage à
celle de la Bible par les Hébreux, au moment de l’exil à Babylone. Les sept
copies visaient non à diffuser le patrimoine, mais à le protéger dans des lieux
jugés imprenables par d’autres envahisseurs. D’ailleurs, la copie placée à
Yuan-Ming-Yuan, le Palais d’Été près de Pékin, allait être détruite lors de la
seconde guerre de l’opium par l’armée anglo-française en 1860. L’entreprise est
tout sauf optimiste. Elle apparaît encyclopédique pour les Occidentaux,
mais l’état de la Chine sous les Mandchous ne cessa de dépérir malgré tous
leurs efforts de redresser la situation. Après la Renaissance Ming, les Qing accéléraient le processus de perte de l’auto-détermination de l’ensemble de l’État chinois. Des ministres
profitèrent de la somnolence de la bureaucratie pour commettre des crimes financiers.
Une révolte  dite des Lotus Blanc, une de ces nombreuses so-
dite des Lotus Blanc, une de ces nombreuses so-cié-
tés
secrètes réclamant la restauration des Ming, ayant environ deux millions de membres et qui se serait soulevé quatre-vingt fois sous la dynastie Qing, se porta contre l’un de ces ministres prévaricateurs. Les armées étaient portées aux frontières de la Russie. Eberhard explique ainsi le rapide déclin de la maison mandchoue : «…ce n’est pas tant la situation du trésor qu’il faut considérer que l’appauvrissement du pays lui-même. Le nombre des personnes véritablement riches avait beaucoup diminué, celui des membres de la classe moyenne avait beaucoup augmenté, mais ces derniers, s’ils étaient instruits, ne possédaient ni argent ni autres richesses. Les véritables raisons de la décadence doivent être recherchées dans un accroissement démographique devenu énorme, alors que les condtiions de production et les moyens techniques restaient les mêmes qu’auparavant» (W. Eberhard. op. cit. p. 281).
 «On peut se demander pourquoi
l’industrie ne s’est pas développée en Chine comme elle s’est développée en
Europe. C’est en effet au XVIIIe siècle qu’a commencé l’industrialisation de
l’Europe et c’est à la même époque que le problème démographique a pris une
importance aiguë en Chine. Le même processus aurait donc pu provoquer, en Chine
aussi, une résorption de l’excédent de population, mais la Chine ne s’est pas
industrialisée. Alors qu’en Europe, les artisans et la bourgeoisie
s’orientaient vers l’industrie et créaient les premières manufactures, en
Chine, les travailleurs manuels restaient sous la dépendance, sous la
domination de la classe dirigeante et possédante. La richesse de cette classe
consistait en terres, et, du fait de l’augmentation de la population et de la
raréfaction des terres cultivables disponibles, le terrain avait pris beaucoup
de valeur. Les propriétaires terriens n’étaient donc nullement intéressés à
voir l’industrie se développer dans le pays, bien au contraire, et partout où
des
«On peut se demander pourquoi
l’industrie ne s’est pas développée en Chine comme elle s’est développée en
Europe. C’est en effet au XVIIIe siècle qu’a commencé l’industrialisation de
l’Europe et c’est à la même époque que le problème démographique a pris une
importance aiguë en Chine. Le même processus aurait donc pu provoquer, en Chine
aussi, une résorption de l’excédent de population, mais la Chine ne s’est pas
industrialisée. Alors qu’en Europe, les artisans et la bourgeoisie
s’orientaient vers l’industrie et créaient les premières manufactures, en
Chine, les travailleurs manuels restaient sous la dépendance, sous la
domination de la classe dirigeante et possédante. La richesse de cette classe
consistait en terres, et, du fait de l’augmentation de la population et de la
raréfaction des terres cultivables disponibles, le terrain avait pris beaucoup
de valeur. Les propriétaires terriens n’étaient donc nullement intéressés à
voir l’industrie se développer dans le pays, bien au contraire, et partout où
des  |
| Fabrication du papier peint |
 qui aurait hissé la valeur d’échange au-dessus de la valeur d’usage. Depuis des
siècles, la Chine faisait commerce avec des puissances équivalentes à la
sienne. Des jonques cabotaient le long de la Mer Jaune, du golfe du Tonkin, en
Indonésie, dans l’Océan Indien en Inde et jusque dans l’Est africain. On en
trouva une même sur les côtes de la Colombie Britannique au Canada. La production industrielle, telle que conçue
par les Occidentaux, semblait laisser froid les bureaucrates chinois. L’Inde
britannique allait tomber la première victime du démantèlement de son industrie
locale du textile pour devenir cliente des factories de Manchester. La production
industrielle d’opium sur les terres indiennes, originellement produite pour la
consommation britannique, subit le contre-effet du puritanisme victorien et les
Britanniques allèrent l’imposer à la Chine des Qing, au milieu du XIXe
siècle. Si les armées mandchoues purent acquérir de beaux trophées de guerre en
Asie centrale, elles ne faisaient pas le poids devant l’irruption massive des
Occidentaux.
qui aurait hissé la valeur d’échange au-dessus de la valeur d’usage. Depuis des
siècles, la Chine faisait commerce avec des puissances équivalentes à la
sienne. Des jonques cabotaient le long de la Mer Jaune, du golfe du Tonkin, en
Indonésie, dans l’Océan Indien en Inde et jusque dans l’Est africain. On en
trouva une même sur les côtes de la Colombie Britannique au Canada. La production industrielle, telle que conçue
par les Occidentaux, semblait laisser froid les bureaucrates chinois. L’Inde
britannique allait tomber la première victime du démantèlement de son industrie
locale du textile pour devenir cliente des factories de Manchester. La production
industrielle d’opium sur les terres indiennes, originellement produite pour la
consommation britannique, subit le contre-effet du puritanisme victorien et les
Britanniques allèrent l’imposer à la Chine des Qing, au milieu du XIXe
siècle. Si les armées mandchoues purent acquérir de beaux trophées de guerre en
Asie centrale, elles ne faisaient pas le poids devant l’irruption massive des
Occidentaux. de la Réforme catholique qui visait à combattre
l'hérésie et le paganisme, accédèrent à la cour des Grands Khans. C'est par
leur habileté en tant que savants et techniciens qu'ils purent obtenir des
postes de confiance. Dès la fin de l'ère Yuan, les Matteo Ricci et Adam Schall
avaient ébloui les lettrés chinois avec leurs fines connaissances en astronomie
et en d'autres matières. Mais le but final restait la conversion des
Chinois et leur soumission spirituelle à Rome. Selon les nouveaux principes de
la pastorale réformiste, ils distribuèrent des «images religieuses, qui
firent l'étonnement des Chinois inaccoutumés à la technique picturale
européenne et aux lois de la perspective. Selon un auteur chinois de la fin du
XVIe siècle, l'une de ces peintures apportées par Ricci, représentait "le
Seigneur du Ciel, qui est le Maître et le Créateur de l'Univers et des dix
mille choses. Le Seigneur du Ciel est peint sous l'aspect d'un bébé, que tient sur
son sein une femme, appelée la Mère Céleste. La peinture est exécutée sur du
bronze, et elle est coloriée. Les figures ont l'air vivante". Entre les
lignes de cette description, on devine l'étonnement de l'auteur, et devant
l'humilité du Seigneur du Ciel et devant l'apparence de vie donnée par le
peintre» (Tsoui Chi. op. cit. p. 195). Mais les Chinois restèrent
indifférents à reproduire ce type de peinture. Par contre, il apparut aux yeux
de certains, que la religion chrétienne pouvait être compatible avec le
Confucianisme, voire même le Taoïsme. Les Jésuites en Chine s'y méprirent car
ils pensèrent que la soumission à Rome n'était pas impossible si l'on acceptait
d'adapter cerains rites païens dans le cérémonial chrétien. Le pape refusa un
tel accommodement et bientôt l'influence religieuse devint suspecte auprès de
la cour des Qing. La réaction, devenue viscérale devant des étrangers trop
entreprenants, ne se fit pas attendre auprès des successeurs de Ricci et d'Adam Schall. Les missionnaires, tenus de respecter la bulle papale qui interdisait
les rites chinois, furent soumis à des règlements contraignants leur
interdisant de posséder des terres dans l'intérieur du pays, les obligeant à
résider dans les «Ports à Traité»
de la Réforme catholique qui visait à combattre
l'hérésie et le paganisme, accédèrent à la cour des Grands Khans. C'est par
leur habileté en tant que savants et techniciens qu'ils purent obtenir des
postes de confiance. Dès la fin de l'ère Yuan, les Matteo Ricci et Adam Schall
avaient ébloui les lettrés chinois avec leurs fines connaissances en astronomie
et en d'autres matières. Mais le but final restait la conversion des
Chinois et leur soumission spirituelle à Rome. Selon les nouveaux principes de
la pastorale réformiste, ils distribuèrent des «images religieuses, qui
firent l'étonnement des Chinois inaccoutumés à la technique picturale
européenne et aux lois de la perspective. Selon un auteur chinois de la fin du
XVIe siècle, l'une de ces peintures apportées par Ricci, représentait "le
Seigneur du Ciel, qui est le Maître et le Créateur de l'Univers et des dix
mille choses. Le Seigneur du Ciel est peint sous l'aspect d'un bébé, que tient sur
son sein une femme, appelée la Mère Céleste. La peinture est exécutée sur du
bronze, et elle est coloriée. Les figures ont l'air vivante". Entre les
lignes de cette description, on devine l'étonnement de l'auteur, et devant
l'humilité du Seigneur du Ciel et devant l'apparence de vie donnée par le
peintre» (Tsoui Chi. op. cit. p. 195). Mais les Chinois restèrent
indifférents à reproduire ce type de peinture. Par contre, il apparut aux yeux
de certains, que la religion chrétienne pouvait être compatible avec le
Confucianisme, voire même le Taoïsme. Les Jésuites en Chine s'y méprirent car
ils pensèrent que la soumission à Rome n'était pas impossible si l'on acceptait
d'adapter cerains rites païens dans le cérémonial chrétien. Le pape refusa un
tel accommodement et bientôt l'influence religieuse devint suspecte auprès de
la cour des Qing. La réaction, devenue viscérale devant des étrangers trop
entreprenants, ne se fit pas attendre auprès des successeurs de Ricci et d'Adam Schall. Les missionnaires, tenus de respecter la bulle papale qui interdisait
les rites chinois, furent soumis à des règlements contraignants leur
interdisant de posséder des terres dans l'intérieur du pays, les obligeant à
résider dans les «Ports à Traité»  «Il n'est pas besoin de remonter
bien loin pour expliquer ce revirement dans les relations sino-étrangères. Les
Pères Jésuites qui étaient arrivés en Chine, à la fin de la dynastie des Ming,
n'avaient rien demandé aux Chinois. Ils n'avaient point exigé qu'on les traitât
d'une manière particulière. Ils n'avaient même pas tenté de prôner leur culture
comme supérieure à celle de leurs hôtes. Ils avaient bien plutôt offert leur
science et leur foi comme des dons désintéressés. Les missionnaires catholiques
qui succédèrent aux Jésuites, sous la dynastie des Ts'ing, adoptèrent, au
contraire, une attitude dogmatique et un ton protecteur, tout à fait opposés à
la mentalité chinoise. Mais plus encore, leur présence coïncida avec les
tentatives faites par les puissances occientales pour exploiter commercialement
la Chine» (p. 197).
«Il n'est pas besoin de remonter
bien loin pour expliquer ce revirement dans les relations sino-étrangères. Les
Pères Jésuites qui étaient arrivés en Chine, à la fin de la dynastie des Ming,
n'avaient rien demandé aux Chinois. Ils n'avaient point exigé qu'on les traitât
d'une manière particulière. Ils n'avaient même pas tenté de prôner leur culture
comme supérieure à celle de leurs hôtes. Ils avaient bien plutôt offert leur
science et leur foi comme des dons désintéressés. Les missionnaires catholiques
qui succédèrent aux Jésuites, sous la dynastie des Ts'ing, adoptèrent, au
contraire, une attitude dogmatique et un ton protecteur, tout à fait opposés à
la mentalité chinoise. Mais plus encore, leur présence coïncida avec les
tentatives faites par les puissances occientales pour exploiter commercialement
la Chine» (p. 197). l'interdiction du christianisme tout
en s'entourant de savants et artistes jésuites. En 1740, un massacre de Chinois
opéré à Batavia par les Hollandais (protestants) entraîna le refroidissement entre la
Chine et l'Occident au point que Rome préféra remplacer les
Jésuites par les Lazaristes en 1787. Profitant de la perte de popularité des
catholiques, les protestants envoyèrent leurs ambassadeurs auprès de
l'Empereur, à la cour de Pékin. Ce fut d'abord la mission Macartney en 1793 et,
deux ans plus tard, une ambassade hollandaise. L'accueil fut plutôt froid.
L'expédition anglaise était constituée de cinq voiliers et sept cents hommes,
ce qui était beaucoup plus impressionnant - et plus inquiétant - que les
missionnaires qui l'avaient précédée. Comme toujours dans des situations
semblables, l'arrogance des ambassadeurs britanniques fut répondus par la
suffisance de la bureaucratie céleste et de la Cour de Pékin. Le secrétaire de
Macartney, George Staunton, a laissé un récit détaillé de cette expédition qui
ressemblait à tant d'autres que la Royal Society commandait alors (réédité sous
le titre Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie, Genève,
Olizane, 2005). Staunton avait pour mission d'observer et de rapporter toutes
les observations possibles, tant sur les mœurs des habitants que des ressources
locales et le commerce dont la balance avec la Chine était alors déficitaire
pour les Britanniques. L’expédition traversa une grande partie du pays pour
finalement arriver à Rehe, la résidence de l’empereur, où les visiteurs furent
reçus sans enthousiasme mais poliment par la cour. Selon les règles de la diplomatie chinoise,
les ambassadeurs étrangers ne venaient dans l’Empire que dans le seul but de
rendre allégeance à l’Empereur. Or, tel n’était pas le cas de Macartney. La
chose se révéla lorsque Macartney refusa de se présenter devant l’Empereur
Qianlong en faisant le salut traditionnel du Kowtow, profonde courbette
diplomatique qui aurait été une
l'interdiction du christianisme tout
en s'entourant de savants et artistes jésuites. En 1740, un massacre de Chinois
opéré à Batavia par les Hollandais (protestants) entraîna le refroidissement entre la
Chine et l'Occident au point que Rome préféra remplacer les
Jésuites par les Lazaristes en 1787. Profitant de la perte de popularité des
catholiques, les protestants envoyèrent leurs ambassadeurs auprès de
l'Empereur, à la cour de Pékin. Ce fut d'abord la mission Macartney en 1793 et,
deux ans plus tard, une ambassade hollandaise. L'accueil fut plutôt froid.
L'expédition anglaise était constituée de cinq voiliers et sept cents hommes,
ce qui était beaucoup plus impressionnant - et plus inquiétant - que les
missionnaires qui l'avaient précédée. Comme toujours dans des situations
semblables, l'arrogance des ambassadeurs britanniques fut répondus par la
suffisance de la bureaucratie céleste et de la Cour de Pékin. Le secrétaire de
Macartney, George Staunton, a laissé un récit détaillé de cette expédition qui
ressemblait à tant d'autres que la Royal Society commandait alors (réédité sous
le titre Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie, Genève,
Olizane, 2005). Staunton avait pour mission d'observer et de rapporter toutes
les observations possibles, tant sur les mœurs des habitants que des ressources
locales et le commerce dont la balance avec la Chine était alors déficitaire
pour les Britanniques. L’expédition traversa une grande partie du pays pour
finalement arriver à Rehe, la résidence de l’empereur, où les visiteurs furent
reçus sans enthousiasme mais poliment par la cour. Selon les règles de la diplomatie chinoise,
les ambassadeurs étrangers ne venaient dans l’Empire que dans le seul but de
rendre allégeance à l’Empereur. Or, tel n’était pas le cas de Macartney. La
chose se révéla lorsque Macartney refusa de se présenter devant l’Empereur
Qianlong en faisant le salut traditionnel du Kowtow, profonde courbette
diplomatique qui aurait été une  preuve d’un lien de subordination du roi
d’Angleterre. L’Empereur finit par éconduire les visiteurs. Au-delà de ces
considérations ostentatoires, l’échec de l’ambassade reposerait sur l’influence
et les conseils de Ho Lin auprès du vieil Empereur qui finit par «rejeter la
requête de Macartney pour l’établissement d’un représentant et d’un centre
commercial britannique à Pékin; pour l’extension des facilités de navigation et
un tarif de douanes régulier applicable aux négociants britanniques à Chousan,
Ningpo et Tientsìn; et pour l’autorisation du travail des missionnaires
chinois. On racontait couramment que Ho Chen avait conseillé à l’empereur
d’accorder au moins quelques-unes de faveurs demandées par l’ambassadeur, mais
que le vieux souverain en avait été finalement dissuadé par ses fils, et en
particulier par celui qui devint plus tard l’empereur Kía-k’ing» (E.
Backhouse et J.-O.-P. Bland. Les empereurs mandchous, Paris, Payot,
Col. Bibliothèque historique, 1934, p. 121). À partir de ce moment, la Chine
venait de faire de la Grande-Bretagne sa pire ennemie.
preuve d’un lien de subordination du roi
d’Angleterre. L’Empereur finit par éconduire les visiteurs. Au-delà de ces
considérations ostentatoires, l’échec de l’ambassade reposerait sur l’influence
et les conseils de Ho Lin auprès du vieil Empereur qui finit par «rejeter la
requête de Macartney pour l’établissement d’un représentant et d’un centre
commercial britannique à Pékin; pour l’extension des facilités de navigation et
un tarif de douanes régulier applicable aux négociants britanniques à Chousan,
Ningpo et Tientsìn; et pour l’autorisation du travail des missionnaires
chinois. On racontait couramment que Ho Chen avait conseillé à l’empereur
d’accorder au moins quelques-unes de faveurs demandées par l’ambassadeur, mais
que le vieux souverain en avait été finalement dissuadé par ses fils, et en
particulier par celui qui devint plus tard l’empereur Kía-k’ing» (E.
Backhouse et J.-O.-P. Bland. Les empereurs mandchous, Paris, Payot,
Col. Bibliothèque historique, 1934, p. 121). À partir de ce moment, la Chine
venait de faire de la Grande-Bretagne sa pire ennemie. se
succédèrent à un rythme inconnu jusque-là, le rythme occidental. Le colonialisme sut percevoir très
vite la façade décrépie du gouvernement Qing. Tandis que des soulèvements
populaires régionalisés surgissaient ici et là sur l’immense territoire occupant l’armée impériale, la pénétration du continent asiatique
s’accélérait. L’Inde était quasi-entièrement entre les mains de la Compagnie des
Indes orientales depuis 1759. Des ports en Indochine commençaient à laisser
passer le commerce en contrebande car même si l’accroissement démographique
augmentait les échanges commerciaux, ceux-ci, insuffisants, étaient toujours sous la surveillance
étatique. Ce que l’Occident voulait imposer à la Chine, c’était moins
l’occupation territoriale, comme en Inde, que la liberté commerciale et une
certaine obligation à ce commerce. C’est ainsi que déroutant la production
d’opium de l’Inde vers la Chine, l’Angleterre pressa le gouvernement
d’acheter la production anglaise. Contrairement aux interprétations
idéologiques qui ont eu cours au XXe siècle, il apparaît que la Chine ne refusa
pas le commerce de l’opium, mais voulait le faire à sa façon, selon le commerce
frontalier habituel. On fumait déjà de l’opium en Chine depuis très longtemps,
mais :
se
succédèrent à un rythme inconnu jusque-là, le rythme occidental. Le colonialisme sut percevoir très
vite la façade décrépie du gouvernement Qing. Tandis que des soulèvements
populaires régionalisés surgissaient ici et là sur l’immense territoire occupant l’armée impériale, la pénétration du continent asiatique
s’accélérait. L’Inde était quasi-entièrement entre les mains de la Compagnie des
Indes orientales depuis 1759. Des ports en Indochine commençaient à laisser
passer le commerce en contrebande car même si l’accroissement démographique
augmentait les échanges commerciaux, ceux-ci, insuffisants, étaient toujours sous la surveillance
étatique. Ce que l’Occident voulait imposer à la Chine, c’était moins
l’occupation territoriale, comme en Inde, que la liberté commerciale et une
certaine obligation à ce commerce. C’est ainsi que déroutant la production
d’opium de l’Inde vers la Chine, l’Angleterre pressa le gouvernement
d’acheter la production anglaise. Contrairement aux interprétations
idéologiques qui ont eu cours au XXe siècle, il apparaît que la Chine ne refusa
pas le commerce de l’opium, mais voulait le faire à sa façon, selon le commerce
frontalier habituel. On fumait déjà de l’opium en Chine depuis très longtemps,
mais : La fumée contenait environ 0,2 p. 100 de morphine, c’est-à-dire
un taux relativement faible. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, les fumeurs
prirent l’habitude de mettre une petite gouttelette ou boulette d’extrait d’opium
pur dans leur pipe avant de l’allumer, et la vapeur d’eau et d’opium ainsi
dégagée recelait de 9 à 10 p. 100 de morphine, ce qui en faisait un puissant
narcotique. Les importations d’opium, provenant essentiellement de la
production officielle du gouvernement des Indes britanniques, se développèrent
rapidement à partir de 1820. Les affréteurs anglo-américains acheminaient
l’opium, légalement selon leurs propres lois, jusqu’à la côte chinoise où les
contrebandiers prenaient le relais et l’introduisaient, illégalement en regard
de la loi chinoise, dans leur pays. Ces derniers faisaient partie d’un réseau
de contrebande qui n’était pas aussi secret qu’il pouvait le paraître,
puisqu’ils corrompaient les fonctionnaires régionaux et payaient en fait de belles
sommes à la Maison impériale elle-même…
La fumée contenait environ 0,2 p. 100 de morphine, c’est-à-dire
un taux relativement faible. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, les fumeurs
prirent l’habitude de mettre une petite gouttelette ou boulette d’extrait d’opium
pur dans leur pipe avant de l’allumer, et la vapeur d’eau et d’opium ainsi
dégagée recelait de 9 à 10 p. 100 de morphine, ce qui en faisait un puissant
narcotique. Les importations d’opium, provenant essentiellement de la
production officielle du gouvernement des Indes britanniques, se développèrent
rapidement à partir de 1820. Les affréteurs anglo-américains acheminaient
l’opium, légalement selon leurs propres lois, jusqu’à la côte chinoise où les
contrebandiers prenaient le relais et l’introduisaient, illégalement en regard
de la loi chinoise, dans leur pays. Ces derniers faisaient partie d’un réseau
de contrebande qui n’était pas aussi secret qu’il pouvait le paraître,
puisqu’ils corrompaient les fonctionnaires régionaux et payaient en fait de belles
sommes à la Maison impériale elle-même… Les prohibitions de [l’Empereur] Tao-Kuang restèrent
sans effet et l’on finit par réaliser, dans les années 1830, que l’accoutumance
à l’opium avait envahi la bureaucratie, atteint les eunuques du Palais à Pékin
et même les militaires, dont certains, de ce fait, étaient devenus tout à fait
impropre au service. Vers 1836, on se rendit également compte que les
importations d’opium, en drainant l’argent vers l’étranger, créaient une crise
fiscale en Chine, car le paiement des impôts, dus en argent, devenait plus cher
en monnaie de cuivre qui était le moyen de paiement du peuple. Ces
considérations politiques et économiques, venant s’ajouter au devoir moral de
l’empereur, inspirèrent le mouvement anti-opium, dont Lin Tse-hsu devint le
vertueux défenseur» (J. K. Fairbank. La Grande Révolution chinoise, Paris,
Flammarion, Col. Champs # 380, 1999, pp.139-140).
Les prohibitions de [l’Empereur] Tao-Kuang restèrent
sans effet et l’on finit par réaliser, dans les années 1830, que l’accoutumance
à l’opium avait envahi la bureaucratie, atteint les eunuques du Palais à Pékin
et même les militaires, dont certains, de ce fait, étaient devenus tout à fait
impropre au service. Vers 1836, on se rendit également compte que les
importations d’opium, en drainant l’argent vers l’étranger, créaient une crise
fiscale en Chine, car le paiement des impôts, dus en argent, devenait plus cher
en monnaie de cuivre qui était le moyen de paiement du peuple. Ces
considérations politiques et économiques, venant s’ajouter au devoir moral de
l’empereur, inspirèrent le mouvement anti-opium, dont Lin Tse-hsu devint le
vertueux défenseur» (J. K. Fairbank. La Grande Révolution chinoise, Paris,
Flammarion, Col. Champs # 380, 1999, pp.139-140). Lin était un fonctionnaire probe et
non sans un certain patriotisme glorieux. Administrateur à Canton, il s’attaqua
à la menace étrangère en saisissant les stocks d’opium détenus par les
marchands britanniques. C’était suffisant pour décider le gouvernement de
Londres à agir, et ce fut la première Guerre de l’Opium (1839-1842). En avril 1840, une armada britannique constituée de 16
vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons
et 4 000 hommes longe les côte de la Chine du Sud. Sous le commandement de l’amiral Elliot, elle arrive
au large de Canton en juin. Un croiseur britannique bombarde Canton
et occupe l'archipel voisin de Zhoushan (舟山) (d'où est tiré le terme de diplomatie de la canonnière).
Les britanniques attaquent Canton mais sans succès, car Lin a fait
planter des pieux retenus par des chaînes dans le port pour empêcher les
bateaux d'accoster. Il y a aussi une milice qui défend la ville. En attendant, les Britanniques conquièrent Hong Kong (alors un avant-poste mineur) et en font une tête de pont. Les combats commencent réellement en juillet, quand les HMS Volage et HMS Hyacinth défont 29 navires chinois. Les Britanniques capturent le fort qui gardait l'embouchure de la rivière des Perles — la voie maritime entre Hong Kong et Guangzhou. C'est alors que la cour se soumet à la diplomatie de la canonnière, car il faut bien admettre que derrière
l’opium, l’intérêt du conflit visait surtout à ouvrir Pékin à accepter des
relations avec la Grande-Bretagne sur une base égalitaire, c’est-à-dire une
pure libéralisation de tous commerces. Devant la défaite militaire, les Qing
acceptèrent l'implantation de concessions déjà utilisées jadis pour les
marchands portugais et espagnols.
Lin était un fonctionnaire probe et
non sans un certain patriotisme glorieux. Administrateur à Canton, il s’attaqua
à la menace étrangère en saisissant les stocks d’opium détenus par les
marchands britanniques. C’était suffisant pour décider le gouvernement de
Londres à agir, et ce fut la première Guerre de l’Opium (1839-1842). En avril 1840, une armada britannique constituée de 16
vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons
et 4 000 hommes longe les côte de la Chine du Sud. Sous le commandement de l’amiral Elliot, elle arrive
au large de Canton en juin. Un croiseur britannique bombarde Canton
et occupe l'archipel voisin de Zhoushan (舟山) (d'où est tiré le terme de diplomatie de la canonnière).
Les britanniques attaquent Canton mais sans succès, car Lin a fait
planter des pieux retenus par des chaînes dans le port pour empêcher les
bateaux d'accoster. Il y a aussi une milice qui défend la ville. En attendant, les Britanniques conquièrent Hong Kong (alors un avant-poste mineur) et en font une tête de pont. Les combats commencent réellement en juillet, quand les HMS Volage et HMS Hyacinth défont 29 navires chinois. Les Britanniques capturent le fort qui gardait l'embouchure de la rivière des Perles — la voie maritime entre Hong Kong et Guangzhou. C'est alors que la cour se soumet à la diplomatie de la canonnière, car il faut bien admettre que derrière
l’opium, l’intérêt du conflit visait surtout à ouvrir Pékin à accepter des
relations avec la Grande-Bretagne sur une base égalitaire, c’est-à-dire une
pure libéralisation de tous commerces. Devant la défaite militaire, les Qing
acceptèrent l'implantation de concessions déjà utilisées jadis pour les
marchands portugais et espagnols. «Comme le faisait remarquer le
défunt Joseph Fletcher, brillant spécialiste de l’Asie centrale, les accords
anglo-chinois de Nankin et les suivants comportaient : 1° l’extraterritorialité
(une juridiction consulaire étrangère pour les ressortissants étrangers),
amélioration d’une ancienne pratique chinoise; 2° une indemnité; 3° un tarif
douanier modéré et des contacts directs entre les étrangers et les agents des
douanes; 4° la clause de la nation la plus favorisée (expression chère à la
"bienveillance impartiale" de la Chine envers tous les pays de
l’extérieur); 5° la liberté de faire commerce avec tous les arrivants, sans
monopole (ce qui fut longtemps la coutume à Kashgar) - toutes dispositions qui
suivaient de prêt l’exemple de Kokand en 1835. En outre, les endroits
spécialement affectés au commerce (les ports ouverts) étaient une vieille
coutume frontalière chinoise, et les relations égalitaires sans prosternement
se pratiquaient couramment sur les frontières avec la Russie et Kokand, loin de
la Chine proprement dite» (pp. 141-142).
«Comme le faisait remarquer le
défunt Joseph Fletcher, brillant spécialiste de l’Asie centrale, les accords
anglo-chinois de Nankin et les suivants comportaient : 1° l’extraterritorialité
(une juridiction consulaire étrangère pour les ressortissants étrangers),
amélioration d’une ancienne pratique chinoise; 2° une indemnité; 3° un tarif
douanier modéré et des contacts directs entre les étrangers et les agents des
douanes; 4° la clause de la nation la plus favorisée (expression chère à la
"bienveillance impartiale" de la Chine envers tous les pays de
l’extérieur); 5° la liberté de faire commerce avec tous les arrivants, sans
monopole (ce qui fut longtemps la coutume à Kashgar) - toutes dispositions qui
suivaient de prêt l’exemple de Kokand en 1835. En outre, les endroits
spécialement affectés au commerce (les ports ouverts) étaient une vieille
coutume frontalière chinoise, et les relations égalitaires sans prosternement
se pratiquaient couramment sur les frontières avec la Russie et Kokand, loin de
la Chine proprement dite» (pp. 141-142).  chinoises, mais elle n’effaçait pas le fait que les
traités inégaux étaient une défaite humiliante de la Chine. L’indemnité visait
à rembourser le stock saisi par l’incorruptible Lin qui fut, en retour, démis
de ses fonctions. Pour nous qui voyons depuis des générations la Guerre de
l’Opium comme une étape importante dans l’accélération de l'effondrement de la Chine, les historiens
chinois préfèrent parler aujourd'hui de l’effort d’occidentalisation en
utilisant «un terme classique signifiant "redressement" et destiné
à souligner l'autonomie et l’initiative de la Chine. Plusieurs facteurs
contribuèrent à la naissance de ce mouvement, dont, en premier lieu, la
tradition politicienne, ancrée chez les administrateurs-lettrés, qui favorisait
la recherche d’un savoir "utile à la société sur le plan pratique".
Les politiciens exerçaient leur habileté sur des questions comme celle de
parvenir à acheminer par bateau sur le Grand Canal le tribut de céréales
destiné à nourrir Pékin. […] le canal s’était envasé, le fleuve Jaune et
le fleuve Huai l’inondaient parfois, la léthargie bureaucratique s’était
emparée de l’Administration, et les équipages héréditaires de jonques
céréalières étaient corrompus et révoltés. Confrontés à ce problème dans les
années 1820, les politiciens répondirent qu’il fallait expédier le riz à
destination de Pékin par voie de mer, autour de la péninsule du Shantung.
C’était effectivement réalisable, mais les intérêts de longue date en jeu dans
le Grand Canal s’opposèrent à la poursuite de cette opération. (Après 1872, une
nouvelle solution consisterait à créer une ligne chinoise de bateaux à vapeur
et à lui donner le monopole des transports de riz)» (pp. 151-152.). C'est ainsi que l'esprit chinois, déjà préparé par le pragmatisme taoiste entra dans le redressement de la créativité chinoise confrontée à sa némésis depuis deux siècles.
chinoises, mais elle n’effaçait pas le fait que les
traités inégaux étaient une défaite humiliante de la Chine. L’indemnité visait
à rembourser le stock saisi par l’incorruptible Lin qui fut, en retour, démis
de ses fonctions. Pour nous qui voyons depuis des générations la Guerre de
l’Opium comme une étape importante dans l’accélération de l'effondrement de la Chine, les historiens
chinois préfèrent parler aujourd'hui de l’effort d’occidentalisation en
utilisant «un terme classique signifiant "redressement" et destiné
à souligner l'autonomie et l’initiative de la Chine. Plusieurs facteurs
contribuèrent à la naissance de ce mouvement, dont, en premier lieu, la
tradition politicienne, ancrée chez les administrateurs-lettrés, qui favorisait
la recherche d’un savoir "utile à la société sur le plan pratique".
Les politiciens exerçaient leur habileté sur des questions comme celle de
parvenir à acheminer par bateau sur le Grand Canal le tribut de céréales
destiné à nourrir Pékin. […] le canal s’était envasé, le fleuve Jaune et
le fleuve Huai l’inondaient parfois, la léthargie bureaucratique s’était
emparée de l’Administration, et les équipages héréditaires de jonques
céréalières étaient corrompus et révoltés. Confrontés à ce problème dans les
années 1820, les politiciens répondirent qu’il fallait expédier le riz à
destination de Pékin par voie de mer, autour de la péninsule du Shantung.
C’était effectivement réalisable, mais les intérêts de longue date en jeu dans
le Grand Canal s’opposèrent à la poursuite de cette opération. (Après 1872, une
nouvelle solution consisterait à créer une ligne chinoise de bateaux à vapeur
et à lui donner le monopole des transports de riz)» (pp. 151-152.). C'est ainsi que l'esprit chinois, déjà préparé par le pragmatisme taoiste entra dans le redressement de la créativité chinoise confrontée à sa némésis depuis deux siècles. «L’Angleterre avait profité des
difficultés intérieures pour étendre le trafic de l’opium sur les côtes du
Guangdonc et du Fujian à partir de 1850. L’affaire de l’Arrow, navire
contrebandier arraisonné par les autorités chinoises, fournit en 1856 le
prétexte au déclenchement d’une nouvelle série d’opérations militaires à
laquelle les historiens occidentaux ont donné le nom de "seconde guerre de
l’opium". 5 000 soldats britanniques investissent Canton en 1857. L’année
suivante, les navires anglais et français détruisent les forts de Dagu qui
défendent l’embouchure du Halhe (Belhe) non loin de Tianjin, aux abords de
Pékin. Sous la menace, le gouvernement des Qing est contraint de signer la même
année le traité de Tianjin (1858). Dix nouvelles villes sont ouvertes aux
étrangers qui y acquièrent des concessions; des consulats sont établis à Pékin
et les missions catholiques et protestantes obtiennent de s’installer librement
dans l’intérieur et d’y devenir propriétaires de bâtiments et de terrains. Une
nouvelle indemnité de guerre est infligée à la Chine qui doit verser 4 millions
de liang d’argent à la Grande-Bretagne et 2 millions à la France. Des
droits analogues à ceux qu’ont obtenus ces deux pays sont reconnus à la Russie
et aux États-Unis. Cependant, les combats reprennent en dépit du
"traité" et la résistance chinoise est assez efficace pour provoquer une
seconde expédition après les lourdes pertes subies en 1859 par la flotte
franco-anglaise devant les forts de Dagu. L’année suivante, c’est la marche sur
Pékin d’un corps expéditionnaire d’environ 20 000 hommes, composé de troupes
coloniales britanniques et françaises, son entrée dans la ville suivie du
pillage et de l’incendie du Palais d’été, le célèbre Yuanmingyuan que
l’empereur Qianlong avait fait embellir sur les conseils et avec l’aide des
missionnaires jésuites.
«L’Angleterre avait profité des
difficultés intérieures pour étendre le trafic de l’opium sur les côtes du
Guangdonc et du Fujian à partir de 1850. L’affaire de l’Arrow, navire
contrebandier arraisonné par les autorités chinoises, fournit en 1856 le
prétexte au déclenchement d’une nouvelle série d’opérations militaires à
laquelle les historiens occidentaux ont donné le nom de "seconde guerre de
l’opium". 5 000 soldats britanniques investissent Canton en 1857. L’année
suivante, les navires anglais et français détruisent les forts de Dagu qui
défendent l’embouchure du Halhe (Belhe) non loin de Tianjin, aux abords de
Pékin. Sous la menace, le gouvernement des Qing est contraint de signer la même
année le traité de Tianjin (1858). Dix nouvelles villes sont ouvertes aux
étrangers qui y acquièrent des concessions; des consulats sont établis à Pékin
et les missions catholiques et protestantes obtiennent de s’installer librement
dans l’intérieur et d’y devenir propriétaires de bâtiments et de terrains. Une
nouvelle indemnité de guerre est infligée à la Chine qui doit verser 4 millions
de liang d’argent à la Grande-Bretagne et 2 millions à la France. Des
droits analogues à ceux qu’ont obtenus ces deux pays sont reconnus à la Russie
et aux États-Unis. Cependant, les combats reprennent en dépit du
"traité" et la résistance chinoise est assez efficace pour provoquer une
seconde expédition après les lourdes pertes subies en 1859 par la flotte
franco-anglaise devant les forts de Dagu. L’année suivante, c’est la marche sur
Pékin d’un corps expéditionnaire d’environ 20 000 hommes, composé de troupes
coloniales britanniques et françaises, son entrée dans la ville suivie du
pillage et de l’incendie du Palais d’été, le célèbre Yuanmingyuan que
l’empereur Qianlong avait fait embellir sur les conseils et avec l’aide des
missionnaires jésuites. Les conventions signées à Pékin en
1860 obligent la Chine à de nouveaux sacrifices : Tianjin est ouverte aux
étrangers, la presqu’île de Jiulong (Kowloon), en face de Hongkong, cédée à la
Grande-Bretagne. Une nouvelle indemnité de 16 millions de liang est exigée du gouvernement
chinois. Enfin, deux clauses d’ordre économique complètent ces conventions :
les textiles que les nations occidentales, et l’Angleterre plus que toute
autre, cherchent à écouler sur le marché chinois sont exemptés de droits de
douane; d’autre part, les flottes étrangères obtiennent une entière liberté de
circulation sur le réseau fluvial chinois.
Les conventions signées à Pékin en
1860 obligent la Chine à de nouveaux sacrifices : Tianjin est ouverte aux
étrangers, la presqu’île de Jiulong (Kowloon), en face de Hongkong, cédée à la
Grande-Bretagne. Une nouvelle indemnité de 16 millions de liang est exigée du gouvernement
chinois. Enfin, deux clauses d’ordre économique complètent ces conventions :
les textiles que les nations occidentales, et l’Angleterre plus que toute
autre, cherchent à écouler sur le marché chinois sont exemptés de droits de
douane; d’autre part, les flottes étrangères obtiennent une entière liberté de
circulation sur le réseau fluvial chinois. Traité de Tianjin et conventions de Pékin se situent dans un contexte historique très différent de celui du traité
de Nankin en 1842. La première "guerre" de l’opium appartenait encore
à l’époque de la marine à voile et des aventures commerciales. En 1857-1860,
lors de la seconde série d’attaques étrangères, la grande industrie est déjà en
plein essor dans les pays européens les plus évolués. Les accords signés, qui
seront scrupuleusement respectés du côté chinois, ont aussi une portée beaucoup
plus large et l’effet des privilèges obtenus par les étrangers ne tardera pas à
se faire sentir sur l’économoie chinoise» (J. Gernet. op. cit. p. 499).
Traité de Tianjin et conventions de Pékin se situent dans un contexte historique très différent de celui du traité
de Nankin en 1842. La première "guerre" de l’opium appartenait encore
à l’époque de la marine à voile et des aventures commerciales. En 1857-1860,
lors de la seconde série d’attaques étrangères, la grande industrie est déjà en
plein essor dans les pays européens les plus évolués. Les accords signés, qui
seront scrupuleusement respectés du côté chinois, ont aussi une portée beaucoup
plus large et l’effet des privilèges obtenus par les étrangers ne tardera pas à
se faire sentir sur l’économoie chinoise» (J. Gernet. op. cit. p. 499). Qu’est-ce à dire? D’une part, niveau
colonial, il s’agit de s’engager plus profondément à l’intérieur du territoire
chinois en partant des concessions et du droit de libre navigation sur les
fleuves chinois. D’autre part, niveau impérialiste, le contrôle des douanes favorise les intérêts occidentaux et les effets de ce contrôle seront à
l’origine de la révolution de 1911.
Qu’est-ce à dire? D’une part, niveau
colonial, il s’agit de s’engager plus profondément à l’intérieur du territoire
chinois en partant des concessions et du droit de libre navigation sur les
fleuves chinois. D’autre part, niveau impérialiste, le contrôle des douanes favorise les intérêts occidentaux et les effets de ce contrôle seront à
l’origine de la révolution de 1911. révolutionnaires : la propriété
foncière privée était abolie; nourriture, vêtements et autres biens de
consommation courante étaient mis en commun dans des entrepôts publics, et
distribués à la population selon leurs besoins par leurs chefs militaires; l'opium, le tabac et l'alcool étaient désormais interdits. Cette
révolte à la fois puritaine et millénariste instaura une trêve dans la seconde
guerre d’Opium et c’est par une alliance entre forces mandchoues et britanniques
que l’on parviendra à éradiquer le mouvement. Si le nombre des pertes est inconnu
de part et d’autres, certains n’hésitent pas à l’évaluer entre 20 et 30 000 000
pour les deux camps (le chiffre de 17 millions semble le plus raisonnable). Des événements comme la révolte des Taiping sont un phénomènes que l’on retrouve dans des périodes d’anomie sociale. Les Anabaptistes de Münster (1535) comme l’actuel «Califat» de l’État islamique (2012-2016) sont des millénarismes très différents des luttes sociales ordinaires. D’où l’excessif dans lequel tombent ces régimes. Les Taiping n’étaient pas différents tant sur le côté moral (excès de puritanisme) que le côté social (un égalitarisme qui n’efface pas la hiérarchie politique) de ces autres mouvements. Aussi, si le Parti Communiste chinois a pu voir un temps les Taiping comme les ancêtres d’une nature paysanne ouverte sur le communisme, il s’en tient aujourd’hui le plus loin possible.
révolutionnaires : la propriété
foncière privée était abolie; nourriture, vêtements et autres biens de
consommation courante étaient mis en commun dans des entrepôts publics, et
distribués à la population selon leurs besoins par leurs chefs militaires; l'opium, le tabac et l'alcool étaient désormais interdits. Cette
révolte à la fois puritaine et millénariste instaura une trêve dans la seconde
guerre d’Opium et c’est par une alliance entre forces mandchoues et britanniques
que l’on parviendra à éradiquer le mouvement. Si le nombre des pertes est inconnu
de part et d’autres, certains n’hésitent pas à l’évaluer entre 20 et 30 000 000
pour les deux camps (le chiffre de 17 millions semble le plus raisonnable). Des événements comme la révolte des Taiping sont un phénomènes que l’on retrouve dans des périodes d’anomie sociale. Les Anabaptistes de Münster (1535) comme l’actuel «Califat» de l’État islamique (2012-2016) sont des millénarismes très différents des luttes sociales ordinaires. D’où l’excessif dans lequel tombent ces régimes. Les Taiping n’étaient pas différents tant sur le côté moral (excès de puritanisme) que le côté social (un égalitarisme qui n’efface pas la hiérarchie politique) de ces autres mouvements. Aussi, si le Parti Communiste chinois a pu voir un temps les Taiping comme les ancêtres d’une nature paysanne ouverte sur le communisme, il s’en tient aujourd’hui le plus loin possible. Derrière cette marche sanglante, il est vrai que
l’esprit national chinois tendait à se redresser, à la fois contre les occupants
mandchous et contre la pénétration occidentale qui la souenait en l’avilissant. La révolte des Boxers (;
littéralement : «mouvement de l'union de la justice et de la concorde»)
fut une révolte fomentée par les Poings de la justice et de la
concorde, autre société secrète dont le symbole était un poing
fermé, d'où le surnom de Boxers
Derrière cette marche sanglante, il est vrai que
l’esprit national chinois tendait à se redresser, à la fois contre les occupants
mandchous et contre la pénétration occidentale qui la souenait en l’avilissant. La révolte des Boxers (;
littéralement : «mouvement de l'union de la justice et de la concorde»)
fut une révolte fomentée par les Poings de la justice et de la
concorde, autre société secrète dont le symbole était un poing
fermé, d'où le surnom de Boxers  donné à ses membres en Occident, et qui
se dé-
donné à ses membres en Occident, et qui
se dé-rou-
la en Chi-
ne,
entre 1899 et 1901. Ce mou-
vement, initialement opposé à la fois aux réformes, aux colons étrangers et au pouvoir féodal de la dynastie Qing fut utilisé par l'impératrice douairière Cixi contre les seuls colons, conduisant à partir du 20 juin 1900 au siège des légations étrangères présentes à Pékin. C'est l'épisode des «55 jours de Pékin», qui se termina par la victoire des huit nations alliées contre la Chine (Autriche-Hongrie, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni et États-Unis). Venant après la guerre sino-japonaise de 1894-1895, que la Chine avait perdue, cette nouvelle défaite apparue comme une étape supplémentaire dans le combat qui opposait conservatisme et colonialisme à réformisme et indépendance. Cette fois-ci, la révolte, qui fit 526 civils étrangers tués, 30 000 Chinois chrétiens, 2 500 militaires occidentaux et 20 000 militaires chinois, se solda par l’anéantissement du mouvement (alors que les Taiping avaient pu survivre quelques temps cachés), tout en sonnant le glas de la dynastie Qing.
 commerciales, chargée de diffuser une
nouvelle littérature de grande consommation. D’autres journaux emboîteront le
pas. Avec l’année 1900, la Chine entre dans une ère nouvelle. Sa démographie
est jeune. L’éducation, la science, le statut de la femme, autant de sujets
«occidentaux» qui deviennent des sujets de portée nationale. Les missions chrétiennes,
après avoir été décimées par les Boxers, se ressaisissent. Mais, «il ne
faudrait cependant pas oublier que l’histoire moderne de la Chine a été faite
par la Chine et non par les étrangers, même si l’activité étrangère a joué
comme un stimulus à la fois négatif (l’agression étrangère) et positif (le
savoir et les institutions étrangères). La principale caractéristique politique
des années 1900 est la naissance du sentiment nationaliste. Malgré son
apparition tardive, ce dernier prenait sa source dans un sens de l’identité
culturelle qui se trouvait profondément ancré dans la société chinoise et ses
traditions. Les Chinois avaient accepté la dynastie mandchoue sinisée. Il leur
fallait accepter la présence occidentale dans les ports ouverts. La tradition
politicienne, appuyée par les exemples étrangers, avait produit le mouvement
des activités à l’occidentale, puis le mouvement de réforme, et enfin les
Boxers. Mais ni les administrateurs bureaucrates ni les lettrés radicaux
n’avaient su créer un nouvel ordre adapté aux besoins de la Chine. Quant aux
rebelles paysans, ils n’avaient bien entendu pas même essayé. Nombreux étaient
ceux en 1900 à qui il apparaissait comme une évidence que la seule solution
restait pour détruire l’ordre ancien était la révolution» (J. K. Fairbank.
op. cit. pp. 210-211).
commerciales, chargée de diffuser une
nouvelle littérature de grande consommation. D’autres journaux emboîteront le
pas. Avec l’année 1900, la Chine entre dans une ère nouvelle. Sa démographie
est jeune. L’éducation, la science, le statut de la femme, autant de sujets
«occidentaux» qui deviennent des sujets de portée nationale. Les missions chrétiennes,
après avoir été décimées par les Boxers, se ressaisissent. Mais, «il ne
faudrait cependant pas oublier que l’histoire moderne de la Chine a été faite
par la Chine et non par les étrangers, même si l’activité étrangère a joué
comme un stimulus à la fois négatif (l’agression étrangère) et positif (le
savoir et les institutions étrangères). La principale caractéristique politique
des années 1900 est la naissance du sentiment nationaliste. Malgré son
apparition tardive, ce dernier prenait sa source dans un sens de l’identité
culturelle qui se trouvait profondément ancré dans la société chinoise et ses
traditions. Les Chinois avaient accepté la dynastie mandchoue sinisée. Il leur
fallait accepter la présence occidentale dans les ports ouverts. La tradition
politicienne, appuyée par les exemples étrangers, avait produit le mouvement
des activités à l’occidentale, puis le mouvement de réforme, et enfin les
Boxers. Mais ni les administrateurs bureaucrates ni les lettrés radicaux
n’avaient su créer un nouvel ordre adapté aux besoins de la Chine. Quant aux
rebelles paysans, ils n’avaient bien entendu pas même essayé. Nombreux étaient
ceux en 1900 à qui il apparaissait comme une évidence que la seule solution
restait pour détruire l’ordre ancien était la révolution» (J. K. Fairbank.
op. cit. pp. 210-211). Sous les Yuan, le sentiment national avait permis
la résurrection d’une dynastie nationale, les Ming. Le premier empereur Qing avait tenu à humilier encore plus la
nationalité han. Mais aucun mouvement nationaliste n’était jailli en réaction à l’humiliation.
Au début du XXe siècle, on passe du pur sentiment national au nationalisme. Une
diaspora chinoise s’est développée à partir du dernier tiers du XIXe siècle.
Ces enclaves, fondées au sein des États-Unis, du Canada et même dans les
Antilles, maintiennent des liens avec les familles d’origine. «Dans tous les
ports d’Asie du Sud-Est, les communautés chinoises disposaient à la fin du
siècle de chambres de commerce, avaient créé leurs propres écoles et constitué
des sociétés secrètes qui resserrraient les liens entre elles. Au tournant du
siècle, les mouvements révolutionnaires conduits par Sun Yat-sen et K’ang
Yu-wei recherchèrent donc avec empressement le soutien des Chinois de
l’étranger. Le gouvernement Ch’ing commença également à se rendre compte que, au
lieu d’exécuter ses citoyens d’outre-mer lorsqu’ils revenaient dans leur pays
après avoir résidé à l’étranger, il valait mieux les traiter favorablement et
considérer qu’ils servaient l’intérêt national chinois. Des fonctionnaires
consulaires furent envoyés outre-mer, et parfois même des délégations du
gouvernement, qui rivalisaient avec les révolutionnaires» (pp. 212-213).
Sous les Yuan, le sentiment national avait permis
la résurrection d’une dynastie nationale, les Ming. Le premier empereur Qing avait tenu à humilier encore plus la
nationalité han. Mais aucun mouvement nationaliste n’était jailli en réaction à l’humiliation.
Au début du XXe siècle, on passe du pur sentiment national au nationalisme. Une
diaspora chinoise s’est développée à partir du dernier tiers du XIXe siècle.
Ces enclaves, fondées au sein des États-Unis, du Canada et même dans les
Antilles, maintiennent des liens avec les familles d’origine. «Dans tous les
ports d’Asie du Sud-Est, les communautés chinoises disposaient à la fin du
siècle de chambres de commerce, avaient créé leurs propres écoles et constitué
des sociétés secrètes qui resserrraient les liens entre elles. Au tournant du
siècle, les mouvements révolutionnaires conduits par Sun Yat-sen et K’ang
Yu-wei recherchèrent donc avec empressement le soutien des Chinois de
l’étranger. Le gouvernement Ch’ing commença également à se rendre compte que, au
lieu d’exécuter ses citoyens d’outre-mer lorsqu’ils revenaient dans leur pays
après avoir résidé à l’étranger, il valait mieux les traiter favorablement et
considérer qu’ils servaient l’intérêt national chinois. Des fonctionnaires
consulaires furent envoyés outre-mer, et parfois même des délégations du
gouvernement, qui rivalisaient avec les révolutionnaires» (pp. 212-213). Sun Yat-sen (1866-1925) était né dans la partie la plus riche et, disons-le, la
plus bourgeoise de la Chine, entre Macao et Canton. Il voyagea très tôt, passant une partie
de sa jeunesse à Hawaï. C’était un déraciné dont le bagage intellectuel était
assez limité. Contrairement à Liang Ch’i-ch’ao, c’était un activiste qui
cherchait des fonds pour soutenir la révolution. Après plusieurs coups manqués,
ses complots animés par des associations de conspirateurs s’orientent vers un
véritable mouvement politique. «Le plus célèbre essai de soulèvement est
celui qui a lieu à Canton le 27 avril 1911 et qui fait 72 victimes (les
"72 martyrs"). L’idéologie républicaine de Sun Wen [vrai nom de
Sun Yat-sen] est assez sommaire : ses trois thèmes fondamentaux (le Sanminzhuyi)
mettent l’accent sur le nationalisme, la démocratie libérale et la justice
sociale. Mais les doctrines importent peu au regard de l’action et les
partisans de Sun Wen (son ami Huang Xing, un Hounanais lié aux sociétés
secrètes de sa province et en relation avec les milieux révolutionnaire des
nouvelles armées, Wang Jingwei (1883-1944), Hu Hanmin (1879-1936), Zhang
Binglin (1868-1936) croient naïvement que le salut de la Chine est entre leurs
mains» (J. Gernet. op. cit. pp. 542-543). Cette faiblesse idéologique
possède en elle les causes de l’échec de la Première République chinoise
Sun Yat-sen (1866-1925) était né dans la partie la plus riche et, disons-le, la
plus bourgeoise de la Chine, entre Macao et Canton. Il voyagea très tôt, passant une partie
de sa jeunesse à Hawaï. C’était un déraciné dont le bagage intellectuel était
assez limité. Contrairement à Liang Ch’i-ch’ao, c’était un activiste qui
cherchait des fonds pour soutenir la révolution. Après plusieurs coups manqués,
ses complots animés par des associations de conspirateurs s’orientent vers un
véritable mouvement politique. «Le plus célèbre essai de soulèvement est
celui qui a lieu à Canton le 27 avril 1911 et qui fait 72 victimes (les
"72 martyrs"). L’idéologie républicaine de Sun Wen [vrai nom de
Sun Yat-sen] est assez sommaire : ses trois thèmes fondamentaux (le Sanminzhuyi)
mettent l’accent sur le nationalisme, la démocratie libérale et la justice
sociale. Mais les doctrines importent peu au regard de l’action et les
partisans de Sun Wen (son ami Huang Xing, un Hounanais lié aux sociétés
secrètes de sa province et en relation avec les milieux révolutionnaire des
nouvelles armées, Wang Jingwei (1883-1944), Hu Hanmin (1879-1936), Zhang
Binglin (1868-1936) croient naïvement que le salut de la Chine est entre leurs
mains» (J. Gernet. op. cit. pp. 542-543). Cette faiblesse idéologique
possède en elle les causes de l’échec de la Première République chinoise véritablement contribué,
sinon comme une force d’appoint relativement négligeable. La
"révolution" de 1911 n’est pas, comme on l’a prétendu afin de l’insérer
dans le schéma d’une évolution historique dont le modèle a été fourni par
l’Europe ou par la théorie marxiste des cinq stades de l’humanité (communisme
primitif, esclavagisme, féodalisme, capitalisme et socialisme), une révolution "bourgeoise", mais un simple intermède dans la décomposition du
pouvoir politique en Chine. Le succès des républicains est inattendu : une
révolte militaire à Wuchang (Hubei) le 10 octobre 1911 déclenche un vate
mouvement de sécession qui gagne la plupart des provinces. Au début de
décembre, la Chine du Sud, du Centre et du Nord-Ouest a rompu avec Pékin, à la
suite d’une alliance entre assemblées provinciales et militaires. Sun Wen
revient des États-Unis et de Grande-Bretagne juste à temps pour être élu
président de la République à Nankin et prend ses fonctions le 1er janvier 1912.
Mais en même temps, il offre à Yuan Shikai la présidence de la République pour
le cas où il serait prêt à défendre le nouveau régime, et cela même révèle bien
l’extrême faiblesse de cette République dépourvue de force militaire et de
revenus. La République n’est en fin de compte, avec l’appoint des groupes
d’émigrés politiques, que la continuation des ancienenes assemblées
provinciales de notables débarrassées de ce semblant de pouvoir central que constituait
le gouvernement de Pékin. En fait, bien que les notables soient d’accord pour
que leurs provinces soient représentées dans un Parlement national, tous les
yeux sont tournés vers Yuan Shikai, le seul homme à disposer d’une armée bien
entraînée et bien équipée, le seul aussi à avoir quelque audience auprès des
nations étrangères. La révolution, qui se fait pratiquement sans effusion de
sang, est avant tout le résultat de l’effacement inéluctable d’une dynastie qui
ne pouvait plus se maintenir qu’à l’aide de ponctions financières sur les
provinces et d’emprunts aux banques étrangères» (J. Gernet. op. cit. p.
543).
véritablement contribué,
sinon comme une force d’appoint relativement négligeable. La
"révolution" de 1911 n’est pas, comme on l’a prétendu afin de l’insérer
dans le schéma d’une évolution historique dont le modèle a été fourni par
l’Europe ou par la théorie marxiste des cinq stades de l’humanité (communisme
primitif, esclavagisme, féodalisme, capitalisme et socialisme), une révolution "bourgeoise", mais un simple intermède dans la décomposition du
pouvoir politique en Chine. Le succès des républicains est inattendu : une
révolte militaire à Wuchang (Hubei) le 10 octobre 1911 déclenche un vate
mouvement de sécession qui gagne la plupart des provinces. Au début de
décembre, la Chine du Sud, du Centre et du Nord-Ouest a rompu avec Pékin, à la
suite d’une alliance entre assemblées provinciales et militaires. Sun Wen
revient des États-Unis et de Grande-Bretagne juste à temps pour être élu
président de la République à Nankin et prend ses fonctions le 1er janvier 1912.
Mais en même temps, il offre à Yuan Shikai la présidence de la République pour
le cas où il serait prêt à défendre le nouveau régime, et cela même révèle bien
l’extrême faiblesse de cette République dépourvue de force militaire et de
revenus. La République n’est en fin de compte, avec l’appoint des groupes
d’émigrés politiques, que la continuation des ancienenes assemblées
provinciales de notables débarrassées de ce semblant de pouvoir central que constituait
le gouvernement de Pékin. En fait, bien que les notables soient d’accord pour
que leurs provinces soient représentées dans un Parlement national, tous les
yeux sont tournés vers Yuan Shikai, le seul homme à disposer d’une armée bien
entraînée et bien équipée, le seul aussi à avoir quelque audience auprès des
nations étrangères. La révolution, qui se fait pratiquement sans effusion de
sang, est avant tout le résultat de l’effacement inéluctable d’une dynastie qui
ne pouvait plus se maintenir qu’à l’aide de ponctions financières sur les
provinces et d’emprunts aux banques étrangères» (J. Gernet. op. cit. p.
543).Contrairement à la Chine qui ne parvient pas à transformer son sentiment national en unité politique et sociale, le Japon va y parvenir dès le XVIe siècle grâce aux shöguns Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu. Un poète de la fin du XVIe siècle, Shôha, a résumé leur caractère et leur politique en trois haikai restés fameux :
 Le premier, Nobunaga, est «le type accompli
de la Renaissance japonaise». Brave combattant, très ambitieux, il était
toutefois d'une cruauté sans pitié et d'un orgueil supérieur. Oda Nobunaga
devait venir à bout des rivalités féodales qui opposaient les grands Daimyô
dans des guerres intestines ruineuses et menaçantes pour la sécurité d’un Japon
qui ne s'était pas encore remis des tentatives d'invasions venues du continent. Les
uns après les autres, les clans rivaux sont vaincus voire exterminés par les samurai d’Obunaga.
De même il s'en prendra aux monastères bouddhiques. Ainsi, la manière dont il
parvint à réduire la secte jödo-shinshû, à Osaka, où les bonzes avaient érigé
une véritable forteresse, laisse froid dans le dos. Depuis 1574, Nobunaga et ses généraux ne
parvenaient pas à s'emparer du monastère. Mais le soir de l'assaut final prévu, «les
femmes, les enfants, les vieillards furent évacués de nuit en 1579 : Nobunaga
les intercepta et leur fit couper nez et oreilles; soixante mille hommes
maintenaient le siège; les pertes étaient éormes des deux côtés; quand les
assaillants se furent emparés d'une partie des édifices, l'empereur intervint
et un arrangement fut conclu (1580); les bonzes sortirent du temple qu'ils
incendièrent, et le Hongan-jí [école du bouddhisme japonais] fut transféré à Nakajímaen Settsu, puis, en 1601,
à Kyôto. Ce fut, en même temps, la fin des guerres civiles suscitées par cette
secte - les Ikhóto no ran - qui duraient depuis le début du siècle. (p.
168). Bref, c'est ainsi que Nobunaga s'était rendu maître de 32 provinces sur
les 68 que comprenait le Japon. Sa fin fut tragique. Au cours d'une marche pour
aider
Le premier, Nobunaga, est «le type accompli
de la Renaissance japonaise». Brave combattant, très ambitieux, il était
toutefois d'une cruauté sans pitié et d'un orgueil supérieur. Oda Nobunaga
devait venir à bout des rivalités féodales qui opposaient les grands Daimyô
dans des guerres intestines ruineuses et menaçantes pour la sécurité d’un Japon
qui ne s'était pas encore remis des tentatives d'invasions venues du continent. Les
uns après les autres, les clans rivaux sont vaincus voire exterminés par les samurai d’Obunaga.
De même il s'en prendra aux monastères bouddhiques. Ainsi, la manière dont il
parvint à réduire la secte jödo-shinshû, à Osaka, où les bonzes avaient érigé
une véritable forteresse, laisse froid dans le dos. Depuis 1574, Nobunaga et ses généraux ne
parvenaient pas à s'emparer du monastère. Mais le soir de l'assaut final prévu, «les
femmes, les enfants, les vieillards furent évacués de nuit en 1579 : Nobunaga
les intercepta et leur fit couper nez et oreilles; soixante mille hommes
maintenaient le siège; les pertes étaient éormes des deux côtés; quand les
assaillants se furent emparés d'une partie des édifices, l'empereur intervint
et un arrangement fut conclu (1580); les bonzes sortirent du temple qu'ils
incendièrent, et le Hongan-jí [école du bouddhisme japonais] fut transféré à Nakajímaen Settsu, puis, en 1601,
à Kyôto. Ce fut, en même temps, la fin des guerres civiles suscitées par cette
secte - les Ikhóto no ran - qui duraient depuis le début du siècle. (p.
168). Bref, c'est ainsi que Nobunaga s'était rendu maître de 32 provinces sur
les 68 que comprenait le Japon. Sa fin fut tragique. Au cours d'une marche pour
aider  Hideyoshi à donner le coup de grâce à Môri Terumoto replié à Takamatsu,
Nobunaga avait envoyer ses généraux aider son allié. «lui-même s'arrêta à
Kyôto avec une faible escorte d'une centaine d'hommes seulement et s'installa
dans le temple Honnô-ji. Akechi Mitsuhide, au lieu de rallier Hideyoshi,
pénétra dans Kyôto et assaillit Honnô-ji; Nobunaga opposa une défense
désespérée, mais il fut grièvement blessé par une flèche, et, se voyant perdu,
incendia le temple et fit harakiri (22 juin 1852). Son fils aîné, Nobutada, qui
avait établi ses quartiers dans le temple Myôdô-ji, ne put porter secours à
temps à son père, se retira dans le palais de Nijô o,û il fut attaqué à son
tour, et se donna la mort» (p. 169). De tels récits où la trahison et les
gestes accomplis avec panache rappels les chroniques de la Renaissance
italienne.
Hideyoshi à donner le coup de grâce à Môri Terumoto replié à Takamatsu,
Nobunaga avait envoyer ses généraux aider son allié. «lui-même s'arrêta à
Kyôto avec une faible escorte d'une centaine d'hommes seulement et s'installa
dans le temple Honnô-ji. Akechi Mitsuhide, au lieu de rallier Hideyoshi,
pénétra dans Kyôto et assaillit Honnô-ji; Nobunaga opposa une défense
désespérée, mais il fut grièvement blessé par une flèche, et, se voyant perdu,
incendia le temple et fit harakiri (22 juin 1852). Son fils aîné, Nobutada, qui
avait établi ses quartiers dans le temple Myôdô-ji, ne put porter secours à
temps à son père, se retira dans le palais de Nijô o,û il fut attaqué à son
tour, et se donna la mort» (p. 169). De tels récits où la trahison et les
gestes accomplis avec panache rappels les chroniques de la Renaissance
italienne.  Ce fut donc Hideyoshi qui récupéra la tâche
d'en finir avec les Daimyô résistants. «Hideyoshi n'appartenait pas à la
noblesse nippone; sorti du peuple, il s'était élevé par sa valeur personnelle.
Son père était un ancien militaire, rendu inapte par une blessure, et devenu
bonze […] Lui-même était disgracié par la nature, petit et laid; étant
enfant, il était surnommé "figure de singe". D’un caractère
ingouvernable, ne reconnaissant aucun maître, il ne put rester au temple où il
avait été mis pour faire de lui un bonze. Il exerça de nombreux métiers,
jusqu’au jour où il entra au service de Nobunaga, qu’il jugea seul digne de le
commander. Celui-ci remarqua bientôt sa vive intelligence et lui donna sa
confiance. Hideyoshi devint rapidement son principal conseiller et son meilleur
général» (p. 171). L’un des Daimyô résistant, Shibata Katsuie, s’était
réfugié dans son château où Hideyoshi vint l’assiéger : «se voyant perdu, il
donna un grand festin, avec chants et danses, auxquel participèrent hommes et
femmes, puis toutes les femmes furent tuées, à commencer par la sienne, sœur de
Nobunaga, le château fut incendié et les hommes se donnèrent la mort. L’Echizen
et le Kaga tombaient aux mains de Hideyoshi» (p. 171). Pour peu, on se croirait dans
le tableau de Delacroix, La mort de Sardanapale.
Ce fut donc Hideyoshi qui récupéra la tâche
d'en finir avec les Daimyô résistants. «Hideyoshi n'appartenait pas à la
noblesse nippone; sorti du peuple, il s'était élevé par sa valeur personnelle.
Son père était un ancien militaire, rendu inapte par une blessure, et devenu
bonze […] Lui-même était disgracié par la nature, petit et laid; étant
enfant, il était surnommé "figure de singe". D’un caractère
ingouvernable, ne reconnaissant aucun maître, il ne put rester au temple où il
avait été mis pour faire de lui un bonze. Il exerça de nombreux métiers,
jusqu’au jour où il entra au service de Nobunaga, qu’il jugea seul digne de le
commander. Celui-ci remarqua bientôt sa vive intelligence et lui donna sa
confiance. Hideyoshi devint rapidement son principal conseiller et son meilleur
général» (p. 171). L’un des Daimyô résistant, Shibata Katsuie, s’était
réfugié dans son château où Hideyoshi vint l’assiéger : «se voyant perdu, il
donna un grand festin, avec chants et danses, auxquel participèrent hommes et
femmes, puis toutes les femmes furent tuées, à commencer par la sienne, sœur de
Nobunaga, le château fut incendié et les hommes se donnèrent la mort. L’Echizen
et le Kaga tombaient aux mains de Hideyoshi» (p. 171). Pour peu, on se croirait dans
le tableau de Delacroix, La mort de Sardanapale. Hideyoshi atteignait le sommet de sa gloire. Avec son bras droit, Yeyasu, il
parvenait à éteindre tous les feux qui s’élevaient un peu partout au Japon et
les vaincus finissaient par se soumettre. «Hideyoshi était désormais le
maître incontesté de tout le pays». C’est alors qu’Hideyoshi
s’engagea dans une guerre contre la Corée. On dispute encore à savoir les vrais
raisons de cette agression. On parle du besoin de maintenir les soldats occupés
afin que les troubles ne reprennent pas au Japon ou encore à l’extension des
liens commerciaux avec la Corée d’abord, puis la Chine ensuite. Plus probable
que la Corée était perçue comme le point de départ des tentatives antérieures
des Mongols en vue d’envahir le Japon et qu’il valait mieux en faire un état
tampon au service du Japon que d’attendre que les Ming s’en servent à nouveau
pour menacer le pays. Quoi qu’il en soit une querelle d’ambassades conduisit à
la campagne de 1592. Le débarquement réussi, les paysans coréens se soulevèrent
et firent la guérilla aux envahisseurs. L’Empereur de Chine s’en mêla et lança
un ultimatum du retrait des troupes nippones de la péninsule. Hideyoshi ne
demanda que le rétablissement des liens commerciaux, mais l’Empereur refusa. Ce
fut l’occasion d’une seconde campagne en 1597. «Tout au long de l’été [1598],
les combats firent rage et la guerre tourna à l’avantage des Japonais. Konishi
envoya à Hideyoshi les oreilles de 38 000 soldats ennemis et on peut voir
encore de nos jours à Kyoto le Mimizuka ou "Mausolée des Oreilles".
La guerre aurait pu durer encore longtemps mais la mort de Hideyoshi le 18
septembre 1598 vint y mettre fin. Les Japonais n’avaient plus de raison de
rester en Corée et retirèrent rapidement toutes leurs forces» (A. Fabre.
op. cit. p. 259). La Corée resterait satellite de l’Empire du Milieu.
Hideyoshi atteignait le sommet de sa gloire. Avec son bras droit, Yeyasu, il
parvenait à éteindre tous les feux qui s’élevaient un peu partout au Japon et
les vaincus finissaient par se soumettre. «Hideyoshi était désormais le
maître incontesté de tout le pays». C’est alors qu’Hideyoshi
s’engagea dans une guerre contre la Corée. On dispute encore à savoir les vrais
raisons de cette agression. On parle du besoin de maintenir les soldats occupés
afin que les troubles ne reprennent pas au Japon ou encore à l’extension des
liens commerciaux avec la Corée d’abord, puis la Chine ensuite. Plus probable
que la Corée était perçue comme le point de départ des tentatives antérieures
des Mongols en vue d’envahir le Japon et qu’il valait mieux en faire un état
tampon au service du Japon que d’attendre que les Ming s’en servent à nouveau
pour menacer le pays. Quoi qu’il en soit une querelle d’ambassades conduisit à
la campagne de 1592. Le débarquement réussi, les paysans coréens se soulevèrent
et firent la guérilla aux envahisseurs. L’Empereur de Chine s’en mêla et lança
un ultimatum du retrait des troupes nippones de la péninsule. Hideyoshi ne
demanda que le rétablissement des liens commerciaux, mais l’Empereur refusa. Ce
fut l’occasion d’une seconde campagne en 1597. «Tout au long de l’été [1598],
les combats firent rage et la guerre tourna à l’avantage des Japonais. Konishi
envoya à Hideyoshi les oreilles de 38 000 soldats ennemis et on peut voir
encore de nos jours à Kyoto le Mimizuka ou "Mausolée des Oreilles".
La guerre aurait pu durer encore longtemps mais la mort de Hideyoshi le 18
septembre 1598 vint y mettre fin. Les Japonais n’avaient plus de raison de
rester en Corée et retirèrent rapidement toutes leurs forces» (A. Fabre.
op. cit. p. 259). La Corée resterait satellite de l’Empire du Milieu. nombreuses conversions.
Hideyoshi vit certains de ses généraux, son médecin et ses 800 élèves de même
que des dames de la cour se convertir. Cela suffit à faire naître en lui un esprit de suspicion :
nombreuses conversions.
Hideyoshi vit certains de ses généraux, son médecin et ses 800 élèves de même
que des dames de la cour se convertir. Cela suffit à faire naître en lui un esprit de suspicion : Mexique avec une
riche cargaison, et avait été désemparé par un typhon, vint s’échouer dans le
port d’Urado en Tosa, sur la côte sud de Shikoku; sa cargaison fut confisquée,
et comme des armes furent trouvées à bord, sa présence parut suspecte; le
pilote, interrogé, montra sur une carte les vastes possessions du roi d’Espagne
et déclara, par vantardise, que les missionnaires préparaient les voies aux
conquérants. Ces propos éveillèrent les soupçons du taikô; six franciscains
espagnols et vingt chrétiens japonais, dont trois jésuites pris par mégarde,
furent condamnés à être crucifiés à Nagasaki : ce furent les vingt six premiers
martyrs du Japon (5 février 1597). Les Jésuites, grâce à leurs amitiés à la
cour, ne furent pas inquiétés. Après que de nombreuses églises eurent été
détruites dans Kyûshû, les persécutions cessèrent, et les relations avec les
Portugais et même les Espagnols n’en furent pas affectées. Néanmoins, lorsque
Hideyoshi passa de vie à trépas, les chrétiens éprouvèrent, d’après les jésuites,
un véritable soulagement» (p. 182).
Mexique avec une
riche cargaison, et avait été désemparé par un typhon, vint s’échouer dans le
port d’Urado en Tosa, sur la côte sud de Shikoku; sa cargaison fut confisquée,
et comme des armes furent trouvées à bord, sa présence parut suspecte; le
pilote, interrogé, montra sur une carte les vastes possessions du roi d’Espagne
et déclara, par vantardise, que les missionnaires préparaient les voies aux
conquérants. Ces propos éveillèrent les soupçons du taikô; six franciscains
espagnols et vingt chrétiens japonais, dont trois jésuites pris par mégarde,
furent condamnés à être crucifiés à Nagasaki : ce furent les vingt six premiers
martyrs du Japon (5 février 1597). Les Jésuites, grâce à leurs amitiés à la
cour, ne furent pas inquiétés. Après que de nombreuses églises eurent été
détruites dans Kyûshû, les persécutions cessèrent, et les relations avec les
Portugais et même les Espagnols n’en furent pas affectées. Néanmoins, lorsque
Hideyoshi passa de vie à trépas, les chrétiens éprouvèrent, d’après les jésuites,
un véritable soulagement» (p. 182). de
la personne de l’empereur, il ne voulut pas restaurer son autorité et prétendit
demeurer le seul maître. Le rouage essentiel de sa machinerie administrative
furent les cinq ministres ou bugyô, avec lesquels il dirigea les affaires et
qui étaient respectivement chargés des travaux publics, des finances et de
l’agriculture, de la police et des affaires criminelles, de la justice, des
cultes; lui-même était son propre ministre des affaires étrangères. Ces bugyô
étaient des parvenus que le taikô avait dotés de fiefs importants; outre ces
fiefs, ils administraient les possessions de Hideyoshi, mais n’intervenaient
pas dans la gestion interne des grands daimyata : la centralisation était donc
encore incomplète. Les ministres de l’empereur subsistaient, mais n’avaient
plus qu’une existence théorique et honorifique. Pour lui-même, Hideyoshi
s’était fixé des règles de conduite de travail, voire de philosophie, qu’il
exprimait en maximes toujours présentes à son esprit et souvent à ses yeux. Un
recensement des terres fut ordonné et les impôts furent réformés. L’unité de
mesure agraire, le lan, fut réduite, si bien que l’impôt foncier se
trouva accru d’environ vingt pour cent et pesa plus lourdement sur la
paysannerie. Des monnaies d’or et d’argent furent frappées, les sens
continuèrent à être utilisés» (pp. 182-183).
de
la personne de l’empereur, il ne voulut pas restaurer son autorité et prétendit
demeurer le seul maître. Le rouage essentiel de sa machinerie administrative
furent les cinq ministres ou bugyô, avec lesquels il dirigea les affaires et
qui étaient respectivement chargés des travaux publics, des finances et de
l’agriculture, de la police et des affaires criminelles, de la justice, des
cultes; lui-même était son propre ministre des affaires étrangères. Ces bugyô
étaient des parvenus que le taikô avait dotés de fiefs importants; outre ces
fiefs, ils administraient les possessions de Hideyoshi, mais n’intervenaient
pas dans la gestion interne des grands daimyata : la centralisation était donc
encore incomplète. Les ministres de l’empereur subsistaient, mais n’avaient
plus qu’une existence théorique et honorifique. Pour lui-même, Hideyoshi
s’était fixé des règles de conduite de travail, voire de philosophie, qu’il
exprimait en maximes toujours présentes à son esprit et souvent à ses yeux. Un
recensement des terres fut ordonné et les impôts furent réformés. L’unité de
mesure agraire, le lan, fut réduite, si bien que l’impôt foncier se
trouva accru d’environ vingt pour cent et pesa plus lourdement sur la
paysannerie. Des monnaies d’or et d’argent furent frappées, les sens
continuèrent à être utilisés» (pp. 182-183). Hideyoshi, toujours dans l’esprit de la
Renaissance japonaise, fit construire de grands palais généralement protégés
par de fortes murailles. La mentalité de garnison semblait le prendre de plus
en plus. C’étaient de formidables forteresses avec fossés et murailles faites
d’énormes blocs de pierres. Les temples et les églises contribuaient à
l’embellissement des grandes villes nippones. Comme ses contemporains italiens,
il aimait les fêtes somptueuses et les triomphes. Fervent adepte du cha-no-yu,
la cérémonie du thé, le maître Sen Hikyô jouissait d’une grande faveur auprès
de lui. Il organisa l’énorme cérémonie de thé que Hideyoshi donna en 1587 dans
le bois de Kitano, près de Kyôto où avaient été conviés tous les amateurs de thé
de l’empire par un édit officiel, avec ordre d’apporter tous les objets
précieux se rapportant à cette cérémonie. Six mille personnes répondirent à
l’appel. Plus qu’en Chine encore, les arts plastiques étaient encouragés par Hideyoshi. Le
costume, l’armement, tout ce qui appartient à l’art de la guerre, furent de
même embellis et perfectionnés. Du Bouddhisme, Hideyoshi hérita le principe de
l’égalité devant les compétences, ramenant de la métempsychose, l’égalité
social, l’affranchissement en masse des paysans et leur mutation en soldats
avec ce qu’elle comporte de vertu et de morale chevaleresque.
Hideyoshi, toujours dans l’esprit de la
Renaissance japonaise, fit construire de grands palais généralement protégés
par de fortes murailles. La mentalité de garnison semblait le prendre de plus
en plus. C’étaient de formidables forteresses avec fossés et murailles faites
d’énormes blocs de pierres. Les temples et les églises contribuaient à
l’embellissement des grandes villes nippones. Comme ses contemporains italiens,
il aimait les fêtes somptueuses et les triomphes. Fervent adepte du cha-no-yu,
la cérémonie du thé, le maître Sen Hikyô jouissait d’une grande faveur auprès
de lui. Il organisa l’énorme cérémonie de thé que Hideyoshi donna en 1587 dans
le bois de Kitano, près de Kyôto où avaient été conviés tous les amateurs de thé
de l’empire par un édit officiel, avec ordre d’apporter tous les objets
précieux se rapportant à cette cérémonie. Six mille personnes répondirent à
l’appel. Plus qu’en Chine encore, les arts plastiques étaient encouragés par Hideyoshi. Le
costume, l’armement, tout ce qui appartient à l’art de la guerre, furent de
même embellis et perfectionnés. Du Bouddhisme, Hideyoshi hérita le principe de
l’égalité devant les compétences, ramenant de la métempsychose, l’égalité
social, l’affranchissement en masse des paysans et leur mutation en soldats
avec ce qu’elle comporte de vertu et de morale chevaleresque. Ce fut alors à Ieyasu que vint la tâche d’en
terminer avec l’unité et la centralisation du Japon. L’occasion de la mort de
Hideyoshi suffisait à ranimer les ambitions refoulées. Mais Ieyasu les prit de
vitesse en convoquant son armée et en se portant contre les fiefs rebelles. Une
bataille stratégique fut livrée le matin du 21 octobre 1600 à Sekigahara et «est
considérée comme l’une des plus importantes du Japon, car elle fut capitale
pour les destinées de l’empire. La victoire remportée par Ieyasu fit de lui le
maître incontesté du pay» (p. 187). «En 1603, il obtint de
Go-Yôzei-tennô le titre de shôgun. Mais instruit par les exemples de Nobunaga
et de Hideyoshi, il voulut assurer la transmission de cette
Ce fut alors à Ieyasu que vint la tâche d’en
terminer avec l’unité et la centralisation du Japon. L’occasion de la mort de
Hideyoshi suffisait à ranimer les ambitions refoulées. Mais Ieyasu les prit de
vitesse en convoquant son armée et en se portant contre les fiefs rebelles. Une
bataille stratégique fut livrée le matin du 21 octobre 1600 à Sekigahara et «est
considérée comme l’une des plus importantes du Japon, car elle fut capitale
pour les destinées de l’empire. La victoire remportée par Ieyasu fit de lui le
maître incontesté du pay» (p. 187). «En 1603, il obtint de
Go-Yôzei-tennô le titre de shôgun. Mais instruit par les exemples de Nobunaga
et de Hideyoshi, il voulut assurer la transmission de cette  dignité dans sa
famille; c’est dans ce but qu’il abdiqua deux ans plus tard en faveur de son
fils Hidetada; celui-ci s’installa dans la capitale shôgunale, Edo, tandis que
son père se retira à Sumpu (aujourd’hui Shizuoka) en Suruga, mais continua
néanmoins à assumer la charge du gouvernement tout en se consacrant à la
littérature et à la poésie» (p. 188). Un dernier damiyô s’opposa à la
nouvelle dynastie shôgunale des Tokugawa, Hideyori. En novembre 1614, il avait
organisé une puissante armée et occupa Osaka. Ieyasu leva l’armée shôgunale et
se porta à l’assaut de la forteresse. C’est là qu’il fut blessé. Osaka fut
prise et les partisans de Hideyori, femmes et enfants compris, furent
impitoyablement massacrés. La patience de Ieyasu avait quand même sa limite.
Ieyasu mourut le 1er juin, suite à la blessure subie au siège d’Osaka. Habile
administrateur et fin politique :
dignité dans sa
famille; c’est dans ce but qu’il abdiqua deux ans plus tard en faveur de son
fils Hidetada; celui-ci s’installa dans la capitale shôgunale, Edo, tandis que
son père se retira à Sumpu (aujourd’hui Shizuoka) en Suruga, mais continua
néanmoins à assumer la charge du gouvernement tout en se consacrant à la
littérature et à la poésie» (p. 188). Un dernier damiyô s’opposa à la
nouvelle dynastie shôgunale des Tokugawa, Hideyori. En novembre 1614, il avait
organisé une puissante armée et occupa Osaka. Ieyasu leva l’armée shôgunale et
se porta à l’assaut de la forteresse. C’est là qu’il fut blessé. Osaka fut
prise et les partisans de Hideyori, femmes et enfants compris, furent
impitoyablement massacrés. La patience de Ieyasu avait quand même sa limite.
Ieyasu mourut le 1er juin, suite à la blessure subie au siège d’Osaka. Habile
administrateur et fin politique : «Il édifia une minutieuse organisation
politique et adminis-
«Il édifia une minutieuse organisation
politique et adminis-trative, si puissante qu’elle subsista et conserva le pouvoir à ses descendants jusqu’en 1867. Les principes de son gouvernement sont résumés dans un document qu’on a appelé le "Testament de Ieyasu", mais dont la plus grande partie n’a été rédigée qu’après sa mort; en s’inspirant de ces principes, les Tokugawa élaborèrent des lois et des réglements successifs en matière administrative, pénale, civile et commerciale; Ieyasu lui-même, après la prise d’Osaka et avant de retourner à Sumpu, édicta un règlement pour les buke et les amurai et, en accord avec le kampaku Nijô Akizane, un code des kuge. Mais déjà l’ensemble de son système avait commencé à être appliqué.
 Ieyazu continua le mouvement de civilisation amorcé par Hideyoshi.
Les arts et les lettres furent cultivés. Ieyasu n’était pas hanté par des rêves
d’expansion comme son prédécesseur. Il s’efforça, dans un premier temps, d’étendre le commerce avec
les étrangers et, pour cette raison, toléra l’établissement des missions
catholiques au Japon. Il fit chercher le franciscain Jeronimo afin de nouer des
contacts plus étroits avec le roi d’Espagne, mais celui-ci déclina l’offre du
shôgun qui en fut fort contrit. Aussi, lorsqu’un navire hollandais atterri en
piteux état suite à un coup de typhon, le 19 avril 1600, Ieyasu prit-il contact
avec le capitaine-major du groupe, l’Anglais Will Adams (c’est l’anecdote raconté
dans le célèbre roman de James Clavell, Shôgun, 1975). Les qualités de
Adams séduisirent Ieyasu pour lequel il participa à la construction d’un navire
dont le tonnage équivalait à celui des navires portugais et espagnols.
Pleinement satisfait, Ieysu le gratifia d’honneurs, lui fit épouser une
japonaise pour lui faire oublier son épouse laissée en Europe et finit ses
jours, séquestré dans une cage dorée à Edo en 1620.
Ieyazu continua le mouvement de civilisation amorcé par Hideyoshi.
Les arts et les lettres furent cultivés. Ieyasu n’était pas hanté par des rêves
d’expansion comme son prédécesseur. Il s’efforça, dans un premier temps, d’étendre le commerce avec
les étrangers et, pour cette raison, toléra l’établissement des missions
catholiques au Japon. Il fit chercher le franciscain Jeronimo afin de nouer des
contacts plus étroits avec le roi d’Espagne, mais celui-ci déclina l’offre du
shôgun qui en fut fort contrit. Aussi, lorsqu’un navire hollandais atterri en
piteux état suite à un coup de typhon, le 19 avril 1600, Ieyasu prit-il contact
avec le capitaine-major du groupe, l’Anglais Will Adams (c’est l’anecdote raconté
dans le célèbre roman de James Clavell, Shôgun, 1975). Les qualités de
Adams séduisirent Ieyasu pour lequel il participa à la construction d’un navire
dont le tonnage équivalait à celui des navires portugais et espagnols.
Pleinement satisfait, Ieysu le gratifia d’honneurs, lui fit épouser une
japonaise pour lui faire oublier son épouse laissée en Europe et finit ses
jours, séquestré dans une cage dorée à Edo en 1620. Les commerçants hollandais, protestants,
ouvrirent donc la compétition avec les navires hispano-portugais, catholiques.
Bientôt, les Anglais allaient les rejoindre. Ce que Ieyasu comprit vite, c’est
la rivalité exacerbée qui opposait les groupes nationaux les uns aux autres.
Tolérant en matière religieuse, Ieyasu laissa les missionnaires catholiques
faire du prosélytisme, mais les sectes bouddhistes s’en montrèrent marri.
Ieyasu cependant «se rendait compte des agissements des
religieux, et Hollandais et Anglais se chargeaient de le mettre en garde. Il
voyait les excès des catholiques contre les bouddhistes dans les districts où
ils étaient nombreux et forts, les querelles des religieux espagnols et des
jésuites portugais, les intrigues des derniers pour faire expulser les
Espagnols et celles des Espagnols pour chasser les Hollandais; il connaissait
les luttes religieuses de l’Occident et était prévenu contre les visées
politiques - réelles ou supposées - des Espagnols; s’il tolérait les
conversions des gens du peuple, il n’aimait pas celles des daimyô et des
amurai; il savait aussi que bien des chrétiens soutenaient la cause de
Hideyori. Ce sont toutes ces raisons, d’ordre politique, beaucoup plus que des
motifs religieux, qui décidèrent Ieyasu à modifier son attitude. En 1611, il
publia un premier édit contre les chrétiens, puis, en 1614, un édit de
proscription générale du christianisme : les missionnaires furent chassés; les
chrétiens de Hondo furent exilés dans le Nord; certains, surtout dans la classe
militaire, furent exécutés; d’autres durent s’expatrier, tels Takayama Ukon
(Don Justo), qui mourut, à Manille en 1615, et sa famille, Naitô Yukiyasu
(Jean), une fille de Otomo Sôrin, et d’autres encore; les églises furent
rasées; à Nagasaki, la persécution fut particulièrement cruelle. Après la prise
de la forteresse d’Osaka, Ieyasu décréta, peu avant sa mort, une nouvelle
proscription» (p. 198).
Les commerçants hollandais, protestants,
ouvrirent donc la compétition avec les navires hispano-portugais, catholiques.
Bientôt, les Anglais allaient les rejoindre. Ce que Ieyasu comprit vite, c’est
la rivalité exacerbée qui opposait les groupes nationaux les uns aux autres.
Tolérant en matière religieuse, Ieyasu laissa les missionnaires catholiques
faire du prosélytisme, mais les sectes bouddhistes s’en montrèrent marri.
Ieyasu cependant «se rendait compte des agissements des
religieux, et Hollandais et Anglais se chargeaient de le mettre en garde. Il
voyait les excès des catholiques contre les bouddhistes dans les districts où
ils étaient nombreux et forts, les querelles des religieux espagnols et des
jésuites portugais, les intrigues des derniers pour faire expulser les
Espagnols et celles des Espagnols pour chasser les Hollandais; il connaissait
les luttes religieuses de l’Occident et était prévenu contre les visées
politiques - réelles ou supposées - des Espagnols; s’il tolérait les
conversions des gens du peuple, il n’aimait pas celles des daimyô et des
amurai; il savait aussi que bien des chrétiens soutenaient la cause de
Hideyori. Ce sont toutes ces raisons, d’ordre politique, beaucoup plus que des
motifs religieux, qui décidèrent Ieyasu à modifier son attitude. En 1611, il
publia un premier édit contre les chrétiens, puis, en 1614, un édit de
proscription générale du christianisme : les missionnaires furent chassés; les
chrétiens de Hondo furent exilés dans le Nord; certains, surtout dans la classe
militaire, furent exécutés; d’autres durent s’expatrier, tels Takayama Ukon
(Don Justo), qui mourut, à Manille en 1615, et sa famille, Naitô Yukiyasu
(Jean), une fille de Otomo Sôrin, et d’autres encore; les églises furent
rasées; à Nagasaki, la persécution fut particulièrement cruelle. Après la prise
de la forteresse d’Osaka, Ieyasu décréta, peu avant sa mort, une nouvelle
proscription» (p. 198). Ce
processus de fermeture du Japon fut sans précédent. Hidetada, le successeur
d’Ieyasu renouvela la persécution des chrétiens. Il édicta l’exil de tous les
religieux et la peine de mort pour ceux qui auraient des contacts avec eux. En
1622, il soupçonna l’Église catholique d’apporter sa complicité dans des
complots espagnols pour envahir le Japon, ce qui fit augmenter la virulance des
édits : «en même temps, les relations avec l’étranger étaient restreintes :
en 1617, seuls les ports de Hirado et de Nagasaki restèrent ouverts au commerce
extéreiur; il fut défendu, en 1621, aux Japonais de quitter leur pays» (p.
201). Iemitzu, son fils et successeur, fut encore plus intraitable : «Iemitsu
n’avait que dix-neuf ans lorsqu’il accéda au shôgunat. Mais il était très
volontaire et autoritaire : on l’a comparé, pour ce trait de caractère, à Louis
XIV. Dès la mort de son père, il sut s’imposer et obtenir des grands vassaux
une absolue soumission. Par la loi sankin-kôdai, de 1634, il obligea les
daimyô à séjourner six mois de l’année à Edo et, lorsqu’ils étaient dans leurs
domaines, à laisser leurs femmes et leurs enfants en otages à la capitale. Il
fut le premier shôgun qui employa le titre de taikun dans ses relations
avec les étrangers» (p. 202). Iemitsu ordonna de pourchasser avec cruauté
tous les chrétiens en terre japonaise. il fallait les exterminer. À cela
s’ajouta des insurrections dans la presqu’île de Shimabara et dans les îles
Amakusa suite aux exactions des daimyô de l’endroit. L’armée shôgunale fit
appel à l’artillerie produite par les Hollandais et put ainsi venir à bout des
rebelles. Mais la paranoïa de Iemitsu était sans bornes et commanda sa politique dite de sakoku, de fermeture du Japon :
Ce
processus de fermeture du Japon fut sans précédent. Hidetada, le successeur
d’Ieyasu renouvela la persécution des chrétiens. Il édicta l’exil de tous les
religieux et la peine de mort pour ceux qui auraient des contacts avec eux. En
1622, il soupçonna l’Église catholique d’apporter sa complicité dans des
complots espagnols pour envahir le Japon, ce qui fit augmenter la virulance des
édits : «en même temps, les relations avec l’étranger étaient restreintes :
en 1617, seuls les ports de Hirado et de Nagasaki restèrent ouverts au commerce
extéreiur; il fut défendu, en 1621, aux Japonais de quitter leur pays» (p.
201). Iemitzu, son fils et successeur, fut encore plus intraitable : «Iemitsu
n’avait que dix-neuf ans lorsqu’il accéda au shôgunat. Mais il était très
volontaire et autoritaire : on l’a comparé, pour ce trait de caractère, à Louis
XIV. Dès la mort de son père, il sut s’imposer et obtenir des grands vassaux
une absolue soumission. Par la loi sankin-kôdai, de 1634, il obligea les
daimyô à séjourner six mois de l’année à Edo et, lorsqu’ils étaient dans leurs
domaines, à laisser leurs femmes et leurs enfants en otages à la capitale. Il
fut le premier shôgun qui employa le titre de taikun dans ses relations
avec les étrangers» (p. 202). Iemitsu ordonna de pourchasser avec cruauté
tous les chrétiens en terre japonaise. il fallait les exterminer. À cela
s’ajouta des insurrections dans la presqu’île de Shimabara et dans les îles
Amakusa suite aux exactions des daimyô de l’endroit. L’armée shôgunale fit
appel à l’artillerie produite par les Hollandais et put ainsi venir à bout des
rebelles. Mais la paranoïa de Iemitsu était sans bornes et commanda sa politique dite de sakoku, de fermeture du Japon : «Mais
faire disparaître les chrétiens ne suffisait pas à Iemitsu : il redoutait les
manœuvres et les visées des étrangers, et résolut de les éliminer et d’écarter
tout contact avec eux. Dès 1623, le bakufu refusa de recevoir une ambassade
espagnole. L’édit de 1633 interdit de se rendre à l’étranger à tout navire
autre que les go-shuin-bune, c’est-à-dire ceux qui auraient reçu une patente scellée du sceau rouge (go-shu-in) du shôgun; en outre,
tout Japonais revenant, après un délai accordé, d’un pays étranger où il était
domicilié devait être mis à mort; celui qui chercherait à quitter le Japon
serait passible du même sort. En 1634, ces prescriptions furent renforcées.
Pour empêcher plus sûrement les navires japonais de se livrer à la navigation
lointaine, défense fut faite, en 1637, de construire des bateaux d’un tonnage
supérieur à cinq cents koku. Les Portugais, qui étaient suspectés de complicité
dans la
«Mais
faire disparaître les chrétiens ne suffisait pas à Iemitsu : il redoutait les
manœuvres et les visées des étrangers, et résolut de les éliminer et d’écarter
tout contact avec eux. Dès 1623, le bakufu refusa de recevoir une ambassade
espagnole. L’édit de 1633 interdit de se rendre à l’étranger à tout navire
autre que les go-shuin-bune, c’est-à-dire ceux qui auraient reçu une patente scellée du sceau rouge (go-shu-in) du shôgun; en outre,
tout Japonais revenant, après un délai accordé, d’un pays étranger où il était
domicilié devait être mis à mort; celui qui chercherait à quitter le Japon
serait passible du même sort. En 1634, ces prescriptions furent renforcées.
Pour empêcher plus sûrement les navires japonais de se livrer à la navigation
lointaine, défense fut faite, en 1637, de construire des bateaux d’un tonnage
supérieur à cinq cents koku. Les Portugais, qui étaient suspectés de complicité
dans la  révolte de Shimabara, furent chassés en 1638. Un édit de 1639 interdit
à quiconque, sous peine de mort, d’atterrir au Japon, même en qualité
d’ambassadeur; si bien que les quatre ambassadeurs portugais, envoyés en 1640
de Macao à Nagasaki pour demander la reprise des relations commerciales, furent
décapités avec leur suite. Quant aux Hollandais, ils conservèrent le droit de
trafiquer; mais, malgré leurs complaisances pour la répression du soulèvement
de Shimabara, ils durent démolir, en 1638, leur dépôt de hirado trop solidement
construit en pierres; puis, à partir de 1640, il ne furent plus qu’une poignée
confinée à Deshima, îlot de deux cents mètres de long sur quatre vingts de
large dans la rade de Nagasaki, d’où ils n’avaient pas le droit de sortir et où
pouvaient venir chaque année quelques navires en nombre limité. Seuls les
Chinois restaient autorisés à commercer dans la ville.
révolte de Shimabara, furent chassés en 1638. Un édit de 1639 interdit
à quiconque, sous peine de mort, d’atterrir au Japon, même en qualité
d’ambassadeur; si bien que les quatre ambassadeurs portugais, envoyés en 1640
de Macao à Nagasaki pour demander la reprise des relations commerciales, furent
décapités avec leur suite. Quant aux Hollandais, ils conservèrent le droit de
trafiquer; mais, malgré leurs complaisances pour la répression du soulèvement
de Shimabara, ils durent démolir, en 1638, leur dépôt de hirado trop solidement
construit en pierres; puis, à partir de 1640, il ne furent plus qu’une poignée
confinée à Deshima, îlot de deux cents mètres de long sur quatre vingts de
large dans la rade de Nagasaki, d’où ils n’avaient pas le droit de sortir et où
pouvaient venir chaque année quelques navires en nombre limité. Seuls les
Chinois restaient autorisés à commercer dans la ville. Et
sans doute devons-nous considérer cette réaction d’intérêts coïncidant avec les
motivations pour extirper le christianisme de l’archipel, tant «il est peu
probable que la crainte du christianisme ait été la raison dominante de la
politique d’isolement. On trouve à ce propos un témoignage intéressant dans le
récit que fit un lettré Ming, Huang Zonhxi, d’un voyage qu’il effectua au Japon
vers 1646 pour obtenir de l’aide contre les Mandchous. À propos de la politique
d’isolement, il dit que la peur des Européens et du christianisme en était un
motif, mais que sa raison profonde résidait dans la détermination des Tokugawa
d’obtenir la paix et la prospérité, et d’éviter toute immixtion de l’extérieur
susceptible de compromettre ce dessein.
Et
sans doute devons-nous considérer cette réaction d’intérêts coïncidant avec les
motivations pour extirper le christianisme de l’archipel, tant «il est peu
probable que la crainte du christianisme ait été la raison dominante de la
politique d’isolement. On trouve à ce propos un témoignage intéressant dans le
récit que fit un lettré Ming, Huang Zonhxi, d’un voyage qu’il effectua au Japon
vers 1646 pour obtenir de l’aide contre les Mandchous. À propos de la politique
d’isolement, il dit que la peur des Européens et du christianisme en était un
motif, mais que sa raison profonde résidait dans la détermination des Tokugawa
d’obtenir la paix et la prospérité, et d’éviter toute immixtion de l’extérieur
susceptible de compromettre ce dessein. Le mal que se donna le bakufu pour appliquer cette politique paraît
confirmer l’opinion de Huang. Les mesures prises étaient typiques de la Chine
confucéenne, de tout temps isolationniste et préoccupée de sécurité intérieure,
et en particulier de la Chine Ming, qui démantela sa flotte, ferma ses ports,
et limita le commerce aux endroits où il pouvait être strictement réglé.
Le mal que se donna le bakufu pour appliquer cette politique paraît
confirmer l’opinion de Huang. Les mesures prises étaient typiques de la Chine
confucéenne, de tout temps isolationniste et préoccupée de sécurité intérieure,
et en particulier de la Chine Ming, qui démantela sa flotte, ferma ses ports,
et limita le commerce aux endroits où il pouvait être strictement réglé. repli sur soi, ce fut, pour reprendre l’un des mots célèbres de Mao Tsé-toung,
afin de compter sur ses propres forces. Les apports occidentaux, non
dénués des intérêts stratégiques commerciaux, diplomatiques et militaires, profitaient des
dissensions intérieures. Les Hollandais ne soutinrent-ils pas les Mandchous
lors de leur campagne contre les Ming? Ces cadeaux seraient sans doute payer plus
tard de l’humiliation honteuse de toute la culture nippone, et les événements
qui suivirent 1945 devaient le démontrer. Les invasions barbares pèsent
toujours d’un poids écrasant sur les épaules des conquis. C’est comme s’il n’y avait d’autres choix, dans ce contexte de paranoïa collective, que de mourir étouffer sur soi-même ou écrasé par un adversaire, ce qui, à première vue, semble revenir au même. La Chine n’avait
cessé d’en faire l’expérience et, malgré son fort sentiment national han, ne
parvenait pas à restaurer l’unité étatique. Or, le travail de Nobunaga,
Hideyoshi et Ieyasu avait permis de dominer les rivalités internes et d’établir
l’unité nationale sous le règne de l’Empereur auprès duquel les Tokugawa assuraient la
gouvernance forte au point de faire épouser leur fille par l’héritier du trône.
Le sort des Tokugawa était désormais lié au sort de la famille impériale, donc
de l’unité d’intrigue de l’histoire nippone.
repli sur soi, ce fut, pour reprendre l’un des mots célèbres de Mao Tsé-toung,
afin de compter sur ses propres forces. Les apports occidentaux, non
dénués des intérêts stratégiques commerciaux, diplomatiques et militaires, profitaient des
dissensions intérieures. Les Hollandais ne soutinrent-ils pas les Mandchous
lors de leur campagne contre les Ming? Ces cadeaux seraient sans doute payer plus
tard de l’humiliation honteuse de toute la culture nippone, et les événements
qui suivirent 1945 devaient le démontrer. Les invasions barbares pèsent
toujours d’un poids écrasant sur les épaules des conquis. C’est comme s’il n’y avait d’autres choix, dans ce contexte de paranoïa collective, que de mourir étouffer sur soi-même ou écrasé par un adversaire, ce qui, à première vue, semble revenir au même. La Chine n’avait
cessé d’en faire l’expérience et, malgré son fort sentiment national han, ne
parvenait pas à restaurer l’unité étatique. Or, le travail de Nobunaga,
Hideyoshi et Ieyasu avait permis de dominer les rivalités internes et d’établir
l’unité nationale sous le règne de l’Empereur auprès duquel les Tokugawa assuraient la
gouvernance forte au point de faire épouser leur fille par l’héritier du trône.
Le sort des Tokugawa était désormais lié au sort de la famille impériale, donc
de l’unité d’intrigue de l’histoire nippone. Si
les arts, la philosophie et la littérature suivirent l’impulsion donnée par
Hideyoshi et Ieyasu, le XVIIIe siècle commença, vers sa fin, à montrer des signes
d’essoufflement. L’assiette budgétaire du Japon était vide, la dynastie
commençait à se ramollir et les tentations de l’Occident miroitaient toujours
aux yeux de ceux qui communiquaient par contrebande au péril de leur vie. Le
régime, tant qu'à lui, se sclérosait et pesait de plus en plus dur sur les
épaules des paysans et des artisans des villes. Les réformes du shôgun Yoshimune (1716-1745) visaient
surtout à résoudre le déficit des finances du shôgunat et l'endettement des
samurai. Elles prônaient surtout un retour à une austérité qui ne satisfaisait
personne :
Si
les arts, la philosophie et la littérature suivirent l’impulsion donnée par
Hideyoshi et Ieyasu, le XVIIIe siècle commença, vers sa fin, à montrer des signes
d’essoufflement. L’assiette budgétaire du Japon était vide, la dynastie
commençait à se ramollir et les tentations de l’Occident miroitaient toujours
aux yeux de ceux qui communiquaient par contrebande au péril de leur vie. Le
régime, tant qu'à lui, se sclérosait et pesait de plus en plus dur sur les
épaules des paysans et des artisans des villes. Les réformes du shôgun Yoshimune (1716-1745) visaient
surtout à résoudre le déficit des finances du shôgunat et l'endettement des
samurai. Elles prônaient surtout un retour à une austérité qui ne satisfaisait
personne : riche daimyô, Tanuma n'hésita pas à prendre
résolument le contrepied des efforts prônés par Yoshimune. Il encouragea
ouvertement le développement et la prospérité de la classe marchande,
autorisant les associations et accordant des monopoles. Afin d'accélérer le
cours des échanges, il ordonna la frappe de pièces d'argent : jusqu'alors
l'argent avait toujours circulé sous forme de lingots que l'on coupait au poids
demandé, comme cela se pratiquait couramment en Chine. Loin de refuser les
relations avec l'étranger, Tanuma encouragea le commerce de Nagasaki et
envisagea même avec la Russie un plan d'exploitation commune du Hokkaidô. Bien
que le but essentiel des réformes de Tanuma fût la recherche systématique des
capitaux dont le shôgunat et ses hommes manquaient cruellement, elles
aboutirent au processus de libéralisation qui devait triompher brutalement un
siècle plus tard. Peut-être venaient-elles trop tôt; elles furent en tout état
de cause mal acceptées; de plus les dernières années au pouvoir de Tanuma
virent une cruelle série de calamités naturelles : la mort du shôgun Ieharu
entraîna la disgrâce de son entreprenant ministre. Le shôgun suivant, Ienari
(1787-1837), fut, de tous les Tokugawa, celui qui resta le plus longtemps à la
tête du pays» (D. et V. Elisseeff, op. cit. 1974, p. 125).
riche daimyô, Tanuma n'hésita pas à prendre
résolument le contrepied des efforts prônés par Yoshimune. Il encouragea
ouvertement le développement et la prospérité de la classe marchande,
autorisant les associations et accordant des monopoles. Afin d'accélérer le
cours des échanges, il ordonna la frappe de pièces d'argent : jusqu'alors
l'argent avait toujours circulé sous forme de lingots que l'on coupait au poids
demandé, comme cela se pratiquait couramment en Chine. Loin de refuser les
relations avec l'étranger, Tanuma encouragea le commerce de Nagasaki et
envisagea même avec la Russie un plan d'exploitation commune du Hokkaidô. Bien
que le but essentiel des réformes de Tanuma fût la recherche systématique des
capitaux dont le shôgunat et ses hommes manquaient cruellement, elles
aboutirent au processus de libéralisation qui devait triompher brutalement un
siècle plus tard. Peut-être venaient-elles trop tôt; elles furent en tout état
de cause mal acceptées; de plus les dernières années au pouvoir de Tanuma
virent une cruelle série de calamités naturelles : la mort du shôgun Ieharu
entraîna la disgrâce de son entreprenant ministre. Le shôgun suivant, Ienari
(1787-1837), fut, de tous les Tokugawa, celui qui resta le plus longtemps à la
tête du pays» (D. et V. Elisseeff, op. cit. 1974, p. 125). L'archipel avait, en effet, été frappé par une série de cataclysmes naturels :destruction des récoltes par un violent typhon en 1771, épidémie de peste en 1773, éruption du volcan Asama en Shinano en juillet-août 1783, grande famine de 1783-174, sécheresse dans les provinces centrales en 1785, inondations dans le Kantô en 1786 et le tout baignant dans une administration qui ne parvenait pas à suffire à la tâche devant
 tant de calamités. La construction de forts le long des
rivages demeurait l'une des obsessions du shôgunat. «En 1836 se produisit
une grave famine; l'indifférence et la dureté des riches marchands provoqua
l'indignation et le ressentiment de certains. L'un d'eux, Oshio Heilhachirô (ou
Chûsai) inspecteur de police à Osaka, demanda que les réserves de riz soient
distribuées, mais il ne fut pas écouté; alors lui-même vendit tous ses biens et
en donna le montant aux indigents; puis il publia un manifeste intitulé
"Punition du Ciel" : d'après lui, les malheurs qui éprouvaient le
pays étaient dus au manque de respect pour la volonté de l'empereur; il
rassembla ses fidèles - policiers, samurai, rônin - et, le 25 mars 1837, il mit
le feu à sa maison, tandis que ses hommes allumaient des incendies en
différents points de Osaka : en deux jours, une grande partie de la ville (dix
huit mille maisons) fut réduite en cendres; il s'enfuit en Yoshino, mais revint
bientôt à Osaka, y fut découvert et se donna la mort. Peu de temps après, des
incidents similaires survinrent en Echigo et, l'année suivante, en Mikawa. Il
est symptomatique que ces mouvements, conduits par des samurai et des rônin,
fussent dirigés contre les autorités du bakufu» (R. Bersihand op. cit. p.
219). Ce qu'il faut retenir de cette révolte, c'est que Oshio opposait la
politique du bakufu au respect de la volonté de l'Empereur. Ce faisant, il
mettait sur les rails la révolution du Meiji.
tant de calamités. La construction de forts le long des
rivages demeurait l'une des obsessions du shôgunat. «En 1836 se produisit
une grave famine; l'indifférence et la dureté des riches marchands provoqua
l'indignation et le ressentiment de certains. L'un d'eux, Oshio Heilhachirô (ou
Chûsai) inspecteur de police à Osaka, demanda que les réserves de riz soient
distribuées, mais il ne fut pas écouté; alors lui-même vendit tous ses biens et
en donna le montant aux indigents; puis il publia un manifeste intitulé
"Punition du Ciel" : d'après lui, les malheurs qui éprouvaient le
pays étaient dus au manque de respect pour la volonté de l'empereur; il
rassembla ses fidèles - policiers, samurai, rônin - et, le 25 mars 1837, il mit
le feu à sa maison, tandis que ses hommes allumaient des incendies en
différents points de Osaka : en deux jours, une grande partie de la ville (dix
huit mille maisons) fut réduite en cendres; il s'enfuit en Yoshino, mais revint
bientôt à Osaka, y fut découvert et se donna la mort. Peu de temps après, des
incidents similaires survinrent en Echigo et, l'année suivante, en Mikawa. Il
est symptomatique que ces mouvements, conduits par des samurai et des rônin,
fussent dirigés contre les autorités du bakufu» (R. Bersihand op. cit. p.
219). Ce qu'il faut retenir de cette révolte, c'est que Oshio opposait la
politique du bakufu au respect de la volonté de l'Empereur. Ce faisant, il
mettait sur les rails la révolution du Meiji. Pendant
ce temps, les commerçants occidentaux ne pouvaient éviter de caboter le long des côtes
nippones. La Russie, libérée des guerres napoléoniennes, avait traversé le pont
des îles Aléoutiennes et se retrouvait en Alaska. Par le fait même, des
compagnies de fourrures longeant le Kamtchatka descendirent vers les îles
Kouriles et Sakhaline, ce qui fit régner une panique générale durant deux ans
dans tout le nord du Japon : «En 1811, l'officier de marine russe Golownine,
commandant le navire de guerre "Diana", fut envoyé faire le levé des
côtes de Ezo et la carte des abords des Kouriles méridionales. Ayant débarqué à
Kunashiri, l'île la plus proche de Ezo, il fut arrêté, emmené à Hakodate, puis
emprisonné à Matsumae, tandis que la "Diana" reprenait la mer sous le
commandement de son second, Ricord; il ne fut libéré qu'au bout de deux ans,
lorsque Ricord revint pour apporter les excuses du gouvernement russe pour les
incursions de Chowstoff et de Davidoff, et put prouver qu'il n'y avait pas
participé. En échange, les Russes libérèrent Takadaya Kahei qu'ils avaient
capturé en 1812, alors qu'il revenait d'Etorû, et emmené au Kamtchatka» (p.
221). On retrouve là les lointaines racines qui conduiront à la guerre de 1904-1905.
Pendant
ce temps, les commerçants occidentaux ne pouvaient éviter de caboter le long des côtes
nippones. La Russie, libérée des guerres napoléoniennes, avait traversé le pont
des îles Aléoutiennes et se retrouvait en Alaska. Par le fait même, des
compagnies de fourrures longeant le Kamtchatka descendirent vers les îles
Kouriles et Sakhaline, ce qui fit régner une panique générale durant deux ans
dans tout le nord du Japon : «En 1811, l'officier de marine russe Golownine,
commandant le navire de guerre "Diana", fut envoyé faire le levé des
côtes de Ezo et la carte des abords des Kouriles méridionales. Ayant débarqué à
Kunashiri, l'île la plus proche de Ezo, il fut arrêté, emmené à Hakodate, puis
emprisonné à Matsumae, tandis que la "Diana" reprenait la mer sous le
commandement de son second, Ricord; il ne fut libéré qu'au bout de deux ans,
lorsque Ricord revint pour apporter les excuses du gouvernement russe pour les
incursions de Chowstoff et de Davidoff, et put prouver qu'il n'y avait pas
participé. En échange, les Russes libérèrent Takadaya Kahei qu'ils avaient
capturé en 1812, alors qu'il revenait d'Etorû, et emmené au Kamtchatka» (p.
221). On retrouve là les lointaines racines qui conduiront à la guerre de 1904-1905. des Indes tentèrent la
population de Nagasaki en envoyant de Calcutta, un navire commandé par Torey.
Il fut ravitaillé puis sommé de sortir de la rade dans les vingt quatre heures
et d'aller porter sa marchandise ailleurs. Encore, en 1808, la population de
Nagasaki fut en émoi avec l'apparition inopinée de la frégate anglaise Phaeton,
«commandée par Pellew, en quête de deux navires hollandais qui lui
avaient été signalés faisant route sur le Japon et qu'il cherchait à capturer.
Entré dans la rade, il se saisit de deux Hollandais de la factorerie, venus à
son bord pour servir d'interprètes, et les garda deux jours en otages pour le
cas où son ravitaillement en vivres lui aurait été refusé; puis il partie sans
avoir été inquiété. Dès que le «Phaeton» avait été reconnu, le gouverneur de
Nagasaki avait ordonné à la défense du port d'entrer en action; mais les
armements étaient dispersés, les chefs pris de panique étaient incapables
d’agir, l'impréparation était complète; le gouverneur fit harakiri pour n’avoir
pu empêcher ni châtier cette audacieuse violation des lois nationales» (p.
222). De telles attitudes apparaissent pathologiques. «En 1824, un navire
anglais, cherchant à se procurer de vivres et de l'eau, débarqua dans une île,
au sud du golfe de Kagoshima, quelques hommes d'équipage qui se livrèrent à des
déprédations et des violences; les habitants prirent leurs armes, et il y eut
des morts et des blessés des deux côtés. À la suite de cet incident, un nouvel
édit du bakufu, renforçant les édits d'expulsion, fut promulgué au mois d'avril
1825 : si un navire étranger s'approchait des côtes, il devait être détruit; si
du personnel était mis à terre, il devait être arrêté ou tué» (p. 222). Une
fois de plus, la fausse illusion de la Muraille de Chine se faisait sentir. Si
le Japon se cantonnait dans son quant-à-soi, le monde, lui, continuait
d'évoluer au rythme que lui imposait maintenant l'Occident industriel. On en était encore aux
voiliers, bientôt viendront les navires à vapeur.
des Indes tentèrent la
population de Nagasaki en envoyant de Calcutta, un navire commandé par Torey.
Il fut ravitaillé puis sommé de sortir de la rade dans les vingt quatre heures
et d'aller porter sa marchandise ailleurs. Encore, en 1808, la population de
Nagasaki fut en émoi avec l'apparition inopinée de la frégate anglaise Phaeton,
«commandée par Pellew, en quête de deux navires hollandais qui lui
avaient été signalés faisant route sur le Japon et qu'il cherchait à capturer.
Entré dans la rade, il se saisit de deux Hollandais de la factorerie, venus à
son bord pour servir d'interprètes, et les garda deux jours en otages pour le
cas où son ravitaillement en vivres lui aurait été refusé; puis il partie sans
avoir été inquiété. Dès que le «Phaeton» avait été reconnu, le gouverneur de
Nagasaki avait ordonné à la défense du port d'entrer en action; mais les
armements étaient dispersés, les chefs pris de panique étaient incapables
d’agir, l'impréparation était complète; le gouverneur fit harakiri pour n’avoir
pu empêcher ni châtier cette audacieuse violation des lois nationales» (p.
222). De telles attitudes apparaissent pathologiques. «En 1824, un navire
anglais, cherchant à se procurer de vivres et de l'eau, débarqua dans une île,
au sud du golfe de Kagoshima, quelques hommes d'équipage qui se livrèrent à des
déprédations et des violences; les habitants prirent leurs armes, et il y eut
des morts et des blessés des deux côtés. À la suite de cet incident, un nouvel
édit du bakufu, renforçant les édits d'expulsion, fut promulgué au mois d'avril
1825 : si un navire étranger s'approchait des côtes, il devait être détruit; si
du personnel était mis à terre, il devait être arrêté ou tué» (p. 222). Une
fois de plus, la fausse illusion de la Muraille de Chine se faisait sentir. Si
le Japon se cantonnait dans son quant-à-soi, le monde, lui, continuait
d'évoluer au rythme que lui imposait maintenant l'Occident industriel. On en était encore aux
voiliers, bientôt viendront les navires à vapeur. «À
la fin du XVIIIe siècle, Takayama Masayuki, venu à Kyôto en 1765 à l'âge de
dix-huit ans, y étudia l'histoire et obtint la protection du dainagon Nakayama;
il se dévoua entièrement à la cause de la dynastie : à Kyôto, il s'agenouillait
sur le pont de Sanjô et, face au palais, il vénérait l'empereur; puis il
parcourut les provinces en cherchant à réveiller partout le prestige du
souverain; enfin, en 1793, il offrit sa vie en témoignage de fidélité et commit
le harakiri. Gamô Kumpei entreprit les mêmes études et des voyages similaires,
se lamentant sur les tombeaux en ruine des souverains et sur l'autorité
impériale méconnue; il écrivit aussi sur la défense des côtes du Japon. Tous
les deux, avec Haysshi Shihei, sont appelés san-hijin, les trois
excentriques» (pp. 224-225). L’attitude de Takayama Masyuki ne va pas sans rappeler celle qu’un autre intellectuel, Yukio Mishima, devait reproduire près de deux siècles plus tard.
«À
la fin du XVIIIe siècle, Takayama Masayuki, venu à Kyôto en 1765 à l'âge de
dix-huit ans, y étudia l'histoire et obtint la protection du dainagon Nakayama;
il se dévoua entièrement à la cause de la dynastie : à Kyôto, il s'agenouillait
sur le pont de Sanjô et, face au palais, il vénérait l'empereur; puis il
parcourut les provinces en cherchant à réveiller partout le prestige du
souverain; enfin, en 1793, il offrit sa vie en témoignage de fidélité et commit
le harakiri. Gamô Kumpei entreprit les mêmes études et des voyages similaires,
se lamentant sur les tombeaux en ruine des souverains et sur l'autorité
impériale méconnue; il écrivit aussi sur la défense des côtes du Japon. Tous
les deux, avec Haysshi Shihei, sont appelés san-hijin, les trois
excentriques» (pp. 224-225). L’attitude de Takayama Masyuki ne va pas sans rappeler celle qu’un autre intellectuel, Yukio Mishima, devait reproduire près de deux siècles plus tard. «En
août 1823 arriva à Nagasaki le médecin bavarois Siebold, au service des
Hollandais; il enseigna, pendant deux ans et demi, la médecine et les sciences
naturelles à des étudiants et des médecins venus de toutes les parties du Japon
pour suivre ses cours; il leur donna en outre des notions des langues
européennes, principalement de l'allemand, et les instruisit sur les grands
pays du monde. Il accompagna à Edo l'ambassade hollandaise de 1826; il y eut de
fréquents entretiens avec des savants et des étudiants; puis il retourna à
Nagasaki avec l'ambassade; là, il fut arrêté et emprisonné en 1828, pour s'être
fait livrer, par Takahashi Sakuzaemon, la carte du Japon levée par Inô Chûkei;
il ne fut relâché qu'en 1830, et banni avec interdiction de revenir au Japon;
il y retourna cependant en 1859 en mission officielle; quant à Takahashi, il
mourut en prison. De différents côtés, des protestations s'élevèrent contre le traitement
infligé par le bakufu à Siebold, en considération des services qu'il avait
rendus au pays; et les grands daimyô, surtout Shimaxu de Satsuma et Date de
Uwajima en Iyo, accueillirent ses élèves, encouragèrent les études occidentales
et réclamèrent la reprise de relations avec les étrangers, désapprouvant ainsi
la politique des shôgun» (p. 227).
«En
août 1823 arriva à Nagasaki le médecin bavarois Siebold, au service des
Hollandais; il enseigna, pendant deux ans et demi, la médecine et les sciences
naturelles à des étudiants et des médecins venus de toutes les parties du Japon
pour suivre ses cours; il leur donna en outre des notions des langues
européennes, principalement de l'allemand, et les instruisit sur les grands
pays du monde. Il accompagna à Edo l'ambassade hollandaise de 1826; il y eut de
fréquents entretiens avec des savants et des étudiants; puis il retourna à
Nagasaki avec l'ambassade; là, il fut arrêté et emprisonné en 1828, pour s'être
fait livrer, par Takahashi Sakuzaemon, la carte du Japon levée par Inô Chûkei;
il ne fut relâché qu'en 1830, et banni avec interdiction de revenir au Japon;
il y retourna cependant en 1859 en mission officielle; quant à Takahashi, il
mourut en prison. De différents côtés, des protestations s'élevèrent contre le traitement
infligé par le bakufu à Siebold, en considération des services qu'il avait
rendus au pays; et les grands daimyô, surtout Shimaxu de Satsuma et Date de
Uwajima en Iyo, accueillirent ses élèves, encouragèrent les études occidentales
et réclamèrent la reprise de relations avec les étrangers, désapprouvant ainsi
la politique des shôgun» (p. 227). L'issue
des deux guerres de l'Opium en Chine laissèrent entrevoir que si les
Occidentaux bénéficiaient des traités inégaux, le Japon s'en voyait exclu. Hong
Kong devenait une ville anglaise et les concessions de véritables colonies
étrangères. Alors que la poussée pro-occidentale était en pleine croissance en Asie, «le Japon prit peur qu'un sort semblable ne l'atteignît, d'autant plus que les
passages de bateaux étrangers dans son voisinage devenaient plus nombreux;
aussi le bakufu chercha-t-il à éviter de motiver une intervention dans ses
affaires; c'est pourquoi, dès 1842, il ordonna de tirer sur tout bateau qui
s'approcherait des côtes, mais, par contre, il défendit de confisquer les
navires échoués et prescrivit de traiter leurs équipages avec bienveillance; en
1843, il interdit aux naufragés de se faire rapatrier par des navires autres
que hollandais ou chinois. Tokugawa Nariaki, dans son daimyat de Mito, se préparait
à repousser les étrangers : il fortifiait les côtes, faisait fondre des canons
- confisquant dans ce but les cloches bouddhiques - fabriquait des fusils,
armait tous les hommes valides de son fief; mais le bakufu prit ombrage de ces
préparatifs, qu'il craignit de voir retourner contre lui : en 1844, il appela
Nariaki à
L'issue
des deux guerres de l'Opium en Chine laissèrent entrevoir que si les
Occidentaux bénéficiaient des traités inégaux, le Japon s'en voyait exclu. Hong
Kong devenait une ville anglaise et les concessions de véritables colonies
étrangères. Alors que la poussée pro-occidentale était en pleine croissance en Asie, «le Japon prit peur qu'un sort semblable ne l'atteignît, d'autant plus que les
passages de bateaux étrangers dans son voisinage devenaient plus nombreux;
aussi le bakufu chercha-t-il à éviter de motiver une intervention dans ses
affaires; c'est pourquoi, dès 1842, il ordonna de tirer sur tout bateau qui
s'approcherait des côtes, mais, par contre, il défendit de confisquer les
navires échoués et prescrivit de traiter leurs équipages avec bienveillance; en
1843, il interdit aux naufragés de se faire rapatrier par des navires autres
que hollandais ou chinois. Tokugawa Nariaki, dans son daimyat de Mito, se préparait
à repousser les étrangers : il fortifiait les côtes, faisait fondre des canons
- confisquant dans ce but les cloches bouddhiques - fabriquait des fusils,
armait tous les hommes valides de son fief; mais le bakufu prit ombrage de ces
préparatifs, qu'il craignit de voir retourner contre lui : en 1844, il appela
Nariaki à  Edo et le retint prisonnier dans Yashiki, ainsi que son conseiller
Fujita Tôko» (pp. 228-229) À aucun moment, le shôgunat ne se départit de sa
motivation paranoïaque. Sa haine de l'étranger restait identique à elle-même
depuis la mort de Ieyasu. Certes, la manière dont les flottes occidentales
mutilaient l'administration et le territoire de l'Empereur Qing justifiait les
pires craintes. Comme lors de l'invasion mongole, la Chine tombée, le Japon
serait le prochain sous la lorgnette des envahisseurs. Déjà, des navires
anglais et français traçaient la reconnaissance des côtes de Ryûkyû. En 1846,
un nouveau partenaire se présenta aux portes du Japon. Le 20 juillet 1842 deux
navires américains se présentent devant Uraga, le Colombus et le Vincennes.
Le commodore Biddle a reçu du président Polk une lettre à remettre à l'Empereur lui
demandant de négocier un traité de commerce. La réponse, plus qu'insolente,
signifia un refus catégorique. La jeune République ne toléra pas l'affront.
Edo et le retint prisonnier dans Yashiki, ainsi que son conseiller
Fujita Tôko» (pp. 228-229) À aucun moment, le shôgunat ne se départit de sa
motivation paranoïaque. Sa haine de l'étranger restait identique à elle-même
depuis la mort de Ieyasu. Certes, la manière dont les flottes occidentales
mutilaient l'administration et le territoire de l'Empereur Qing justifiait les
pires craintes. Comme lors de l'invasion mongole, la Chine tombée, le Japon
serait le prochain sous la lorgnette des envahisseurs. Déjà, des navires
anglais et français traçaient la reconnaissance des côtes de Ryûkyû. En 1846,
un nouveau partenaire se présenta aux portes du Japon. Le 20 juillet 1842 deux
navires américains se présentent devant Uraga, le Colombus et le Vincennes.
Le commodore Biddle a reçu du président Polk une lettre à remettre à l'Empereur lui
demandant de négocier un traité de commerce. La réponse, plus qu'insolente,
signifia un refus catégorique. La jeune République ne toléra pas l'affront. «Le
24 mars 1852, le commodore Perry était nommé au commandement de l’escadre des
Indes Orientales et quittait Norfolk le 24 novembre suivant. Faisant route par
Madère et le Cap, il atteignit Hong-Kong le 6 avril 1853, puis Shanghai le 17
mai; le 23, il appareilla avec quatre bâtiments, les frégates à vapeur Susquehanna
et Misissipi et les sloops Plymouth et Saratoga, et se
rendit aux Ryûkyû : il mouilla à Naha le 26, puis poussa jusqu'aux îles Bonin
avec deux bateaux. Enfin, le 4 juillet, toute l'escadre partit de Naha et vint
mouiller devant Uraga dans l'après-midi du 8, les navires à vapeur près de
terre, un sloop amateloté à chacun d'eux.
«Le
24 mars 1852, le commodore Perry était nommé au commandement de l’escadre des
Indes Orientales et quittait Norfolk le 24 novembre suivant. Faisant route par
Madère et le Cap, il atteignit Hong-Kong le 6 avril 1853, puis Shanghai le 17
mai; le 23, il appareilla avec quatre bâtiments, les frégates à vapeur Susquehanna
et Misissipi et les sloops Plymouth et Saratoga, et se
rendit aux Ryûkyû : il mouilla à Naha le 26, puis poussa jusqu'aux îles Bonin
avec deux bateaux. Enfin, le 4 juillet, toute l'escadre partit de Naha et vint
mouiller devant Uraga dans l'après-midi du 8, les navires à vapeur près de
terre, un sloop amateloté à chacun d'eux. Perry s'y refusa et
fit répondre qu'il resterait à Uraga pour remettre au shogun la lettre du
président Fillmore dont il était chargé; le gouverneur, Toda Ujiaki, en référa
à Edo : une nouvelle entrevue eut lieu le 12, et, la remise du message fut
fixée au surlendemain; la cérémonie se déroula dans un bâtiment en bois
rapidement édifié à Kurihama, tout près d'Uraga; Perry débarqua en grande
pompe, escorté de trois cents marins en armes; sa mission accomplie, il déclara
qu'il reviendrait chercher la réponse du shôgun l'année suivante. Le même jour,
toute l'escadre appareila et pénétra dans la baie de Edo; après avoir procédé à
des sondages devant la capitale du bakufu, elle fit route le 19 juillet pour
Shanghai, où la révolte des Taiping nécessitait sa présence» (pp. 232-232).
Perry s'y refusa et
fit répondre qu'il resterait à Uraga pour remettre au shogun la lettre du
président Fillmore dont il était chargé; le gouverneur, Toda Ujiaki, en référa
à Edo : une nouvelle entrevue eut lieu le 12, et, la remise du message fut
fixée au surlendemain; la cérémonie se déroula dans un bâtiment en bois
rapidement édifié à Kurihama, tout près d'Uraga; Perry débarqua en grande
pompe, escorté de trois cents marins en armes; sa mission accomplie, il déclara
qu'il reviendrait chercher la réponse du shôgun l'année suivante. Le même jour,
toute l'escadre appareila et pénétra dans la baie de Edo; après avoir procédé à
des sondages devant la capitale du bakufu, elle fit route le 19 juillet pour
Shanghai, où la révolte des Taiping nécessitait sa présence» (pp. 232-232). La
situation du Japon d’alors s'inscrivait dans un grand contraste. D'une part, une
bourgeoisie et des daimyô qui s'enrichissaient de l'accroissement démographique
et du développement d'industries artisanales et de commerçants prospères. De
l'autre, une population paysanne qui restait misérable et se soulevait parfois
contre des Daimyô exploiteurs. Comme en Chine, la bourgeoisie urbaine était en
pleine explosion. Elle se développait aux dépens des militaires et des paysans,
amassant des fortunes considérables. Ces chônin acquirent ainsi une influence
considérable qui échappait à la noblesse traditionnelle. «Or ceux-ci
désiraient l'ouverture du pays aux étrangers pour étendre leur commerce, se
rencontrant sur ce point avec certains grands daimyô qui y voyaient un moyen
d'élargir leurs ressources» (p. 233).
La
situation du Japon d’alors s'inscrivait dans un grand contraste. D'une part, une
bourgeoisie et des daimyô qui s'enrichissaient de l'accroissement démographique
et du développement d'industries artisanales et de commerçants prospères. De
l'autre, une population paysanne qui restait misérable et se soulevait parfois
contre des Daimyô exploiteurs. Comme en Chine, la bourgeoisie urbaine était en
pleine explosion. Elle se développait aux dépens des militaires et des paysans,
amassant des fortunes considérables. Ces chônin acquirent ainsi une influence
considérable qui échappait à la noblesse traditionnelle. «Or ceux-ci
désiraient l'ouverture du pays aux étrangers pour étendre leur commerce, se
rencontrant sur ce point avec certains grands daimyô qui y voyaient un moyen
d'élargir leurs ressources» (p. 233).La missive de Perry fut plus efficace que des coups de canon. Elle ébranla les certitudes du bakufu. Le jeune shôgun débile et malade laissa son Premier ministre, Abe Masahiro, décider à sa place. Celui-ci n'osait prendre de décision et, fait exceptionnel, il en réfera à la cour de Kyôto. L'Empereur, qui n'avait pas été consulté depuis des siècles pour les affaires du gouvernement, se voyait sollicité pour résoudre une grave crise internationale. Le shôgunat venait de s'effacer de lui-même derrière le pouvoir impérial. Malgré les réticences des daimyô nationalistes qui voulaient la guerre, les ministres du shôgun conseillèrent de céder. Perry, de son côté, se trouva pressé par les événements. L'amiral Poutiatine, le 21 août 1852, entrait en rade à Nagasaki. Il en repartit sans obtenir de succès. À la fin de l'année 1853, Perry fut informé
 qu'une frégate française, la Constitution, se dirigeait vers le
Japon avec un agenda tenu secret. Perry voulut le devancer. Le 29 janvier 1854,
il était à Naha (Okinawa); «là il eut communication par le gouverneur
général des Indes Néerlandaises, de la mort du shôgun et du désir du bakufu de
remettre à une époque éloignée, en raison de cet événement, la réponse à la
lettre du président Fillmore; Perry vit dans cette requête une manœuvre pour
retarder les pourparlers : il fit appareiller aussitôt ses bâtiments, et le 13
février l’escadre mouillait en baie de Edo, à douze milles au delà de Uraga;
elle se composait de trois navires à vapeur et six voiliers - quatre sloops et
deux transports; un troisième transport rejoignit bientôt; les équipages
s’élevaient à seize cents hommes. Les autorités nippones voulurent ramener les
bâtiments devant Uraga, mais Perry s’y refusa et, sous prétexte de mettre ses
navires en sécurité, alla mouiller, le 24 février, à Kanagawa, près du village
de Yokohama. Les négociations commencèrent alors le 8 mars; elles furent
laborieuses : les Japonais acceptèrent tout d’abord d’assurer le ravitaillement
des bateaux américains et la protection des naufragés, mais ils se refusaient à
conclure un traité de commerce; Perry proposa un traité semblable à celui qui
avait été signé entre les États-Unis et la Chine, et laissa
qu'une frégate française, la Constitution, se dirigeait vers le
Japon avec un agenda tenu secret. Perry voulut le devancer. Le 29 janvier 1854,
il était à Naha (Okinawa); «là il eut communication par le gouverneur
général des Indes Néerlandaises, de la mort du shôgun et du désir du bakufu de
remettre à une époque éloignée, en raison de cet événement, la réponse à la
lettre du président Fillmore; Perry vit dans cette requête une manœuvre pour
retarder les pourparlers : il fit appareiller aussitôt ses bâtiments, et le 13
février l’escadre mouillait en baie de Edo, à douze milles au delà de Uraga;
elle se composait de trois navires à vapeur et six voiliers - quatre sloops et
deux transports; un troisième transport rejoignit bientôt; les équipages
s’élevaient à seize cents hommes. Les autorités nippones voulurent ramener les
bâtiments devant Uraga, mais Perry s’y refusa et, sous prétexte de mettre ses
navires en sécurité, alla mouiller, le 24 février, à Kanagawa, près du village
de Yokohama. Les négociations commencèrent alors le 8 mars; elles furent
laborieuses : les Japonais acceptèrent tout d’abord d’assurer le ravitaillement
des bateaux américains et la protection des naufragés, mais ils se refusaient à
conclure un traité de commerce; Perry proposa un traité semblable à celui qui
avait été signé entre les États-Unis et la Chine, et laissa  entendre que les
États-Unis ne manqueraient pas d’appuyer leurs demandes par l’envoi d’une force
navale plus importante que la sienne s’il n’obtenait pas satisfaction; il
réclama l’ouverture de trois ports, refusant Nagasaki, mais demandant Uraga ou
Kanagawa dans Hondo, Matsumae dans Ezo et Naha dans les Ryûkyû; les
représentatns du bakufu n’acceptèrent pas les deux premiers et offrirent à la
place Shimoda sur la côte sud-est de la presqu’île d’Izu : Perry envoya deux de
ses bâtiments examiner ce port. Finalement le traité de Kanagawa fut conclu le
31 mars 1854 : il comportait douze articles, décidant notamment l’ouverture des
ports de Shimoda et Hakodate, prévoyant l’installation d’un consul des
États-Unis à Shimoda, accordant aux deux pays le traitement de la nation la
plus favorisée, fixant le délai d’échange des ratifications à dix-huit mois; le
bénéfice de l’exterritorialité pour les Américains n’était pas stipulé», et
de conclure Bersihand : «Ainsi, ce traité de Kanagawa mettait fin pacifiquement
à l’isolement du Japon» (p. 253).
entendre que les
États-Unis ne manqueraient pas d’appuyer leurs demandes par l’envoi d’une force
navale plus importante que la sienne s’il n’obtenait pas satisfaction; il
réclama l’ouverture de trois ports, refusant Nagasaki, mais demandant Uraga ou
Kanagawa dans Hondo, Matsumae dans Ezo et Naha dans les Ryûkyû; les
représentatns du bakufu n’acceptèrent pas les deux premiers et offrirent à la
place Shimoda sur la côte sud-est de la presqu’île d’Izu : Perry envoya deux de
ses bâtiments examiner ce port. Finalement le traité de Kanagawa fut conclu le
31 mars 1854 : il comportait douze articles, décidant notamment l’ouverture des
ports de Shimoda et Hakodate, prévoyant l’installation d’un consul des
États-Unis à Shimoda, accordant aux deux pays le traitement de la nation la
plus favorisée, fixant le délai d’échange des ratifications à dix-huit mois; le
bénéfice de l’exterritorialité pour les Américains n’était pas stipulé», et
de conclure Bersihand : «Ainsi, ce traité de Kanagawa mettait fin pacifiquement
à l’isolement du Japon» (p. 253). Car
la convention signée avec les États-Unis appela rapidement d’autres conventions
avec les pays en liste : l’Angleterre, la France, la Hollande, la Russie et
même la Prusse. En retour, le Japon n’envoya pas d’ambasseurs dans les
capitales européennes, mais seulent des ambassades extraordinaires, comme celle qui signa le traité Harris avec le président Buchanan à Washington. Une
première ambassade extraordinaire traversa le Pacifique et atteignit les
États-Unis en 1860. Une seconde mission parcourut les différentes capitales
européennes en 1862. Dans l’ensemble de la population, qui avait été soumis au
stress de l’invasion prochaine de son territoire, l’accueil de l’ouverture fut
reçu différemment : «Ce fut pour les Japonais un
Car
la convention signée avec les États-Unis appela rapidement d’autres conventions
avec les pays en liste : l’Angleterre, la France, la Hollande, la Russie et
même la Prusse. En retour, le Japon n’envoya pas d’ambasseurs dans les
capitales européennes, mais seulent des ambassades extraordinaires, comme celle qui signa le traité Harris avec le président Buchanan à Washington. Une
première ambassade extraordinaire traversa le Pacifique et atteignit les
États-Unis en 1860. Une seconde mission parcourut les différentes capitales
européennes en 1862. Dans l’ensemble de la population, qui avait été soumis au
stress de l’invasion prochaine de son territoire, l’accueil de l’ouverture fut
reçu différemment : «Ce fut pour les Japonais un  bouleversement profond, une
confusion d’esprit bien souvent totale. Les étrangers eux-mêmes eurent
longtemps du mal à voir clair au cœur de ces hiérarchies superposées et non
concurrentes que représentaient le gouvernement impérial et celui du bakufu.
Haine des étrangers et intérêts mercantiles créèrent différents clans et s’affrontèrent
jusqu’au plus profond des consciences. L’ouverture du pays (kaikoku) elle-même
ne fut d’abord admise que comme un pis-aller, une façon de résister en
s’assimilant la surprenante avance technique d’un adversaire trop redoutable.
Si plus tard - et pour un temps - l’Occident apparut au Japon comme la source
de tous les savoirs, on commença par lui imputer tous les malheurs qui devaient
inévitablement frapper un pays brutalement tiré d’une trop longue léthargie :
fuite de l’or, raréfaction de matières premières aussi importantes que le coton
ou la soie, sur lesquelles se fondait une industrie textile naissante, hausse
inexorable des prix contribuèrent à accentuer le caractère dramatique de ce
moment difficile de l’histoire japonaise» (D. et V. Elisseeff. op. cit.
1974, p. 129). La crise internationale emporta le shôgunat lorsqu’en 1867, Yoshinobu renonça
au pouvoir. Meiji Ishin commençait (1868). Autour de la personnalité de
l’empereur Mutsu-hito ou Meiji se groupèrent des réformateurs, descendant de
l’aristocratie ou des familles guerrières. Le plus âgé d’entre eux avait 43
ans, l’empereur 15 seulement. La révolution Meiji fit entrer le Japon dans
l’Époque contemporaine, et cela un demi-siècle avant la révolution chinoise de
1911. Mais ce qui était le plus important, c’est que la révolution Meiji fut un
despotisme éclairé, une révolution par le haut, comme il en fut au XVIIIe
siècle dans des pays comme la Prusse, l’Autriche, l’Espagne et le Portugal et comme il en sera de la Turquie et de l’Iran au XXe siècle,
alors que la révolution de 1911 en sera une populaire mais vite récupérée par
le pouvoir militaire.
bouleversement profond, une
confusion d’esprit bien souvent totale. Les étrangers eux-mêmes eurent
longtemps du mal à voir clair au cœur de ces hiérarchies superposées et non
concurrentes que représentaient le gouvernement impérial et celui du bakufu.
Haine des étrangers et intérêts mercantiles créèrent différents clans et s’affrontèrent
jusqu’au plus profond des consciences. L’ouverture du pays (kaikoku) elle-même
ne fut d’abord admise que comme un pis-aller, une façon de résister en
s’assimilant la surprenante avance technique d’un adversaire trop redoutable.
Si plus tard - et pour un temps - l’Occident apparut au Japon comme la source
de tous les savoirs, on commença par lui imputer tous les malheurs qui devaient
inévitablement frapper un pays brutalement tiré d’une trop longue léthargie :
fuite de l’or, raréfaction de matières premières aussi importantes que le coton
ou la soie, sur lesquelles se fondait une industrie textile naissante, hausse
inexorable des prix contribuèrent à accentuer le caractère dramatique de ce
moment difficile de l’histoire japonaise» (D. et V. Elisseeff. op. cit.
1974, p. 129). La crise internationale emporta le shôgunat lorsqu’en 1867, Yoshinobu renonça
au pouvoir. Meiji Ishin commençait (1868). Autour de la personnalité de
l’empereur Mutsu-hito ou Meiji se groupèrent des réformateurs, descendant de
l’aristocratie ou des familles guerrières. Le plus âgé d’entre eux avait 43
ans, l’empereur 15 seulement. La révolution Meiji fit entrer le Japon dans
l’Époque contemporaine, et cela un demi-siècle avant la révolution chinoise de
1911. Mais ce qui était le plus important, c’est que la révolution Meiji fut un
despotisme éclairé, une révolution par le haut, comme il en fut au XVIIIe
siècle dans des pays comme la Prusse, l’Autriche, l’Espagne et le Portugal et comme il en sera de la Turquie et de l’Iran au XXe siècle,
alors que la révolution de 1911 en sera une populaire mais vite récupérée par
le pouvoir militaire. Les
voyageurs japonais qui participèrent aux ambassades aux États-Unis et en Europe
mesuraient l'arriération de leur pays devant la technologie occidentale. L'Ère
Meiji devait équivaloir au rattrapage du Japon dans tous les domaines. Non
seulement les Japonais imiteraient les Occidentaux, mais ils en seraient les
émules, captant tout ce que ces pays pouvaient leur fournir et
filtrant par la culture nationale tout ce qui nuisait au sentiment national.
Cette période d'Occidentalisation entraîna une série de réformes dans tous les
domaines qui mirent à jour la puissance nippone. Pour les Japonais, il
s'agissait d'abord de ne pas subir le sort de la Chine qui avait été leur première éducatrice et dont maintenant ils cultivaient un dégoût viscéral.
Les
voyageurs japonais qui participèrent aux ambassades aux États-Unis et en Europe
mesuraient l'arriération de leur pays devant la technologie occidentale. L'Ère
Meiji devait équivaloir au rattrapage du Japon dans tous les domaines. Non
seulement les Japonais imiteraient les Occidentaux, mais ils en seraient les
émules, captant tout ce que ces pays pouvaient leur fournir et
filtrant par la culture nationale tout ce qui nuisait au sentiment national.
Cette période d'Occidentalisation entraîna une série de réformes dans tous les
domaines qui mirent à jour la puissance nippone. Pour les Japonais, il
s'agissait d'abord de ne pas subir le sort de la Chine qui avait été leur première éducatrice et dont maintenant ils cultivaient un dégoût viscéral. Le
passage du pouvoir entre les mains de l'Empereur ne se fit pas sans
difficultés. Si le shôgunat s'effaça, le bakufu restait le gouvernement du
Japon. L'ère était à la centralisation et c'est en assumant le pouvoir
personnel que l'Empereur entendit s'imposer au bakofu. Les problèmes légués par l'ère
shôgunale ne disparurent pas automatiquement. Il fallut consolider la dette,
créer une banque d'État; de même transformer l'armée constituée des mercenaires
des daimyô en une véritable armée nationale. Il lui fallut un entraînement
moderne que l'armée française vint lui donner, les Anglais le décorèrent de l'Ordre de la Jarretière. Les
réformes des impôts bouleversèrent les traditions féodales qui ne comptaient que
sur l'exploitation de la paysannerie. Les réformistes renouèrent avec la vieille
pratique de l'emprunt sur les marchés étrangers maintenant que l'ère du sakoku était derrière soi. L'histoire de l'Angleterre ne
montre-t-elle pas que c'est par les emprunts que la Révolution industrielle a
pu se déclencher si précocement dans ce pays?
Le
passage du pouvoir entre les mains de l'Empereur ne se fit pas sans
difficultés. Si le shôgunat s'effaça, le bakufu restait le gouvernement du
Japon. L'ère était à la centralisation et c'est en assumant le pouvoir
personnel que l'Empereur entendit s'imposer au bakofu. Les problèmes légués par l'ère
shôgunale ne disparurent pas automatiquement. Il fallut consolider la dette,
créer une banque d'État; de même transformer l'armée constituée des mercenaires
des daimyô en une véritable armée nationale. Il lui fallut un entraînement
moderne que l'armée française vint lui donner, les Anglais le décorèrent de l'Ordre de la Jarretière. Les
réformes des impôts bouleversèrent les traditions féodales qui ne comptaient que
sur l'exploitation de la paysannerie. Les réformistes renouèrent avec la vieille
pratique de l'emprunt sur les marchés étrangers maintenant que l'ère du sakoku était derrière soi. L'histoire de l'Angleterre ne
montre-t-elle pas que c'est par les emprunts que la Révolution industrielle a
pu se déclencher si précocement dans ce pays?  L'ouverture
du Japon ne signifiait donc pas seulement la pénétration du pays par les
apports étrangers, mais aussi la sortie d'une quantité importante de Japonais
partis à la conquête du monde pour mieux y revenir, aptes à se passer des
étrangers pour moderniser l'archipel. Les termes de fermeture/ouverture sèment
la confusion dans ce qui semble s'être passé. La paranoïa issue du traumatisme de
l'invasion mongole et reportée sur l'angoisse de l'invasion de l'Occident s'est
poursuivie de la «fermeture» des Tokugawa dans l'«ouverture» Meiji. Les motivations profondes restaient les mêmes, mais la stratégie idéologique s'inversait. Il s'agissait maintenant de disposer des moyens acquis auprès des envahisseurs mais enrichis des traditions
japonaises afin, éventuellement, de les retourner contre eux :
L'ouverture
du Japon ne signifiait donc pas seulement la pénétration du pays par les
apports étrangers, mais aussi la sortie d'une quantité importante de Japonais
partis à la conquête du monde pour mieux y revenir, aptes à se passer des
étrangers pour moderniser l'archipel. Les termes de fermeture/ouverture sèment
la confusion dans ce qui semble s'être passé. La paranoïa issue du traumatisme de
l'invasion mongole et reportée sur l'angoisse de l'invasion de l'Occident s'est
poursuivie de la «fermeture» des Tokugawa dans l'«ouverture» Meiji. Les motivations profondes restaient les mêmes, mais la stratégie idéologique s'inversait. Il s'agissait maintenant de disposer des moyens acquis auprès des envahisseurs mais enrichis des traditions
japonaises afin, éventuellement, de les retourner contre eux : 1871, le
gouvernement crée un ministère de l’Instruction publique et décrète l’éducation
obligatoire pour tous. L’application de cette mesure, qui exige la construction
de miliers d’écoles et la formation de dizaines de milliers de maîtres
nouveaux, va s’échelonner sur plusieurs années; les crédits nécessaires ne
seront dégagés que progressivement. Mais au début du XXe siècle, tous les
enfants japonais sont scolarisés. Le système éducatif s’est stabilisé; il peut
être comparé à une pyramide : la base, constituée par les six années d’école
primaire obligatoire, est surmontée du cycle quinquennal passé en école moyenne
puis des trois années d’enseignement secondaire; le sommet comprend un cursus
universitaire de trois ans. L’université de Tokyo est fondée en 1877 par
regroupement d’institutions préexistantes. Dans son sillage apparaissent
d’autres universités impériales et plus tard de nombreuses universités privées»
(pp. 158-160).
1871, le
gouvernement crée un ministère de l’Instruction publique et décrète l’éducation
obligatoire pour tous. L’application de cette mesure, qui exige la construction
de miliers d’écoles et la formation de dizaines de milliers de maîtres
nouveaux, va s’échelonner sur plusieurs années; les crédits nécessaires ne
seront dégagés que progressivement. Mais au début du XXe siècle, tous les
enfants japonais sont scolarisés. Le système éducatif s’est stabilisé; il peut
être comparé à une pyramide : la base, constituée par les six années d’école
primaire obligatoire, est surmontée du cycle quinquennal passé en école moyenne
puis des trois années d’enseignement secondaire; le sommet comprend un cursus
universitaire de trois ans. L’université de Tokyo est fondée en 1877 par
regroupement d’institutions préexistantes. Dans son sillage apparaissent
d’autres universités impériales et plus tard de nombreuses universités privées»
(pp. 158-160). Et
Reischauer de rappeler que ce système d’éducation est né ex nihilo. Si
le régime s’est stabilisé après quelques remous, dès 1880, on commence à songer
à établir une constitution afin d’encadrer la vie politique et en finir avec
les troubles liés aux ambitions personnelles et aux chevauchements des pouvoirs entre l'Empereur et le bakofu. De nouveaux diplomates sont
envoyés en Occident étudier les différentes constitutions existantes. Ces
derniers forment un noyau homogène dit les genro, c’est-à-dire, les Anciens.
«C’est Ito qui est chargé de rédiger la nouvelle constitution. Il
commence par visiter les pays les plus traditionalistes d’Europe, en
particulier l’Allemagne et l’Autriche, afin de s’imprégner des théories constitutionnelles
qui y ont cours. Avec une activité débordante, il s’emploie à mettre en place
les nouveaux organes de la vie politique japonaise» (pp. 163-164) :
Et
Reischauer de rappeler que ce système d’éducation est né ex nihilo. Si
le régime s’est stabilisé après quelques remous, dès 1880, on commence à songer
à établir une constitution afin d’encadrer la vie politique et en finir avec
les troubles liés aux ambitions personnelles et aux chevauchements des pouvoirs entre l'Empereur et le bakofu. De nouveaux diplomates sont
envoyés en Occident étudier les différentes constitutions existantes. Ces
derniers forment un noyau homogène dit les genro, c’est-à-dire, les Anciens.
«C’est Ito qui est chargé de rédiger la nouvelle constitution. Il
commence par visiter les pays les plus traditionalistes d’Europe, en
particulier l’Allemagne et l’Autriche, afin de s’imprégner des théories constitutionnelles
qui y ont cours. Avec une activité débordante, il s’emploie à mettre en place
les nouveaux organes de la vie politique japonaise» (pp. 163-164) : Beaucoup
des problèmes connus dans les grands Empires centraux d’Europe vont se répéter
dans le Japon des Meiji. Si les sujets peuvent élire une Diète bicamérale pour
voter les lois, celle-ci demeure assujettie à l’Empereur. Il ne s’agit pas ici
d’une division des pouvoirs à la Montesquieu mais d’une hiérarchisation des
pouvoirs propres à un système autoritaire associé à une démocratie électorale. Dès 1876, le rattrapage est pleinement effectué par le Japon
contemporain. Il peut, à son tour, jouer la carte coloniale, d’abord en
obligeant la Corée à signer un traité commercial - comme il avait été forcé
lui-même de le faire par l’amiral Perry -, puis il tient à avoir sa part du gâteau
chinois. L’extraordinaire récupération du Japon apparaît lorsqu’un conflit
entre la Chine et le Japon se déclare en Corée en 1894 : «À la plus grande
surprise des puissances occidentales, les forces rénovées du petit archipel
triomphèrent aisément du géant chinois. Les armées japonaises déferlèrent sur
la Corée et la Mandchourie, détruisirent la flotte chinoise et occupèrent le
port de Wei-Haï-Wei dans la péninsule du Chan-toung. Le 17 avril 1895, le traité de Shimonoseki mettait
fin à la guerre
Beaucoup
des problèmes connus dans les grands Empires centraux d’Europe vont se répéter
dans le Japon des Meiji. Si les sujets peuvent élire une Diète bicamérale pour
voter les lois, celle-ci demeure assujettie à l’Empereur. Il ne s’agit pas ici
d’une division des pouvoirs à la Montesquieu mais d’une hiérarchisation des
pouvoirs propres à un système autoritaire associé à une démocratie électorale. Dès 1876, le rattrapage est pleinement effectué par le Japon
contemporain. Il peut, à son tour, jouer la carte coloniale, d’abord en
obligeant la Corée à signer un traité commercial - comme il avait été forcé
lui-même de le faire par l’amiral Perry -, puis il tient à avoir sa part du gâteau
chinois. L’extraordinaire récupération du Japon apparaît lorsqu’un conflit
entre la Chine et le Japon se déclare en Corée en 1894 : «À la plus grande
surprise des puissances occidentales, les forces rénovées du petit archipel
triomphèrent aisément du géant chinois. Les armées japonaises déferlèrent sur
la Corée et la Mandchourie, détruisirent la flotte chinoise et occupèrent le
port de Wei-Haï-Wei dans la péninsule du Chan-toung. Le 17 avril 1895, le traité de Shimonoseki mettait
fin à la guerre  sino-japonaise. La Chine cédait au Japon Formose, les îles
Pescadores et la presqu’île du Liao-toung au sud de la Mandchourie; elle devait
en outre verser une lourde indemnité de guerre, reconnaître l’indépendance de
la Corée et accorder aux ressortissants japonais les mêmes privilèges
diplomatiques et commerciaux qu’aux Occidentaux» (p. 171). Certes, les
puissances occidentales (surtout l’Angleterre et la France) avaient procédé par
des guerres pour obtenir les concessions chinoises, mais la violence sadique
avec laquelle le Japon tomba sur la Corée et la flotte chinoise rappela que ce
pays était d’un caractère tout différent de celui de la Chine. Il commença par la dépecer morceau par morceau, ce qui devait se poursuivre tout au long du premier XXe siècle. Dans la course
au gâteau chinois, la Russie et le Japon s’affrontèrent des 1904.
sino-japonaise. La Chine cédait au Japon Formose, les îles
Pescadores et la presqu’île du Liao-toung au sud de la Mandchourie; elle devait
en outre verser une lourde indemnité de guerre, reconnaître l’indépendance de
la Corée et accorder aux ressortissants japonais les mêmes privilèges
diplomatiques et commerciaux qu’aux Occidentaux» (p. 171). Certes, les
puissances occidentales (surtout l’Angleterre et la France) avaient procédé par
des guerres pour obtenir les concessions chinoises, mais la violence sadique
avec laquelle le Japon tomba sur la Corée et la flotte chinoise rappela que ce
pays était d’un caractère tout différent de celui de la Chine. Il commença par la dépecer morceau par morceau, ce qui devait se poursuivre tout au long du premier XXe siècle. Dans la course
au gâteau chinois, la Russie et le Japon s’affrontèrent des 1904. en rade à Port-Arthur le 6 février 1904 suivie une déclaration de guerre en bonne et due forme. Certes, la Russie pouvait enligner des forces très
supérieures à celles du Japon, mais la nécessité de mener les opérations à
l’extrémité d’une ligne de chemin de fer à voie unique, longue de plusieurs
milliers de kilomètres, rendait la chose difficile. C’est alors que
Saint-Pétersbourg envoya une flotte qui partit de la Baltique, traversa
l’Atlantique, l’Océan Indien et l’Océan Pacifique, après moult tempêtes et avaries,
pour finir par se faire anéantir par la flotte japonaise dans la bataille de
Tsushima (27 et 28 mai 1905). Impressionné, le président Théodore Roosevelt
s’offrit en médiateur et le traité de Portsmouth (New Hampshire) signé le 5
septembre 1905,
en rade à Port-Arthur le 6 février 1904 suivie une déclaration de guerre en bonne et due forme. Certes, la Russie pouvait enligner des forces très
supérieures à celles du Japon, mais la nécessité de mener les opérations à
l’extrémité d’une ligne de chemin de fer à voie unique, longue de plusieurs
milliers de kilomètres, rendait la chose difficile. C’est alors que
Saint-Pétersbourg envoya une flotte qui partit de la Baltique, traversa
l’Atlantique, l’Océan Indien et l’Océan Pacifique, après moult tempêtes et avaries,
pour finir par se faire anéantir par la flotte japonaise dans la bataille de
Tsushima (27 et 28 mai 1905). Impressionné, le président Théodore Roosevelt
s’offrit en médiateur et le traité de Portsmouth (New Hampshire) signé le 5
septembre 1905,  mettait fin au conflit russo-japonais. «Aux termes de cet
accord, la Russie reconnaissait les intérêts japonais en Corée et cédait à
l’archipel la concession du Liao-toung ainsi que le chemin de fer
sud-mandchourien. Enfin les Japonais rachetaient contre une indemnité la moitié
méridionale de l’île de Sakhaline, au nord de Hokkaïdo. Allié militaire de la
Grande-Bretagne, vainqueur de la Russie, possesseur d’un empire colonial en
rapide expansion, le Japon prenait enfin place dans le concert des grandes
puissances» (pp. 172-174). Mais le trait le plus important que tout le
monde tira de la victoire nippone en cette ère où le racisme servait de fondement à l’anthropologie : un peuple de «race jaune» venait de montrer au monde qu’il pouvait mettre à genoux l’un des plus puissants États de «race blanche».
mettait fin au conflit russo-japonais. «Aux termes de cet
accord, la Russie reconnaissait les intérêts japonais en Corée et cédait à
l’archipel la concession du Liao-toung ainsi que le chemin de fer
sud-mandchourien. Enfin les Japonais rachetaient contre une indemnité la moitié
méridionale de l’île de Sakhaline, au nord de Hokkaïdo. Allié militaire de la
Grande-Bretagne, vainqueur de la Russie, possesseur d’un empire colonial en
rapide expansion, le Japon prenait enfin place dans le concert des grandes
puissances» (pp. 172-174). Mais le trait le plus important que tout le
monde tira de la victoire nippone en cette ère où le racisme servait de fondement à l’anthropologie : un peuple de «race jaune» venait de montrer au monde qu’il pouvait mettre à genoux l’un des plus puissants États de «race blanche». ambitieux programme
d’exploitation économique. Il fit entrer la péninsule dans la modernité en
y construisant des chemins de fer, des écoles, des usines et tout un ensemble
d’infrastructures modernes. Coréens et Formosans furent soumis à la double autorité
d’une administration coloniale inaccesible à la pitié et d’une police
omniprésente réputée pour sa brutalité (Reischauer). La Première Guerre
mondiale, à laquelle il participa du côté de l’Entente cordiale, le Japon
récolta les possessions allemandes dans le Pacifique. Il s’établit également à
Tsin-tao en Chine ainsi que des autres établissements allemands du Chan-toung.
Enfin, par un curieux paradoxe, le Japon, allié de l’Entente cordiale, déclara
la guerre à un autre membre de la même Entente, la seconde guerre sino-japonaise! En 1915, le
gouvernement japonais présenta à la Chine les 21 Demandes qui furent
refusées par le gouvernement de la jeune république chinoise. Ces demandes
réduisaient la Chine au statut de protectorat japonais. Les puissances
victorieuses de l’Entente s’entendirent pour modérer l’appétit de Tokyo, mais
elles ne purent empêcher l’archipel de s’octroyer de considérables privilèges
économiques en Mandchourie, dans le Chan-toung et dans la province côtière de
Fou-kien située en face de Formose.
ambitieux programme
d’exploitation économique. Il fit entrer la péninsule dans la modernité en
y construisant des chemins de fer, des écoles, des usines et tout un ensemble
d’infrastructures modernes. Coréens et Formosans furent soumis à la double autorité
d’une administration coloniale inaccesible à la pitié et d’une police
omniprésente réputée pour sa brutalité (Reischauer). La Première Guerre
mondiale, à laquelle il participa du côté de l’Entente cordiale, le Japon
récolta les possessions allemandes dans le Pacifique. Il s’établit également à
Tsin-tao en Chine ainsi que des autres établissements allemands du Chan-toung.
Enfin, par un curieux paradoxe, le Japon, allié de l’Entente cordiale, déclara
la guerre à un autre membre de la même Entente, la seconde guerre sino-japonaise! En 1915, le
gouvernement japonais présenta à la Chine les 21 Demandes qui furent
refusées par le gouvernement de la jeune république chinoise. Ces demandes
réduisaient la Chine au statut de protectorat japonais. Les puissances
victorieuses de l’Entente s’entendirent pour modérer l’appétit de Tokyo, mais
elles ne purent empêcher l’archipel de s’octroyer de considérables privilèges
économiques en Mandchourie, dans le Chan-toung et dans la province côtière de
Fou-kien située en face de Formose. La
jonction du mode de production capitaliste hérité de l’Occident et d’une
main-d’œuvre à bas salaire propulsa l’économie japonaise qui ne cessait de se
mettre à jour face aux techniques de production et à l’accélération du
commerce. Si la diplomatie nippone parvenait à ajouter des franges et des
archipels de territoires au pays, l’impérialisme nippon s’étendait maintenant jusqu’en
Europe et aux États-Unis. Cette richesse profitait peu au peuple japonais et
beaucoup aux nouveaux daimyô d’entreprises multinationales. Le fait est que la
production japonaise était bonne et à moindre coût que ses équivalents
occidentaux. Tout était contrôlé du Palais impérial de Tokyo et le syndicalisme
n’existait pas pour contrevenir aux pires formes d'exploitation des
travailleurs. Toute la machine était au service de l’Empereur et du Japon et
l’individualisme n’était pas une valeur occidentale qui
La
jonction du mode de production capitaliste hérité de l’Occident et d’une
main-d’œuvre à bas salaire propulsa l’économie japonaise qui ne cessait de se
mettre à jour face aux techniques de production et à l’accélération du
commerce. Si la diplomatie nippone parvenait à ajouter des franges et des
archipels de territoires au pays, l’impérialisme nippon s’étendait maintenant jusqu’en
Europe et aux États-Unis. Cette richesse profitait peu au peuple japonais et
beaucoup aux nouveaux daimyô d’entreprises multinationales. Le fait est que la
production japonaise était bonne et à moindre coût que ses équivalents
occidentaux. Tout était contrôlé du Palais impérial de Tokyo et le syndicalisme
n’existait pas pour contrevenir aux pires formes d'exploitation des
travailleurs. Toute la machine était au service de l’Empereur et du Japon et
l’individualisme n’était pas une valeur occidentale qui  avait encore pris racine en
Orient. Voilà pourquoi les partis politiques qui émergèrent de la démocratie
s’affrontèrent de manière violente à la Diète. En 1912 une crise
constitutionnelle frappa le Japon. la crise de Taisho. La Diète refusa
un édit impérial qui lui était lancé. La constitution conservatrice des années
1880 était dépassée. Le libéralisme exigeait un arrangement plus démocratique.
Hara fut élu à la présidence du Conseil. Ce chef d’État avait tout de Bismarck.
S’il avait appris beaucoup de la démocratie anglaise, il restait d’un
tempérament autoritaire car il jugeait qu’une démocratie contrôlée restait la
meilleure forme de démocratie pour le Japon. Il fut assassiné en novembre 1921
par un jeune exalté japonais. Au cours de la décennie qui suivit, l’instabilité
gouvernementale accompagna un gouvernement libéral modèle britannique et les
mêmes problèmes éprouvés en Europe se révélèrent au Japon. Après le boom des
décennies précédentes, les années vingt furent marquées par des crises
frumentaires, le chômage, le violent séisme du 1er septembre 1923 qui ébranla
la plaine du Kanto, entraînant avec lui la capitale, Tokyo, et la plus grande partie
de Yokohama, coutant la vie à 130 000 personnes, bref des signes qui
rappelaient la fin du régime Tokugawa.
avait encore pris racine en
Orient. Voilà pourquoi les partis politiques qui émergèrent de la démocratie
s’affrontèrent de manière violente à la Diète. En 1912 une crise
constitutionnelle frappa le Japon. la crise de Taisho. La Diète refusa
un édit impérial qui lui était lancé. La constitution conservatrice des années
1880 était dépassée. Le libéralisme exigeait un arrangement plus démocratique.
Hara fut élu à la présidence du Conseil. Ce chef d’État avait tout de Bismarck.
S’il avait appris beaucoup de la démocratie anglaise, il restait d’un
tempérament autoritaire car il jugeait qu’une démocratie contrôlée restait la
meilleure forme de démocratie pour le Japon. Il fut assassiné en novembre 1921
par un jeune exalté japonais. Au cours de la décennie qui suivit, l’instabilité
gouvernementale accompagna un gouvernement libéral modèle britannique et les
mêmes problèmes éprouvés en Europe se révélèrent au Japon. Après le boom des
décennies précédentes, les années vingt furent marquées par des crises
frumentaires, le chômage, le violent séisme du 1er septembre 1923 qui ébranla
la plaine du Kanto, entraînant avec lui la capitale, Tokyo, et la plus grande partie
de Yokohama, coutant la vie à 130 000 personnes, bref des signes qui
rappelaient la fin du régime Tokugawa.Devant les mœurs occidentales qui revinrent au Japon après la guerre, la vieille discipline confucéenne n'avait plus qu'à s’écarter devant la mode occidentale des Années folles, la libération de la femme, les valeurs de la
 société de consommation. La
littérature, le cinéma et la musique occidentale compétitionnaient avec les arts
traditionnels du Japon. De plus, la révolution bolchevique en Russie en 1917 n'alla pas sans soulever de nouvelles inquiétudes. Pris dans le tourbillon de la
vie contemporaine, le Japon lâchait la garde militaire. Le budget du ministère
diminuait. La diplomatie se voulait conciliante. Le Japon participait à la Société des
Nations fondée en 1919. Mais la crise de 1929 frappa le pays et ramena
le goût pour l’absolutisme et le militarisme qui coïncidait avec la floraison des fascismes en
Europe. Très différent toutefois, il s’agissait avant tout d’une tendance
ultra-nationaliste et ultra-conservatrice qui survivait toujours durant l’ère des
réformes Meiji mais qui n’avait pas la cote auprès des forces nouvelles.
Souvent appuyés par les paysans qui trouvaient lourd le fardeau du libéralisme
économique et des lois démocratiques, la nouvelle caste se campa auprès du
nouvel empereur Hiro-Hito. Le premier territoire visé fut la Mandchourie sur
lequel des attentats sont commis contre les forces d’occupation nippones, dont
le fameux sabotage du tronçon du chemin de fer sud-mandchourien (incident de Mukden), le 18 septembre
1931, organisé par des
officiers japonais et reporté sur la responsabilité des Chinois. Il n’en fallut
pas plus pour déclencher l’invasion complète de la Mandchourie dont le Japon
fit un État fantoche, le Mandchoukouo à la tête du quel il plaça l’ancien
empereur-enfant Pu Yi. Bien entendu, les puissances occidentales n'étaient pas
dupes de l’affaire et la SDN refuse d’entériner le coup de force japonais. Le
Japon n'avait plus qu'à se retirer de la SDN (1933) :
société de consommation. La
littérature, le cinéma et la musique occidentale compétitionnaient avec les arts
traditionnels du Japon. De plus, la révolution bolchevique en Russie en 1917 n'alla pas sans soulever de nouvelles inquiétudes. Pris dans le tourbillon de la
vie contemporaine, le Japon lâchait la garde militaire. Le budget du ministère
diminuait. La diplomatie se voulait conciliante. Le Japon participait à la Société des
Nations fondée en 1919. Mais la crise de 1929 frappa le pays et ramena
le goût pour l’absolutisme et le militarisme qui coïncidait avec la floraison des fascismes en
Europe. Très différent toutefois, il s’agissait avant tout d’une tendance
ultra-nationaliste et ultra-conservatrice qui survivait toujours durant l’ère des
réformes Meiji mais qui n’avait pas la cote auprès des forces nouvelles.
Souvent appuyés par les paysans qui trouvaient lourd le fardeau du libéralisme
économique et des lois démocratiques, la nouvelle caste se campa auprès du
nouvel empereur Hiro-Hito. Le premier territoire visé fut la Mandchourie sur
lequel des attentats sont commis contre les forces d’occupation nippones, dont
le fameux sabotage du tronçon du chemin de fer sud-mandchourien (incident de Mukden), le 18 septembre
1931, organisé par des
officiers japonais et reporté sur la responsabilité des Chinois. Il n’en fallut
pas plus pour déclencher l’invasion complète de la Mandchourie dont le Japon
fit un État fantoche, le Mandchoukouo à la tête du quel il plaça l’ancien
empereur-enfant Pu Yi. Bien entendu, les puissances occidentales n'étaient pas
dupes de l’affaire et la SDN refuse d’entériner le coup de force japonais. Le
Japon n'avait plus qu'à se retirer de la SDN (1933) :«Au Japon, l’incident de Mandchourie crée une psychose de guerre. La population, atteinte d’un
 véritable délire nationaliste, semble grisée par la dérisoire
facilité avec laquelle les militaires ont annexé un territoire sensiblement
plus étendu que l’archipel et occupé par 30 millions de Chinois réputés pour
leur ardeur au travail. L’armée, et derrière elle l’ensemble du pays, sont
désormais engagés dans une politique d’expansion continentale, "l’affaire
mandchoue" confirme que l’empereur et le gouvernement ont perdu le
contrôle de l’armée. Ce que l’on pressentait depuis l’assassinat de Tchang
Tso-lin en 1928 devient une évidence; c’est l’armée qui dicte la politique
étrangère japonaise par la tactique du "fait accompli". Face à
l’opinion mondiale, le gouvernement civil ne peut que couvrir et défendre à
contrecœur une politique dont il n’est plus le maître. ainsi se dessine une
sorte de gouvernement bicéphale dans lequel l’armée se réserve la conduite de
la politique étrangère» (pp. 222-223).
véritable délire nationaliste, semble grisée par la dérisoire
facilité avec laquelle les militaires ont annexé un territoire sensiblement
plus étendu que l’archipel et occupé par 30 millions de Chinois réputés pour
leur ardeur au travail. L’armée, et derrière elle l’ensemble du pays, sont
désormais engagés dans une politique d’expansion continentale, "l’affaire
mandchoue" confirme que l’empereur et le gouvernement ont perdu le
contrôle de l’armée. Ce que l’on pressentait depuis l’assassinat de Tchang
Tso-lin en 1928 devient une évidence; c’est l’armée qui dicte la politique
étrangère japonaise par la tactique du "fait accompli". Face à
l’opinion mondiale, le gouvernement civil ne peut que couvrir et défendre à
contrecœur une politique dont il n’est plus le maître. ainsi se dessine une
sorte de gouvernement bicéphale dans lequel l’armée se réserve la conduite de
la politique étrangère» (pp. 222-223). |
| L'incident de Moukden vu par Hergé dans l'album de Tintin, Le Lotus bleu |
 26-2 -
marque un nouveau tournant politique. Ce jour-là, un groupe de jeunes officiers
extrémistes mobilisent la première division de Tokyo pour éliminer physiquement
tous les hommes politiques hostiles à leurs desseins. En quelques heures, ils
font massacrer le ministre des Finances, le garde du Sceau privé, deux anciens
Premiers ministres - Takahashi et l’amiral Saito -, ainsi qu’un des trois
généraux en chef de l’armée. L’amiral Suzuki et le grand chambellan sont
grièvement blessés, tandis que Saionji et l’amiral Okada parviennent à
s’enfuir. Ce dernier, alors président du Conseil, bénéficie d’une méprise des
conjurés qui assassinent par erreur son beau-frère» (p. 226). Une telle
boucherie ramenait aux pires heures de l’époque pré-shögunale. À partir
de 1937, le gouvernement constitutionnel n’est plus qu’une ombre. L’armée tient
les rennes du pouvoir. La
26-2 -
marque un nouveau tournant politique. Ce jour-là, un groupe de jeunes officiers
extrémistes mobilisent la première division de Tokyo pour éliminer physiquement
tous les hommes politiques hostiles à leurs desseins. En quelques heures, ils
font massacrer le ministre des Finances, le garde du Sceau privé, deux anciens
Premiers ministres - Takahashi et l’amiral Saito -, ainsi qu’un des trois
généraux en chef de l’armée. L’amiral Suzuki et le grand chambellan sont
grièvement blessés, tandis que Saionji et l’amiral Okada parviennent à
s’enfuir. Ce dernier, alors président du Conseil, bénéficie d’une méprise des
conjurés qui assassinent par erreur son beau-frère» (p. 226). Une telle
boucherie ramenait aux pires heures de l’époque pré-shögunale. À partir
de 1937, le gouvernement constitutionnel n’est plus qu’une ombre. L’armée tient
les rennes du pouvoir. La  brillante école, héritage de l’ère Meiji, devient un
centre de diffusion propagandiste ultra-nationaliste, surtout à travers le Kokutai no hongi, les Principes fondamentaux du Kokutai, «amalgame à
l’usage des écoliers un ensemble hétéroclite de notions étrangement surannées.
On y trouve pêle-mêle des récits mythologiques illustrant la supériorité
japonaise et la continuité dynastique, l’exaltation de la "volonté
impériale", le rappel des vertus confucéennes de loyauté individuelle et
de piété filiale, l’évocation du code médiéval de l’honneur guerrier.
D’inspiration résolument antioccidentale, le Kokutai no hongi stigmatise l’individualisme auquel sont imputés tous les vices de l’occident, depuis la
démocratie jusqu’au communisme. Mais le lecteur n’y trouve aucune directive
utilisable pour une action concrète» (pp. 231-232). Pourquoi en aurait-il
de besoin, de toutes façons? Véritable phase d’archaïsme intellectuel,
psychologique et moral, «Les indications pratiques y occupent une place
réduite et sont, dans le meilleur des cas, d’une extrême imprécision. Les
vertus traditionnelles se trouvent érigées en idéaux intangibles tandis que la
"volonté impériale" devient l’objet d’un véritable culte.
brillante école, héritage de l’ère Meiji, devient un
centre de diffusion propagandiste ultra-nationaliste, surtout à travers le Kokutai no hongi, les Principes fondamentaux du Kokutai, «amalgame à
l’usage des écoliers un ensemble hétéroclite de notions étrangement surannées.
On y trouve pêle-mêle des récits mythologiques illustrant la supériorité
japonaise et la continuité dynastique, l’exaltation de la "volonté
impériale", le rappel des vertus confucéennes de loyauté individuelle et
de piété filiale, l’évocation du code médiéval de l’honneur guerrier.
D’inspiration résolument antioccidentale, le Kokutai no hongi stigmatise l’individualisme auquel sont imputés tous les vices de l’occident, depuis la
démocratie jusqu’au communisme. Mais le lecteur n’y trouve aucune directive
utilisable pour une action concrète» (pp. 231-232). Pourquoi en aurait-il
de besoin, de toutes façons? Véritable phase d’archaïsme intellectuel,
psychologique et moral, «Les indications pratiques y occupent une place
réduite et sont, dans le meilleur des cas, d’une extrême imprécision. Les
vertus traditionnelles se trouvent érigées en idéaux intangibles tandis que la
"volonté impériale" devient l’objet d’un véritable culte.  L’ouvrage
fait constamment appel à des notions vagues telles que "l’esprit japonais",
ou le kokutai. Il est émaillé d’aphorismes comme le fameux hakko
ichiu - "le monde entier sous un même toit" -, emprunté à
l’ancienne philosophie chinoise. Cette proposition énigmatique pouvait revêtir
un double sens : sens bénin si elle désignait la fraternité du genre humain,
sens menaçant si elle évoquait la domination japonaise sur l’ensemble du monde.
L’idéologie du Kokutai no hongi se définit peut-être davantage encore
par ses refus que par ses affirmations : refus du capitalisme sauvage, refus de
la corruption politique, refus de l’individualisme, de l’internationalisme et
d’un monde occidental stéréotypé inspirant autant de crainte que de mépris.
Capitalistes et politiciens se trouvent asociés dans une même réprobation :
solidaires par l’égoïsme de leurs mobiles, ils portent la tache d’une commune
contamination par les valeurs occidentales. Dans la fin des années 30, ce qui
vient d’occident n’inspire que défiance et suspicion. Lorsqu’un enfant
rencontre un Occidental dans la rue, il le désigne spontanément par le mot
anglais spy, c’est-à-dire espion!…» (p. 232).
L’ouvrage
fait constamment appel à des notions vagues telles que "l’esprit japonais",
ou le kokutai. Il est émaillé d’aphorismes comme le fameux hakko
ichiu - "le monde entier sous un même toit" -, emprunté à
l’ancienne philosophie chinoise. Cette proposition énigmatique pouvait revêtir
un double sens : sens bénin si elle désignait la fraternité du genre humain,
sens menaçant si elle évoquait la domination japonaise sur l’ensemble du monde.
L’idéologie du Kokutai no hongi se définit peut-être davantage encore
par ses refus que par ses affirmations : refus du capitalisme sauvage, refus de
la corruption politique, refus de l’individualisme, de l’internationalisme et
d’un monde occidental stéréotypé inspirant autant de crainte que de mépris.
Capitalistes et politiciens se trouvent asociés dans une même réprobation :
solidaires par l’égoïsme de leurs mobiles, ils portent la tache d’une commune
contamination par les valeurs occidentales. Dans la fin des années 30, ce qui
vient d’occident n’inspire que défiance et suspicion. Lorsqu’un enfant
rencontre un Occidental dans la rue, il le désigne spontanément par le mot
anglais spy, c’est-à-dire espion!…» (p. 232). bien la fraternité humaine que la domination du
monde et en particulier de l’Asie. Bref, le kokutai no hongi exprime le
souhait de dresser un État universel de l’ensemble de la Civlisation
extrême-orientale et c’est dans ce cadre que peut se comprendre la troisième et
la plus terrible des guerres sino-japonaises déclarée en 1937. Dans la nuit du
7 juillet 1937, un combat fortuit s’engage entre des soldats chinois et des
troupes japonaises, en manœuvres près de Pékin. C’est l’incident du pont Marco-Polo. À la différence de l’incident de Moukden, il ne s’agit pas
cette fois d’un geste prémédité. Le commandement militaire japonais en Chine du
Nord s’efforce de circonscrire l’affaire sur le plan local, mais le
gouvernement chinois demande au gouvernement japonais un réglement définitif
des questions en litige. Tokyo accepte d’envisager une solution négociée mais
pendant que l’on recherche un terrain d’entente, des avions chinois bombardent,
le 14 août, des navires de guerre japonais mouillant à Changhaï. C’est la ville
qui est atteinte. La guerre est déclarée, et pour l’armée japonaise, il s’agit
d’une guerre totale comme il s’en est livrée une en Espagne et comme il
s’en livrera une autre, à l’échelle planétaire, en 1939.
bien la fraternité humaine que la domination du
monde et en particulier de l’Asie. Bref, le kokutai no hongi exprime le
souhait de dresser un État universel de l’ensemble de la Civlisation
extrême-orientale et c’est dans ce cadre que peut se comprendre la troisième et
la plus terrible des guerres sino-japonaises déclarée en 1937. Dans la nuit du
7 juillet 1937, un combat fortuit s’engage entre des soldats chinois et des
troupes japonaises, en manœuvres près de Pékin. C’est l’incident du pont Marco-Polo. À la différence de l’incident de Moukden, il ne s’agit pas
cette fois d’un geste prémédité. Le commandement militaire japonais en Chine du
Nord s’efforce de circonscrire l’affaire sur le plan local, mais le
gouvernement chinois demande au gouvernement japonais un réglement définitif
des questions en litige. Tokyo accepte d’envisager une solution négociée mais
pendant que l’on recherche un terrain d’entente, des avions chinois bombardent,
le 14 août, des navires de guerre japonais mouillant à Changhaï. C’est la ville
qui est atteinte. La guerre est déclarée, et pour l’armée japonaise, il s’agit
d’une guerre totale comme il s’en est livrée une en Espagne et comme il
s’en livrera une autre, à l’échelle planétaire, en 1939. Au
tout départ, il s'agissait de briser la Chine une fois pour toutes. Le viol
de Nankin en fut le point central. La ville et ses environs fut transformée en un véritable charnier : hommes, femmes, enfants, vieillards… Partout des fosses communes pour y entasser les victimes du martyre. Comme le souligne Jean-Louis Margolin, «Le
massacre de Nankin, alors capitale de la Chine, reste l'emblème de la
criminaité de guerre japonaise. […] les quelques 50 000 à 90 000
victimes recensées en huit semaines dans la ville et ses
Au
tout départ, il s'agissait de briser la Chine une fois pour toutes. Le viol
de Nankin en fut le point central. La ville et ses environs fut transformée en un véritable charnier : hommes, femmes, enfants, vieillards… Partout des fosses communes pour y entasser les victimes du martyre. Comme le souligne Jean-Louis Margolin, «Le
massacre de Nankin, alors capitale de la Chine, reste l'emblème de la
criminaité de guerre japonaise. […] les quelques 50 000 à 90 000
victimes recensées en huit semaines dans la ville et ses  environs imédiats ne
représentent que moins de 1% des morts provoquéses par l’armée japonaise, en
dehors même des combats». A Nankin, on a
demandé aux soldats japonais de massacrer, de torturer et de violer et tuer les civils, histoire de s'entrainer et de s'amuser un peu en attendant et ils l'ont fait! «Nankin fut probablement la plus grande
tuerie en un lieu et un moment précis…» (J.-L. Margolin. «Occupations
nippones», in A. Aglan et R. Frank (éd.). 1937-1947 La guerre-monde, t. 2, Paris,
Gallimard, Col. Folio-Histoire, # 245, 2015, pp. 1898-1899). Le déchaînement de
la brutalité guerrière du Japon demeure un mystère pour bien des observateurs.
On n’a cessé de s’interroger à savoir comment un peuple qui avait donné Bach,
Gœthe et Beethoven, avait pu également organiser si scientifiquement, si méthodiquement, l’extermination de 6 000 000 de Juifs; la même question angoissante surgit
lorsque nous regardons l’horreur avec laquelle les Japonais justifièrent la sphère
de coprospérité asiatique : «Les quatre races du Japon, de la Chine, de la Corée et de la Mandchourie doivent participer à la prospérité commune au
travers d’une division des responsabilités : aux Japonais, la direction
politique et l’industrie lourde; aux Chinois, la main-d’œuvre et l’industrie
légère; aux Coréens, le riz; et aux Mandchous l’élevage», disait clairement,
dès 1930, Kanji Ishiwara (Cité in ibid. p. 1586). Ce n’était encore qu’un
programme de colonisation de l’Asie par le Japon.
environs imédiats ne
représentent que moins de 1% des morts provoquéses par l’armée japonaise, en
dehors même des combats». A Nankin, on a
demandé aux soldats japonais de massacrer, de torturer et de violer et tuer les civils, histoire de s'entrainer et de s'amuser un peu en attendant et ils l'ont fait! «Nankin fut probablement la plus grande
tuerie en un lieu et un moment précis…» (J.-L. Margolin. «Occupations
nippones», in A. Aglan et R. Frank (éd.). 1937-1947 La guerre-monde, t. 2, Paris,
Gallimard, Col. Folio-Histoire, # 245, 2015, pp. 1898-1899). Le déchaînement de
la brutalité guerrière du Japon demeure un mystère pour bien des observateurs.
On n’a cessé de s’interroger à savoir comment un peuple qui avait donné Bach,
Gœthe et Beethoven, avait pu également organiser si scientifiquement, si méthodiquement, l’extermination de 6 000 000 de Juifs; la même question angoissante surgit
lorsque nous regardons l’horreur avec laquelle les Japonais justifièrent la sphère
de coprospérité asiatique : «Les quatre races du Japon, de la Chine, de la Corée et de la Mandchourie doivent participer à la prospérité commune au
travers d’une division des responsabilités : aux Japonais, la direction
politique et l’industrie lourde; aux Chinois, la main-d’œuvre et l’industrie
légère; aux Coréens, le riz; et aux Mandchous l’élevage», disait clairement,
dès 1930, Kanji Ishiwara (Cité in ibid. p. 1586). Ce n’était encore qu’un
programme de colonisation de l’Asie par le Japon. Avec
l’accession du militarisme comme doctrine idéologique du nouveau gouvernement,
le kokutai, comme on l’a vu, recouvre le tout d’un ramassage de
motivations affectives traditionnelles : «Le Japon est décrit comme une
grande famille hiérarchisée, groupée autour d’un empereur-dieu, d’où toute
dissension doit être bannie, et qui doit être régie par le concept central de
loyauté absolue envers le supérieur. Au plan extérieur, on insiste sur
l’originalité fondamentale du pays, sur sa vocation naturelle à conduire le
monde, et d’abord l’Asie, qu’il faut préalablement débarrasser de l’influence occidentale
: "Faire rayonner notre grande vertu sur toute la terre, faire du monde
une seule famille, voilà la mission qui nous a été léguée par nos ancêtres
impériaux et nous la prenons à cœur, jour et nuit", précise le rescrit
impérial publié lors de la signature, en septembre 1940, du pacte constituant
l’Axe Berlin-Rome-Tokyo» (p. 1593). De la sphère de coprospérité, on passe
à l’État universel. Le succès de l’unification du Japon alors que la Chine
reste déchirée confirme sa vocation au cœur de la Civilisation
extrême-orientale. Le sens de l’unité est exacerbé dans toutes les
dimensions de la conscience historique nippone :
Avec
l’accession du militarisme comme doctrine idéologique du nouveau gouvernement,
le kokutai, comme on l’a vu, recouvre le tout d’un ramassage de
motivations affectives traditionnelles : «Le Japon est décrit comme une
grande famille hiérarchisée, groupée autour d’un empereur-dieu, d’où toute
dissension doit être bannie, et qui doit être régie par le concept central de
loyauté absolue envers le supérieur. Au plan extérieur, on insiste sur
l’originalité fondamentale du pays, sur sa vocation naturelle à conduire le
monde, et d’abord l’Asie, qu’il faut préalablement débarrasser de l’influence occidentale
: "Faire rayonner notre grande vertu sur toute la terre, faire du monde
une seule famille, voilà la mission qui nous a été léguée par nos ancêtres
impériaux et nous la prenons à cœur, jour et nuit", précise le rescrit
impérial publié lors de la signature, en septembre 1940, du pacte constituant
l’Axe Berlin-Rome-Tokyo» (p. 1593). De la sphère de coprospérité, on passe
à l’État universel. Le succès de l’unification du Japon alors que la Chine
reste déchirée confirme sa vocation au cœur de la Civilisation
extrême-orientale. Le sens de l’unité est exacerbé dans toutes les
dimensions de la conscience historique nippone : le
temps, puisque l’empire est intrinsèquement éternel et immuable. Pour les
nationalistes, le sens même de l’histoire mondiale, c’est la primauté
nippo-impériale. On en trouve trace dans la déconcertante formule
utilisée en décembre 1941 par le Schéma de l’information et de la
propagande pour la guerre entre le Japon et les puissances anglo-américaines : "Permettre
à l’ensemble des nations et des races d’occuper leur position appropriée",
dans un édifice hiérarchique couronné par le Japon. tout doit évidemment céder
face à un but aussi admirable, ainsi précisé lors du symposium de la revue Chuô
Koron, en décembre 1943 : "Quand la lumière de l’auguste vertu de Sa
Majesté vient à éclairer le monde entier et à l’accorder aux voies de la Terre
Divine, il ne peut plus y avoir quelque chose comme un droit
international". Exaltation d’un retour prétendu à un passé magnifié,
extension indéfinie de l’espace de contrôle qui en assure la pérennité : il y
avait là une dangereuse et contagieuse magie à laquelle bien peu résistèrent,
tant elle s’accordait avec le bain idéologique dans lequel chaque génération du
Japon de 1937 avait été élevée» (p.
1594).
le
temps, puisque l’empire est intrinsèquement éternel et immuable. Pour les
nationalistes, le sens même de l’histoire mondiale, c’est la primauté
nippo-impériale. On en trouve trace dans la déconcertante formule
utilisée en décembre 1941 par le Schéma de l’information et de la
propagande pour la guerre entre le Japon et les puissances anglo-américaines : "Permettre
à l’ensemble des nations et des races d’occuper leur position appropriée",
dans un édifice hiérarchique couronné par le Japon. tout doit évidemment céder
face à un but aussi admirable, ainsi précisé lors du symposium de la revue Chuô
Koron, en décembre 1943 : "Quand la lumière de l’auguste vertu de Sa
Majesté vient à éclairer le monde entier et à l’accorder aux voies de la Terre
Divine, il ne peut plus y avoir quelque chose comme un droit
international". Exaltation d’un retour prétendu à un passé magnifié,
extension indéfinie de l’espace de contrôle qui en assure la pérennité : il y
avait là une dangereuse et contagieuse magie à laquelle bien peu résistèrent,
tant elle s’accordait avec le bain idéologique dans lequel chaque génération du
Japon de 1937 avait été élevée» (p.
1594). Les
formules utilisées par le gouvernement japonais vont dans le même sens que
leurs alliés européens. Le Premier ministre Fumimaro Konoe, en décembre 1938,
donna à sa politique officielle le nom d’«Ordre nouveau en Asie de l’Est» (Tôa
Shin Chitsujo). Pour le moment, il ne s’agissait que du Japon et son
avatard, le Mandchoukouo. Le concept s’élargit ensuite à l’Asie du Sud-Est
jusqu’à l’Indochine et l’Indonésie. On parlait alors de la «Sphère de
Coprospérité de la Grande Asie de l’Est» (Dai-Tôa Kyoeiken) le 1er août
1940. Ce slogan était destiné à l’extérieur du Japon : «la nouvelle
proposition de la libération de l’Asie et de son unification devint donc
centrale, surtout après 1941. Unification sous l’égide du Japon bien entendu :
peu après la conquête de l’Asie du Sud-Est, au printemps de 1942, fut lancé à
l’échelle de la région le mouvement du Triple A (comme Asike) - "Nippon la
Lumière de l’Asie, Nippon le Protecteur de l’Asie, Nippon le Leader de l’Asie"
(le Japon avait alors décrété l’abolition de son appellation d’origine
européenne, et son remplacement, y compris en langues occidentales, par
"Nippon", dans tous les documents officiels). La participation
enthousiasme fut obligatoire pour les fonctionnaires et les enfants des écoles
et le mouvement reçut le soutien de nombreux collaborateurs, dont Sukarno à
Java. Néanmoins, les intentions impérialistes, par trop voyantes, entraînèrent
l’abandon du Triple A dès septembre 1942». (pp. 1600-1601). Le Japon devenait alors le libérateur de l’Asie de l’emprise occidentale et, dans le reflux militaire, devint le mot d’ordre de la mobilisation des «alliés». Tout cela
relevait de la plus bête des propagandes.
Les
formules utilisées par le gouvernement japonais vont dans le même sens que
leurs alliés européens. Le Premier ministre Fumimaro Konoe, en décembre 1938,
donna à sa politique officielle le nom d’«Ordre nouveau en Asie de l’Est» (Tôa
Shin Chitsujo). Pour le moment, il ne s’agissait que du Japon et son
avatard, le Mandchoukouo. Le concept s’élargit ensuite à l’Asie du Sud-Est
jusqu’à l’Indochine et l’Indonésie. On parlait alors de la «Sphère de
Coprospérité de la Grande Asie de l’Est» (Dai-Tôa Kyoeiken) le 1er août
1940. Ce slogan était destiné à l’extérieur du Japon : «la nouvelle
proposition de la libération de l’Asie et de son unification devint donc
centrale, surtout après 1941. Unification sous l’égide du Japon bien entendu :
peu après la conquête de l’Asie du Sud-Est, au printemps de 1942, fut lancé à
l’échelle de la région le mouvement du Triple A (comme Asike) - "Nippon la
Lumière de l’Asie, Nippon le Protecteur de l’Asie, Nippon le Leader de l’Asie"
(le Japon avait alors décrété l’abolition de son appellation d’origine
européenne, et son remplacement, y compris en langues occidentales, par
"Nippon", dans tous les documents officiels). La participation
enthousiasme fut obligatoire pour les fonctionnaires et les enfants des écoles
et le mouvement reçut le soutien de nombreux collaborateurs, dont Sukarno à
Java. Néanmoins, les intentions impérialistes, par trop voyantes, entraînèrent
l’abandon du Triple A dès septembre 1942». (pp. 1600-1601). Le Japon devenait alors le libérateur de l’Asie de l’emprise occidentale et, dans le reflux militaire, devint le mot d’ordre de la mobilisation des «alliés». Tout cela
relevait de la plus bête des propagandes. Pourtant,
malgré l’aspect délirant de ces slogans, il y avait là l’expression d’un
souhait, celui de rassembler la Civilisation extrême-orientale à l’intérieur
d’un système dont la tête résiderait au Japon, ce qui allait de soi.
L’extension de la zone de guerre du Pacifique élargissait la sphère de
coprospérité jusqu’à l’Australie en passant par toutes les îles et archipels de
l’Océan Pacifique à l’est, puis à l’ouest jusqu’à la Birmanie sinon l’Inde. La Grande Asie de l’Est
restait pour le moment la visée de l’empire nippon :
Pourtant,
malgré l’aspect délirant de ces slogans, il y avait là l’expression d’un
souhait, celui de rassembler la Civilisation extrême-orientale à l’intérieur
d’un système dont la tête résiderait au Japon, ce qui allait de soi.
L’extension de la zone de guerre du Pacifique élargissait la sphère de
coprospérité jusqu’à l’Australie en passant par toutes les îles et archipels de
l’Océan Pacifique à l’est, puis à l’ouest jusqu’à la Birmanie sinon l’Inde. La Grande Asie de l’Est
restait pour le moment la visée de l’empire nippon : «La
propagande de l’occupant reposait partout sur cinq piliers, auxquels
s’ajoutaient des mots d’ordre propres à chaque communauté. D’abord un
suprématisme "jaune" : supériorité nippone, racisme anti-Blancs,
appel aux "Asiatiques amollis" à se réveiller. Ensuite la supériorité
de l’esprit sur la matière, censée expliquer celle de l’Orient sur l’Occident
"matérialiste". La centralité de l’empereur, à la paternelle
bienveillance à l’égard de ses enfants (le terme japonais se traduirait plutôt
par "bébés") ignorants et maladroits. Le Hakkoichiu, qu’on
peut traduire par "les huit parties du monde sous le même toit" - on
l’interprète soit comme la volonté d’hégémonie mondiale du Japon, soit comme
son désir d’égalité et d’harmonie entre les peuples. Enfin la sphère de
coprospérité, censée assurer le bonheur commun. Progressivement, la thématique
panasiatique tendra à l’emporter sur celle de la supériorité et de la
centralité nippone, mise à mal par les succès alliés. Cela alla avec des
concessions verbales à une forme d’égalité entre peuples et cultures. De ce
point de vue, le Mandchoukouo - où la nationalité théoriquement dominante, la
mandchoue, ne représentait qu’un petit pourcentage de la population - joua le
rôle d’un modèle. On y vantait l’union fraternelle des "cinq races"
(mandchoue, chinoise, mongole, coréenne et japonaise), autour de la doctrine de
la "Voie Royale" (une manière de despotisme éclairé) chère à Sun
Yat-sen, ainsi que d’un syncrétisme entre confucianisme, bouddhisme et taoïsme
puis, à partir de 1940 surtout, shinto» (pp. 1601-1602).
«La
propagande de l’occupant reposait partout sur cinq piliers, auxquels
s’ajoutaient des mots d’ordre propres à chaque communauté. D’abord un
suprématisme "jaune" : supériorité nippone, racisme anti-Blancs,
appel aux "Asiatiques amollis" à se réveiller. Ensuite la supériorité
de l’esprit sur la matière, censée expliquer celle de l’Orient sur l’Occident
"matérialiste". La centralité de l’empereur, à la paternelle
bienveillance à l’égard de ses enfants (le terme japonais se traduirait plutôt
par "bébés") ignorants et maladroits. Le Hakkoichiu, qu’on
peut traduire par "les huit parties du monde sous le même toit" - on
l’interprète soit comme la volonté d’hégémonie mondiale du Japon, soit comme
son désir d’égalité et d’harmonie entre les peuples. Enfin la sphère de
coprospérité, censée assurer le bonheur commun. Progressivement, la thématique
panasiatique tendra à l’emporter sur celle de la supériorité et de la
centralité nippone, mise à mal par les succès alliés. Cela alla avec des
concessions verbales à une forme d’égalité entre peuples et cultures. De ce
point de vue, le Mandchoukouo - où la nationalité théoriquement dominante, la
mandchoue, ne représentait qu’un petit pourcentage de la population - joua le
rôle d’un modèle. On y vantait l’union fraternelle des "cinq races"
(mandchoue, chinoise, mongole, coréenne et japonaise), autour de la doctrine de
la "Voie Royale" (une manière de despotisme éclairé) chère à Sun
Yat-sen, ainsi que d’un syncrétisme entre confucianisme, bouddhisme et taoïsme
puis, à partir de 1940 surtout, shinto» (pp. 1601-1602). Pendant
que la représentation sociale de la caste militaire nippone se saoulait de
délires de grandeur, ses capacités s’avouèrent vite limitées lorsqu’ils
tentèrent de renouveler le coup de Port-Arthur sur Pearl Harbor à Hawaï,
provoquant l’état de guerre avec les États-Unis. Un siècle après la visite des
canonières de l’Amiral Perry à Uraga, le Japon voulait remettre sa vengeance historique par un carte de visite meurtrière. Malgré une rapide invasion des
territoires du Sud-Est asiatique, les ressources japonaises finirent par
s’épuiser rapidement et les massacres de populations civiles aux Philippines et ailleurs dressèrent contre le «libérateur» la haine des peuples occupés, et lorsque l’Europe fut libérée de Hitler, les puissances alliées se
tournèrent vers le Pacifique. Même l’URSS, que le Japon avait évité d’attaquer,
lui lança une déclaration de guerre officielle, qui arriva seulement après
Hiroshima et Nagasaki.
Pendant
que la représentation sociale de la caste militaire nippone se saoulait de
délires de grandeur, ses capacités s’avouèrent vite limitées lorsqu’ils
tentèrent de renouveler le coup de Port-Arthur sur Pearl Harbor à Hawaï,
provoquant l’état de guerre avec les États-Unis. Un siècle après la visite des
canonières de l’Amiral Perry à Uraga, le Japon voulait remettre sa vengeance historique par un carte de visite meurtrière. Malgré une rapide invasion des
territoires du Sud-Est asiatique, les ressources japonaises finirent par
s’épuiser rapidement et les massacres de populations civiles aux Philippines et ailleurs dressèrent contre le «libérateur» la haine des peuples occupés, et lorsque l’Europe fut libérée de Hitler, les puissances alliées se
tournèrent vers le Pacifique. Même l’URSS, que le Japon avait évité d’attaquer,
lui lança une déclaration de guerre officielle, qui arriva seulement après
Hiroshima et Nagasaki.  possible. D’autres n’ont pas reculé devant les
actes de pures boucheries, ne serait-ce que comme propagande psychologique pour
les autres adversaires. La cruauté sadique du commandement japonais visait
autre chose. On a parlé de la tuerie de Nankin en 1937. On pourrait mentionner
également les 131 000 civils ou prisonniers de guerre philippins assassinés
froidement. 5 000 jeunes Chinois de Singapour, où l’on avait boycotté les
produits nippons, furent «nettoyés» en février 1942. La petite résistance
française et viétnamienne, après le coup de force de mars 1945 conduisit à
ce que 3 des 8 chefs de réseaux moururent sous la torture (au milieu de
dizaines de leurs compatriotes) et des centaines de militaires qui avaient
tenté de se défendre furent massacrés sur place. Ceux qui n’étaient pas abattus
comme des chiens finirent dans des camps de concentration où la déshumanisation
des captifs était le mode commun :
possible. D’autres n’ont pas reculé devant les
actes de pures boucheries, ne serait-ce que comme propagande psychologique pour
les autres adversaires. La cruauté sadique du commandement japonais visait
autre chose. On a parlé de la tuerie de Nankin en 1937. On pourrait mentionner
également les 131 000 civils ou prisonniers de guerre philippins assassinés
froidement. 5 000 jeunes Chinois de Singapour, où l’on avait boycotté les
produits nippons, furent «nettoyés» en février 1942. La petite résistance
française et viétnamienne, après le coup de force de mars 1945 conduisit à
ce que 3 des 8 chefs de réseaux moururent sous la torture (au milieu de
dizaines de leurs compatriotes) et des centaines de militaires qui avaient
tenté de se défendre furent massacrés sur place. Ceux qui n’étaient pas abattus
comme des chiens finirent dans des camps de concentration où la déshumanisation
des captifs était le mode commun :  après le coup de force nippon du 9 mars
1945) évoque celui des Soviétiques aux mains des Allemands», écrit encore
Margolin (p. 1904). Les travaux forcés et la sous-nutrition conduisent
parfois à de purs actes de cannibalisme. Les prisonniers chinois furent surtout
les plus violentés. Ils servirent littéralement de cobayes à des expériences
scientifiques plutôt gratuites : «Quelque 3 000 prisonniers (civils comme
militaires) furent utilisés, comme cobayes humains, par l’unité 731, chargée de
produire en secret des armes bactériologiques à Pingfang, près de Harbin, en
Mandchourie occupée. Les bombes chargées de germes (de peste surtout) furent
parfois expérimentées (comme à Ningbo, grand port de Chine centrale), avec des
résultats divers, encore mal évalués. Plusieurs milliers d’autres détenus
périrent dans d’autres lieux d’expérimentation
après le coup de force nippon du 9 mars
1945) évoque celui des Soviétiques aux mains des Allemands», écrit encore
Margolin (p. 1904). Les travaux forcés et la sous-nutrition conduisent
parfois à de purs actes de cannibalisme. Les prisonniers chinois furent surtout
les plus violentés. Ils servirent littéralement de cobayes à des expériences
scientifiques plutôt gratuites : «Quelque 3 000 prisonniers (civils comme
militaires) furent utilisés, comme cobayes humains, par l’unité 731, chargée de
produire en secret des armes bactériologiques à Pingfang, près de Harbin, en
Mandchourie occupée. Les bombes chargées de germes (de peste surtout) furent
parfois expérimentées (comme à Ningbo, grand port de Chine centrale), avec des
résultats divers, encore mal évalués. Plusieurs milliers d’autres détenus
périrent dans d’autres lieux d’expérimentation  | ||||||||
| Cadavre d’un prisonnier mangé par les soldats Japonais en Nouvelle-Guinée |
 Si
toutes guerres n’est rendue possible que par la levée des inhibitions, la façon dont l’Allemagne nazie et le Japon impérial procédèrent renvoie à un sadisme froid, scientifiquement organisé,
industrialisé au rendement et à l’efficacité. Le sadisme japonais ressurgissait
de la façon la plus mesurée, c’est-à-dire dans l’excès gratuit, on pourrait dire, parfois même, artistique. La logique du
sadisme visant à détruire le sujet sadique lui-même après avoir anéanti le reste du monde, se prolongea finalement
dans la dernière phase de la guerre, lorsque les aviateurs kamikaze
précipitèrent leurs avions sur le pont des cuirassés américains. Pour
l’individu, c’était un geste de courage appris au cours de la récitation du
kokutai, mais qui, pour la dynamique de psychologie collective supposait
l’extermination du peuple nippon tout entier. Lorsque la première bombe
atomique explosa sur Hiroshima, les dirigeants japonais comprirent l’issue
logique de leurs délires et allèrent signer la reddition sur le pont du Missouri quoi qu’il dusse leur en coûter à leur orgueil et leur fierté.
Si
toutes guerres n’est rendue possible que par la levée des inhibitions, la façon dont l’Allemagne nazie et le Japon impérial procédèrent renvoie à un sadisme froid, scientifiquement organisé,
industrialisé au rendement et à l’efficacité. Le sadisme japonais ressurgissait
de la façon la plus mesurée, c’est-à-dire dans l’excès gratuit, on pourrait dire, parfois même, artistique. La logique du
sadisme visant à détruire le sujet sadique lui-même après avoir anéanti le reste du monde, se prolongea finalement
dans la dernière phase de la guerre, lorsque les aviateurs kamikaze
précipitèrent leurs avions sur le pont des cuirassés américains. Pour
l’individu, c’était un geste de courage appris au cours de la récitation du
kokutai, mais qui, pour la dynamique de psychologie collective supposait
l’extermination du peuple nippon tout entier. Lorsque la première bombe
atomique explosa sur Hiroshima, les dirigeants japonais comprirent l’issue
logique de leurs délires et allèrent signer la reddition sur le pont du Missouri quoi qu’il dusse leur en coûter à leur orgueil et leur fierté. |
| Général MacArthur et Empereur Hiro-Hito |
 répartition des revenus et de la propriété» (R. Bersihand. op. cit. p.
434). Ce qui voulait dire projets de réforme agraire, élimination des grands
trusts bancaires et industriels et même création des syndicats libres (avec
possibilité de se déclarer communiste!). Afin de modérer son élan, l’occupant
créa un code du travail privilégiant la négociation et la collaboration de
classes préférable à la lutte. Il arriva ce qui était arrivé partout ailleurs en Occident,
les syndicats japonais fusionnèrent dans une Confédération générale des syndicats
de travailleurs (Rôdô kumiai sô-dômei) tout de suite lié au parti
socialiste. Enfin, la réforme intellectuelle et morale toucha les publications
de journaux et de livres de même que le système d’enseignement. De même, la
liberté politique ressuscita les partis par lesquels s’exprimèrent les
différents intérêts et les différentes voix des Japonais. Le projet d’État
universel nippon s’acheva dans la restructuration par les barbares de fond en comble de la
société et de la mentalité japonaise, ce qui n’alla pas sans crises
intergénérationnelles comme le cinéma d’Ozu (Voyage à Tokyo, 1953) devait le montrer au cours des
années 1950.
répartition des revenus et de la propriété» (R. Bersihand. op. cit. p.
434). Ce qui voulait dire projets de réforme agraire, élimination des grands
trusts bancaires et industriels et même création des syndicats libres (avec
possibilité de se déclarer communiste!). Afin de modérer son élan, l’occupant
créa un code du travail privilégiant la négociation et la collaboration de
classes préférable à la lutte. Il arriva ce qui était arrivé partout ailleurs en Occident,
les syndicats japonais fusionnèrent dans une Confédération générale des syndicats
de travailleurs (Rôdô kumiai sô-dômei) tout de suite lié au parti
socialiste. Enfin, la réforme intellectuelle et morale toucha les publications
de journaux et de livres de même que le système d’enseignement. De même, la
liberté politique ressuscita les partis par lesquels s’exprimèrent les
différents intérêts et les différentes voix des Japonais. Le projet d’État
universel nippon s’acheva dans la restructuration par les barbares de fond en comble de la
société et de la mentalité japonaise, ce qui n’alla pas sans crises
intergénérationnelles comme le cinéma d’Ozu (Voyage à Tokyo, 1953) devait le montrer au cours des
années 1950. Asiatique. Ils ont
pu admirer la résurrection de l’esprit des daimyô et des rônins à travers les
Kamikaze qui se sacrifièrent à bord de leurs avions, nouveaux chevaliers du Ciel, sur le pont des navires
ennemis. La reconstruction, jusque dans ses moindres détails sur le modèle
occidental, du Japon d’après-guerre était une humiliation aussi pire que celle
subie par les Chinois marqués par le port de la natte sous la dynastie Qing.
Dans son ouvrage richement documenté, Violences et crimes du Japon en guerre
1937-1945, Jean-Louis Margolin qualifie de cyclothymique l’ambivalence
des attitudes des Japonais devant leurs prisonniers de guerre. L’important,
pour l’historien, est qu’on ne doit «pas ajouter foi à l’idée d’un atavisme
meurtrier chez les Japonais, même restreint aux périodes féodale et
post-féodale» (J.-L. Margolin. Violences et crimes au Japon en guerre,
Paris, Hachette, Col. Grand Pluriel, 2007, p. 30). Il faut donc chercher ailleurs les causes de ces cruautés gratuites dans le contexte même - social,
idéologique, culturel - de l’époque pour comprendre les raisons de telles
monstruosités. Pour les Occidentaux dont la connaissance du Japon se limite à
la culture des bonzaï et à la cérémonie du thé, l’atavisme de
la cruauté est aussi naturelle aux Japonais qu’aux Allemands, puis aux
Communistes et aux Palestiniens… Pourtant, ce n’est pas de cela dont il s’agit,
et notre survol de la Civilisation extrême-orientale et de l’État nippon
montrent que sur la longue durée, des éléments de psychologie collective se
sont imposés.
Asiatique. Ils ont
pu admirer la résurrection de l’esprit des daimyô et des rônins à travers les
Kamikaze qui se sacrifièrent à bord de leurs avions, nouveaux chevaliers du Ciel, sur le pont des navires
ennemis. La reconstruction, jusque dans ses moindres détails sur le modèle
occidental, du Japon d’après-guerre était une humiliation aussi pire que celle
subie par les Chinois marqués par le port de la natte sous la dynastie Qing.
Dans son ouvrage richement documenté, Violences et crimes du Japon en guerre
1937-1945, Jean-Louis Margolin qualifie de cyclothymique l’ambivalence
des attitudes des Japonais devant leurs prisonniers de guerre. L’important,
pour l’historien, est qu’on ne doit «pas ajouter foi à l’idée d’un atavisme
meurtrier chez les Japonais, même restreint aux périodes féodale et
post-féodale» (J.-L. Margolin. Violences et crimes au Japon en guerre,
Paris, Hachette, Col. Grand Pluriel, 2007, p. 30). Il faut donc chercher ailleurs les causes de ces cruautés gratuites dans le contexte même - social,
idéologique, culturel - de l’époque pour comprendre les raisons de telles
monstruosités. Pour les Occidentaux dont la connaissance du Japon se limite à
la culture des bonzaï et à la cérémonie du thé, l’atavisme de
la cruauté est aussi naturelle aux Japonais qu’aux Allemands, puis aux
Communistes et aux Palestiniens… Pourtant, ce n’est pas de cela dont il s’agit,
et notre survol de la Civilisation extrême-orientale et de l’État nippon
montrent que sur la longue durée, des éléments de psychologie collective se
sont imposés.  Ce que Margolin appelle la cyclothymie des Japonais dépend de la
position qu’ils se pensent occuper par rapport aux étrangers. Les prisonniers chinois de
1897; les prisonniers russes de 1904-1905; les prisonniers allemands de
1914-1918 confortaient les Japonais dans la certitude qu’ils étaient en passe
de devenir la nation dominante en Asie. En 1274 et 1281, les soldats chinois et
coréens envoyés par Khubilay Khan et tombés entre les mains des daimyô japonais
ne furent pas mieux traités que les «étrangers» en 1940-1945. Le Zeitgeist n’était
tout simplement pas le même, mais une structure de psychologie collective était
bien implantée dans l’inconscient collectif nippon que des situations historiques particulières pouvaient réactiver. Il suffit que la paranoïa
issue de la menace mongole renaisse pour que le cycle se renverse de 180°. Le
suicide-spectacle de l’écrivain Yukio Mishima (1970), à l’image de celui de Takayama Masyuki deux siècles plus tôt, illustre parfaitement cette déréliction qui
se révèle comme une impasse psychologique et morale pour tous ces Japonais,
fiers et humiliés, civilisés et parcellarisés dans leur nation, que de ne pas
trouver d’autres excentricités que le suicide rituel.
Ce que Margolin appelle la cyclothymie des Japonais dépend de la
position qu’ils se pensent occuper par rapport aux étrangers. Les prisonniers chinois de
1897; les prisonniers russes de 1904-1905; les prisonniers allemands de
1914-1918 confortaient les Japonais dans la certitude qu’ils étaient en passe
de devenir la nation dominante en Asie. En 1274 et 1281, les soldats chinois et
coréens envoyés par Khubilay Khan et tombés entre les mains des daimyô japonais
ne furent pas mieux traités que les «étrangers» en 1940-1945. Le Zeitgeist n’était
tout simplement pas le même, mais une structure de psychologie collective était
bien implantée dans l’inconscient collectif nippon que des situations historiques particulières pouvaient réactiver. Il suffit que la paranoïa
issue de la menace mongole renaisse pour que le cycle se renverse de 180°. Le
suicide-spectacle de l’écrivain Yukio Mishima (1970), à l’image de celui de Takayama Masyuki deux siècles plus tôt, illustre parfaitement cette déréliction qui
se révèle comme une impasse psychologique et morale pour tous ces Japonais,
fiers et humiliés, civilisés et parcellarisés dans leur nation, que de ne pas
trouver d’autres excentricités que le suicide rituel. Et
la proclamation de la République, si elle faisait disparaître les vieilles
structures impériales, héritait d'une situation anarchique qui plongeait
l'ensemble du pays dans des guerres civiles. Yuan Shih-k'ai, comme l'Empereur
Meiji, hérita des problèmes laissés par le régime vermoulu, mais «le
principal problème de Yuan était institutionnel. En abolissant une monarchie
vieille de 2 100 ans, la révolution avait en 1912 décapité l'État chinois. Il
restait à trouver un homme pour diriger le gouvernement. Yuan se retrouvait
successeur de l'empereur de Chine, sans titre sur lequel s'appuyer et sans
trône sur lequel s'asseoir» (J. K. Fairbank. op. cit. p. 244). Des
pressions extérieures vinent brouiller les cartes, car si Yuan dote la
République d'une constitution, en 1914, le 1er janvier 1916 il rétablit la
monarchie à son nom. Il met en place des hommes dans les différentes régions de
l'Empire qui prennent modèle sur le dictateur et veulent obtenir l'indépendance
de leurs fiefs. C'est la période des Seigneurs de la guerre ramenant la
Chine à l'état des Royaumes Combattants. Yuan Shih-k'ai se trouvait donc dans la même position que Qin Shi
Houang-ti, mais il mourut peu après. Les différentes portions de l'empire se trouvaient en
guerre les unes contre les autres durant dix ans (1916-1926). Sun Yat-sen fonda le
Kuo-Min-Tang, le Parti national du peuple, mais lui-même hésitait toujours à endosser un rôle politique actif. Pressé par les puissances coloniales à entrer
dans le conflit de 1914, le Japon lui déclare la guerre suite au refus des 21
Demandes. La situation ne cesse donc d'empirer :
Et
la proclamation de la République, si elle faisait disparaître les vieilles
structures impériales, héritait d'une situation anarchique qui plongeait
l'ensemble du pays dans des guerres civiles. Yuan Shih-k'ai, comme l'Empereur
Meiji, hérita des problèmes laissés par le régime vermoulu, mais «le
principal problème de Yuan était institutionnel. En abolissant une monarchie
vieille de 2 100 ans, la révolution avait en 1912 décapité l'État chinois. Il
restait à trouver un homme pour diriger le gouvernement. Yuan se retrouvait
successeur de l'empereur de Chine, sans titre sur lequel s'appuyer et sans
trône sur lequel s'asseoir» (J. K. Fairbank. op. cit. p. 244). Des
pressions extérieures vinent brouiller les cartes, car si Yuan dote la
République d'une constitution, en 1914, le 1er janvier 1916 il rétablit la
monarchie à son nom. Il met en place des hommes dans les différentes régions de
l'Empire qui prennent modèle sur le dictateur et veulent obtenir l'indépendance
de leurs fiefs. C'est la période des Seigneurs de la guerre ramenant la
Chine à l'état des Royaumes Combattants. Yuan Shih-k'ai se trouvait donc dans la même position que Qin Shi
Houang-ti, mais il mourut peu après. Les différentes portions de l'empire se trouvaient en
guerre les unes contre les autres durant dix ans (1916-1926). Sun Yat-sen fonda le
Kuo-Min-Tang, le Parti national du peuple, mais lui-même hésitait toujours à endosser un rôle politique actif. Pressé par les puissances coloniales à entrer
dans le conflit de 1914, le Japon lui déclare la guerre suite au refus des 21
Demandes. La situation ne cesse donc d'empirer :  «C'est l'inflation, le
développement du banditisme, l'arrêt total du commerce, l'essor des plantations
d'opium, principale source de revenus des Warlords et l'usage des
narcotiques. La paysannerie chinoise descend un nouveau degré dans l'échelle de
la misère et des souffrances» (J. Gernet. op. cit. pp. 545-546). Les dirigeants de la nouvelle République manquaient totalement d'imagination, bref tout le
contraire de la révolution Meiji. Les concessions étrangères restaient les seules
qui tiraient profit de ce climat d'anarchie. Le Mouvement du 4 mai 1919 vit la jeunesse
étudiante nationaliste se soulever contre les impérialistes, et en particulier
le Japon dont les intérêts de domination du pays étaient particulièrement visibles. 3 000
étudiants se réunissent donc pour manifester à Pékin, devant
la porte Tian'anmen,
en diffusant un manifeste qui proclame : «Le
territoire de la Chine peut être conquis, mais il ne peut être donné! Les
Chinois peuvent être tués, mais ils ne veulent pas être soumis! Notre pays
risque sa perte! Citoyens, mobilisez-vous!» Sun Yat-sen, président alors de
l'État de Canton, s'inspire de la Révolution russe et se dit prêt à collaborer
avec les Communistes qui s'étaient déjà organisés en parti en 1921. Les trois
principes du peuple de Sun (nationalisme, démocratie et socialisme) apparaissaient plutôt comme des vertus plus que des politiques élaborées. La mort de Sun laissa son parti
entre les mains de son gendre, Tchang Kai-chek Une bévue de l'armée anglaise
qui tira sur des étudiants chinois en 1925 manifestant à Shanghaï entraîna la riposte de la
Révolution nationale (1925-1927). C'est durant cette période que Tchang parvint
à éliminer les Seigneurs de la Guerre et à fixer la capitale à Nankin. Mais Tchang
n'adhèra pas à la portion socialiste du programme de Sun et la rupture d'avec
le Parti communiste devint un fait accompli. Désormais, la palette politique chinoise allait se fractionner en deux, ouvrant sur une véritable guerre civile polarisée.
«C'est l'inflation, le
développement du banditisme, l'arrêt total du commerce, l'essor des plantations
d'opium, principale source de revenus des Warlords et l'usage des
narcotiques. La paysannerie chinoise descend un nouveau degré dans l'échelle de
la misère et des souffrances» (J. Gernet. op. cit. pp. 545-546). Les dirigeants de la nouvelle République manquaient totalement d'imagination, bref tout le
contraire de la révolution Meiji. Les concessions étrangères restaient les seules
qui tiraient profit de ce climat d'anarchie. Le Mouvement du 4 mai 1919 vit la jeunesse
étudiante nationaliste se soulever contre les impérialistes, et en particulier
le Japon dont les intérêts de domination du pays étaient particulièrement visibles. 3 000
étudiants se réunissent donc pour manifester à Pékin, devant
la porte Tian'anmen,
en diffusant un manifeste qui proclame : «Le
territoire de la Chine peut être conquis, mais il ne peut être donné! Les
Chinois peuvent être tués, mais ils ne veulent pas être soumis! Notre pays
risque sa perte! Citoyens, mobilisez-vous!» Sun Yat-sen, président alors de
l'État de Canton, s'inspire de la Révolution russe et se dit prêt à collaborer
avec les Communistes qui s'étaient déjà organisés en parti en 1921. Les trois
principes du peuple de Sun (nationalisme, démocratie et socialisme) apparaissaient plutôt comme des vertus plus que des politiques élaborées. La mort de Sun laissa son parti
entre les mains de son gendre, Tchang Kai-chek Une bévue de l'armée anglaise
qui tira sur des étudiants chinois en 1925 manifestant à Shanghaï entraîna la riposte de la
Révolution nationale (1925-1927). C'est durant cette période que Tchang parvint
à éliminer les Seigneurs de la Guerre et à fixer la capitale à Nankin. Mais Tchang
n'adhèra pas à la portion socialiste du programme de Sun et la rupture d'avec
le Parti communiste devint un fait accompli. Désormais, la palette politique chinoise allait se fractionner en deux, ouvrant sur une véritable guerre civile polarisée. Influencé par les régimes
nationalistes totalitaires, le Kuo-Min-Tang restait le parti de l'armée et des
propriétaires fonciers et industriels. La décennie de Nankin (1927-1937) au
cours de laquelle le gouvernement nationaliste aurait pu ressaisir la situation
fut frappé par la grave crise économique de 1929 et la montée de l'agressivité
japonaise. On a vu comment, en 1937, le Japon s'engagea dans la guerre ouverte
contre la Chine. Tchang, n'ayant pas encore suffisamment développé l'infrastructure industrielle qui permette de
moderniser son armée, se contentait de faire la
Influencé par les régimes
nationalistes totalitaires, le Kuo-Min-Tang restait le parti de l'armée et des
propriétaires fonciers et industriels. La décennie de Nankin (1927-1937) au
cours de laquelle le gouvernement nationaliste aurait pu ressaisir la situation
fut frappé par la grave crise économique de 1929 et la montée de l'agressivité
japonaise. On a vu comment, en 1937, le Japon s'engagea dans la guerre ouverte
contre la Chine. Tchang, n'ayant pas encore suffisamment développé l'infrastructure industrielle qui permette de
moderniser son armée, se contentait de faire la  chasse aux com-
chasse aux com-munistes dirigés par le jeune Mao Tsé-toung et qui entreprit une Longue Marche à l'intérieur du pays< vers Yénan dans le Chen-si. Cette épopée mystique du communisme chinois leur permi de rallier des populations paysannes entières contre le gouvernement de Tchang Kai-chek. De plus, si Mao reçoit bon accueil auprès de Staline, ce dernier, prompt à jouer le rôle de grand frère, ne cessa de miner son autorité. C'est le déclenchement de la guerre, en 1937, qui va amener une trêve entre les deux mouvements, nationaliste et communiste. Les Japonais occupent essentiellement la Chine orientale et place une de leur créature à Nankin, en 1940, comme gouvernement de la Chine.
Tous les observateurs étrangers ont remarqué à quel point les troupes communistes, avec leurs moyens limités, tenaient férocement contre l'envahisseur japonais, contrairement au couple nationaliste, Tchang et son épouse, fille de Sun Yat-sen, qui apparaissaient comme les fantoches des profiteurs
 de guerre en recevant l'aide américaine qu'ils dilapidaient dans la corruption. Pour les communistes, il devenait clair que la lutte de libération nationale servait également de creuset à ramener la population chinoise dans un État communiste après guerre. Aussi, la guerre mondiale accoucha-t-elle d'une guerre civile suspendue entre les partisans du Kuo-Min-Tang, toujours sous la houlette de Tchang K'ai chek et le Parti Communiste chinois de Mao Tsé-toung. Alors que la Guerre Froide s'installait à l'échelle planétaire entre l'Union Soviétique et les États-Unis, l'armée révolutionnaire du peuple réussit à chasser Tchang du pouvoir. Il se réfugia à Formose (Taïwan), devenu le bastion de la Chine nationale sous protection des forces armées américaines. Le nouveau gouvernement déménagea la capitale de Nankin à Pékin, se proclamant République populaire de Chine, le 1er octobre 1949.
de guerre en recevant l'aide américaine qu'ils dilapidaient dans la corruption. Pour les communistes, il devenait clair que la lutte de libération nationale servait également de creuset à ramener la population chinoise dans un État communiste après guerre. Aussi, la guerre mondiale accoucha-t-elle d'une guerre civile suspendue entre les partisans du Kuo-Min-Tang, toujours sous la houlette de Tchang K'ai chek et le Parti Communiste chinois de Mao Tsé-toung. Alors que la Guerre Froide s'installait à l'échelle planétaire entre l'Union Soviétique et les États-Unis, l'armée révolutionnaire du peuple réussit à chasser Tchang du pouvoir. Il se réfugia à Formose (Taïwan), devenu le bastion de la Chine nationale sous protection des forces armées américaines. Le nouveau gouvernement déménagea la capitale de Nankin à Pékin, se proclamant République populaire de Chine, le 1er octobre 1949. Chine. Comme le Japon
des Meiji, cette entreprise révolutionnaire se fera dans un pays refermé sur
lui-même, d'abord par sa non-reconnaissance par les pays occidentaux, ensuite
par le retrait du soutien de l'URSS. Le Parti s'empressa de résoudre l'épineuse
question agraire entre 1950 et 1958 : nouvelle répartition des terres, aide
matérielle, coopératives, kolkhozes copiés sur le modèle soviétique. Il s'agissait
également de réformer le système monétaire puisque le yuan n'était plus
convertible en monnaies étrangères. Un système d'éducation fut mis en place
pour former les cadres du Parti et les fonctionnaires de l'État. Enfin un plan
de développement quinquennal était annoncé en 1953. En 1954, c'est au tour d'une
nouvelle constitution à faire reposer l'État chinois sur les principes du
centralisme démocratique. Tout le pouvoir politique résidait de haut en bas, le
secrétariat du Parti s'identifiant aux intérêts du prolétariat des villes et
des paysans des campagnes reprenait le vieux système du centralisme démocratique. Coup sur coup, Mao, qui se pensait poète, lança des mots
d'ordre. D'abord les Cent Fleurs dont le but était de procéder comme la NEP
de l'époque de Lénine, discours qui suscita de vives critiques, puis recul avec le
Grand Bond en Avant vers le communisme, c'est-à-dire la création des
Communes populaires où la vie familiale s'effaçait devant les dortoirs et les
réfectoires, de la garderie aux lieux de travail. Il s'agissait d'accroître le
développement des secteurs névralgiques de l'économie nationale et de la défense. De fait, dès 1964, la Chine possédait la redoutable arme nucléaire.
Chine. Comme le Japon
des Meiji, cette entreprise révolutionnaire se fera dans un pays refermé sur
lui-même, d'abord par sa non-reconnaissance par les pays occidentaux, ensuite
par le retrait du soutien de l'URSS. Le Parti s'empressa de résoudre l'épineuse
question agraire entre 1950 et 1958 : nouvelle répartition des terres, aide
matérielle, coopératives, kolkhozes copiés sur le modèle soviétique. Il s'agissait
également de réformer le système monétaire puisque le yuan n'était plus
convertible en monnaies étrangères. Un système d'éducation fut mis en place
pour former les cadres du Parti et les fonctionnaires de l'État. Enfin un plan
de développement quinquennal était annoncé en 1953. En 1954, c'est au tour d'une
nouvelle constitution à faire reposer l'État chinois sur les principes du
centralisme démocratique. Tout le pouvoir politique résidait de haut en bas, le
secrétariat du Parti s'identifiant aux intérêts du prolétariat des villes et
des paysans des campagnes reprenait le vieux système du centralisme démocratique. Coup sur coup, Mao, qui se pensait poète, lança des mots
d'ordre. D'abord les Cent Fleurs dont le but était de procéder comme la NEP
de l'époque de Lénine, discours qui suscita de vives critiques, puis recul avec le
Grand Bond en Avant vers le communisme, c'est-à-dire la création des
Communes populaires où la vie familiale s'effaçait devant les dortoirs et les
réfectoires, de la garderie aux lieux de travail. Il s'agissait d'accroître le
développement des secteurs névralgiques de l'économie nationale et de la défense. De fait, dès 1964, la Chine possédait la redoutable arme nucléaire. Plusieurs des décisions
prises par Mao conduisirent toutefois à des catastrophes, ainsi la fameuse campagne des
Quatre Nuisibles, dite campagne «Tuez les moineaux» lancée avec le Grand Bond
en Avant. Il faut éliminer les rats, les mouches, les moustiques et les
moineaux friquets qui endommagent les récoltes. De 1958 à 1962, on se mit à chasser
les oiseaux qui maintenaient pourtant un équilibre écologique en tant que prédateurs d'insectes. Les résultats furent pires que les causes qui avaient engendré les
problèmes! Débarassés des oiseaux qui venaient grapiller dans les champs, des millions d'insectes ravagèrent les cultures. Le Parti, tout en conservant Mao à sa tête, offrit la présidence à Liu
Plusieurs des décisions
prises par Mao conduisirent toutefois à des catastrophes, ainsi la fameuse campagne des
Quatre Nuisibles, dite campagne «Tuez les moineaux» lancée avec le Grand Bond
en Avant. Il faut éliminer les rats, les mouches, les moustiques et les
moineaux friquets qui endommagent les récoltes. De 1958 à 1962, on se mit à chasser
les oiseaux qui maintenaient pourtant un équilibre écologique en tant que prédateurs d'insectes. Les résultats furent pires que les causes qui avaient engendré les
problèmes! Débarassés des oiseaux qui venaient grapiller dans les champs, des millions d'insectes ravagèrent les cultures. Le Parti, tout en conservant Mao à sa tête, offrit la présidence à Liu
 Shao-Chi en 1959, au moment où la Chine s'engagea dans son programme nucléaire.
Sur la scène internationale, la Chine se retrouvait toujours isolée. La
rupture avec le Parti communiste d'Union soviétique survint au moment de la Détente amorcée par Khrouchtchev. Pour avertir de la détermination révolutionnaire
de la Chine, celle-ci fit sauter la première bombe atomique en 1964 et annonça
qu'elle tenait à reconquérir tous les territoires qui appartenaient à la Chine
avant la signature des traités inégaux un siècle plus tôt. Et cela commença par
l'invasion du Tibet et une offensive contre Taïwan. Dans ce second cas, la
Chine recula devant les pressions internationales (la Chine nationaliste faisait toujours
partie du Conseil de Sécurité de l'ONU), et dans le premier cas, la résistance
du peuple tibétain contraria l'avance des troupes chinoises dégénérant en
conflit frontalier avec l'Inde. Si l'Indochine refusa son aide dans la guerre
que le Viét Nam livra successivement aux occupants français puis américains, c'est qu'il était approvisionné essentiellement par Moscou. La Chine put finalement se consoler par la reconnaissance
du gouvernement français en 1964.
Shao-Chi en 1959, au moment où la Chine s'engagea dans son programme nucléaire.
Sur la scène internationale, la Chine se retrouvait toujours isolée. La
rupture avec le Parti communiste d'Union soviétique survint au moment de la Détente amorcée par Khrouchtchev. Pour avertir de la détermination révolutionnaire
de la Chine, celle-ci fit sauter la première bombe atomique en 1964 et annonça
qu'elle tenait à reconquérir tous les territoires qui appartenaient à la Chine
avant la signature des traités inégaux un siècle plus tôt. Et cela commença par
l'invasion du Tibet et une offensive contre Taïwan. Dans ce second cas, la
Chine recula devant les pressions internationales (la Chine nationaliste faisait toujours
partie du Conseil de Sécurité de l'ONU), et dans le premier cas, la résistance
du peuple tibétain contraria l'avance des troupes chinoises dégénérant en
conflit frontalier avec l'Inde. Si l'Indochine refusa son aide dans la guerre
que le Viét Nam livra successivement aux occupants français puis américains, c'est qu'il était approvisionné essentiellement par Moscou. La Chine put finalement se consoler par la reconnaissance
du gouvernement français en 1964. intellectuels lors de la Révolution culturelle en
1968, il s'agissait d'une Chine beaucoup moins occidentalisée ou marxiste qu'on ne
le croit. Mao n'aurait d'ailleurs lu qu'une traduction du Manifeste du Parti
communiste de Marx et Engels. Le matérialisme dialectique évoquait surtout le
taoïsme et lorsqu'on regarde le pragmatisme avec lequel s'est opéré la
Révolution chinoise sous sa forme communiste, la tradition philosophique est
nettement reconnaissable. En choisissant de ramener la capitale à Pékin, en reconstruisant de fond en comble l'administration chinoise, Mao indiquait bien qu'il s'inspirait avant tout de l'exemple de l'Empereur Qin. De même que ce lointain prédécesseur, Mao fit
la guerre au Confucianisme, tout en transférant le culte des Ancêtres en soumission au Parti
et à ses dirigeants. Il est vrai aussi que cet archaïsme rejoignait le modèle soviétique.
C'est donc dans la trame de fond même de l'Histoire de la Chine qu'il faut
situer les origines de la Révolution de 1949. Depuis la Révolution de 1911,
après Yuan Shih-k'ai,
après le bref passage de Sun Yat-sen, après Tchang
K'ai-chek, c'était au tour de Mao (et non du Parti communiste) à s'asseoir sur le
trône impérial et à siéger dans la Cité interdite. Ce qu'il y a eu de
révolutionnaire dans la Chine communiste, ce fut de l'expérience des luttes
contre le Kuo-Min-Tang, de l'expédition de la Grande Marche et la guerre épique de
libération nationale que la Chine nouvelle était née. En attendant, la Chine trouvait son État universel qui n'avait cessé de se démembrer depuis la fin de la
dynastie Han.
intellectuels lors de la Révolution culturelle en
1968, il s'agissait d'une Chine beaucoup moins occidentalisée ou marxiste qu'on ne
le croit. Mao n'aurait d'ailleurs lu qu'une traduction du Manifeste du Parti
communiste de Marx et Engels. Le matérialisme dialectique évoquait surtout le
taoïsme et lorsqu'on regarde le pragmatisme avec lequel s'est opéré la
Révolution chinoise sous sa forme communiste, la tradition philosophique est
nettement reconnaissable. En choisissant de ramener la capitale à Pékin, en reconstruisant de fond en comble l'administration chinoise, Mao indiquait bien qu'il s'inspirait avant tout de l'exemple de l'Empereur Qin. De même que ce lointain prédécesseur, Mao fit
la guerre au Confucianisme, tout en transférant le culte des Ancêtres en soumission au Parti
et à ses dirigeants. Il est vrai aussi que cet archaïsme rejoignait le modèle soviétique.
C'est donc dans la trame de fond même de l'Histoire de la Chine qu'il faut
situer les origines de la Révolution de 1949. Depuis la Révolution de 1911,
après Yuan Shih-k'ai,
après le bref passage de Sun Yat-sen, après Tchang
K'ai-chek, c'était au tour de Mao (et non du Parti communiste) à s'asseoir sur le
trône impérial et à siéger dans la Cité interdite. Ce qu'il y a eu de
révolutionnaire dans la Chine communiste, ce fut de l'expérience des luttes
contre le Kuo-Min-Tang, de l'expédition de la Grande Marche et la guerre épique de
libération nationale que la Chine nouvelle était née. En attendant, la Chine trouvait son État universel qui n'avait cessé de se démembrer depuis la fin de la
dynastie Han. L'intelligence politique de
Mao consiste à avoir su se servir de son charisme emblématique pour abattre ses
critiques, ses concurrents et éviter ainsi des coups d'État ou des révoltes de
palais. C'est Mao qui orchestra ses propres coups d'État, comme le montre la
Révolution culturelle de 1966, lorsque Mao se servit du mouvement de jeunesse
pour écarter les cadres du Parti qui lui portaient ombrage. Cette révolution fut d'abord une purge du Parti Communiste chinois de ses éléments dits révisionnistes et
une volonté manifeste de diminuer les pouvoirs de la bureaucratie. S'organisèrent alors les gardes
rouges, groupes de jeunes Chinois brandissant le Petit Livre rouge contenant
des aphorismes du leader. Lors des mouvements étudiants de 1968 qui se
déclenchent un peu partout en Occident, et surtout à Paris en mai 1968, ce Petit
Livre rouge sera brandi avec la même ferveur, la jeunesse ne remarquant pas
le nombre d'idioties contenues dans ce recueil alors que pendant ce temps, les
intellectuels chinois étaient envoyés en
L'intelligence politique de
Mao consiste à avoir su se servir de son charisme emblématique pour abattre ses
critiques, ses concurrents et éviter ainsi des coups d'État ou des révoltes de
palais. C'est Mao qui orchestra ses propres coups d'État, comme le montre la
Révolution culturelle de 1966, lorsque Mao se servit du mouvement de jeunesse
pour écarter les cadres du Parti qui lui portaient ombrage. Cette révolution fut d'abord une purge du Parti Communiste chinois de ses éléments dits révisionnistes et
une volonté manifeste de diminuer les pouvoirs de la bureaucratie. S'organisèrent alors les gardes
rouges, groupes de jeunes Chinois brandissant le Petit Livre rouge contenant
des aphorismes du leader. Lors des mouvements étudiants de 1968 qui se
déclenchent un peu partout en Occident, et surtout à Paris en mai 1968, ce Petit
Livre rouge sera brandi avec la même ferveur, la jeunesse ne remarquant pas
le nombre d'idioties contenues dans ce recueil alors que pendant ce temps, les
intellectuels chinois étaient envoyés en  camp de rééducation, qu'ils
étaient humiliés, battus, tués, les mandarins et bureaucrates bafoués, qu'on détruisait des
milliers de sculptures et de temples bouddhistes. Partout fleurissaient les dazibao dénonciateurs qui permettaient à tous de s'exprimer sur des placards affuchés aux murs.
Poussée trop loin, la révolution culturelle entraîna des centaines de milliers,
voire des millions de morts. Amenée au bord de la guerre civile, le modéré Zhou
Enlai parvint, avec l'Armée populaire de libération, à renvoyer la jeunesse
sur les bancs d'école. Les derniers succès de Mao Tsé-toung se dérouleront sur
la scène internationale. D'abord par sa reconnaissance par l'ONU, d'où la Chine
populaire délogea la Chine nationaliste du fauteuil qu'elle occupait au
Secrétariat général, ensuite par la visite que le président américain Nixon
viet faire à Pékin. En 1975 mourrut Tchang K'ai-chek, puis en 1976,
l'indispensable Zhou Enlai puis Mao lui-même. La phase fondatrice de l'État universel était accomplie, mais la succession, malgré quelques soubresauts, va se faire au
profit du Parti, car désormais, c'est bien lui, le Parti Communiste chinois,
qui siège dans le fauteuil de l'Empereur Qin.
camp de rééducation, qu'ils
étaient humiliés, battus, tués, les mandarins et bureaucrates bafoués, qu'on détruisait des
milliers de sculptures et de temples bouddhistes. Partout fleurissaient les dazibao dénonciateurs qui permettaient à tous de s'exprimer sur des placards affuchés aux murs.
Poussée trop loin, la révolution culturelle entraîna des centaines de milliers,
voire des millions de morts. Amenée au bord de la guerre civile, le modéré Zhou
Enlai parvint, avec l'Armée populaire de libération, à renvoyer la jeunesse
sur les bancs d'école. Les derniers succès de Mao Tsé-toung se dérouleront sur
la scène internationale. D'abord par sa reconnaissance par l'ONU, d'où la Chine
populaire délogea la Chine nationaliste du fauteuil qu'elle occupait au
Secrétariat général, ensuite par la visite que le président américain Nixon
viet faire à Pékin. En 1975 mourrut Tchang K'ai-chek, puis en 1976,
l'indispensable Zhou Enlai puis Mao lui-même. La phase fondatrice de l'État universel était accomplie, mais la succession, malgré quelques soubresauts, va se faire au
profit du Parti, car désormais, c'est bien lui, le Parti Communiste chinois,
qui siège dans le fauteuil de l'Empereur Qin. Le communisme s'est répandu
dans l'ensemble de l'Asie continentale. La Corée, suite à une guerre fratricide à laquelle participent les puissances étrangères entre 1950 et 1953, reste depuis divisée. La Corée du Sud, sous protection
américaine, parvient à se maintenir autour de sa capitale, Séoul, contre l'agressivité de la Corée du Nord,
soutenue par la Chine. Dans les deux cas, la succession des vassalités envers
les Chinois, les Européens, les Japonais et les Américains pour le sud, les
Chinois pour le Nord trahissent l'épithète du Royaume du Matin calme. En
ce qui concerne le Viét Nam, longtemps tenu en vassalité par la Chine malgré
une indépendance
Le communisme s'est répandu
dans l'ensemble de l'Asie continentale. La Corée, suite à une guerre fratricide à laquelle participent les puissances étrangères entre 1950 et 1953, reste depuis divisée. La Corée du Sud, sous protection
américaine, parvient à se maintenir autour de sa capitale, Séoul, contre l'agressivité de la Corée du Nord,
soutenue par la Chine. Dans les deux cas, la succession des vassalités envers
les Chinois, les Européens, les Japonais et les Américains pour le sud, les
Chinois pour le Nord trahissent l'épithète du Royaume du Matin calme. En
ce qui concerne le Viét Nam, longtemps tenu en vassalité par la Chine malgré
une indépendance  reconnue, vit son unité se morceler à partir de 1620 lorsque
le parti s'est scindé en deux fiefs séparés par le Siang Gianh : les Trich au
nord et et les Nguyén au sud, l'empereur n'exerçant plus qu'une autorité
minimale. Avec l'apparition des puissances occidentales en quête de colonies,
l'ensemble de l'Indochine tomba aux mains des Français en 1887. Celle-ci
comprend les protectorats du Tonkin et de l'Annam et la colonie de Cochinchine
qui correspondent au Nord, au Centre et au Sud du viét Nam actuel. Ces
territoires, regroupés en 1948, deviennent le Viét Nam que nous
connaissons. Mais il y a également le protectorat du Laos, celui du Cambodge et
le comptoir de Kouang-Tchéou-Wan rattaché à l'administration de l'Union
indochinoise en 1900. La région vit au rythme à la fois des bouleversements du
continent mais aussi des intérêts impérialistes de la France.
reconnue, vit son unité se morceler à partir de 1620 lorsque
le parti s'est scindé en deux fiefs séparés par le Siang Gianh : les Trich au
nord et et les Nguyén au sud, l'empereur n'exerçant plus qu'une autorité
minimale. Avec l'apparition des puissances occidentales en quête de colonies,
l'ensemble de l'Indochine tomba aux mains des Français en 1887. Celle-ci
comprend les protectorats du Tonkin et de l'Annam et la colonie de Cochinchine
qui correspondent au Nord, au Centre et au Sud du viét Nam actuel. Ces
territoires, regroupés en 1948, deviennent le Viét Nam que nous
connaissons. Mais il y a également le protectorat du Laos, celui du Cambodge et
le comptoir de Kouang-Tchéou-Wan rattaché à l'administration de l'Union
indochinoise en 1900. La région vit au rythme à la fois des bouleversements du
continent mais aussi des intérêts impérialistes de la France.  Dès 1897, le gouverneur
général, le financier Paul Doumer, avait créé les structures administratives qui faisait
de l'Indochine un véritable État colonial doté d'un budget général afin que la
colonie ne pèse plus sur les finances de la métropole. Pour ce faire, Doumer
organisa un système de prélèvement fiscal lourd et vite devenu impopulaire.
Devant l'insuffisance des rentrées de l'impôt foncier et de la capitation et
malgré un ensemble de taxes locales, l'administration se chargea du monopole du
commerce de l'opium, du sel et de l'alcool de riz. Colonie d'exploitation, la
mise en valeur des ressources du pays fournissait à divers groupes industriels et
financiers métropolitains des intérêts impressionnants. Plus que du colonialisme, il s'agissait bien de l'impérialisme financier qui organisait la vie de l'Indochine. De grandes firmes financières
et industrielles métropolitaines, en particulier le groupe Rivard spécialisé
dans les affaires de caoutchouc et la société Michelin, investissaient des sommes
énormes en Indochine où l'exploitation des paysans atteignait un niveau scandaleux, ce
qui sera à l'origine de la création d'un Parti communiste indochinois
Dès 1897, le gouverneur
général, le financier Paul Doumer, avait créé les structures administratives qui faisait
de l'Indochine un véritable État colonial doté d'un budget général afin que la
colonie ne pèse plus sur les finances de la métropole. Pour ce faire, Doumer
organisa un système de prélèvement fiscal lourd et vite devenu impopulaire.
Devant l'insuffisance des rentrées de l'impôt foncier et de la capitation et
malgré un ensemble de taxes locales, l'administration se chargea du monopole du
commerce de l'opium, du sel et de l'alcool de riz. Colonie d'exploitation, la
mise en valeur des ressources du pays fournissait à divers groupes industriels et
financiers métropolitains des intérêts impressionnants. Plus que du colonialisme, il s'agissait bien de l'impérialisme financier qui organisait la vie de l'Indochine. De grandes firmes financières
et industrielles métropolitaines, en particulier le groupe Rivard spécialisé
dans les affaires de caoutchouc et la société Michelin, investissaient des sommes
énormes en Indochine où l'exploitation des paysans atteignait un niveau scandaleux, ce
qui sera à l'origine de la création d'un Parti communiste indochinois  et d'une
première révolte qui sera réprimée dans le sang. Comme en Chine, c'est par le
nationalisme d'abord que l'Indochine se mobilisa en vue d'accéder à son
indépendance. L'année 1930 fut marquée par la mutinerie avortée de la garnison de Yên Bái par des partisans du Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Le leader de la mutinerie, Nguyễn Thái Học, considérait insupportable la situation et organisa la rébellion qui s'empara de Yên Bái, parvint à hisser un instant le drapeau du VNQDĐ avant que l'armée coloniale du Tonkin parvienne à reprendre le fortin. La répression aurait été encore plus sanglante si le Ministre des Colonies de Paris n'était pas intervenu. Finalement seulement dix mutins furent condamnés à la guillotine, dont le chef Nguyễn Thái Học.
Tant que le régime de Vichy demeura l'allié de l'Allemagne nazie,
le Japon laissa la colonie à
et d'une
première révolte qui sera réprimée dans le sang. Comme en Chine, c'est par le
nationalisme d'abord que l'Indochine se mobilisa en vue d'accéder à son
indépendance. L'année 1930 fut marquée par la mutinerie avortée de la garnison de Yên Bái par des partisans du Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Le leader de la mutinerie, Nguyễn Thái Học, considérait insupportable la situation et organisa la rébellion qui s'empara de Yên Bái, parvint à hisser un instant le drapeau du VNQDĐ avant que l'armée coloniale du Tonkin parvienne à reprendre le fortin. La répression aurait été encore plus sanglante si le Ministre des Colonies de Paris n'était pas intervenu. Finalement seulement dix mutins furent condamnés à la guillotine, dont le chef Nguyễn Thái Học.
Tant que le régime de Vichy demeura l'allié de l'Allemagne nazie,
le Japon laissa la colonie à  l'administration française, mais au début de 1945, alors que
l'armée japonaise commençait à reculer devant l'invasion américaine, elle se décida à envahir le Viét Nam. La rétrocession du Viét Nam à la France aux lendemains de
la victoire alliée suscita un désappointement propice à ouvrir sur une guerre de
libération coloniale. Le Viét Minh, fondé depuis 1941, suivit l'exemple chinois
et déclara la guerre à l'occupant français. De 1946 à 1954, les différents
gouvernements fantoches du territoire s'avèrent impuissants à dominer la montée
du Viét Minh. L'Indochine se divisa : le royaume du Laos, celui des Khmers au
Cambodge resteront dans l'orbite occidental. Le Viét Nam parvint
définitivement à se libérer de la France après la capitulation du camp
retranché de Điện Biên Phủ.
l'administration française, mais au début de 1945, alors que
l'armée japonaise commençait à reculer devant l'invasion américaine, elle se décida à envahir le Viét Nam. La rétrocession du Viét Nam à la France aux lendemains de
la victoire alliée suscita un désappointement propice à ouvrir sur une guerre de
libération coloniale. Le Viét Minh, fondé depuis 1941, suivit l'exemple chinois
et déclara la guerre à l'occupant français. De 1946 à 1954, les différents
gouvernements fantoches du territoire s'avèrent impuissants à dominer la montée
du Viét Minh. L'Indochine se divisa : le royaume du Laos, celui des Khmers au
Cambodge resteront dans l'orbite occidental. Le Viét Nam parvint
définitivement à se libérer de la France après la capitulation du camp
retranché de Điện Biên Phủ. Les Américains étaient déjà
sur place du temps du régime français afin de conseiller les forces militaires.
Ils craignaient, selon la théorie des dominos, qu'après la chute de la Chine
dans le Communisme, tous les États d'Asie du Sud-Est tomberaint un après l'autre. Après le départ de la France, les Américains continuèrent à soutenir les différents
chefs d'État du Sud Viét Nam qui résistaient à l'offensive Viet Minh puisque le
Viét Nam Nord relevait désormais du Parti communiste avec Ho Chi-Minh
à sa tête. Le drame de la Corée se répètait. En 1967, le président Lyndon Johnson
des États-Unis déclencha la guerre du Viet Nam visant à extirper le
communisme du Nord. Après une guerre éprouvante pour les jeunes Américains,
la paysannerie viétnamienne, aidée de subsides russes, parvint à obtenir
l'évacuation complète du pays et sa réunification par les Accords de Paris de 1975. Au Viet Nam comme en Corée, il est difficile de ne pas remarquer que les vieilles divisions du temps des royaumes
Les Américains étaient déjà
sur place du temps du régime français afin de conseiller les forces militaires.
Ils craignaient, selon la théorie des dominos, qu'après la chute de la Chine
dans le Communisme, tous les États d'Asie du Sud-Est tomberaint un après l'autre. Après le départ de la France, les Américains continuèrent à soutenir les différents
chefs d'État du Sud Viét Nam qui résistaient à l'offensive Viet Minh puisque le
Viét Nam Nord relevait désormais du Parti communiste avec Ho Chi-Minh
à sa tête. Le drame de la Corée se répètait. En 1967, le président Lyndon Johnson
des États-Unis déclencha la guerre du Viet Nam visant à extirper le
communisme du Nord. Après une guerre éprouvante pour les jeunes Américains,
la paysannerie viétnamienne, aidée de subsides russes, parvint à obtenir
l'évacuation complète du pays et sa réunification par les Accords de Paris de 1975. Au Viet Nam comme en Corée, il est difficile de ne pas remarquer que les vieilles divisions du temps des royaumes  satellites, territoires partagés entre vassaux toujours en guerre, se retrouvent aujourd'hui dans les territoires marqués par des lignes de démarcations. La libération nationale ou l'unification sous le parapluie du Parti Communiste n'efface pas totalement les anciens royaumes asiatiques. Quoi qu'il en soit de ces persistances historiques et de ces ruptures politiques, la République socialiste du Viét Nam réunifié, après une tentative de
redressement socialiste qui échoua, s'engagea dans le processus capitaliste en
vue de produire pour l'exportation et jouer sur le même plan que les fameux
Tigres asiatiques (Les Tigres asiatiques sont les États qui sont
dits «nouveaux pays exportateurs» Thaïlande,
Malaisie, Indonésie,
Viêt Nam
et Philippines
et qui rêvent d'atteindre le niveau des Quatre Dragons : Corée
du Sud, Hong
Kong, Singapour
et Taïwan).
Bref, après le Japon et la Chine qui étaient déjà de superpuissances économiques et
politiques de la Civilisation extrême-orientale, le Viet Nam était prêt à entrer de
plain pied dans la nouvelle Église universelle, celle du Marché néo-libéral.
satellites, territoires partagés entre vassaux toujours en guerre, se retrouvent aujourd'hui dans les territoires marqués par des lignes de démarcations. La libération nationale ou l'unification sous le parapluie du Parti Communiste n'efface pas totalement les anciens royaumes asiatiques. Quoi qu'il en soit de ces persistances historiques et de ces ruptures politiques, la République socialiste du Viét Nam réunifié, après une tentative de
redressement socialiste qui échoua, s'engagea dans le processus capitaliste en
vue de produire pour l'exportation et jouer sur le même plan que les fameux
Tigres asiatiques (Les Tigres asiatiques sont les États qui sont
dits «nouveaux pays exportateurs» Thaïlande,
Malaisie, Indonésie,
Viêt Nam
et Philippines
et qui rêvent d'atteindre le niveau des Quatre Dragons : Corée
du Sud, Hong
Kong, Singapour
et Taïwan).
Bref, après le Japon et la Chine qui étaient déjà de superpuissances économiques et
politiques de la Civilisation extrême-orientale, le Viet Nam était prêt à entrer de
plain pied dans la nouvelle Église universelle, celle du Marché néo-libéral. Ce que nous appelons Civilisation
extrême-orientale pourrait fort bien apparaître aujourd'hui comme
l'archipel économique de la sphère asiatique dans le contexte de la
mondialisation. Les expériences d'État universel se sclérosent assez vite. Le
corps de Mao n'était pas encore refroidi que sa femme et ses acolytes tentèrent
un coup d'État qui fut tué dans l'œuf. Jiang Qing ne serait pas la Cixi du XXe siècle. À partir de
1980, Deng Xiaoping mit en place une nouvelle équipe chargée de réformer
l’ensemble du système communiste, ce qui comprenait une ouverture des marchés
libres, la réconciliation avec l’URSS (pour le temps qui lui restait à vivre),
un meilleur équilibre des finances publiques. La montée des conservateurs avec
Li Peng entraîna la fameuse rébellion étudiante sur la Place Tianenmen d’avril
à juin 1989, rébellion qui fut réprimée violemment. Si la Chine était prête à
se libéraliser au niveau économique, il n’en était pas de même sur le plan
idéologique et culturel. Dans le fond, il restait toujours de moins en moins de
choses de l’idéologie «marxiste» dans l’État universel chinois. C’était un
système qui s’engageait dans la voie de l’économie capitaliste tout en
conservant une superstructure directoriale, voire dictatoriale. Entre le
Secrétaire général du Parti Communiste chinois et le Premier ministre, on
retrouvait la vieille dichotomie entre l’Empereur et son Premier ministre. Sans
doute que la constitution garantit-elle un aspect démocratique à ce système que
n’avait pas l’ancien régime, mais la dynamique de la croissance économique
importe plus que le respect des principes kantiens de liberté, autant pour le gouvernement de Pékin que pour les partenaires
économiques occidentaux qui se voilent les yeux devant le
non-respect des droits de la personne. La Chine devient même
Ce que nous appelons Civilisation
extrême-orientale pourrait fort bien apparaître aujourd'hui comme
l'archipel économique de la sphère asiatique dans le contexte de la
mondialisation. Les expériences d'État universel se sclérosent assez vite. Le
corps de Mao n'était pas encore refroidi que sa femme et ses acolytes tentèrent
un coup d'État qui fut tué dans l'œuf. Jiang Qing ne serait pas la Cixi du XXe siècle. À partir de
1980, Deng Xiaoping mit en place une nouvelle équipe chargée de réformer
l’ensemble du système communiste, ce qui comprenait une ouverture des marchés
libres, la réconciliation avec l’URSS (pour le temps qui lui restait à vivre),
un meilleur équilibre des finances publiques. La montée des conservateurs avec
Li Peng entraîna la fameuse rébellion étudiante sur la Place Tianenmen d’avril
à juin 1989, rébellion qui fut réprimée violemment. Si la Chine était prête à
se libéraliser au niveau économique, il n’en était pas de même sur le plan
idéologique et culturel. Dans le fond, il restait toujours de moins en moins de
choses de l’idéologie «marxiste» dans l’État universel chinois. C’était un
système qui s’engageait dans la voie de l’économie capitaliste tout en
conservant une superstructure directoriale, voire dictatoriale. Entre le
Secrétaire général du Parti Communiste chinois et le Premier ministre, on
retrouvait la vieille dichotomie entre l’Empereur et son Premier ministre. Sans
doute que la constitution garantit-elle un aspect démocratique à ce système que
n’avait pas l’ancien régime, mais la dynamique de la croissance économique
importe plus que le respect des principes kantiens de liberté, autant pour le gouvernement de Pékin que pour les partenaires
économiques occidentaux qui se voilent les yeux devant le
non-respect des droits de la personne. La Chine devient même  le plus grand
créditeur des États-Unis, devançant le Japon, en 2000! Sa monnaie devient
convertible sur les marchés internationaux l’année suivante. Sa courbe
démographique doit être maintenue le plus stable possible alors que sa
croissance industrielle et commerciale fait un bond sans précédent. À son tour,
la Chine vit ses Trente glorieuses. En retour, de nouveaux problèmes se
créent : retour de la pauvreté dans les campagnes, accentuation de la crise nationale
tibétaine qui indigne les organisations de droits de la personne, et surtout
le fléau de la pollution. La désertification s’approche dangereusement de
Pékin. Les grandes villes industrielles comme Shanghaï vivent sous des dômes de
pollution atmosphérique. Le fleuve Amour est une véritable égout à ciel ouvert,
une épidémie de SRAS crée une panique tandis qu’un violent tremblement de terre
au Sichuan en 2008 annonce presque la crise qui suivra avec l’éclatement de la
bulle financière en 2009. Même si la Chine devient la seconde puissance
économique, immédiatement après les États-Unis, des signes de ralentissement
économique se manifestent dès 2010, surtout avec la montée de l’inflation. La
Chine est devenue le paradis des investisseurs étrangers qui veulent produire à
faible coup en profitant d’une main-d’œuvre sous payée et contrôlée par les
organes du Parti Communiste. Ce programme communiste s’est transformé en son
contraire : la Chine post-maoiste est devenu un territoire de spéculations
financières capitaliste qui risque un jour de faire apparaître le pays comme
un colosse aux pieds d’argile.
le plus grand
créditeur des États-Unis, devançant le Japon, en 2000! Sa monnaie devient
convertible sur les marchés internationaux l’année suivante. Sa courbe
démographique doit être maintenue le plus stable possible alors que sa
croissance industrielle et commerciale fait un bond sans précédent. À son tour,
la Chine vit ses Trente glorieuses. En retour, de nouveaux problèmes se
créent : retour de la pauvreté dans les campagnes, accentuation de la crise nationale
tibétaine qui indigne les organisations de droits de la personne, et surtout
le fléau de la pollution. La désertification s’approche dangereusement de
Pékin. Les grandes villes industrielles comme Shanghaï vivent sous des dômes de
pollution atmosphérique. Le fleuve Amour est une véritable égout à ciel ouvert,
une épidémie de SRAS crée une panique tandis qu’un violent tremblement de terre
au Sichuan en 2008 annonce presque la crise qui suivra avec l’éclatement de la
bulle financière en 2009. Même si la Chine devient la seconde puissance
économique, immédiatement après les États-Unis, des signes de ralentissement
économique se manifestent dès 2010, surtout avec la montée de l’inflation. La
Chine est devenue le paradis des investisseurs étrangers qui veulent produire à
faible coup en profitant d’une main-d’œuvre sous payée et contrôlée par les
organes du Parti Communiste. Ce programme communiste s’est transformé en son
contraire : la Chine post-maoiste est devenu un territoire de spéculations
financières capitaliste qui risque un jour de faire apparaître le pays comme
un colosse aux pieds d’argile. Il en va de même des mœurs chinoises. Jusqu’aux Trente
glorieuses, à Pékin, les Chinois se déplaçaient en vélos. Depuis,
l’automobile personnelle a pris la place, accentuant les émissions de gaz carbonique.
Le combustible qui fait rouler les usines chinoises est encore le charbon,
grand émetteur de CO₂ les conditions
d’hygiènes font cruellement défauts comme l’a démontrée la crise du SRAS. Pays
le plus peuplé du monde, en voie d’être rattrapé par son voisin indien, la
Chine a, effectivement, fait un grand bond en avant depuis un siècle, depuis la
Révolution de 1911. Les maximes confucéennes sont de plus en plus difficiles à
faire respecter. Le mouvement étudiant ou de jeunesse qui caractérise les
grands événements révolutionnaires de la Chine du XXe siècle (du mouvement du 4
mai 1919 à la manifestation de la Place Tiananmen de 1989) découvre la liberté
d’expression via la Toile sur les réseaux informatiques. Ici, le gouvernement a
de la misère à sévir, aussi devient-il plus répressif face aux dissidents
politiques. Mais, contrairement à l’époque communiste, où la propriété privée
était en danger, ils obtiennent peu d’échos de support de la part des
gouvernements occidentaux. La police des mœurs est encore très forte en
ce qui a trait à la morale chinoise.
Il en va de même des mœurs chinoises. Jusqu’aux Trente
glorieuses, à Pékin, les Chinois se déplaçaient en vélos. Depuis,
l’automobile personnelle a pris la place, accentuant les émissions de gaz carbonique.
Le combustible qui fait rouler les usines chinoises est encore le charbon,
grand émetteur de CO₂ les conditions
d’hygiènes font cruellement défauts comme l’a démontrée la crise du SRAS. Pays
le plus peuplé du monde, en voie d’être rattrapé par son voisin indien, la
Chine a, effectivement, fait un grand bond en avant depuis un siècle, depuis la
Révolution de 1911. Les maximes confucéennes sont de plus en plus difficiles à
faire respecter. Le mouvement étudiant ou de jeunesse qui caractérise les
grands événements révolutionnaires de la Chine du XXe siècle (du mouvement du 4
mai 1919 à la manifestation de la Place Tiananmen de 1989) découvre la liberté
d’expression via la Toile sur les réseaux informatiques. Ici, le gouvernement a
de la misère à sévir, aussi devient-il plus répressif face aux dissidents
politiques. Mais, contrairement à l’époque communiste, où la propriété privée
était en danger, ils obtiennent peu d’échos de support de la part des
gouvernements occidentaux. La police des mœurs est encore très forte en
ce qui a trait à la morale chinoise. Le Japon a été près de former l’État universel
qui aurait recouvert l’ensemble de la Civilisation extrême-orientale, mais son
agressivité paranoïaque, son impatience diplomatique, sa vanité militaire et son
goût inassouvi de dominer le plus de territoires possibles avant même de
stabiliser son pouvoir lui ont causé sa perte. De s’être engagé aux côtés des
dictatures fascistes et surtout d’avoir pensé qu’il pouvait répéter avec Pearl
Harbor le coup de Port-Arthur, voilà qui a manqué de jugement et démontré sa
velléité de «libérer l’Asie»
Le Japon a été près de former l’État universel
qui aurait recouvert l’ensemble de la Civilisation extrême-orientale, mais son
agressivité paranoïaque, son impatience diplomatique, sa vanité militaire et son
goût inassouvi de dominer le plus de territoires possibles avant même de
stabiliser son pouvoir lui ont causé sa perte. De s’être engagé aux côtés des
dictatures fascistes et surtout d’avoir pensé qu’il pouvait répéter avec Pearl
Harbor le coup de Port-Arthur, voilà qui a manqué de jugement et démontré sa
velléité de «libérer l’Asie»  des puissances occidentales. Entrevue d’abord d’un
œil favorable par les pays asiatiques, sa cruauté imbécile et son impitoyable
exploitation des «peuples frères», pire que celle des Occidentaux, ont démontré aux yeux de ses
«colonies», la vérité derrière sa propagande. En retour, les deux bombes atomiques larguées par des avions américains sur Hiroshima et Nagasaki - la ville portuaire qui, sous les Tokugawa, restait le seul endroit où les Occidentaux pouvaient commercer avec le Japon - ont causé un traumatisme qui n'a cessé de hanter le peuple nippon. La question atomique, en tant qu'énergie domestique plus qu'armement, demeure une problématique traumatisante qui s'exprimait déjà dans l'un des premiers films catastrophes du genre, Godzilla (1954), mais le trauma revint de nouveau à la réalité lorsque l'usine atomique de Fukujima, après le tsunami de 2011 qui ravagea la côte orientale du Japon, vit ses réacteurs en flammes.
des puissances occidentales. Entrevue d’abord d’un
œil favorable par les pays asiatiques, sa cruauté imbécile et son impitoyable
exploitation des «peuples frères», pire que celle des Occidentaux, ont démontré aux yeux de ses
«colonies», la vérité derrière sa propagande. En retour, les deux bombes atomiques larguées par des avions américains sur Hiroshima et Nagasaki - la ville portuaire qui, sous les Tokugawa, restait le seul endroit où les Occidentaux pouvaient commercer avec le Japon - ont causé un traumatisme qui n'a cessé de hanter le peuple nippon. La question atomique, en tant qu'énergie domestique plus qu'armement, demeure une problématique traumatisante qui s'exprimait déjà dans l'un des premiers films catastrophes du genre, Godzilla (1954), mais le trauma revint de nouveau à la réalité lorsque l'usine atomique de Fukujima, après le tsunami de 2011 qui ravagea la côte orientale du Japon, vit ses réacteurs en flammes.Pourtant, malgré Hiroshima et l’occupation américaine, le Japon ne s’en est quand même pas mal tiré et il a
 pris vite sa
revenge dans le domaine économique. La reconstruction du Japon à l’intérieur
des institutions économiques libérales a redonné une impulsion au développement
de son industrie. Parallèlement, la culture américaine a pénétré l’intérieur de
la psyché nippone. Dans le courant des années 1960, comme partout
ailleurs, la jeunesse japonaise inaugure une nouvelle génération. On y retrouve
des mouvements anarchistes aussi bien que des mouvements militants pour la
libération de la femme. Par contre, l’autorité paternelle, héritée du
confucianisme, perdure. Elle exige des prouesses de sa jeunesse. La diplomation
universitaire est un nouveau rite initiatique de l’accomplissement
professionnel et nombre de ces
pris vite sa
revenge dans le domaine économique. La reconstruction du Japon à l’intérieur
des institutions économiques libérales a redonné une impulsion au développement
de son industrie. Parallèlement, la culture américaine a pénétré l’intérieur de
la psyché nippone. Dans le courant des années 1960, comme partout
ailleurs, la jeunesse japonaise inaugure une nouvelle génération. On y retrouve
des mouvements anarchistes aussi bien que des mouvements militants pour la
libération de la femme. Par contre, l’autorité paternelle, héritée du
confucianisme, perdure. Elle exige des prouesses de sa jeunesse. La diplomation
universitaire est un nouveau rite initiatique de l’accomplissement
professionnel et nombre de ces  jeunes qui ne réussissent pas n’ont plus qu’à
supporter l’humiliation de leurs parents et se font seppuku : «Dans ces
exclusives humaines, il y a plus grave. Le Japon en arrive à rejeter ses
propres enfants lorsqu’ils ne peuvent plus servir d’animaux économiques, et
condamne ses vieux à la précarité et au désespoir», écrit Jacques Gravereau
dans Le Japon au XXe siècle, (Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H177,
1993, p. 517). Il ne faut donc pas s’abuser : derrière la succession des modes
importées de l’étranger demeurent un conformisme bourgeois et patriarcal de la
culture japonaise. Il en va tout simplement de même en Corée du Sud. Le succès
mondial sur le réseau You Tube de Psy avec sa vidéo promotionnelle Gangnam Style, montre que la frontière entre les civilisations n’est plus ce
qu’elle était il y a 30 ans à peine.
jeunes qui ne réussissent pas n’ont plus qu’à
supporter l’humiliation de leurs parents et se font seppuku : «Dans ces
exclusives humaines, il y a plus grave. Le Japon en arrive à rejeter ses
propres enfants lorsqu’ils ne peuvent plus servir d’animaux économiques, et
condamne ses vieux à la précarité et au désespoir», écrit Jacques Gravereau
dans Le Japon au XXe siècle, (Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H177,
1993, p. 517). Il ne faut donc pas s’abuser : derrière la succession des modes
importées de l’étranger demeurent un conformisme bourgeois et patriarcal de la
culture japonaise. Il en va tout simplement de même en Corée du Sud. Le succès
mondial sur le réseau You Tube de Psy avec sa vidéo promotionnelle Gangnam Style, montre que la frontière entre les civilisations n’est plus ce
qu’elle était il y a 30 ans à peine. Il est évident que la Civilisation
extrême-orientale entre de plain pied dans la nouvelle Église universelle que
représente la foi dans la toute-puissance du marché néo-libéral capitaliste. Le
conformisme japonais et le puritanisme chinois sont largement compatibles avec
cette économie qui regarde peu à autre chose que les échanges. Comme
les différentes cultures occidentales se sont folklorisées sous l’explosion technologique
diffusée à l’échelle planétaire, la culture chinoise apparaît comme une pourvoyeuse de potiches
Il est évident que la Civilisation
extrême-orientale entre de plain pied dans la nouvelle Église universelle que
représente la foi dans la toute-puissance du marché néo-libéral capitaliste. Le
conformisme japonais et le puritanisme chinois sont largement compatibles avec
cette économie qui regarde peu à autre chose que les échanges. Comme
les différentes cultures occidentales se sont folklorisées sous l’explosion technologique
diffusée à l’échelle planétaire, la culture chinoise apparaît comme une pourvoyeuse de potiches  kitsch lorsqu'elle ne s'abandonne pas à des relents de mégalomanie païenne, tandis que le
Japon est le pays qui exporte le plus de touristes dans les capitales
occidentales annuellement. Pourtant, la littérature des cultures
extrême-orientale, le cinéma, les manga qui sont repris par les publications
nord-américaines et européennes montrent que le métissage peu être créatif pour
autant qu’on respecte les qualités respectives des apports. Le problème ne
réside pas dans l’interpénétration des civilisations, mais le respect d’une
harmonie qui fait passer de l’imitation à l’émulation, ou, selon la dialectique
hégélienne, de la thèse de l’une et de l’anti-thèse de l’autre dans une synthèse surgissante.
kitsch lorsqu'elle ne s'abandonne pas à des relents de mégalomanie païenne, tandis que le
Japon est le pays qui exporte le plus de touristes dans les capitales
occidentales annuellement. Pourtant, la littérature des cultures
extrême-orientale, le cinéma, les manga qui sont repris par les publications
nord-américaines et européennes montrent que le métissage peu être créatif pour
autant qu’on respecte les qualités respectives des apports. Le problème ne
réside pas dans l’interpénétration des civilisations, mais le respect d’une
harmonie qui fait passer de l’imitation à l’émulation, ou, selon la dialectique
hégélienne, de la thèse de l’une et de l’anti-thèse de l’autre dans une synthèse surgissante. lorsqu’on considère le
caractère du tissu historique chinois. Bien davantage que pour aucune autre
culture, l’historien moderne de l’Empire est influencé par une tradition
historiographique chinoise compliquée et très développée. Cette tradition
possède certaines caractéristiques qui déterminent la connaissance que nous
avons du passé de la Chine. Il s’agit avant tout d’une histoire officielle, à
caractère politique, enregistrée par des fonctionnaires de l’État. C’est
essentiellement la relation de la pratique du pouvoir dynastique par les
dynasties successives, et celle du comportement de leur administration. C’est
une histoire didactique, appliquant les normes d’une éthique et d’une morale
traditionelles aux événements du passé, et destinée à indiquer des exemples de
domination politique, bons ou mauvais, aux futurs gouvernants et aux
fonctionnaires par lesquels s’exerce le pouvoir. Elle est centrée sur la cour
et ne nous montre guère ce qui se passe dans les diverses provinces de
l’Empire, loin de la capitale. Elle concerne exclusivement le comportement de
la classe dirigeante, dans son rôle de soutien de la puissance dynastique. Le
petit peuple apparaît rarement, sinon comme sujet passif de la politique
nationale ou lorsque des épreuves le poussent à la rébellion» (D.
Twitchette, in A. J. Toynbee. op. cit. p. 61).
lorsqu’on considère le
caractère du tissu historique chinois. Bien davantage que pour aucune autre
culture, l’historien moderne de l’Empire est influencé par une tradition
historiographique chinoise compliquée et très développée. Cette tradition
possède certaines caractéristiques qui déterminent la connaissance que nous
avons du passé de la Chine. Il s’agit avant tout d’une histoire officielle, à
caractère politique, enregistrée par des fonctionnaires de l’État. C’est
essentiellement la relation de la pratique du pouvoir dynastique par les
dynasties successives, et celle du comportement de leur administration. C’est
une histoire didactique, appliquant les normes d’une éthique et d’une morale
traditionelles aux événements du passé, et destinée à indiquer des exemples de
domination politique, bons ou mauvais, aux futurs gouvernants et aux
fonctionnaires par lesquels s’exerce le pouvoir. Elle est centrée sur la cour
et ne nous montre guère ce qui se passe dans les diverses provinces de
l’Empire, loin de la capitale. Elle concerne exclusivement le comportement de
la classe dirigeante, dans son rôle de soutien de la puissance dynastique. Le
petit peuple apparaît rarement, sinon comme sujet passif de la politique
nationale ou lorsque des épreuves le poussent à la rébellion» (D.
Twitchette, in A. J. Toynbee. op. cit. p. 61). Mais prenons un mandarin chinois ou un lettré japonais qui ouvrirait un livre qui raconterait une quelconque histoire nationale d'un des États paroissiaux de la Civilisation occidentale, ne lirait-il pas quelque chose d'analogue? Les dynasties se suivent et se ressemblent. Des querelles de palais aboutissent à l'assassinat d'un roi. Des États se morcellent puis se réunifient. Les paysans applaudissent ou se soulèvent et la trame ne commence guère à changer avant la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'arrivée de l'ambassade Macartney dans l'Empire Qing. D'autre part, ce n'est pas avant le milieu du XXe siècle que la connaissance historique parvient à maturité, sensible à dégager la connaissance méthodique des récits mythistoriques, et encore dans les milieux universitaires où des départements d'histoire ouvrent à l'histoire économique et sociale ou à celle des idées et des mentalités! Ce bond qualitatif est en train de se faire dans les institutions de la Civilisation extrême-orientale et le siècle qui vient nous en fera savoir sûrement plus que maintenant.
Mais prenons un mandarin chinois ou un lettré japonais qui ouvrirait un livre qui raconterait une quelconque histoire nationale d'un des États paroissiaux de la Civilisation occidentale, ne lirait-il pas quelque chose d'analogue? Les dynasties se suivent et se ressemblent. Des querelles de palais aboutissent à l'assassinat d'un roi. Des États se morcellent puis se réunifient. Les paysans applaudissent ou se soulèvent et la trame ne commence guère à changer avant la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'arrivée de l'ambassade Macartney dans l'Empire Qing. D'autre part, ce n'est pas avant le milieu du XXe siècle que la connaissance historique parvient à maturité, sensible à dégager la connaissance méthodique des récits mythistoriques, et encore dans les milieux universitaires où des départements d'histoire ouvrent à l'histoire économique et sociale ou à celle des idées et des mentalités! Ce bond qualitatif est en train de se faire dans les institutions de la Civilisation extrême-orientale et le siècle qui vient nous en fera savoir sûrement plus que maintenant. En attendant, Chinois, Japonais, Coréens et
Viétnamiens liront l’Histoire avec les a priori légués par le Confucianisme ou le Taoïsme. Ils peuvent en référer à Ohsawa ou à Zhang Xuecheng (1736-1796), l'un des esprits les plus profonds et des plus originaux
du XVIIIe siècle. Ce contemporain de Condorcet et de Herder vivait «à une
époque où la mode est à l'érudition, à la critique textuelle et surtout à
l'exégèse des Classiques, Zhang Xiecheng apparaît comme une exception dans la
mesure où il représente des tendances opposées : méthode historiographique et
philosophie de l'histoire sont les thèmes principaux de sa réflexion. Ainsi
s'explique le peu d'audience qu'il a eu à son époque. Mais Zhang Xuecheng sera
réhabilité au XXe siècle par les sinologues japonais et chinois», et aussi
découvert par leurs contemporains français, Jacques Gernet. (op. cit. p. 450). Sensibles aux réalités régionales, Zhang
Xuecheng «estime qu'il importe avant tout de connaître l'histoire des pays
chinois : la Chine, aussi étendue que l'Europe, ne peut être traitée comme un
tout uniforme et ce n'est que par une histoire des différentes régions, le
recours aux monographies locales (fangzhi) et la
En attendant, Chinois, Japonais, Coréens et
Viétnamiens liront l’Histoire avec les a priori légués par le Confucianisme ou le Taoïsme. Ils peuvent en référer à Ohsawa ou à Zhang Xuecheng (1736-1796), l'un des esprits les plus profonds et des plus originaux
du XVIIIe siècle. Ce contemporain de Condorcet et de Herder vivait «à une
époque où la mode est à l'érudition, à la critique textuelle et surtout à
l'exégèse des Classiques, Zhang Xiecheng apparaît comme une exception dans la
mesure où il représente des tendances opposées : méthode historiographique et
philosophie de l'histoire sont les thèmes principaux de sa réflexion. Ainsi
s'explique le peu d'audience qu'il a eu à son époque. Mais Zhang Xuecheng sera
réhabilité au XXe siècle par les sinologues japonais et chinois», et aussi
découvert par leurs contemporains français, Jacques Gernet. (op. cit. p. 450). Sensibles aux réalités régionales, Zhang
Xuecheng «estime qu'il importe avant tout de connaître l'histoire des pays
chinois : la Chine, aussi étendue que l'Europe, ne peut être traitée comme un
tout uniforme et ce n'est que par une histoire des différentes régions, le
recours aux monographies locales (fangzhi) et la  rédaction de nouvelles
monographies (Zhang Xuecheng lui-même s'est attaché à composer un fangzhi qui
a été malheureusement perdu) qu'il sera possible de s'orienter dans une
histoire aussi complexe que celle du monde chinois. Il importe donc de
constituer des archives locales, de recueillir des informations directes par
des enquêtes orales auprès des vieillards, de collectionner les inscriptions,
les manuscrits, les traditions locales… Comme Gu Yanwu, Zhang Xuecheng estime
que les sources de l’histoire sont de nature encyclopédique. Mais il apparaît
plus radical dans ce domaine : toutes les œuvres écrites, de quelque nature
qu’elles soient, y compris les vénérables Classiques, sont à ses yeux des
témoignages historiques. Cependant, il ne s’agit pas, une fois recueillie cette
documentation exhaustive, de se livrer à une compilation mécanique, à la façon
des équipes d’historiographes du VIIe siècle. L’histoire doit être œuvre
personnelle tout en demeurant un reflet exact du passé. Les meilleures œuvres
historiques ont toujours été le fait d’individus isolés : c’est le cas de la
plus admirable de toutes, les Mémoires historiques de Sima Qian» (p.
450).
rédaction de nouvelles
monographies (Zhang Xuecheng lui-même s'est attaché à composer un fangzhi qui
a été malheureusement perdu) qu'il sera possible de s'orienter dans une
histoire aussi complexe que celle du monde chinois. Il importe donc de
constituer des archives locales, de recueillir des informations directes par
des enquêtes orales auprès des vieillards, de collectionner les inscriptions,
les manuscrits, les traditions locales… Comme Gu Yanwu, Zhang Xuecheng estime
que les sources de l’histoire sont de nature encyclopédique. Mais il apparaît
plus radical dans ce domaine : toutes les œuvres écrites, de quelque nature
qu’elles soient, y compris les vénérables Classiques, sont à ses yeux des
témoignages historiques. Cependant, il ne s’agit pas, une fois recueillie cette
documentation exhaustive, de se livrer à une compilation mécanique, à la façon
des équipes d’historiographes du VIIe siècle. L’histoire doit être œuvre
personnelle tout en demeurant un reflet exact du passé. Les meilleures œuvres
historiques ont toujours été le fait d’individus isolés : c’est le cas de la
plus admirable de toutes, les Mémoires historiques de Sima Qian» (p.
450). Montesquieu
et Voltaire, proches contemporains de Zhang Xuecheng, partageaient également la
même vision de l’histoire. Si riche pouvait être la documentation, il ne
suffisait pas de l’étaler par goût d’érudition ou pour épater le bourgeois d’un
savoir inutile. L’historiographie avait son utilité qui se distinguait
de la propagande des historiographes de princes ou de gouvernements municipaux.
Et Jacques Gernet de continuer : «Le plus étrange est que ces préoccupations
historiographiques débouchent sur une philosophie : de la célèbre formule de
Zhang Xuecheng : "tout est histoire, même les Classiques", découle
par un mouvement inverse l’affirmation que l’histoire a même dignité que les
Classiques. Elle s’incorpore un principe philosophique, elle inclut en elle le Dao
(Tao), lui-même invisible et dont l’homme ne connaît que les manifestations
historiques. Les sociétés humaines obéissent à cette raison naturelle qu’est le
Dao. Le présent lui-même est histoire. Il porte témoignage sur la raison
universelle et à ce titre a même dignité que le passé, contrairement à
l’opinion des amoureux de l’Antiquité. Si le mouvement de critique textuelle
représente une saine réaction contre les excès de la philosophie
intellectualiste de Zhu Xi et de la philosophie intuitionniste de Wang
Yangming, il a aussi ses aspects négatifs. Le triomphe de l’érudition va
souvent de pair avec un renoncement à tout
Montesquieu
et Voltaire, proches contemporains de Zhang Xuecheng, partageaient également la
même vision de l’histoire. Si riche pouvait être la documentation, il ne
suffisait pas de l’étaler par goût d’érudition ou pour épater le bourgeois d’un
savoir inutile. L’historiographie avait son utilité qui se distinguait
de la propagande des historiographes de princes ou de gouvernements municipaux.
Et Jacques Gernet de continuer : «Le plus étrange est que ces préoccupations
historiographiques débouchent sur une philosophie : de la célèbre formule de
Zhang Xuecheng : "tout est histoire, même les Classiques", découle
par un mouvement inverse l’affirmation que l’histoire a même dignité que les
Classiques. Elle s’incorpore un principe philosophique, elle inclut en elle le Dao
(Tao), lui-même invisible et dont l’homme ne connaît que les manifestations
historiques. Les sociétés humaines obéissent à cette raison naturelle qu’est le
Dao. Le présent lui-même est histoire. Il porte témoignage sur la raison
universelle et à ce titre a même dignité que le passé, contrairement à
l’opinion des amoureux de l’Antiquité. Si le mouvement de critique textuelle
représente une saine réaction contre les excès de la philosophie
intellectualiste de Zhu Xi et de la philosophie intuitionniste de Wang
Yangming, il a aussi ses aspects négatifs. Le triomphe de l’érudition va
souvent de pair avec un renoncement à tout  esprit de réflexion et de synthèse.
La recherche du détail est devenue une fin en soi et la découverte la plus
futile satisfait la vanité des érudits. Il importe donc de revenir à cette
vérité fondamentale : le monde visible est informé par un Dao immanent,
conception typiquement chinoise mais qui, dans la perspective d’historien qui
est celle de Zhang Xuecheng, n’est pas sans résonances hégéliennes : c’est par
un contact direct avec l’histoire vécue et passée que se forme le sens
philosophique» (pp. 450-451). Dans nos catégories historiques, Zhang Xuecheng aurait été du côté des modernes contre les anciens dans la fameuse querelle qui sévissait à la même époque en Europe. Même lorsqu'elles sont éloignées l'une de l'autre, il arrive souvent que les civilisations parcourent des chemins parallèles et se retrouvent (et parfois se reconnaissent) lorsqu'elles se rencontrent.
esprit de réflexion et de synthèse.
La recherche du détail est devenue une fin en soi et la découverte la plus
futile satisfait la vanité des érudits. Il importe donc de revenir à cette
vérité fondamentale : le monde visible est informé par un Dao immanent,
conception typiquement chinoise mais qui, dans la perspective d’historien qui
est celle de Zhang Xuecheng, n’est pas sans résonances hégéliennes : c’est par
un contact direct avec l’histoire vécue et passée que se forme le sens
philosophique» (pp. 450-451). Dans nos catégories historiques, Zhang Xuecheng aurait été du côté des modernes contre les anciens dans la fameuse querelle qui sévissait à la même époque en Europe. Même lorsqu'elles sont éloignées l'une de l'autre, il arrive souvent que les civilisations parcourent des chemins parallèles et se retrouvent (et parfois se reconnaissent) lorsqu'elles se rencontrent.Voilà pourquoi il est essentiel de considérer la philosophie que nous pouvons avoir de l’histoire de la Civilisation extrême-orientale tout en souhaitant retrouver d’autres perles négligées comme celles de Zhang Xuecheng ou de George Ohsawa. C’est seulement ainsi que nous pourrons restaurer ce que nous avons perdu lorsque Étiemble écrivait : «C’en était fini de l’Europe chinoise : allait commencer le siècle de la Chine européanisée, mais de force, elle, alors que, si l’Europe s’était parfois enchinoisée à l’excès, c’était de son propre gré» (Étiemble. L’Europe chinoise, t. 2 : De la sinophilie à la sinophobie, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 1989, p. 384)⌛





























































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire