 |
Claude Monet. Impression soleil levant, 1872.
|
LES MODERNITÉS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES À L'ÈRE DE L'ANUS MUNDI (3)
LES IMPRESSIONNISTES
Nous désignons par le terme d'Anus Mundi, terme utilisé
à Auschwitz, la période de régression de la civilisation
occidentale entre 1860 et 1945 (80 ans) qui sépare les dé-
buts de la Guerre de Sécession et la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
 |
| Gustave Doré, Lac en Écosse après l'orage, 1875-1878 |
De tous les courants d’art qui se sont succédé avant la
Grande Guerre, celui qui convient le mieux à la définition de génial donnée par Max Scheler, c’est
l’impressionnisme. Par sa légende, le nombre de ses membres, la variété de leur
style personnel, l’abondance de leur production, leur rapide réception à
l’extérieur de la France, le mouvement impressionniste a envahi la conscience
historique au point de réduire la place, tout aussi importante, réservée à
l’art réaliste, naturaliste et symboliste. Plus que le romantisme,
l’impressionnisme s’est voulu une révolution de l’espace figuratif occidental.
Par sa facilité à dialoguer avec les autres tendances tout  comme par ses
différentes ruptures internes, il marqua une rupture avec la continuité de
l’histoire de l’art. Pour Philippe Muray, dans son dix-neuvième siècle à travers les âges, l’Occident «avait connu les
paradis de la chair de Titien, Tintoret, Véronèse, Rubens, les constellations
de femmes nues offertes aux souverains catholiques. Le monde déraidi, comme dit
sublimement Claudel, où passe le souffle de l’esprit, où s’ouvrent les chemins
de la nuit obscure et des estuaires du ciel. Les émissions vénitiennes de
lumière laser d’un côté, de l’autre les féeries dans le puisard de Bosch ou
Brueghel. Cocagnes et Tentations. Le 19e, c’est une tout autre affaire. D’abord
une excursion exotique, les fauves, plumes, palmes, oiseaux de feu, lianes :
Delacroix, Gros, Géricault, Ingres, Barye, Chassériau, Odilon Redon. Nymphes, odalisques, culs-de-lampes. Gothique, Gustave Doré. Puis l’apparente fuite
comme par ses
différentes ruptures internes, il marqua une rupture avec la continuité de
l’histoire de l’art. Pour Philippe Muray, dans son dix-neuvième siècle à travers les âges, l’Occident «avait connu les
paradis de la chair de Titien, Tintoret, Véronèse, Rubens, les constellations
de femmes nues offertes aux souverains catholiques. Le monde déraidi, comme dit
sublimement Claudel, où passe le souffle de l’esprit, où s’ouvrent les chemins
de la nuit obscure et des estuaires du ciel. Les émissions vénitiennes de
lumière laser d’un côté, de l’autre les féeries dans le puisard de Bosch ou
Brueghel. Cocagnes et Tentations. Le 19e, c’est une tout autre affaire. D’abord
une excursion exotique, les fauves, plumes, palmes, oiseaux de feu, lianes :
Delacroix, Gros, Géricault, Ingres, Barye, Chassériau, Odilon Redon. Nymphes, odalisques, culs-de-lampes. Gothique, Gustave Doré. Puis l’apparente fuite  à la
campagne : Millet, Pissarro, Sisley. Ou encore Gauguin, la nef bardée d’idoles
polynésiennes partie à la recherche de l’Empire du soleil. Mais tout cela en
même temps raconte un effondrement, et on peut appeler cette décomposition
minutieuse “impressionnisme”, ce n’est jamais qu’un malentendu de plus. Le
fameux passage à la lumière ou aux couleurs pures n’annonce que l’implosion
dans un trou noir de tout ce qui, en même temps que c’est peint, disparaît en
lambeaux et en amas, en particules et nébuleuses. “Nous sommes au quatrième
quart d’un siècle qui finira par une révolution colossale”, écrivait encore Van Gogh. Mais une chose importe, continuait-il, “c’est de ne pas être dupe de la
fausseté de son époque, pas au point toutefois qu’on n’y repère les heures
malsaines, étouffantes et déprimées qui précèdent l’orage”».
Philippe Muray, qui s’en prend impitoyablement à tous les mythes du XIXe
siècle, se rallie à la tradition des refusés.
Il participe au mythe impressionniste en enchérissant sur les dénonciations
qui ont commencé dès la production des premières toiles du genre. L’historien
de l’art, Pierre Francastel, longtemps avant lui, avait nuancé le mythe :
«Si l’on admet que c’est avec
l’impressionnisme que se pose vraiment la question de l’effondrement de
l’ancien espace plastique, encore faut-il distinguer. Je ne songe pas un moment
à soutenir l’idée absurde, que les impressionnistes ont été, tout d’un coup,
des novateurs et rien d’autre. Ils ont, au contraire, cheminé péniblement, à
petits coups, avec des repentirs, des fausses voies. Ils ont été, dans
l’ensemble, des précurseurs plutôt que des réalisateurs».
Mais, là encore, Francastel ne dit pas qu’ils n’ont été que les dupes de la
fausseté de leur temps. Herbert Read s’approche un peu plus près de la vérité,
lorsqu’il leur reconnaît «une prise de
conscience de problèmes dialectiques dans la démarche artistique elle-même, qui
ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de sa situation
par rapport à la connaissance. Le vieux langage de l’art ne convenait désormais
plus à la connaissance humaine : un nouveau langage devait être créé, syllabe
par syllabe, image par image, avant que l’art puisse encore une fois être
nécessité sociale aussi bien qu’individuelle».
à la
campagne : Millet, Pissarro, Sisley. Ou encore Gauguin, la nef bardée d’idoles
polynésiennes partie à la recherche de l’Empire du soleil. Mais tout cela en
même temps raconte un effondrement, et on peut appeler cette décomposition
minutieuse “impressionnisme”, ce n’est jamais qu’un malentendu de plus. Le
fameux passage à la lumière ou aux couleurs pures n’annonce que l’implosion
dans un trou noir de tout ce qui, en même temps que c’est peint, disparaît en
lambeaux et en amas, en particules et nébuleuses. “Nous sommes au quatrième
quart d’un siècle qui finira par une révolution colossale”, écrivait encore Van Gogh. Mais une chose importe, continuait-il, “c’est de ne pas être dupe de la
fausseté de son époque, pas au point toutefois qu’on n’y repère les heures
malsaines, étouffantes et déprimées qui précèdent l’orage”».
Philippe Muray, qui s’en prend impitoyablement à tous les mythes du XIXe
siècle, se rallie à la tradition des refusés.
Il participe au mythe impressionniste en enchérissant sur les dénonciations
qui ont commencé dès la production des premières toiles du genre. L’historien
de l’art, Pierre Francastel, longtemps avant lui, avait nuancé le mythe :
«Si l’on admet que c’est avec
l’impressionnisme que se pose vraiment la question de l’effondrement de
l’ancien espace plastique, encore faut-il distinguer. Je ne songe pas un moment
à soutenir l’idée absurde, que les impressionnistes ont été, tout d’un coup,
des novateurs et rien d’autre. Ils ont, au contraire, cheminé péniblement, à
petits coups, avec des repentirs, des fausses voies. Ils ont été, dans
l’ensemble, des précurseurs plutôt que des réalisateurs».
Mais, là encore, Francastel ne dit pas qu’ils n’ont été que les dupes de la
fausseté de leur temps. Herbert Read s’approche un peu plus près de la vérité,
lorsqu’il leur reconnaît «une prise de
conscience de problèmes dialectiques dans la démarche artistique elle-même, qui
ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de sa situation
par rapport à la connaissance. Le vieux langage de l’art ne convenait désormais
plus à la connaissance humaine : un nouveau langage devait être créé, syllabe
par syllabe, image par image, avant que l’art puisse encore une fois être
nécessité sociale aussi bien qu’individuelle».
Cette prise de conscience aurait difficilement
pu avoir lieu avant ce dernier tiers du XIXe siècle. Même s’il est possible de
reconnaître dans l’école vénitienne du XVIIIe siècle et surtout dans leur
héritier britannique William Turner (1775-1851), un précédent historique aux
compositions impressionnistes, Turner n’en demeurant pas moins un isolé dans
son temps. Un pré-impressionniste, car ses expériences sur la couleur et
l’atmosphère fluide de ses compositions, si elles ont eu un impact sur l’art
romantique, lui sont restés propres et n’ont pas donné naissance à cette
tendance qui sera celle des peintres impressionnistes. Cette révolution fut
donc tout à fait légitime, mais comme toutes révolutions, elle contenait en soi
une mythographie à laquelle ces peintres ont été les premiers à ériger les
pierres. Les critiques, les historiens, les professeurs d’art ont, à la suite,
apporté leurs propres pierres pour dresser leur monument. Et comme à toute
révolution, il y a des contre-révolutionnaires, ceux-ci ont glosé sur les refusés et continuent aujourd’hui à
minimiser leur apport ou leurs innovations. Pour accéder au rapport entre la
tendance impressionniste et l’esprit morbide fin de siècle propre à l’ère de l’Anus mundi, il faut s’attarder presque autant à la démythification
positive que négative des impressionnistes qu’à situer leurs œuvres dans les
cadres de cette époque tourmentée psychologiquement et socialement.
 |
| William Turner. le HMS Temeraire, tracté par un remorqueur à vapeur muni de roues à aubes vers Rotherhithe, 1838. |
Il est difficile de partager, dans l’histoire de
l’impressionnisme, ce qui relève du mythe et de la vérité. Par exemple, voulant
résumer les origines du mouvement artistique, Jacques Le Rider éprouve
certaines  difficultés à trancher : «Rappel
historique : Monet, Pissarro, Sisley et quelques autres peintres ont formé une
“société anonyme” qui expose cent soixante-cinq toiles en 1874 dans l’ancien
atelier de Nadar. La majorité des critiques considère ces œuvres comme bâclées,
et Louis Leroy, journaliste du Charivari, lance le mot “impressionniste” - par
allusion au tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).
Initialement, c’est tantôt Manet, tantôt Monet qui est considéré comme le “roi
de l’impressionnisme”, et les artistes impressionnistes ne revendiquent cette
dénomination qu’à partir de leur troisième exposition de 1877. Leurs
détracteurs parlent de “peinture de communards”, d’“école démocratique”,
d’“école des taches”, mais aussi de nihilisme et de “lugubrisme”. “L’enrôlement
de l’impressionnisme dans les rangs du réalisme [puis du naturalisme] se fit
naturellement, dans la logique d’une évidence”. (Denys Riout)».
Le 25 avril 1874, au lendemain de l’exposition chez Nadar qui fut un succès
d’estime plus qu’un succès financier – la coopérative formée par les
impressionnistes allait imploser peu après -, en effet, un article signé Louis
Leroy paraissait dans Le Charivari titré
L’Exposition des impressionnistes, et
le critique de se moquer : «veuillez
me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du
tableaux…; que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil
levant. Impression, j’en étais sûr. Je me
disais aussi, puisque je suis
difficultés à trancher : «Rappel
historique : Monet, Pissarro, Sisley et quelques autres peintres ont formé une
“société anonyme” qui expose cent soixante-cinq toiles en 1874 dans l’ancien
atelier de Nadar. La majorité des critiques considère ces œuvres comme bâclées,
et Louis Leroy, journaliste du Charivari, lance le mot “impressionniste” - par
allusion au tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).
Initialement, c’est tantôt Manet, tantôt Monet qui est considéré comme le “roi
de l’impressionnisme”, et les artistes impressionnistes ne revendiquent cette
dénomination qu’à partir de leur troisième exposition de 1877. Leurs
détracteurs parlent de “peinture de communards”, d’“école démocratique”,
d’“école des taches”, mais aussi de nihilisme et de “lugubrisme”. “L’enrôlement
de l’impressionnisme dans les rangs du réalisme [puis du naturalisme] se fit
naturellement, dans la logique d’une évidence”. (Denys Riout)».
Le 25 avril 1874, au lendemain de l’exposition chez Nadar qui fut un succès
d’estime plus qu’un succès financier – la coopérative formée par les
impressionnistes allait imploser peu après -, en effet, un article signé Louis
Leroy paraissait dans Le Charivari titré
L’Exposition des impressionnistes, et
le critique de se moquer : «veuillez
me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du
tableaux…; que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil
levant. Impression, j’en étais sûr. Je me
disais aussi, puisque je suis  impressionné, il doit y avoir de l’impression
là-dedans…».
Le mythe commence donc autour du nom du groupe. Impression, impressionnistes,
impressionnisme : de la diversité des œuvres, on passait à l’unité de
mouvance artistique. Mais le rigolo faisait écho à ce que les artistes
eux-mêmes en disaient : «Monet
lui-même a expliqué… qu’il avait envoyé une toile faite au Havre, de sa fenêtre
: du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant.
“On me demande le titre pour le catalogue; ça ne pouvait vraiment pas passer
pour une vue du Havre. Je répondis : Mettez Impression!” En effet, cette œuvre fut inscrite au catalogue comme: Impression, Soleil levant (c’était une des deux versions représentant le port que l’artiste
avait peintes en 1872)».
Cette version est sans doute la plus crédible pour l’origine du mot impression. Mais Monet en pensait-il
lui-même être à l’origine d’un mouvement? Pour leur historien John Rewald, des
artistes se réunissaient fréquemment et partageaient leurs théories sur la
nature, l’art et le regard. Cela aussi appartenait au mythe : «Réunis presque par le hasard, ils avaient
accepté leur sort commun de même qu’ils allaient accepter qu’on les désigne
comme “impressionnistes”, mot inventé par un critique malveillant pour
ridiculiser leurs efforts».
Le mythe reposait autant sur l’hostilité originelle, puis permanente au
mouvement qu’à l’anecdote racontée par Monet.
impressionné, il doit y avoir de l’impression
là-dedans…».
Le mythe commence donc autour du nom du groupe. Impression, impressionnistes,
impressionnisme : de la diversité des œuvres, on passait à l’unité de
mouvance artistique. Mais le rigolo faisait écho à ce que les artistes
eux-mêmes en disaient : «Monet
lui-même a expliqué… qu’il avait envoyé une toile faite au Havre, de sa fenêtre
: du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant.
“On me demande le titre pour le catalogue; ça ne pouvait vraiment pas passer
pour une vue du Havre. Je répondis : Mettez Impression!” En effet, cette œuvre fut inscrite au catalogue comme: Impression, Soleil levant (c’était une des deux versions représentant le port que l’artiste
avait peintes en 1872)».
Cette version est sans doute la plus crédible pour l’origine du mot impression. Mais Monet en pensait-il
lui-même être à l’origine d’un mouvement? Pour leur historien John Rewald, des
artistes se réunissaient fréquemment et partageaient leurs théories sur la
nature, l’art et le regard. Cela aussi appartenait au mythe : «Réunis presque par le hasard, ils avaient
accepté leur sort commun de même qu’ils allaient accepter qu’on les désigne
comme “impressionnistes”, mot inventé par un critique malveillant pour
ridiculiser leurs efforts».
Le mythe reposait autant sur l’hostilité originelle, puis permanente au
mouvement qu’à l’anecdote racontée par Monet.
 |
| Jean-Baptiste Camille Corot. L'entrée du port à La Rochelle, 1851. |
L’impressionnisme émergeait de l’école de
peintres rassemblés à Barbizon. Barbizon nous est connu pour les œuvres de
Millet et de quelques autres peintres déjà rassemblés pour peindre la nature
rurale et le travail des paysans. Parmi eux, Jean-Baptiste Camille Corot
(1796-1875) parcourait toute la France et l’Italie à la  recherche de paysages
qu’il peindrait dans le style néo-classique. Peu à peu toutefois, son style
s’imprégna de la luminosité et les traits, s’ils ne disparurent pas, n’empêchaient
plus la magie des effets de lumières de jouer sur les murs de L’entrée du port à La Rochelle (1851) ou
sur le Pont et moulin près de Mantes (1860-1865).
Comme le remarque Lionello Venturi, chez Corot, «les contrastes de lumière et ombre sont sacrifiés dans ses peintures au
règne absolu des demi-tons et des nuances, ce qui lui fait gagner en
délicatesse et en grâce ce qu’il perdait en robustesse et en énergie. La
lumière solaire de Rome lui avait suggéré l’énergie des contrastes, et
l’énergie fut pour lui l’antidote nécessaire d’un laisser aller qui constituait
un danger constant pour sa nature simple et bonne. Une conséquence importante
de la vision en masse par tons de lumière est qu’il faut renoncer à un premier
plan naturel. Bien mieux, pour interpréter la nature et non pas la reproduire,
Corot met au premier plan du tableau un point éloigné du pays et, bien plutôt
qu’il ne représente matériellement les détails des objets, il participe à la
vie imprimée sur les objets par les lumières et les ombres. Ainsi arrive-t-il à
transformer les choses en valeurs de vie. Comme la valeur est l’infini alors
que l’objet est le fini, pour découvrir l’infini dans le fini, l’artiste doit
se détacher de son sujet par une vision aussi éloignée matériellement que
proche spirituellement. Il ne conduit pas l’observateur par la main dans la
profondeur de l’espace naturel, mais lui présente un objet vu en surface où il
est à la fois proche et lointain, mais vu comme constituant un tout se
suffisant à lui-même. aussi bien le proche que le lointain appartiennent au
monde de l’infini, au monde de l’art, distinct du monde de la nature. C’est la
raison pour laquelle un peu de terre grossière, un fleuve trouble, un pont en
ruines et quelques collines éloignées sont devenus un absolu de l’art, une des
merveilles du monde».
Ce qui caractérisait Corot, c’était précisément ce qui empêcha Barbizon d’aller
plus loin dans la recherche chromatique dans laquelle devait triompher
l’impressionnisme. Corot, ajoute le même historien, «n’a pas permis à sa fantaisie de s’élancer au-delà de la réalité; il
s’est efforcé de retenir son imagination créatrice dans les limites de la
réalité, la réalité naturelle qu’il voyait. Donc, Corot était un réaliste, mais
d’un genre spécial puisqu’il se refusait à peindre les détails objectifs des
choses, comme le voulaient les réalistes. Renonçant aux détails, il resta
fidèle à son impression de lumière et d’ombre et s’arrêta dès qu’il eut réalisé
cette impression. La réaction dramatique à la lutte de la lumière et de l’ombre
au premier plan, et l’extase devant la clarté de l’horizon humain, furent
complètement absorbées et fondues dans son impression visuelle».
recherche de paysages
qu’il peindrait dans le style néo-classique. Peu à peu toutefois, son style
s’imprégna de la luminosité et les traits, s’ils ne disparurent pas, n’empêchaient
plus la magie des effets de lumières de jouer sur les murs de L’entrée du port à La Rochelle (1851) ou
sur le Pont et moulin près de Mantes (1860-1865).
Comme le remarque Lionello Venturi, chez Corot, «les contrastes de lumière et ombre sont sacrifiés dans ses peintures au
règne absolu des demi-tons et des nuances, ce qui lui fait gagner en
délicatesse et en grâce ce qu’il perdait en robustesse et en énergie. La
lumière solaire de Rome lui avait suggéré l’énergie des contrastes, et
l’énergie fut pour lui l’antidote nécessaire d’un laisser aller qui constituait
un danger constant pour sa nature simple et bonne. Une conséquence importante
de la vision en masse par tons de lumière est qu’il faut renoncer à un premier
plan naturel. Bien mieux, pour interpréter la nature et non pas la reproduire,
Corot met au premier plan du tableau un point éloigné du pays et, bien plutôt
qu’il ne représente matériellement les détails des objets, il participe à la
vie imprimée sur les objets par les lumières et les ombres. Ainsi arrive-t-il à
transformer les choses en valeurs de vie. Comme la valeur est l’infini alors
que l’objet est le fini, pour découvrir l’infini dans le fini, l’artiste doit
se détacher de son sujet par une vision aussi éloignée matériellement que
proche spirituellement. Il ne conduit pas l’observateur par la main dans la
profondeur de l’espace naturel, mais lui présente un objet vu en surface où il
est à la fois proche et lointain, mais vu comme constituant un tout se
suffisant à lui-même. aussi bien le proche que le lointain appartiennent au
monde de l’infini, au monde de l’art, distinct du monde de la nature. C’est la
raison pour laquelle un peu de terre grossière, un fleuve trouble, un pont en
ruines et quelques collines éloignées sont devenus un absolu de l’art, une des
merveilles du monde».
Ce qui caractérisait Corot, c’était précisément ce qui empêcha Barbizon d’aller
plus loin dans la recherche chromatique dans laquelle devait triompher
l’impressionnisme. Corot, ajoute le même historien, «n’a pas permis à sa fantaisie de s’élancer au-delà de la réalité; il
s’est efforcé de retenir son imagination créatrice dans les limites de la
réalité, la réalité naturelle qu’il voyait. Donc, Corot était un réaliste, mais
d’un genre spécial puisqu’il se refusait à peindre les détails objectifs des
choses, comme le voulaient les réalistes. Renonçant aux détails, il resta
fidèle à son impression de lumière et d’ombre et s’arrêta dès qu’il eut réalisé
cette impression. La réaction dramatique à la lutte de la lumière et de l’ombre
au premier plan, et l’extase devant la clarté de l’horizon humain, furent
complètement absorbées et fondues dans son impression visuelle».
 |
| Charles-François Daubigny. Bord de rivière au clair de lune, |
Voilà pourquoi Charles-François Daubigny
(1817-1878) devrait apparaître comme le premier véritable impressionniste, bien
avant Monet. Celui-ci avait toujours été la cible des critiques et d’un public
pour le  moins peu courtois : «Aux
Salons ses toiles avaient été régulièrement l’objet d’attaques violentes; même
Théophile Gautier, favorable cependant aux recherches nouvelles, ne put
s’empêcher d’écrire : “Il est vraiment dommage que ce paysagiste, d’un
sentiment si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une impression et
néglige à ce point les détails. Ces tableaux ne sont plus que des ébauches, et
des ébauches peu avancées… Chaque objet se dessine par un contour apparent ou
réel et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des taches de couleur
juxtaposées”. Mais le but de Daubigny était justement de résumer des
impressions (en 1865 un critique l’avait même appelé le “chef de l’école de
l’impression”) et il était prêt à sacrifier une partie de la vérité littérale à
la recherche d’une expression plus fidèle des aspects sans cesse changeants de
la nature».
Tout cela se passait bien avant le Salon
des refusés. Rappelons l’anecdote. Pour le Salon officiel, le jury composé d’artistes académiciens avait
refusé 3 000 des 5 000 œuvres présentées. L’empereur Napoléon III,
moins peu courtois : «Aux
Salons ses toiles avaient été régulièrement l’objet d’attaques violentes; même
Théophile Gautier, favorable cependant aux recherches nouvelles, ne put
s’empêcher d’écrire : “Il est vraiment dommage que ce paysagiste, d’un
sentiment si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une impression et
néglige à ce point les détails. Ces tableaux ne sont plus que des ébauches, et
des ébauches peu avancées… Chaque objet se dessine par un contour apparent ou
réel et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des taches de couleur
juxtaposées”. Mais le but de Daubigny était justement de résumer des
impressions (en 1865 un critique l’avait même appelé le “chef de l’école de
l’impression”) et il était prêt à sacrifier une partie de la vérité littérale à
la recherche d’une expression plus fidèle des aspects sans cesse changeants de
la nature».
Tout cela se passait bien avant le Salon
des refusés. Rappelons l’anecdote. Pour le Salon officiel, le jury composé d’artistes académiciens avait
refusé 3 000 des 5 000 œuvres présentées. L’empereur Napoléon III,  trouvant
même que la purge était excessive, patronna le Salon des refusés qui s’ouvrit le 15 mai 1863 au Palais de
l’Industrie au grand dam des académiciens. 1 200 œuvres furent exposées dans
douze salles annexes, parmi lesquelles des toiles de Manet. Parmi ces artistes,
de futurs peintres impressionnistes. Nul doute qu’on y parla beaucoup d’impression, du moins presque autant
qu’au Café Guerbois : «Il paraît certain
que le mot impression fut souvent
prononcé au cours de ces discussions. Les critiques l’employaient depuis
quelque temps pour caractériser les efforts des paysagistes comme Corot,
Daubigny et Jongkind; [Théodore]
Rousseau lui-même avait parlé de ses tentatives pour rester fidèle “à
l’impression vierge de la nature” et Manet, bien qu’il ne fût pas
essentiellement intéressé par le paysage, avait insisté, à l’occasion de sa
grande exposition de 1867, pour dire que son intention était de “communiquer
son impression”. Albert Wolff, critique plutôt hostile aux jeunes peintres,
venait d’écrire justement à propos de Manet qu’il rendait “admirablement la
première impression de la nature”. D’après son ami Proust, Manet se servait du
terme impression déjà depuis une
dizaine d’années environ».
Précisons toutefois que nous ne sommes pas rendus encore à l’ère de
l’impressionnisme, mais toujours sous la mouvance de Barbizon.
trouvant
même que la purge était excessive, patronna le Salon des refusés qui s’ouvrit le 15 mai 1863 au Palais de
l’Industrie au grand dam des académiciens. 1 200 œuvres furent exposées dans
douze salles annexes, parmi lesquelles des toiles de Manet. Parmi ces artistes,
de futurs peintres impressionnistes. Nul doute qu’on y parla beaucoup d’impression, du moins presque autant
qu’au Café Guerbois : «Il paraît certain
que le mot impression fut souvent
prononcé au cours de ces discussions. Les critiques l’employaient depuis
quelque temps pour caractériser les efforts des paysagistes comme Corot,
Daubigny et Jongkind; [Théodore]
Rousseau lui-même avait parlé de ses tentatives pour rester fidèle “à
l’impression vierge de la nature” et Manet, bien qu’il ne fût pas
essentiellement intéressé par le paysage, avait insisté, à l’occasion de sa
grande exposition de 1867, pour dire que son intention était de “communiquer
son impression”. Albert Wolff, critique plutôt hostile aux jeunes peintres,
venait d’écrire justement à propos de Manet qu’il rendait “admirablement la
première impression de la nature”. D’après son ami Proust, Manet se servait du
terme impression déjà depuis une
dizaine d’années environ».
Précisons toutefois que nous ne sommes pas rendus encore à l’ère de
l’impressionnisme, mais toujours sous la mouvance de Barbizon.
 |
| Claude Monet. Bassin aux nymphéas, 1899. |
 |
| Auguste Renoir. Autoportrait. |
C’est le succès parisien qui fit le mouvement
impressionniste. Lionello Venturi le reconnaît : «L’impressionnisme en tant que goût…, a été réalisé par quelques
peintres à Paris entre 1870 et 1880. Il se sépara nettement de la tradition de
la peinture européenne et son influence se répandit dans de vastes proportions.
Il est encore vivant aujourd’hui comme un des éléments du goût actuel. Il n’a
pas seulement modifié la peinture, mais encore la littérature, la musique, et
jusqu’à la critique. En laissant de côté certaines compositions de personnages
de Renoir, le type d’impressionnisme le plus facile à saisir et le plus courant
- et même son origine historique - se trouvent dans la peinture de paysage».
Venturi se satisfait de parler goût, et
la chose devrait en rester là. Mais les critiques de l’époque, séduits par
l’originalité des œuvres rassemblées, poussèrent plus loin l’analyse. Il y a
peu encore, la critique d’art Joy Newton considérait que : «les Impressionnistes étaient les seuls, à
cette époque, à découvrir de nouvelles qualités esthétiques dans la vie
moderne. Auparavant, les peintres cherchaient un sujet pittoresque comme motif,
mais les Impressionnistes ont appliqué leur technique lyrique à des sujets
considérés jusqu’alors comme laids. Les nombreux tableaux des cafés, des
marchés, des gares, des théâtres et des gens à leur travail ont une atmosphère
qui rappelle certains passages des romans de Zola…».
Cette association n’est pas originale; elle rappelle deux choses qui
sont : les origines esthétiques de l’impression
Barbizon rejoignant la philosophie positiviste des peintres réalistes dans
la formation du mouvement impressionniste et la dérive même du mouvement qui,
de son culte de la nature, finit par le pousser dans l’extravagance des
post-impressionnistes du tournant du siècle ramenant la perception du regard
dans l’organisation cérébrale du champ visuel.
Le mythe impressionniste, une fois que nous
quittons le champ des anecdotes pour entrer dans celui de l’histoire de l’art,
se résume à ce qu’en critique Pierre Francastel : «Les impressionnistes auraient  découvert à un moment donné une nouvelle
méthode de représenter l’univers et elle se serait ensuite diffusée
internationalement. Les faits sont présentés absolument comme si
l’impressionnisme était une recette qui restait à découvrir, comme on trouve un
produit naturel encore inconnu dans la nature. Toute l’histoire de
l’impressionnisme telle que M. Rewald la conçoit se réduit en somme au récit
d’une série de rencontres entre quelques jeunes gens travaillant à Paris vers
la même époque et à la mise au point progressive entre eux tous d’un procédé
technique. On retrouve ici l’erreur d’optique qui a présidé jadis à la
formation des thèses relatives aux origines de la Renaissance. Même illusion de
l’existence d’une sorte de formule toute prête dans la nature ou dans le
cerveau humain et qu’il s’agit de mettre au jour. […] [I]l a rassemblé des anecdotes sur la vie des
peintres impressionnistes. Il s’est refusé à poser le problème du style, il a
méconnu le fait que, toute leur vie, les impressionnistes - et c’est ce qui
fait leur grandeur - ont tâtonné et que le mouvement dont ils ont été les
initiateurs ne s’est pas terminé un beau soir d’été parce que le dernier mot
d’une certaine méthode était trouvé, tandis que déjà leurs successeurs passaient
à la recherche de la formule suivante, toute prête dans les magasins de
l’histoire».
La critique de Francastel, plus intéressée par la sociologie de l’art que par
les anecdotes truculentes, vise surtout à souligner les faiblesses du livre de
Rewald. Mais il montre à quel point il est difficile de parler des
impressionnistes sans participer du mythe, soit en bien soit en mal.
L’importance que le XXe siècle leur a accordée s’est étendue dans l’espace et
dans le temps. Il existe un impressionnisme jusqu’aux Étas-Unis, bien
évidemment, mais tous ces impressionnismes nationaux sont effacés pour laisser
la place au seul mouvement parisien : «Les
réalisations de l’impressionnisme étaient devenues le patrimoine commun, point
de départ pour de nouvelles conquêtes. Il est exact, néanmoins, que les jeunes
avaient fini par rejeter la plupart des principes impressionnistes, que les
fauves, les cubistes, les expressionnistes, les futuristes, les dadaïstes, les
surréalistes avaient
découvert à un moment donné une nouvelle
méthode de représenter l’univers et elle se serait ensuite diffusée
internationalement. Les faits sont présentés absolument comme si
l’impressionnisme était une recette qui restait à découvrir, comme on trouve un
produit naturel encore inconnu dans la nature. Toute l’histoire de
l’impressionnisme telle que M. Rewald la conçoit se réduit en somme au récit
d’une série de rencontres entre quelques jeunes gens travaillant à Paris vers
la même époque et à la mise au point progressive entre eux tous d’un procédé
technique. On retrouve ici l’erreur d’optique qui a présidé jadis à la
formation des thèses relatives aux origines de la Renaissance. Même illusion de
l’existence d’une sorte de formule toute prête dans la nature ou dans le
cerveau humain et qu’il s’agit de mettre au jour. […] [I]l a rassemblé des anecdotes sur la vie des
peintres impressionnistes. Il s’est refusé à poser le problème du style, il a
méconnu le fait que, toute leur vie, les impressionnistes - et c’est ce qui
fait leur grandeur - ont tâtonné et que le mouvement dont ils ont été les
initiateurs ne s’est pas terminé un beau soir d’été parce que le dernier mot
d’une certaine méthode était trouvé, tandis que déjà leurs successeurs passaient
à la recherche de la formule suivante, toute prête dans les magasins de
l’histoire».
La critique de Francastel, plus intéressée par la sociologie de l’art que par
les anecdotes truculentes, vise surtout à souligner les faiblesses du livre de
Rewald. Mais il montre à quel point il est difficile de parler des
impressionnistes sans participer du mythe, soit en bien soit en mal.
L’importance que le XXe siècle leur a accordée s’est étendue dans l’espace et
dans le temps. Il existe un impressionnisme jusqu’aux Étas-Unis, bien
évidemment, mais tous ces impressionnismes nationaux sont effacés pour laisser
la place au seul mouvement parisien : «Les
réalisations de l’impressionnisme étaient devenues le patrimoine commun, point
de départ pour de nouvelles conquêtes. Il est exact, néanmoins, que les jeunes
avaient fini par rejeter la plupart des principes impressionnistes, que les
fauves, les cubistes, les expressionnistes, les futuristes, les dadaïstes, les
surréalistes avaient  successivement ouvert des horizons tout à fait nouveau.
Mais leurs efforts avaient été alimentés par l’œuvre de Cézanne, Gauguin, van
Gogh et Seurat qui, tous, étaient passés par une phase impressionniste. Si
l’influence directe de l’impressionnisme sur l’art contemporain peut paraître
parfois négligeable, si de tous les maîtres du XXe siècle, seul Bonnard a
continué à développer son propre style dans un esprit authentiquement
impressionniste, ce fut néanmoins l’art de Monet et de ses compagnons qui
abolit d’innombrables préjugés et ouvrit la route à des hardiesses de plus en
plus grandes de technique, de couleur et d’abstraction».
Rewald a effectivement tort de ne pas s’être intéressé à l’impressionnisme hors
du cercle parisien, excluant par le fait même les recherches esthétiques faites
ailleurs, dans d’autres nations occidentales. Et, comme il se doit, l’expansion
dans l’espace du mythe français de l’impressionnisme trouve son équivalent dans
l’étirement dans le temps. L’impressionnisme français remonte dans le passé
jusqu’à marginaliser les tendances existantes, réaliste, naturaliste et
symboliste, puis à avaler ses prédécesseurs de Barbizon : «À cent lieux de la théâtralité de la
peinture académique, émergent dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers
balbutiements de la modernité picturale. En se fondant sur l’expérience
visuelle concrète, l’artiste, promoteur de ce qui
successivement ouvert des horizons tout à fait nouveau.
Mais leurs efforts avaient été alimentés par l’œuvre de Cézanne, Gauguin, van
Gogh et Seurat qui, tous, étaient passés par une phase impressionniste. Si
l’influence directe de l’impressionnisme sur l’art contemporain peut paraître
parfois négligeable, si de tous les maîtres du XXe siècle, seul Bonnard a
continué à développer son propre style dans un esprit authentiquement
impressionniste, ce fut néanmoins l’art de Monet et de ses compagnons qui
abolit d’innombrables préjugés et ouvrit la route à des hardiesses de plus en
plus grandes de technique, de couleur et d’abstraction».
Rewald a effectivement tort de ne pas s’être intéressé à l’impressionnisme hors
du cercle parisien, excluant par le fait même les recherches esthétiques faites
ailleurs, dans d’autres nations occidentales. Et, comme il se doit, l’expansion
dans l’espace du mythe français de l’impressionnisme trouve son équivalent dans
l’étirement dans le temps. L’impressionnisme français remonte dans le passé
jusqu’à marginaliser les tendances existantes, réaliste, naturaliste et
symboliste, puis à avaler ses prédécesseurs de Barbizon : «À cent lieux de la théâtralité de la
peinture académique, émergent dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers
balbutiements de la modernité picturale. En se fondant sur l’expérience
visuelle concrète, l’artiste, promoteur de ce qui  va devenir la révolution
impressionniste, peint ce qu’il observe et ce qu’il sent, bref, réalise
directement une expérience. Le caractère est profondément novateur, moderne :
en exprimant une réalité mouvante, fugitive, l’œuvre réalisée par l’artiste
cesse d’être une simple représentation pour donner naissance à une réalité
vivante, perceptive».
Ne voilà-t-il pas que l’impressionnisme succède pour le remplacer au romantisme
(rejet de la théâtralité) et englobe
par le fait même tous les peintres qui ont travaillé sur l’expérience chromatique
et l’observation. Or, comme nous l’avons vu précédemment, réalistes et
symbolistes avaient chacun leurs soucis d’approcher méthodiquement l’expérience
visuelle et l’observation de l’espace figuratif. C’est ce que nous entendons
par l’aspect positivement amplificateur du mythe de l’impressionnisme, mais il
y a également un aspect négativement réducteur lié aux commentaires
désobligeants qui se sont manifestés dès l’époque et sur lequel, le génie
impressionniste apparaît comme la victime d’une injuste persécution et qui se
résume par cet encart d’Albert Wolff paru dans Le Figaro du 3 avril 1876 : «La
rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau
désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une
exposition qu’on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les
drapeaux qui décorent la façade, entre, et à ses yeux épouvantés s’offre un
spectacle cruel : cinq à six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux
atteints de la folie de l’ambition, s’y sont donné rendez-vous pour exposer
leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j’ai
le cœur serré…».
va devenir la révolution
impressionniste, peint ce qu’il observe et ce qu’il sent, bref, réalise
directement une expérience. Le caractère est profondément novateur, moderne :
en exprimant une réalité mouvante, fugitive, l’œuvre réalisée par l’artiste
cesse d’être une simple représentation pour donner naissance à une réalité
vivante, perceptive».
Ne voilà-t-il pas que l’impressionnisme succède pour le remplacer au romantisme
(rejet de la théâtralité) et englobe
par le fait même tous les peintres qui ont travaillé sur l’expérience chromatique
et l’observation. Or, comme nous l’avons vu précédemment, réalistes et
symbolistes avaient chacun leurs soucis d’approcher méthodiquement l’expérience
visuelle et l’observation de l’espace figuratif. C’est ce que nous entendons
par l’aspect positivement amplificateur du mythe de l’impressionnisme, mais il
y a également un aspect négativement réducteur lié aux commentaires
désobligeants qui se sont manifestés dès l’époque et sur lequel, le génie
impressionniste apparaît comme la victime d’une injuste persécution et qui se
résume par cet encart d’Albert Wolff paru dans Le Figaro du 3 avril 1876 : «La
rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau
désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une
exposition qu’on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les
drapeaux qui décorent la façade, entre, et à ses yeux épouvantés s’offre un
spectacle cruel : cinq à six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux
atteints de la folie de l’ambition, s’y sont donné rendez-vous pour exposer
leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j’ai
le cœur serré…».
 |
| Édouard Manet. Théodore Duret.1868 |
Tous les mouvements d’art ou de lettres ont eu leurs
détracteurs. Réalistes, naturalistes, symbolistes, chaque artiste ou écrivain
recevait sa part de pavés. Dans la mesure où les œuvres exposées des
impressionnistes étaient nombreuses, probablement que la quantité des pavés a
cru en proportion. Répondant au sarcastique critique du Figaro, «au printemps de
1878, Duret vint à l’aide de ses amis en écrivant une brochure, Les peintres impressionnistes, dans laquelle il essaya de convaincre le
public que les innovateurs sont toujours en butte aux railleries avant d’être
reconnus […], et il concluait en prédisant que le jour viendrait où leur art
serait universellement accepté».
Cette défense généreuse promouvait non plus le goût mais l’innovation attribuée
à l’impressionnisme. Au-delà du goût, c’était le «progrès» qu’ils
représentaient en peinture qui était sanctionné  par les rieurs. C’est à leur
corps défendant, finalement, que le mot finit par leur être imposer au fond de
la gorge : «Le mot impressionnisme, inventé par esprit de dérision, devait
bientôt être accepté par le groupe d’amis. Malgré la répugnance manifestée par
Renoir pour tout ce qui pouvait leur donner l’apparence de constituer une
nouvelle école artistique, malgré l’hostilité de Degas à admettre l’application
de ce terme à son art, et malgré l’obstination de Zola à appeler ces peintres
“naturalistes”, le mot nouveau devait rester. Bien que chargé de ridicule et
vague en lui-même, ce vocable semblait aussi bon que tout autre pour souligner
l’élément commun de leurs efforts. Aucun terme, à lui seul, ne pouvait
prétendre définir avec précision les tendances d’un groupe de peintres qui
mettaient leurs propres sensations au-dessus de tout programme artistique. Mais
quelle qu’ait été la signification du mot “impressionnisme” à l’origine, son
vrai sens devait être formulé non par des critiques ironiques mais par les
peintres eux-mêmes. C’est ainsi que de leur milieu, et sans doute avec leur
consentement, vint la première définition du terme. C’est un ami de Renoir qui
la proposa bientôt, en écrivant : “Traiter un sujet pour les tons et non pour
le sujet lui-même, voilà ce qui distingue les impressionnistes des autres peintres”». L’historien d’art Venturi a essayé de trouver une raison plus profonde de la
part des critiques qui ont rejeté l’œuvre
des impressionnistes. Il avance comme explication que «l’atmosphère
par les rieurs. C’est à leur
corps défendant, finalement, que le mot finit par leur être imposer au fond de
la gorge : «Le mot impressionnisme, inventé par esprit de dérision, devait
bientôt être accepté par le groupe d’amis. Malgré la répugnance manifestée par
Renoir pour tout ce qui pouvait leur donner l’apparence de constituer une
nouvelle école artistique, malgré l’hostilité de Degas à admettre l’application
de ce terme à son art, et malgré l’obstination de Zola à appeler ces peintres
“naturalistes”, le mot nouveau devait rester. Bien que chargé de ridicule et
vague en lui-même, ce vocable semblait aussi bon que tout autre pour souligner
l’élément commun de leurs efforts. Aucun terme, à lui seul, ne pouvait
prétendre définir avec précision les tendances d’un groupe de peintres qui
mettaient leurs propres sensations au-dessus de tout programme artistique. Mais
quelle qu’ait été la signification du mot “impressionnisme” à l’origine, son
vrai sens devait être formulé non par des critiques ironiques mais par les
peintres eux-mêmes. C’est ainsi que de leur milieu, et sans doute avec leur
consentement, vint la première définition du terme. C’est un ami de Renoir qui
la proposa bientôt, en écrivant : “Traiter un sujet pour les tons et non pour
le sujet lui-même, voilà ce qui distingue les impressionnistes des autres peintres”». L’historien d’art Venturi a essayé de trouver une raison plus profonde de la
part des critiques qui ont rejeté l’œuvre
des impressionnistes. Il avance comme explication que «l’atmosphère  impressionniste suggérée par les vibrations de couleurs
séparées et pleine de reflets des lumières était le motif central de l’artiste
: aussi celui-ci accentuait-il l’effet de la surface et diminuait-il l’illusion
de la profondeur. Cela était dû à l’intime cohérence de la vision; mais nombre
de critiques ne s’en aperçurent pas, et, confondant la peinture en surface avec
la peinture superficielle, critiquèrent les impressionnistes en ce pourquoi précisément, ils auraient dû les louer; car il n'existe aucune loi esthétique imposant à la peinture
impressionniste suggérée par les vibrations de couleurs
séparées et pleine de reflets des lumières était le motif central de l’artiste
: aussi celui-ci accentuait-il l’effet de la surface et diminuait-il l’illusion
de la profondeur. Cela était dû à l’intime cohérence de la vision; mais nombre
de critiques ne s’en aperçurent pas, et, confondant la peinture en surface avec
la peinture superficielle, critiquèrent les impressionnistes en ce pourquoi précisément, ils auraient dû les louer; car il n'existe aucune loi esthétique imposant à la peinture  un effet à trois dimensions. Enfin la conception même du
mouvement fut toute nouvelle chez les impressionnistes. Étant donné que
l’origine de leur peinture se trouve dans les reflets de l’eau, l’effet
d’ensemble fut un effet de mouvement perpétuel, de vibrations cosmiques. Le
moindre objet statique introduit par inadvertance au milieu de cette vibration détruisait
entièrement l’effet. Réaliser la vibration cosmique signifia pour eux révéler
l’impression de l’énergie qui est la vie de la nature. La lumière vibrante
imprimée dans toute chose représente la vie et la vigueur».
Inutile de préciser que Venturi défend l’apport des impressionnistes,
contrairement à l’anthropologue Gilbert Durand : «Le cas de l’Impressionnisme est bien significatif : en un sens il est
l’aboutissement triomphant du naturalisme romantique. Mais ce n’est qu’une
apparence. En profondeur, il n’est que l’envahissement scientiste et prométhéen
de la sensibilité, via les lois de Chevreul sur la lumière qui sont aux
antipodes de la Farbenlehre de Gœthe, tandis que le choix du nom de l’école
elle-même, “impressionnisme”, ramène et réduit la nature à un codage purement
psychologique. Car l’apologie décadente et scientiste de la paranoïa marie avec
bonheur la dissection scientiste des données naturelles et la frénésie
envahissante des pulsions du moi».
Comme on peut le constater, la querelle autour des impressionnistes n’est pas
terminée.
un effet à trois dimensions. Enfin la conception même du
mouvement fut toute nouvelle chez les impressionnistes. Étant donné que
l’origine de leur peinture se trouve dans les reflets de l’eau, l’effet
d’ensemble fut un effet de mouvement perpétuel, de vibrations cosmiques. Le
moindre objet statique introduit par inadvertance au milieu de cette vibration détruisait
entièrement l’effet. Réaliser la vibration cosmique signifia pour eux révéler
l’impression de l’énergie qui est la vie de la nature. La lumière vibrante
imprimée dans toute chose représente la vie et la vigueur».
Inutile de préciser que Venturi défend l’apport des impressionnistes,
contrairement à l’anthropologue Gilbert Durand : «Le cas de l’Impressionnisme est bien significatif : en un sens il est
l’aboutissement triomphant du naturalisme romantique. Mais ce n’est qu’une
apparence. En profondeur, il n’est que l’envahissement scientiste et prométhéen
de la sensibilité, via les lois de Chevreul sur la lumière qui sont aux
antipodes de la Farbenlehre de Gœthe, tandis que le choix du nom de l’école
elle-même, “impressionnisme”, ramène et réduit la nature à un codage purement
psychologique. Car l’apologie décadente et scientiste de la paranoïa marie avec
bonheur la dissection scientiste des données naturelles et la frénésie
envahissante des pulsions du moi».
Comme on peut le constater, la querelle autour des impressionnistes n’est pas
terminée.
Exposer les différents aspects du mythe ne nous
révèle pas pour autant ce que fut l’impressionnisme, objectivement ni
subjectivement. Cela nous informe surtout sur la réception du mouvement.
Commençons par un paradoxe. Lorsque les Américains négocièrent avec l’Allemagne
un arrangement suite à leur dette de  guerre, le fameux plan Dawes signé le 24
juillet 1924, chargé de prêter aux débiteurs le montant à rembourser,
l’économiste Paul Auld commenta par cette figure de style : «Que reste-t-il alors à ces esprits sérieux
qui croient que le monde est détraqué? Il faut d’une manière ou d’une autre
convaincre le prêteur, dans son propre intérêt. Aussi, on adopte la méthode
impressionniste. Le détail est séparé de l’ensemble du sujet, et l’on peint le
danger comme quelque chose de vague, sombre et mystérieux».
La méthode impressionniste consisterait-elle à séparer les détails de
l’ensemble du sujet, tout cela sur fond brumeux? Que la chose soit exacte ou
non en ce qui a trait au plan Dawes, ou le fait que l’économie serait une
affaire de perception impressionniste,
la facture impressionniste pourrait se résumer à cette phrase. Mais ce ne
serait là que le résultat, nous n’en sommes pas encore à la définition même du
processus créatif. Pour cela, il faut interroger l’intention des artistes. Que
voulait un peintre classé dans la catégorie impressionniste lorsqu’il se
trouvait devant sa toile? «C’est Manet,
le précurseur, qui fut le premier à déclarer qu’il voulait être “de son temps”
et peindre “ce qu’il voyait”. Autrement dit, inspirés par Courbet, les
impressionnistes étaient avant tout des réalistes qui rejetaient les légendes
chrétiennes, la flatterie sociale et l’esthétique académique afin de révéler,
au lieu d’interpréter, le monde qui les entourait. Rejetant l’idée consacrée
selon laquelle la peinture était une activité cérébrale, les impressionnistes,
dans leurs essais optiques, comptaient sur l’œil humain pour transmettre la
réalité sans médiation mentale. En conséquence, ils quittèrent leurs ateliers
sombres pour le grand jour de la société, de la ville et de la campagne».
L’œil. Pour un impressionniste, tout est dans l’œil, le regard, bref la
perception visuelle; ce qui le distingue d’un peintre réaliste comme Courbet.
La sensibilité l’emporte sur la
guerre, le fameux plan Dawes signé le 24
juillet 1924, chargé de prêter aux débiteurs le montant à rembourser,
l’économiste Paul Auld commenta par cette figure de style : «Que reste-t-il alors à ces esprits sérieux
qui croient que le monde est détraqué? Il faut d’une manière ou d’une autre
convaincre le prêteur, dans son propre intérêt. Aussi, on adopte la méthode
impressionniste. Le détail est séparé de l’ensemble du sujet, et l’on peint le
danger comme quelque chose de vague, sombre et mystérieux».
La méthode impressionniste consisterait-elle à séparer les détails de
l’ensemble du sujet, tout cela sur fond brumeux? Que la chose soit exacte ou
non en ce qui a trait au plan Dawes, ou le fait que l’économie serait une
affaire de perception impressionniste,
la facture impressionniste pourrait se résumer à cette phrase. Mais ce ne
serait là que le résultat, nous n’en sommes pas encore à la définition même du
processus créatif. Pour cela, il faut interroger l’intention des artistes. Que
voulait un peintre classé dans la catégorie impressionniste lorsqu’il se
trouvait devant sa toile? «C’est Manet,
le précurseur, qui fut le premier à déclarer qu’il voulait être “de son temps”
et peindre “ce qu’il voyait”. Autrement dit, inspirés par Courbet, les
impressionnistes étaient avant tout des réalistes qui rejetaient les légendes
chrétiennes, la flatterie sociale et l’esthétique académique afin de révéler,
au lieu d’interpréter, le monde qui les entourait. Rejetant l’idée consacrée
selon laquelle la peinture était une activité cérébrale, les impressionnistes,
dans leurs essais optiques, comptaient sur l’œil humain pour transmettre la
réalité sans médiation mentale. En conséquence, ils quittèrent leurs ateliers
sombres pour le grand jour de la société, de la ville et de la campagne».
L’œil. Pour un impressionniste, tout est dans l’œil, le regard, bref la
perception visuelle; ce qui le distingue d’un peintre réaliste comme Courbet.
La sensibilité l’emporte sur la  réflexion logique, le goût scientiste se
déplace de la forme vers les mécanismes de la perception sensorielle des couleurs. En cela, les
impressionnistes firent un pas de plus vers la reproduction de la réalité qui
ne perçoit pas les lignes, mais seulement les formes par l’éclairage et les
dispositions : «Il ne s’agit plus de
représenter la réalité, mais ce qui apparaît à l’artiste à l’issue d’une
observation pénétrante : la vie en mouvement à travers la palpitation vitale de
la nature et la réalité mouvante des phénomènes, les restituant par la force
des couleurs et des lumières, dimensions essentielles des productions
impressionnistes. Paul Smith parle “de la volonté affichée par les peintres de
traduire la moindre information visuelle arrachée au spectacle mouvant du
réel”. L’artiste est résolument moderne; il réalise un brouillage conduisant à
une dissolution de la forme, une liberté du sujet, favorisant l’expression de
la couleur et de la lumière, transformant le tableau, contrairement à la tradition
académique, en espace perceptif, vivant. L’œuvre devient dynamique et vibrante,
la fonction de l’art vise avant tout une expérience. Voilà une caractéristique
essentielle de la modernité artistique».
Par contre, les impressionnistes complétèrent parfaitement la rupture amorcée
par le réalisme de Courbet : «Sans
souscrire aux spéculations idéologiques sur la “visibilité pure” […], nous devons admettre cependant que, dans
la pratique picturale, Courbet et les impressionnistes opposent la visibilité
comme production à la visibilité
comme représentation. Cette
restitution matérialiste passe effectivement par la dé-nomination du réel,
c’est-à-dire par l’exercice d’une amnésie verbale devant le motif».
Cette distinction est essentielle.
réflexion logique, le goût scientiste se
déplace de la forme vers les mécanismes de la perception sensorielle des couleurs. En cela, les
impressionnistes firent un pas de plus vers la reproduction de la réalité qui
ne perçoit pas les lignes, mais seulement les formes par l’éclairage et les
dispositions : «Il ne s’agit plus de
représenter la réalité, mais ce qui apparaît à l’artiste à l’issue d’une
observation pénétrante : la vie en mouvement à travers la palpitation vitale de
la nature et la réalité mouvante des phénomènes, les restituant par la force
des couleurs et des lumières, dimensions essentielles des productions
impressionnistes. Paul Smith parle “de la volonté affichée par les peintres de
traduire la moindre information visuelle arrachée au spectacle mouvant du
réel”. L’artiste est résolument moderne; il réalise un brouillage conduisant à
une dissolution de la forme, une liberté du sujet, favorisant l’expression de
la couleur et de la lumière, transformant le tableau, contrairement à la tradition
académique, en espace perceptif, vivant. L’œuvre devient dynamique et vibrante,
la fonction de l’art vise avant tout une expérience. Voilà une caractéristique
essentielle de la modernité artistique».
Par contre, les impressionnistes complétèrent parfaitement la rupture amorcée
par le réalisme de Courbet : «Sans
souscrire aux spéculations idéologiques sur la “visibilité pure” […], nous devons admettre cependant que, dans
la pratique picturale, Courbet et les impressionnistes opposent la visibilité
comme production à la visibilité
comme représentation. Cette
restitution matérialiste passe effectivement par la dé-nomination du réel,
c’est-à-dire par l’exercice d’une amnésie verbale devant le motif».
Cette distinction est essentielle.
La visibilité, encore rattachée à la cérébralité
en tant que reproduction chez Courbet, passe avec les impressionnistes à une
véritable production en soi. Le
sujet, la nature, ne relève plus tant de l’ordre naturaliste mais comme
expression de la vivacité et de la diversité de la vie, d’où ce déplacement des
scènes  encore théâtralisées chez Courbet à des scènes sans autre mise en scène
que celle de la nature et de l’instant, car on le verra surtout avec Cézanne,
le temps entre dans la composition impressionniste comme jamais depuis l’âge
baroque. Cézanne est à Courbet ce qu’un Caravage était à un Piero della
Francesca. Il y a donc une opposition structurelle entre Courbet d’un côté et
les impressionnistes de l’autre. Comme le dit Vincent Fauque en citant
Cézanne : «L’impressionnisme est
moderne en ce sens qu’il instaure quelque chose de “primitif”, d’instinctif. À
travers “une apologie de la sensation immédiate et pure, l’impressionniste voit
et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibrations
colorées”. Restituer au spectateur les impressions du peintre et le convier à
une expérience, voilà un des aspects essentiels que revêt le caractère de la
modernité et qui explique la surprise, déconcertante par nature, et la
réprobation avec laquelle vont être accueillies les premières productions
picturales des impressionnistes. Il ne s’agit plus de représenter, en
dépeignant objectivement un sujet, mais de faire place à la sensation
qu’éprouve le peintre et qu’il s’efforce de faire partager au spectateur;
démarche subjective par définition. “Peindre d’après nature ce n’est pas copier
l’objectif, c’est réaliser ses sensations”, nous dira Cézanne».
Voilà pourquoi il est permis d’affirmer que «l’impressionnisme fut une réaction au réalisme, à l’objectivité du
réalisme, et une affirmation des droits de la subjectivité, de la personnalité
de l’artiste. Ce détachement par rapport à l’objectivité était un idéal - mais
point un idéal intellectuel - précisément parce qu’il était fondé sur la
sensation. L’impressionnisme fut aussi une réaction au romantisme, une révolte
contre les passions humaines, d’ordre littéraire, historique ou politique qu’on
avait introduites dans l’art».
Ce sont les impressionnistes qui finissent par représenter le naturalisme en
peinture. La question, contrairement à celle décrite par Zola dans L’œuvre n’est pas entre Cézanne et
Manet, mais bien entre Courbet et Cézanne : «Son naturalisme radical le conduit à une attitude originale, bien que
simple, répétant toute approche dogmatique. Son attitude le conduit à
“explorer” le monde et à en exprimer la réalité telle qu’elle est ressentie.
Cette primauté de l’instinct et de la spontanéité amène le peintre à conférer à
ce qui est perçu plus d’importance qu’à ce qui est vu. Pour Giulio Argan, “il
s’agit de soustraire la sensation visuelle à toute expérience, à toute idée
reçue ou comportement préexistant susceptible d’en altérer l’instantanéité”». En cet instant, le terme impressionnisme fut sur le point d’être remplacé par celui de naturalisme : «Au début, Duranty appelle l’impressionnisme la “Nouvelle Peinture”.
Puis, les peintres du groupe sont nommé les Naturalistes, ce qui pouvait plaire
à Zola quand il faisait l’éloge de Manet. Mais les novateurs furent qualifiés
d’Impressionnistes quand Claude Monet, en 1874, exposa chez Nadar, boulevard
des Capucines, le tableau qu’on peut voir aujourd’hui au Musée Marmottan, et
qu’il intitula: Impression, lever de soleil. “Ça ne peut vraiment pas passer
pour une vue du Havre, pensait Monet, en mal de titre, devant ce lever de
soleil sur un port, mettez : impression”».
encore théâtralisées chez Courbet à des scènes sans autre mise en scène
que celle de la nature et de l’instant, car on le verra surtout avec Cézanne,
le temps entre dans la composition impressionniste comme jamais depuis l’âge
baroque. Cézanne est à Courbet ce qu’un Caravage était à un Piero della
Francesca. Il y a donc une opposition structurelle entre Courbet d’un côté et
les impressionnistes de l’autre. Comme le dit Vincent Fauque en citant
Cézanne : «L’impressionnisme est
moderne en ce sens qu’il instaure quelque chose de “primitif”, d’instinctif. À
travers “une apologie de la sensation immédiate et pure, l’impressionniste voit
et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibrations
colorées”. Restituer au spectateur les impressions du peintre et le convier à
une expérience, voilà un des aspects essentiels que revêt le caractère de la
modernité et qui explique la surprise, déconcertante par nature, et la
réprobation avec laquelle vont être accueillies les premières productions
picturales des impressionnistes. Il ne s’agit plus de représenter, en
dépeignant objectivement un sujet, mais de faire place à la sensation
qu’éprouve le peintre et qu’il s’efforce de faire partager au spectateur;
démarche subjective par définition. “Peindre d’après nature ce n’est pas copier
l’objectif, c’est réaliser ses sensations”, nous dira Cézanne».
Voilà pourquoi il est permis d’affirmer que «l’impressionnisme fut une réaction au réalisme, à l’objectivité du
réalisme, et une affirmation des droits de la subjectivité, de la personnalité
de l’artiste. Ce détachement par rapport à l’objectivité était un idéal - mais
point un idéal intellectuel - précisément parce qu’il était fondé sur la
sensation. L’impressionnisme fut aussi une réaction au romantisme, une révolte
contre les passions humaines, d’ordre littéraire, historique ou politique qu’on
avait introduites dans l’art».
Ce sont les impressionnistes qui finissent par représenter le naturalisme en
peinture. La question, contrairement à celle décrite par Zola dans L’œuvre n’est pas entre Cézanne et
Manet, mais bien entre Courbet et Cézanne : «Son naturalisme radical le conduit à une attitude originale, bien que
simple, répétant toute approche dogmatique. Son attitude le conduit à
“explorer” le monde et à en exprimer la réalité telle qu’elle est ressentie.
Cette primauté de l’instinct et de la spontanéité amène le peintre à conférer à
ce qui est perçu plus d’importance qu’à ce qui est vu. Pour Giulio Argan, “il
s’agit de soustraire la sensation visuelle à toute expérience, à toute idée
reçue ou comportement préexistant susceptible d’en altérer l’instantanéité”». En cet instant, le terme impressionnisme fut sur le point d’être remplacé par celui de naturalisme : «Au début, Duranty appelle l’impressionnisme la “Nouvelle Peinture”.
Puis, les peintres du groupe sont nommé les Naturalistes, ce qui pouvait plaire
à Zola quand il faisait l’éloge de Manet. Mais les novateurs furent qualifiés
d’Impressionnistes quand Claude Monet, en 1874, exposa chez Nadar, boulevard
des Capucines, le tableau qu’on peut voir aujourd’hui au Musée Marmottan, et
qu’il intitula: Impression, lever de soleil. “Ça ne peut vraiment pas passer
pour une vue du Havre, pensait Monet, en mal de titre, devant ce lever de
soleil sur un port, mettez : impression”».
 |
| Auguste Renoir. Le déjeuner des canotiers. |
Cette immédiateté entre l’artiste et la nature
passait par l’instantané du champ visuel chromatique. L’impressionnisme, c’est
la lumière prise comme médium entre le monde réel des formes et l’expérience
perceptive de l’artiste. La lumière donne à l’artiste la perception des formes
et réussit mieux que la perspective traditionnelle, réaliste, à rendre compte
de la profondeur des champs de vision. Et Rewald de remarquer : «La nature cessait d’être un objet
susceptible d’interprétation comme pour les peintres de Barbizon; elle devenait
la source directe de sensations pures, et rien ne pouvait mieux reproduire ces
sensations que cette nouvelle technique qui, au lieu d’insister sur les
détails, retenait l’impression générale dans toute sa richesse de couleur et de
vie».
Et le mot final pourrait revenir à Paul Klee : «L’art ne reproduit pas le visible; il rend visible».
Les peintres prirent progressivement conscience de cette expérience intérieure
grâce à une invention pratique dans le monde de la technique, celle des tubes
de couleurs. Désormais, le lourd  équipement des peintres se ramenait à une boîte qu'il devenait facile de déplacer vers l’extérieur. Les peintres, en sortant de leur studio,
se heurtaient au monde industriel, laid, bruyant et puant. Aussi, se
dirigèrent-ils vers des endroits plus beaux, plus calmes, plus
odoriférants : «Au cours des années
qui précédèrent 1870, trois jeunes gens : Monet, Renoir et Pissarro peignaient
les rives de la Seine et de l’Oise. C’étaient des peintres réalistes, attentifs
aux effets produits par la lumière dans l’eau, au mouvement, à la vie de ces
reflets, conscients des divisions de couleur qu’opère la transparence de l’eau,
dispensant ainsi le peintre d’employer, dans les ombres, des tons foncés. Ils
furent donc amenés à éclaircir leur palette et séparèrent les tons sur la toile
non pour suivre quelque théorie mais en raison de leur expérience spontanée de
la réalité. Pendant quelque temps, ils peignirent l’eau de cette façon
nouvelle, mais les collines, les arbres, les maisons et le ciel dans la
tradition réaliste, si bien que leurs toiles n’avaient pas d’équilibre. Afin
d’éviter cette erreur, ils s’efforcèrent de peindre tous les objets naturels -
et
équipement des peintres se ramenait à une boîte qu'il devenait facile de déplacer vers l’extérieur. Les peintres, en sortant de leur studio,
se heurtaient au monde industriel, laid, bruyant et puant. Aussi, se
dirigèrent-ils vers des endroits plus beaux, plus calmes, plus
odoriférants : «Au cours des années
qui précédèrent 1870, trois jeunes gens : Monet, Renoir et Pissarro peignaient
les rives de la Seine et de l’Oise. C’étaient des peintres réalistes, attentifs
aux effets produits par la lumière dans l’eau, au mouvement, à la vie de ces
reflets, conscients des divisions de couleur qu’opère la transparence de l’eau,
dispensant ainsi le peintre d’employer, dans les ombres, des tons foncés. Ils
furent donc amenés à éclaircir leur palette et séparèrent les tons sur la toile
non pour suivre quelque théorie mais en raison de leur expérience spontanée de
la réalité. Pendant quelque temps, ils peignirent l’eau de cette façon
nouvelle, mais les collines, les arbres, les maisons et le ciel dans la
tradition réaliste, si bien que leurs toiles n’avaient pas d’équilibre. Afin
d’éviter cette erreur, ils s’efforcèrent de peindre tous les objets naturels -
et 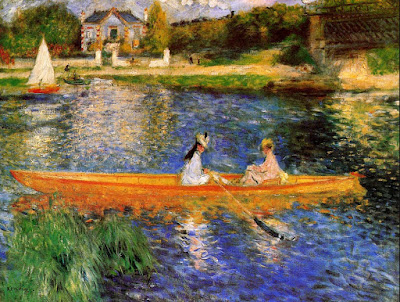 jusqu’aux personnages humains - de la même façon qu’ils avaient peint l’eau.
Ils créèrent donc toutes leurs images non pas seul on une forme abstraite, non
pas en clair-obscur, mais comme un reflet de lumière réel ou imaginaire. De la
nature, ils n’avaient choisi qu’un seul élément - la lumière - pour interpréter
la nature entière. La lumière, alors, ne fut plus un élément de la réalité,
mais un principe de style. L’impressionnisme était né».
Il fallut une dizaine d’années pour que l’expérience porta ses fruits. Vers
1883, Renoir «commença à se rendre compte
que, travaillant en plein air, il avait été trop préoccupé des phénomènes de
lumière pour prêter une attention suffisante à d’autres problèmes. “En peignant
directement devant la nature, disait Renoir, on en arrive à ne plus chercher
que l’effet, à ne plus composer, et on tombe vite dans la monotonie”. Si grand
était son mépris pour ce qu’il avait réalisé jusqu’alors qu’il se prit d’une
véritable haine pour l’impressionnisme. Par réaction, il peignit plusieurs
toiles où chaque détail - y compris le feuillage des arbres - était d’abord
soigneusement tracé à l’encre, avant d’être coloré».
La grande quantité d’œuvres peintes produites pendant la décennie des années
1870 semble avoir déjà atteint une certaine saturation au début des années
1880.
jusqu’aux personnages humains - de la même façon qu’ils avaient peint l’eau.
Ils créèrent donc toutes leurs images non pas seul on une forme abstraite, non
pas en clair-obscur, mais comme un reflet de lumière réel ou imaginaire. De la
nature, ils n’avaient choisi qu’un seul élément - la lumière - pour interpréter
la nature entière. La lumière, alors, ne fut plus un élément de la réalité,
mais un principe de style. L’impressionnisme était né».
Il fallut une dizaine d’années pour que l’expérience porta ses fruits. Vers
1883, Renoir «commença à se rendre compte
que, travaillant en plein air, il avait été trop préoccupé des phénomènes de
lumière pour prêter une attention suffisante à d’autres problèmes. “En peignant
directement devant la nature, disait Renoir, on en arrive à ne plus chercher
que l’effet, à ne plus composer, et on tombe vite dans la monotonie”. Si grand
était son mépris pour ce qu’il avait réalisé jusqu’alors qu’il se prit d’une
véritable haine pour l’impressionnisme. Par réaction, il peignit plusieurs
toiles où chaque détail - y compris le feuillage des arbres - était d’abord
soigneusement tracé à l’encre, avant d’être coloré».
La grande quantité d’œuvres peintes produites pendant la décennie des années
1870 semble avoir déjà atteint une certaine saturation au début des années
1880.
 |
| Jongkind. Le port de Rotterdam, 1857 |
C’est pour avoir négligé les expériences
antérieures qu’il apparaît difficile de situer chronologiquement l’expérience
impressionniste. De 1860 environ à 1883, cela semble bien court pour une
expérience visuelle aussi importante. Mais en étendant dans l’amont jusqu’à
rejoindre Turner et Constable, le premier avec son impressionnisme chromatique
et le second avec sa sensibilité à reproduire la nature, l’impressionnisme ne
marquait pas le début d’une tradition artistique, mais plutôt sa fin. Durant
une certaine période, l’impressionnisme était entièrement contenu dans la
démarche du réalisme, voilà pourquoi Castagnary, l’ami  de Courbet et défenseur
du style réaliste reconnaissait la valeur de l’un des premiers peintres,
Jongkind (1819-1891), d’origine néerlandaise, dont on peut dire qu’il fut
impressionniste : «“Moi je l’aime,
ce Jongkind, avait déclaré Castagnary, l’ami de Courbet, il est artiste
jusqu’au bout des ongles; je lui trouve une vraie et rare sensibilité. Chez lui
tout gît dans l’impression.” Pour rester fidèle à ses impressions, Jongkind
s’ingénia à représenter dans ses toiles non ce qu’il savait de son sujet, mais
ce qu’il apercevait dans des conditions atmosphériques données. Avant de venir
à Honfleur dans l’été de 1864, il avait peint deux vues de l’abside de
Notre-Dame [de Paris], une fois dans
la lumière argentée d’un matinée d’hiver, une autre sous le ciel embrasé du
couchant. Plusieurs semaines et plusieurs mois peut-être séparent ces deux
études, mais dans chaque cas l’artiste avait
de Courbet et défenseur
du style réaliste reconnaissait la valeur de l’un des premiers peintres,
Jongkind (1819-1891), d’origine néerlandaise, dont on peut dire qu’il fut
impressionniste : «“Moi je l’aime,
ce Jongkind, avait déclaré Castagnary, l’ami de Courbet, il est artiste
jusqu’au bout des ongles; je lui trouve une vraie et rare sensibilité. Chez lui
tout gît dans l’impression.” Pour rester fidèle à ses impressions, Jongkind
s’ingénia à représenter dans ses toiles non ce qu’il savait de son sujet, mais
ce qu’il apercevait dans des conditions atmosphériques données. Avant de venir
à Honfleur dans l’été de 1864, il avait peint deux vues de l’abside de
Notre-Dame [de Paris], une fois dans
la lumière argentée d’un matinée d’hiver, une autre sous le ciel embrasé du
couchant. Plusieurs semaines et plusieurs mois peut-être séparent ces deux
études, mais dans chaque cas l’artiste avait  tenu à se placer exactement au
même endroit et à reproduire ce qu’il voyait. Tandis que sous la lumière vive
chaque détail architectural lui était apparu clairement, ces mêmes détails
s’étaient confondus dans la masse indistincte de l’abside au soleil couchant;
et Jongkind avait renoncé alors à tracer les arcs-boutants puisqu’il ne pouvait
plus nettement les voir. En substituant ainsi la forme apparente à la forme
réelle, Jongkind - comme Constable et Boudin avant lui - faisait des conditions
atmosphériques son véritable sujet d’étude. Monet allait bientôt le suivre dans
cette voie, peignant une rouge normande, un jour sous un ciel nuageux, et un
autre jour sous la neige. En observant comment les couleurs soi-disant locales
et les formes familières variaient selon les changements subis par leur
entourage, il fit un pas décisif vers la pleine compréhension de la nature».
Rien ne laissait présager, sinon cette atmosphère
propre aux œuvres de Jongkind que ce dernier finirait par aller à
contre-courant de la vague réaliste de l’époque. Au contraire, tandis que
l’aventure de Courbet s’achevait dans le four de la Commune de Paris, celle des
impressionnistes allait s’imposer au cours de la décennie qui suivrait :
tenu à se placer exactement au
même endroit et à reproduire ce qu’il voyait. Tandis que sous la lumière vive
chaque détail architectural lui était apparu clairement, ces mêmes détails
s’étaient confondus dans la masse indistincte de l’abside au soleil couchant;
et Jongkind avait renoncé alors à tracer les arcs-boutants puisqu’il ne pouvait
plus nettement les voir. En substituant ainsi la forme apparente à la forme
réelle, Jongkind - comme Constable et Boudin avant lui - faisait des conditions
atmosphériques son véritable sujet d’étude. Monet allait bientôt le suivre dans
cette voie, peignant une rouge normande, un jour sous un ciel nuageux, et un
autre jour sous la neige. En observant comment les couleurs soi-disant locales
et les formes familières variaient selon les changements subis par leur
entourage, il fit un pas décisif vers la pleine compréhension de la nature».
Rien ne laissait présager, sinon cette atmosphère
propre aux œuvres de Jongkind que ce dernier finirait par aller à
contre-courant de la vague réaliste de l’époque. Au contraire, tandis que
l’aventure de Courbet s’achevait dans le four de la Commune de Paris, celle des
impressionnistes allait s’imposer au cours de la décennie qui suivrait :  «Dans leur effort pour atteindre ce but et
trouver une expression plus fidèle à la première impression que donne
l’apparence des choses, les impressionnistes avaient créé un style nouveau.
S’étant complètement dégagés des principes traditionnels, ils avaient élaboré
ce style de manière à pouvoir suivre en toute liberté la voie des découvertes
que leur suggérait leur sensibilité intense. En agissant de cette manière, ils
renonçaient à toute prétention de recréer la réalité. Rejetant l’objectivité du
réalisme, ils avaient choisi un seul élément de la réalité - la lumière - pour
interpréter la nature tout entière. Ce nouveau point de vue avait petit à petit
amené les peintres à établir une nouvelle palette et à inventer une nouvelle
technique, adaptés à leurs efforts, pour capter le jeu fluide de la lumière.
L’observation attentive de la lumière les avait conduits à supprimer les ombres
noires traditionnelles et à adopter des couleurs claires. Elle les avait
conduits également à subordonner la notion abstraite de couleur locale à
l’effet atmosphérique
«Dans leur effort pour atteindre ce but et
trouver une expression plus fidèle à la première impression que donne
l’apparence des choses, les impressionnistes avaient créé un style nouveau.
S’étant complètement dégagés des principes traditionnels, ils avaient élaboré
ce style de manière à pouvoir suivre en toute liberté la voie des découvertes
que leur suggérait leur sensibilité intense. En agissant de cette manière, ils
renonçaient à toute prétention de recréer la réalité. Rejetant l’objectivité du
réalisme, ils avaient choisi un seul élément de la réalité - la lumière - pour
interpréter la nature tout entière. Ce nouveau point de vue avait petit à petit
amené les peintres à établir une nouvelle palette et à inventer une nouvelle
technique, adaptés à leurs efforts, pour capter le jeu fluide de la lumière.
L’observation attentive de la lumière les avait conduits à supprimer les ombres
noires traditionnelles et à adopter des couleurs claires. Elle les avait
conduits également à subordonner la notion abstraite de couleur locale à
l’effet atmosphérique  général. En appliquant la couleur en touches
perceptibles, ils avaient réussi à adoucir les contours des objets et à les
fondre avec leur entourage. Cette technique leur avait, de plus, permis
d’introduire une couleur dans la zone d’une autre sans la dégrader ni la
perdre, diversifiant ainsi les coloris. Mais surtout, la multitude de touches
apparentes et leurs contrastes avaient contribué à exprimer ou à suggérer
l’activité, la vibration de la lumière et à les recréer, dans une certaine
mesure, sur la toile. D’autre part, cette exécution par petites touches vives
semblait convenir le mieux à leurs efforts pour saisir des aspects rapidement
changeants. Puisque la main est plus lente que l’œil - prompt à percevoir les
effets instantanés - une technique permettait aux peintres un travail rapide
était essentielle pour qu’ils puissent traduire leurs perceptions sans trop de
retard. Faisant allusion à ces problèmes, Renoir avait coutume de dire : “En
plein air on triche tout le temps”. Cependant la “tricherie” consistait
simplement à faire un choix parmi la multitude d’aspects qu’offrait la nature,
afin de transposer les miracles de la lumière en un langage de couleurs et à
deux dimensions, et aussi à rendre l’aspect choisi avec les tons et l’exécution
qui se rapprochaient le plus de l’impression reçue».
Si Renoir, en 1883, pouvait remarquer une certaine saturation de
l’impressionnisme, les expériences se poursuivaient et allaient finir par
varier complètement le regard des premiers peintres de la tendance. Le
post-impressionnisme triompherait, à travers différentes approches, au cours
des deux décennies qui séparent la fin du siècle.
général. En appliquant la couleur en touches
perceptibles, ils avaient réussi à adoucir les contours des objets et à les
fondre avec leur entourage. Cette technique leur avait, de plus, permis
d’introduire une couleur dans la zone d’une autre sans la dégrader ni la
perdre, diversifiant ainsi les coloris. Mais surtout, la multitude de touches
apparentes et leurs contrastes avaient contribué à exprimer ou à suggérer
l’activité, la vibration de la lumière et à les recréer, dans une certaine
mesure, sur la toile. D’autre part, cette exécution par petites touches vives
semblait convenir le mieux à leurs efforts pour saisir des aspects rapidement
changeants. Puisque la main est plus lente que l’œil - prompt à percevoir les
effets instantanés - une technique permettait aux peintres un travail rapide
était essentielle pour qu’ils puissent traduire leurs perceptions sans trop de
retard. Faisant allusion à ces problèmes, Renoir avait coutume de dire : “En
plein air on triche tout le temps”. Cependant la “tricherie” consistait
simplement à faire un choix parmi la multitude d’aspects qu’offrait la nature,
afin de transposer les miracles de la lumière en un langage de couleurs et à
deux dimensions, et aussi à rendre l’aspect choisi avec les tons et l’exécution
qui se rapprochaient le plus de l’impression reçue».
Si Renoir, en 1883, pouvait remarquer une certaine saturation de
l’impressionnisme, les expériences se poursuivaient et allaient finir par
varier complètement le regard des premiers peintres de la tendance. Le
post-impressionnisme triompherait, à travers différentes approches, au cours
des deux décennies qui séparent la fin du siècle.
 |
| Auguste Renoir. Femmes dans un jardin. |
 |
| Eugène Boudin. L'impératrice Eugénie sur la plage à Trouville, |
Sur la quantité de peintres que l’on rattache à
la peinture impressionniste, certains atteignirent sans doute leur maturité
plus rapidement que d’autres. Par contre, d’autres s’essayèrent à élargir le
champ des possibilités offert par la nouvelle approche qui substituait à la
clarté de la ligne l’impression fournie par la lumière. Héritiers de la méthode
expérimentale de Claude Bernard, tout comme les réalistes, les
impressionnistes, en déplaçant du cerveau à l’œil le centre d’élaboration de
l’art peint apportèrent une  innovation qui satisfaisait au scientisme issu du
positivisme. On ne saurait trouver tendance artistique plus voué à la
reproduction du réel puisque de l’objet observé, on passait à la méthode
d’observation. Il y a une épistémologie à l’origine du travail des
impressionnistes. L’un des premiers peintres à prendre son matériel et à sortir
à l’extérieur de son atelier s’appelait Eugène Boudin (1824-1898). Comme il
était originaire du Calvados et vivait à proximité de l’océan, sa nature était
essentiellement maritime. Comme élève, il avait le jeune Claude Monet
(1840-1926) : «Au lieu de brosser de
jolis tableaux de genre, il s’était mis à faire des études en plein air. Tout
ce qu’il rapporta de Paris était la conviction que : “les romantiques ont fait
leur temps. Il faut désormais chercher les simples beautés de la nature, la
nature bien vue dans toute sa variété, sa fraîcheur.” Cette conviction, Boudin
souhaitait à présent la communiquer à son jeune élève, et Monet la partagea
bientôt, car non seulement il regardait travailler Boudin, mais il profitait
encore de sa conversation. Boudin avait à la fois un œil sensible et un esprit
clair. Il savait exprimer ses observations et son expérience en paroles
simples. “Tout ce qui est peint directement et sur place, disait-il, par
exemple, a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu’on ne
retrouve plus dans l’atelier.” Il spécifiait qu’il fait “montrer un entêtement
extrême à rester dans l’impression primitive, qui est la bonne”, en insistant
sur le fait que “ce n’est pas un morceau qui doit frapper dans un tableau, mais
bien l’ensemble”».
Boudin situait le travail cérébral du peintre dans la mémoire, entre
l’impression laissée par le déjà vu dont
le travail devait conduire à la création artistique comme un inédit. Personne n’avait vu ce que seul
le peintre avait pu voir sur la plage en peignant les reflets de la mer et les
nuages poussés par le vent.
innovation qui satisfaisait au scientisme issu du
positivisme. On ne saurait trouver tendance artistique plus voué à la
reproduction du réel puisque de l’objet observé, on passait à la méthode
d’observation. Il y a une épistémologie à l’origine du travail des
impressionnistes. L’un des premiers peintres à prendre son matériel et à sortir
à l’extérieur de son atelier s’appelait Eugène Boudin (1824-1898). Comme il
était originaire du Calvados et vivait à proximité de l’océan, sa nature était
essentiellement maritime. Comme élève, il avait le jeune Claude Monet
(1840-1926) : «Au lieu de brosser de
jolis tableaux de genre, il s’était mis à faire des études en plein air. Tout
ce qu’il rapporta de Paris était la conviction que : “les romantiques ont fait
leur temps. Il faut désormais chercher les simples beautés de la nature, la
nature bien vue dans toute sa variété, sa fraîcheur.” Cette conviction, Boudin
souhaitait à présent la communiquer à son jeune élève, et Monet la partagea
bientôt, car non seulement il regardait travailler Boudin, mais il profitait
encore de sa conversation. Boudin avait à la fois un œil sensible et un esprit
clair. Il savait exprimer ses observations et son expérience en paroles
simples. “Tout ce qui est peint directement et sur place, disait-il, par
exemple, a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu’on ne
retrouve plus dans l’atelier.” Il spécifiait qu’il fait “montrer un entêtement
extrême à rester dans l’impression primitive, qui est la bonne”, en insistant
sur le fait que “ce n’est pas un morceau qui doit frapper dans un tableau, mais
bien l’ensemble”».
Boudin situait le travail cérébral du peintre dans la mémoire, entre
l’impression laissée par le déjà vu dont
le travail devait conduire à la création artistique comme un inédit. Personne n’avait vu ce que seul
le peintre avait pu voir sur la plage en peignant les reflets de la mer et les
nuages poussés par le vent.
 |
| Eugène Boudin. Effets du soir à Honfleur, 1824. |
 |
| Camille Pissarro. Briqueterie. |
Pour être en mesure de réaliser une telle
entreprise, il fallait une gamme de colorations beaucoup plus vaste. En 1876,
le romancier et critique d’art Louis Edmond Duranty (1833-1880) l’expliquait
dans son essai, La nouvelle peinture, dont nous avons déjà parlé, qui
se présentait comme une défrense des impressionnistes : «Dans
la coloration ils ont fait une véritable découverte, dont l’origine ne peut se
trouver ailleurs… La découverte consiste proprement à avoir reconnu que la
grande lumière décolore les tons, que le  soleil reflété par les objets tend, à
force de clarté, à les ramener à cette unité lumineuse qui fond ses sept rayons
prismatiques en un seul éclat incolore, qui est la lumière. D’intuition en
intuition, ils en sont arrivés peu à peu à décomposer la lueur solaire en ses rayons,
en ses éléments, et à recomposer son unité par l’harmonie générale des
irisations qu’ils répandent sur leurs toiles. Au point de vue de la délicatesse
de l’œil, de la subtile pénétration du coloris, c’est un résultat tout à fait
extraordinaire. Le plus savant physicien ne pourrait rien reprocher à leurs
analyses de la lumière».
Des découvertes du chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) (mort à 102
ans!), dont la loi du contraste simultané
des couleurs énoncée dans un lourd mémoire de 750 pages en 1839 et qui
affirme qu’une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance
complémentaire dans le ton, les complémentaires s’éclairent mutuellement et les
couleurs non complémentaires paraissent sales comme
soleil reflété par les objets tend, à
force de clarté, à les ramener à cette unité lumineuse qui fond ses sept rayons
prismatiques en un seul éclat incolore, qui est la lumière. D’intuition en
intuition, ils en sont arrivés peu à peu à décomposer la lueur solaire en ses rayons,
en ses éléments, et à recomposer son unité par l’harmonie générale des
irisations qu’ils répandent sur leurs toiles. Au point de vue de la délicatesse
de l’œil, de la subtile pénétration du coloris, c’est un résultat tout à fait
extraordinaire. Le plus savant physicien ne pourrait rien reprocher à leurs
analyses de la lumière».
Des découvertes du chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) (mort à 102
ans!), dont la loi du contraste simultané
des couleurs énoncée dans un lourd mémoire de 750 pages en 1839 et qui
affirme qu’une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance
complémentaire dans le ton, les complémentaires s’éclairent mutuellement et les
couleurs non complémentaires paraissent sales comme  lorsqu’un jaune placé près
d’un vert prend une nuance violette. Delacroix la connaissait, probablement,
mais ce furent les impressionnistes qui s’appliquèrent à l’élaborer dans leurs
toiles. En tant que chimiste, Chevreul travaillait pour l’industrie teinturière
qui cherchait à améliorer les tons de leurs produits. En important cette loi
dans le monde de la peinture, l’impressionnisme opéra selon les principes
épistémologiques de l’expérimentation. «La
qualité la plus évidente des impressionnistes, celle qui leur a été le plus
rapidement reconnue, c’est d’avoir fait usage d’une gamme de couleurs plus
claire que tous les autres peintres depuis le XVIe siècle. Cela provient de la
séparation des couleurs; la fusion optique de deux lumières
lorsqu’un jaune placé près
d’un vert prend une nuance violette. Delacroix la connaissait, probablement,
mais ce furent les impressionnistes qui s’appliquèrent à l’élaborer dans leurs
toiles. En tant que chimiste, Chevreul travaillait pour l’industrie teinturière
qui cherchait à améliorer les tons de leurs produits. En important cette loi
dans le monde de la peinture, l’impressionnisme opéra selon les principes
épistémologiques de l’expérimentation. «La
qualité la plus évidente des impressionnistes, celle qui leur a été le plus
rapidement reconnue, c’est d’avoir fait usage d’une gamme de couleurs plus
claire que tous les autres peintres depuis le XVIe siècle. Cela provient de la
séparation des couleurs; la fusion optique de deux lumières  distinctes sur la
toile étant beaucoup plus brillante que le mélange de deux teintes sur cette
toile. Si on mélange deux teintes, du bleu et du jaune, on obtient un vert
grisâtre moins intense que le bleu et le jaune primitifs. Mais si on juxtapose
le bleu et le jaune sur la toile, à une certaine distance, l’œil voit le vert
qui en résulte beaucoup plus intense que celui qui provient du mélange des deux
teintes. Les impressionnistes n’ont jamais fait un emploi systématique de cette
fusion de lumières, mais ils n’en ont pas moins atteint un effet clair et
intense par la subtilité de leur sensibilité chromatique, la plus fine que l’on
trouve dans toute l’histoire de l’art».
Du contrapposto de l’âge baroque qui
expérimentait sur les contrastes entre l’obscurité et la lumière, les
impressionnistes expérimentaient désormais sur les contrastes entre les
différentes couleurs, primaires et complémentaires. Observer la nature et en
chercher une transposition fidèle des contrastes lumineux à la manière des
peintres hollandais du XVIIe siècle, mais en insistant davantage sur les perceptions
chromatiques plutôt que la composition théâtrale
en atelier fut leur apport incontestable.
distinctes sur la
toile étant beaucoup plus brillante que le mélange de deux teintes sur cette
toile. Si on mélange deux teintes, du bleu et du jaune, on obtient un vert
grisâtre moins intense que le bleu et le jaune primitifs. Mais si on juxtapose
le bleu et le jaune sur la toile, à une certaine distance, l’œil voit le vert
qui en résulte beaucoup plus intense que celui qui provient du mélange des deux
teintes. Les impressionnistes n’ont jamais fait un emploi systématique de cette
fusion de lumières, mais ils n’en ont pas moins atteint un effet clair et
intense par la subtilité de leur sensibilité chromatique, la plus fine que l’on
trouve dans toute l’histoire de l’art».
Du contrapposto de l’âge baroque qui
expérimentait sur les contrastes entre l’obscurité et la lumière, les
impressionnistes expérimentaient désormais sur les contrastes entre les
différentes couleurs, primaires et complémentaires. Observer la nature et en
chercher une transposition fidèle des contrastes lumineux à la manière des
peintres hollandais du XVIIe siècle, mais en insistant davantage sur les perceptions
chromatiques plutôt que la composition théâtrale
en atelier fut leur apport incontestable.
 |
| Claude Monet. Voilier à Argenteuil 1875 |
L'un des tableaux qui attire le regard des historiens de l'art est le fameux Voilier à Argenteuil de
Monet qui apparaît comme une véritable application expérimentale de la loi de
Chevreul : «Dans l’original, le toit
violet d’une maison orange se reflète dans l’eau : le reflet se compose de
zones vibrantes d’un jaune qui représente la lumière, et d’un violet qui
représente l’ombre, avec le résultat d’accentuer la vibration du reflet. Mais
la forme du toit est perdue; ce qui reste, c’est la forme d’une vibration. Il
faut se rendre compte que le peintre avait le devoir de renoncer à la forme du
toit; autrement, il eût arrêté la vibration, et, la vibration cessant, le but
du peintre eût été manqué. En effet, les peintres qui, en assimilant la
vibration impressionniste de la lumière lui ont ajouté un dessin et un
clair-obscur traditionnels, ont perdu à la fois la forme et la couleur. C’est
pourquoi aussi la séparation des couleurs est à la base des “déformations”
typiques de l’art moderne qui ont été adoptées par beaucoup de peintres ne
pratiquant pourtant pas la séparation des couleurs. Mais les impressionnistes
 ont été les premiers à sentir la nécessité de déformer pour trouver la forme
des couleurs séparées - ce qui était plus facile à faire dans un ciel, un
fleuve, une barque, que dans un personnage humain. C’est une des raisons pour
lesquelles l’impressionnisme naquit dans la peinture de paysage, et ne fut
appliqué que plus tard à la figure humaine». Nous pouvons observer par cette œuvre que «la lumière est l’élément qui révèle l’apparence de la réalité, et ce
que les impressionnistes ont peint, précisément, ce n’est pas la réalité, mais
l’apparence. Ils concentrèrent leur attention sur l’apparence avec une
conscience plus nette que les peintres précédents. Or saisir l’apparence est
une forme de la sensation, aussi libre que possible à l’égard de la
connaissance et de la volonté. Cela revient à dire que les impressionnistes
restèrent fidèles à leurs sensations, à leurs impressions sur la nature, et
qu’ils trouvèrent une forme plus proche que toutes celles qu’on avait trouvées
avant eux de la première impression et de l’apparence. Elle était plus proche à
cause de la vive sensibilité de ces peintres, et de la conscience qu’ils
avaient de la valeur absolue en art de l’apparence des choses. Au lieu de
sous-estimer leurs impressions, ils gardèrent leur liberté à l’égard des
principes traditionnels de la forme abstraite». C'est ainsi qu'en poursuivant la veine réaliste/naturaliste, l'impressionnisme finit par la briser pour reconnaître que la seule réalité qui nous saute aux yeux n'est qu'une apparence. Que la réalité est ancrée plus profondément et que nous n'en percevons que la surface trouble. On ne retrouvera donc pas de métaphysique dans les tableaux impressionnistes et lorsque certains de leurs peintres se laisseront tenter par l'idéologie, ce sera pour célébrer des fêtes patriotiques, comme chez Monet encore, avec les célébrations de l'Exposition universelle de Paris, le 30 juin 1878. Mais
ont été les premiers à sentir la nécessité de déformer pour trouver la forme
des couleurs séparées - ce qui était plus facile à faire dans un ciel, un
fleuve, une barque, que dans un personnage humain. C’est une des raisons pour
lesquelles l’impressionnisme naquit dans la peinture de paysage, et ne fut
appliqué que plus tard à la figure humaine». Nous pouvons observer par cette œuvre que «la lumière est l’élément qui révèle l’apparence de la réalité, et ce
que les impressionnistes ont peint, précisément, ce n’est pas la réalité, mais
l’apparence. Ils concentrèrent leur attention sur l’apparence avec une
conscience plus nette que les peintres précédents. Or saisir l’apparence est
une forme de la sensation, aussi libre que possible à l’égard de la
connaissance et de la volonté. Cela revient à dire que les impressionnistes
restèrent fidèles à leurs sensations, à leurs impressions sur la nature, et
qu’ils trouvèrent une forme plus proche que toutes celles qu’on avait trouvées
avant eux de la première impression et de l’apparence. Elle était plus proche à
cause de la vive sensibilité de ces peintres, et de la conscience qu’ils
avaient de la valeur absolue en art de l’apparence des choses. Au lieu de
sous-estimer leurs impressions, ils gardèrent leur liberté à l’égard des
principes traditionnels de la forme abstraite». C'est ainsi qu'en poursuivant la veine réaliste/naturaliste, l'impressionnisme finit par la briser pour reconnaître que la seule réalité qui nous saute aux yeux n'est qu'une apparence. Que la réalité est ancrée plus profondément et que nous n'en percevons que la surface trouble. On ne retrouvera donc pas de métaphysique dans les tableaux impressionnistes et lorsque certains de leurs peintres se laisseront tenter par l'idéologie, ce sera pour célébrer des fêtes patriotiques, comme chez Monet encore, avec les célébrations de l'Exposition universelle de Paris, le 30 juin 1878. Mais  à travers le Voilier à Argenteuil, nous découvrons la bacchanale qui se dégage de l'esprit impressionniste. Finis les mystères macabres des symbolistes. «Le
ciel et l’eau sont dominés par le coucher du soleil avec des tons orange,
jaunes et violets vibrant dans l’enthousiasme païen pour une fête orgiaque et
cependant équilibrés par les verts et par les bleus. Le voilier, à peine en
dehors du centre de la toile, peint d’un vert terne et presque neutre, est,
pour la lumière, une espèce de limite, tandis qu’au ciel, le soleil, en son
dernier salut de chaque jour, répand tout son trésor de pierreries et le
réfléchi dans l’eau. Le voilier, par son opacité, suggère la venue du soir, le
calme après la fête. L’excitation créatrice de Monet est visible dans les
couleurs séparées et dans la clarté de la palette, aussi bien que dans les
coups de pinceau furieux. Il semble plongé dans le mouvement des couleurs et
dans la vibration de la lumière; il est en proie, devant la nature, à un
émerveillement. Et pourtant au milieu d’une telle profusion de richesse, il
n’est pas joyeux; il sent la fin proche et c’est ce sentiment de mélancolie diffuse que donnent l’harmonie des couleurs et l’humanité de la nature».
à travers le Voilier à Argenteuil, nous découvrons la bacchanale qui se dégage de l'esprit impressionniste. Finis les mystères macabres des symbolistes. «Le
ciel et l’eau sont dominés par le coucher du soleil avec des tons orange,
jaunes et violets vibrant dans l’enthousiasme païen pour une fête orgiaque et
cependant équilibrés par les verts et par les bleus. Le voilier, à peine en
dehors du centre de la toile, peint d’un vert terne et presque neutre, est,
pour la lumière, une espèce de limite, tandis qu’au ciel, le soleil, en son
dernier salut de chaque jour, répand tout son trésor de pierreries et le
réfléchi dans l’eau. Le voilier, par son opacité, suggère la venue du soir, le
calme après la fête. L’excitation créatrice de Monet est visible dans les
couleurs séparées et dans la clarté de la palette, aussi bien que dans les
coups de pinceau furieux. Il semble plongé dans le mouvement des couleurs et
dans la vibration de la lumière; il est en proie, devant la nature, à un
émerveillement. Et pourtant au milieu d’une telle profusion de richesse, il
n’est pas joyeux; il sent la fin proche et c’est ce sentiment de mélancolie diffuse que donnent l’harmonie des couleurs et l’humanité de la nature».
 |
| Claude Monet. La Gare Saint-Lazare à Paris,1877. |
Si l’essentiel des grandes œuvres
impressionnistes ont été peintes en prenant la nature vierge comme modèle,
certains peintres ramenèrent la technique dans la description de la nouvelle et
trépidante vie urbaine. Monet, encore lui, fit fait ce saut, en 1877, en
peignant La Gare Saint-Lazare de
Paris : «L’immense enceinte avec sa
verrière contre laquelle les grosses locomotives crachaient leur fumée opaque,
les départs et les arrivées des trains, la foule et le contraste saisissant
entre le ciel limpide dans le fond et les sombres  machines fumantes, tout cela
offrait des sujets nouveaux et passionnants; sans se lasser, Monet installait son
chevalet dans différents coins de la gare. Comme Degas aimait à le faire, il
étudiait le même motif sous des aspects multiples, saisissant avec vigueur et
subtilité à la fois le caractère spécifique du lieu et son atmosphère propre.
Duranty aurait pu reconnaître dans ces études la conquête d’une des scènes les
plus caractéristiques de la vie contemporaine, si le point de vue de Monet
n’avait pas été dépourvu de toute préoccupation sociale. Il voyait dans cette
gare de chemin de fer un prétexte plutôt qu’un but en soi; il découvrait et
fouillait tous les aspects picturaux du machinisme, mais ne faisait aucun
commentaire sur sa laideur, son utilité ou sa beauté, ni sur ses rapports avec
l’homme».
Camille Pissarro (1830-1903) également
machines fumantes, tout cela
offrait des sujets nouveaux et passionnants; sans se lasser, Monet installait son
chevalet dans différents coins de la gare. Comme Degas aimait à le faire, il
étudiait le même motif sous des aspects multiples, saisissant avec vigueur et
subtilité à la fois le caractère spécifique du lieu et son atmosphère propre.
Duranty aurait pu reconnaître dans ces études la conquête d’une des scènes les
plus caractéristiques de la vie contemporaine, si le point de vue de Monet
n’avait pas été dépourvu de toute préoccupation sociale. Il voyait dans cette
gare de chemin de fer un prétexte plutôt qu’un but en soi; il découvrait et
fouillait tous les aspects picturaux du machinisme, mais ne faisait aucun
commentaire sur sa laideur, son utilité ou sa beauté, ni sur ses rapports avec
l’homme».
Camille Pissarro (1830-1903) également  délaissera quelquefois la nature pour
décrire des paysages urbains : la Seine et ses bateaux, les rues bondées
par les omnibus et les calèches, les passants sur un pavé mouillé, des scènes
de nuit éclairées au gaz. Au moment où Renoir considérait que le genre
s’installait de manière trop classique, les impressionnistes poussèrent plus
loin dans l’inventivité en travaillant sur les compositions atmosphériques : «Chez Louis Anquetin, nous trouvons une autre
recherche de la forme fermée. En 1887, il expose sa méthode pour trouver une
synthèse coloristique. Elle consiste à regarder un paysage à travers des
plaques de verre de différentes couleurs. Cette idée est née d’un événement
tout particulier. Dans la maison de son enfance, il y avait une véranda avec
une porte aux vitres polychromes jaunes, vertes, rouges et bleues, comme il
était de bon ton dans les maisons bourgeoises des années 70 et 80. En regardant
le paysage à travers ces vitres, le gamin de seize ans remarqua que
l’atmosphère changeait selon la couleur de la vitre. Que ce soit le matin ou le
soir, ces vitres avaient un effet particulier: le vert donnait une impression
de fraîcheur matinale, le bleu l’illusion d’un clair de lune, le rouge
l’effervescence d’un coucher de soleil et le jaune la
délaissera quelquefois la nature pour
décrire des paysages urbains : la Seine et ses bateaux, les rues bondées
par les omnibus et les calèches, les passants sur un pavé mouillé, des scènes
de nuit éclairées au gaz. Au moment où Renoir considérait que le genre
s’installait de manière trop classique, les impressionnistes poussèrent plus
loin dans l’inventivité en travaillant sur les compositions atmosphériques : «Chez Louis Anquetin, nous trouvons une autre
recherche de la forme fermée. En 1887, il expose sa méthode pour trouver une
synthèse coloristique. Elle consiste à regarder un paysage à travers des
plaques de verre de différentes couleurs. Cette idée est née d’un événement
tout particulier. Dans la maison de son enfance, il y avait une véranda avec
une porte aux vitres polychromes jaunes, vertes, rouges et bleues, comme il
était de bon ton dans les maisons bourgeoises des années 70 et 80. En regardant
le paysage à travers ces vitres, le gamin de seize ans remarqua que
l’atmosphère changeait selon la couleur de la vitre. Que ce soit le matin ou le
soir, ces vitres avaient un effet particulier: le vert donnait une impression
de fraîcheur matinale, le bleu l’illusion d’un clair de lune, le rouge
l’effervescence d’un coucher de soleil et le jaune la  chaleur du plein midi. Ce
système lui donne non seulement la clef d’une simplification coloristique, mais
aussi la possibilité de traduire les valeurs essentielles d’une atmosphère. Ce
principe - un monochromisme émotionnel - eut une grande importance, entre
autres pour van Gogh qui en est enthousiasmé. Anquetin représente à sa manière
la même aspiration vers l’abstraction et la simplification, et sa palette
montre aussi qu’il cherche à délimiter la surface, à créer un effet de synthèse».
Il fallait non plus seulement ramener la nature telle que l’œil la percevait,
ce qui restera le propre des impressionnistes, mais il fallait désormais
travailler sur l’atmosphère qui se dégage des ondes que nous percevons, et non
seulement la luminosité ou la couleur, mais aussi la moiteur, la froidure, la
sécheresse, et toutes les atmosphères dans lesquelles les relations humaines
peuvent baigner. Ce sera-là l’essentiel des néo-impressionnistes et des
pointillistes qui pousseront le genre jusqu’à sa folie mégalomane avec Seurat
et son Un dimanche après-mdi à l’île de
la Grande Jatte peint entre 1884 et 1886. Après avoir «étudié les traités scientifiques de Chevreul, dont les théories sur
l’harmonie des couleurs avaient déjà intéressé Delacroix. C’est ainsi que
Seurat avait été amené à l’idée de réconcilier l’art avec la science,
conception bien en accord avec les courants idéologiques de l’époque qui
cherchaient à substituer la connaissance à l’intuition.
chaleur du plein midi. Ce
système lui donne non seulement la clef d’une simplification coloristique, mais
aussi la possibilité de traduire les valeurs essentielles d’une atmosphère. Ce
principe - un monochromisme émotionnel - eut une grande importance, entre
autres pour van Gogh qui en est enthousiasmé. Anquetin représente à sa manière
la même aspiration vers l’abstraction et la simplification, et sa palette
montre aussi qu’il cherche à délimiter la surface, à créer un effet de synthèse».
Il fallait non plus seulement ramener la nature telle que l’œil la percevait,
ce qui restera le propre des impressionnistes, mais il fallait désormais
travailler sur l’atmosphère qui se dégage des ondes que nous percevons, et non
seulement la luminosité ou la couleur, mais aussi la moiteur, la froidure, la
sécheresse, et toutes les atmosphères dans lesquelles les relations humaines
peuvent baigner. Ce sera-là l’essentiel des néo-impressionnistes et des
pointillistes qui pousseront le genre jusqu’à sa folie mégalomane avec Seurat
et son Un dimanche après-mdi à l’île de
la Grande Jatte peint entre 1884 et 1886. Après avoir «étudié les traités scientifiques de Chevreul, dont les théories sur
l’harmonie des couleurs avaient déjà intéressé Delacroix. C’est ainsi que
Seurat avait été amené à l’idée de réconcilier l’art avec la science,
conception bien en accord avec les courants idéologiques de l’époque qui
cherchaient à substituer la connaissance à l’intuition.  Mettant à profit les
découvertes de Chevreul et d’autres savants, Seurat réduisit sa palette aux quatre couleurs fondamentales du cercle de Chevreul avec leurs tons intermédiaires :
bleu, bleu-violet, violet, violet-rouge,
rouge, rouge-orangé, orangé,
orangé-jaune, jaune, jaune-vert, vert,
vert-bleu et bleu de nouveau. Il mélangeait ces tons avec du blanc, mais pour
s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur et de l’harmonie,
il ne mélangeait jamais ces teintes entre elles. Pour remplacer le mélange des
pigments, il employait des petites taches de couleur pure, juxtaposées ou
entre-mêlées de telle manière que le mélange se faisait optiquement,
c’est-à-dire dans l’œil du spectateur. Il donna à ce procédé le nom de
divisionnisme. Il remplaça le “désordre” des coups de pinceau impressionnistes
par une exécution méticuleuse, faite de taches soigneusement posées, qui
donnait à ses œuvres une certaine austérité, une atmosphère de calme et de
stabilité. Abandonnant l’expression spontanée des sensations, prônée par les
impressionnistes, et ne laissant rien au hasard, il trouva dans l’observation stricte
des lois de l’optique une discipline et le moyen de réalisations nouvelles».
Entre l’atmosphère chaude et moite des tableaux de Van Gogh et les tableaux
quasi psychédéliques, froids et secs de Seurat, il semblait que la tendance
impressionniste atteignait les limites de ses possibilités, mais du pointillisme nous reparlerons.
Mettant à profit les
découvertes de Chevreul et d’autres savants, Seurat réduisit sa palette aux quatre couleurs fondamentales du cercle de Chevreul avec leurs tons intermédiaires :
bleu, bleu-violet, violet, violet-rouge,
rouge, rouge-orangé, orangé,
orangé-jaune, jaune, jaune-vert, vert,
vert-bleu et bleu de nouveau. Il mélangeait ces tons avec du blanc, mais pour
s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur et de l’harmonie,
il ne mélangeait jamais ces teintes entre elles. Pour remplacer le mélange des
pigments, il employait des petites taches de couleur pure, juxtaposées ou
entre-mêlées de telle manière que le mélange se faisait optiquement,
c’est-à-dire dans l’œil du spectateur. Il donna à ce procédé le nom de
divisionnisme. Il remplaça le “désordre” des coups de pinceau impressionnistes
par une exécution méticuleuse, faite de taches soigneusement posées, qui
donnait à ses œuvres une certaine austérité, une atmosphère de calme et de
stabilité. Abandonnant l’expression spontanée des sensations, prônée par les
impressionnistes, et ne laissant rien au hasard, il trouva dans l’observation stricte
des lois de l’optique une discipline et le moyen de réalisations nouvelles».
Entre l’atmosphère chaude et moite des tableaux de Van Gogh et les tableaux
quasi psychédéliques, froids et secs de Seurat, il semblait que la tendance
impressionniste atteignait les limites de ses possibilités, mais du pointillisme nous reparlerons.
 |
| Georges Seurat. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, 1884-1886 |
 |
| Jean Béraud. Boulevard des Capucines, 1889 |
Si l’innovation apportée par les
impressionnistes occupa une partie des historiens de l’art, une autre
découvrait dans leur composition des relents d’une continuité avec l’art
occidental. C’est le cas de Pierre Francastel dont on a vu le besoin de
démythifier l’impressionnisme. Pour lui, les questions posées – et répondues –
par les impressionnistes ne sortent pas des questions posées depuis la
naissance du cadre figuratif du temps d’Alberti, par exemple : «On a parlé de frémissement de l’air, de
souffles impalpables qui courent dans l’atmosphère. C’est l’aspect lyrique, en
un mot, qui a été d’abord saisi par les spectateurs de bonne volonté. […] Le vrai problème consiste à savoir quelle
influence réelle l’enregistrement des sensations lumineuses a eu sur le mode de
représentation de l’espace. On serait tenté, à certains moments, de la réduire
presque à rien. au fond, en effet, si l’on y regarde de près, on s’aperçoit
vite que le schéma de composition de la  plupart des toiles impressionnistes est
strictement analogue à celui d’une toile classique. […] Les points d’appui de la composition s’estompent sous le semis des
touches colorées qui reproduisent le tremblement de la lumière, mais ramené à
ses lignes générales, le tableau suggère toujours le fameux espace cubique de
la Renaissance et l’on regarde toujours à travers la fameuse fenêtre ouverte
d’Alberti».
Francastel tient à démentir une position qui donnerait aux impressionnistes le
fait d’avoir été les premiers à défaire le cadre du lieu visuel de l’art
occidental. D’une modernité l’autre, la seconde marquerait la fin de la
première instaurée à l’époque de la Renaissance. Comme les préraphélites
voulurent revenir à l’ère antérieure à la Renaissance, les impressionnistes
auraient réussi à faire un bond en avant, vers l’art contemporain qui leur
serait tributaire aujourd’hui. Moins qu’une
plupart des toiles impressionnistes est
strictement analogue à celui d’une toile classique. […] Les points d’appui de la composition s’estompent sous le semis des
touches colorées qui reproduisent le tremblement de la lumière, mais ramené à
ses lignes générales, le tableau suggère toujours le fameux espace cubique de
la Renaissance et l’on regarde toujours à travers la fameuse fenêtre ouverte
d’Alberti».
Francastel tient à démentir une position qui donnerait aux impressionnistes le
fait d’avoir été les premiers à défaire le cadre du lieu visuel de l’art
occidental. D’une modernité l’autre, la seconde marquerait la fin de la
première instaurée à l’époque de la Renaissance. Comme les préraphélites
voulurent revenir à l’ère antérieure à la Renaissance, les impressionnistes
auraient réussi à faire un bond en avant, vers l’art contemporain qui leur
serait tributaire aujourd’hui. Moins qu’une  rupture, l’impressionnisme, selon
Francastel, n’en serait qu’une continuité historique : «Le procédé qui consiste à mettre en place
les lignes générales du sujet conformément aux formules traditionnelles
élaborées par la Renaissance, a donné naissance à un très grand nombre de
toiles impressionnistes et apparemment aux plus belles. Prenez les toiles les
plus floues, les plus suggestives de Monet, les Meules, les Cathédrales, les Ponts de Londres, vous constaterez toujours que
le schéma général de la composition est strictement traditionnel en ce qui
concerne le cadrage et la ségrégation des plans en profondeur. Si l’on devine
les paysages les plus vaporeux de l’impressionnisme, c’est précisément en
fonction de leur respect du système antérieur de figuration de l’espace. J’ai
proposé déjà de désigner ce phénomène du nom de “grille” impressionniste. On
dirait que les toiles ainsi composées sont constituées par la superposition de
deux images qui coïncident par quelques points suivant le procédé des
photographies chromatiques qui superposent avec des caches plusieurs séries
d’enregistrements dans l’absolu respect d’un certain nombre de repères. Le
système de représentation colorée de l’univers vient se superposer ici au
canevas fourni par un petit nombre d’éléments linéaires empruntés à la
figuration renaissante de l’espace».
Est-ce à dire que Francastel ne reconnaît aucun apport de la mouvance
impressionniste?
rupture, l’impressionnisme, selon
Francastel, n’en serait qu’une continuité historique : «Le procédé qui consiste à mettre en place
les lignes générales du sujet conformément aux formules traditionnelles
élaborées par la Renaissance, a donné naissance à un très grand nombre de
toiles impressionnistes et apparemment aux plus belles. Prenez les toiles les
plus floues, les plus suggestives de Monet, les Meules, les Cathédrales, les Ponts de Londres, vous constaterez toujours que
le schéma général de la composition est strictement traditionnel en ce qui
concerne le cadrage et la ségrégation des plans en profondeur. Si l’on devine
les paysages les plus vaporeux de l’impressionnisme, c’est précisément en
fonction de leur respect du système antérieur de figuration de l’espace. J’ai
proposé déjà de désigner ce phénomène du nom de “grille” impressionniste. On
dirait que les toiles ainsi composées sont constituées par la superposition de
deux images qui coïncident par quelques points suivant le procédé des
photographies chromatiques qui superposent avec des caches plusieurs séries
d’enregistrements dans l’absolu respect d’un certain nombre de repères. Le
système de représentation colorée de l’univers vient se superposer ici au
canevas fourni par un petit nombre d’éléments linéaires empruntés à la
figuration renaissante de l’espace».
Est-ce à dire que Francastel ne reconnaît aucun apport de la mouvance
impressionniste?
 |
| Auguste Renoir. Le village d'Essoyes, 1894. |
Absolument pas. Pour lui, «les impressionnistes se sont fait une nouvelle conception de l’espace
autant parce qu’ils ont abandonné les grands sujets et le répertoire matériel
d’accessoires de la Renaissance, que parce qu’ils ont procédé à l’analyse
scientifique des qualités de la lumière. Ils ont brisé simultanément, de ce
fait, les cadres sociaux et les catégories correspondantes de la représentation
théorique du monde».
Mais procéder à l’analyse scientifique de la couleur ou détruire les cadres
sociaux et leurs catégories représentationnelles ne signifient en rien qu’il y
ait une rupture foncière dans la continuité de l’art occidental, car «quelle que soit la nouveauté de
l’impressionnisme, il est de fait que l’on ne peut encore dire qu’il y ait à ce
stade de l’histoire de la peinture destruction absolue de l’espace plastique
traditionnel et de sa représentation. Les hardiesses n’ont qu’un caractère
fragmentaire si l’on considère dans son ensemble l’œuvre de ce premier groupe
d’artistes novateurs de l’école de Paris. Même lorsque des innovations dont
l’avenir a prouvé qu’elles avaient une immense portée sont bien apparentes,
elles se combinent encore avec des systèmes de figuration classiques».
Enfin, il serait malheureux d’accorder aux impressionnistes seuls la
transformation qualitative de la production artistique en cette fin de XIXe
siècle. Comme nous l’avons vu, réalistes et symbolistes ont également travaillé
le spectre des couleurs et ont essayé de modifier les paramètres de l’héritage
de la Renaissance.
 |
| Claude Monet. Locomotive sous la neige, 1875. |
 |
| Claude Monet. Impression. Soleil levant, 1872 (en noir et blanc). |
Nous rappellerons qu’à travers l’analyse de
l’œuvre de Monet, Voilier à Argenteuil, Lionello
Venturi constatait une certaine mélancolie. Il est vrai que les œuvres impressionnistes
tirent de la nature une image équivoque. Contrairement aux symbolistes, où l’eau
fait croître les plantes à travers lesquelles passe le corps noyé d’Ophélie, la
nature impressionniste nous apparaît chaude et lumineuse, mais elle n’est
pas encore cette nature luxuriante et insouciante du douanier Rousseau. Elle
n’évoque ni joies ni mystères. La transparence du regard impressionniste ne suffit pas à dérober le fond psychologique qui s'y dissimule. Margaret Livingstone, professeur de neurobiologie de l'Université Harvard, fait remarquer que la désaturation des couleurs de la toile fondatrice, Impression. Soleil levant (1872), va jusqu'à faire disparaître le soleil levant et son reflet! Ce soleil semble être le point le plus lumineux de la toile, mais la mesure de sa luminance avec un photomètre montre que Monet lui a donné la même luminosité que le ciel qui l'entoure. Elle rappelle aussi que la fovéa de la rétine de l'oeil humain distingue les couleurs alors que la vision périphérique capte les mouvements et les ombres, ce qui explique que lorsque le regard se détourne du soleil, l'intensité lumineuse de ce dernier s'estompe et que la vision périphérique lui donne alors un aspect indécis, comme un lever de soleil. L'exercice suffit à nous faire prendre conscience que derrière les apparences se cachent d'autres apparences et que les enveloppes d'apparences qui enrobent le réel peuvent être nombreuses, à l'image des pelures d'oignons.
 |
| Camille Monet sur son lit de mort, 1879. |
Il est vrai que, dans leur existence, bon nombre d'impressionnistes ont vécu une vie difficile. Le jeune Monet ne vivait pas une vie
particulièrement aisée. Durant l’été 1868, le voilà qu’il se retrouve à la rue,
la peinture impressionniste ne faisant pas encore vivre son artiste : «“Je viens d’être mis à la porte de
l’auberge, et cela nu comme un ver. J’ai casé Camille (son épouse] et mon
pauvre petit Jean, à l’abri pour quelques jours, dans le pays. Je pars ce soir
pour Le Havre, voir à tenter quelque chose auprès de mon amateur. Ma famille ne
veut plus rien faire pour moi. Je ne sais donc encore où je coucherai demain.
Votre ami bien tourmenté - Claude Monet. P.-S. J’étais si bouleversé hier que
j’ai fait la houlette de me jeter à l’eau. Heureusement il n’en est rien
résulté de mal”. L’amateur de Monet - il s’agit probablement de M. Gaudibert -
fut plus sensible à la détresse du peintre que ne le furent ses parents. Il
paraît avoir assuré à Monet une pension qui lui permit une tranquillité provisoire,
et lui redonna du courage pour travailler».
Comme Renoir et cela la même année 1883, il lui arrivera de considérer la veine
impressionniste épuisée : «J’ai de
plus en plus de mal à me satisfaire et j’en arrive à me demander si je deviens
fou ou bien si ce que je fais n’est ni mieux ni plus mal qu’auparavant, mais
simplement que j’ai plus de difficulté aujourd’hui à faire ce que je faisais
jadis facilement».
Il serait douteux que les deux peintres en soient arrivés à la même conclusion
sans en avoir discuter auparavant. L’année suivante, 1884, Degas, à l’abri des
problèmes financiers, ne se voyait pas épargné par une certaine mélancolie dont
ses ballerines supportent souvent l’apparence : «Lui aussi traversait une crise de découragement et se considérait
presque  comme un vieillard, à présent qu’il avait atteint la cinquantaine.
Expliquant cet état d’esprit, il écrivait à un ami : “… On se ferme comme une
porte, et non pas seulement sur ses amis. On supprime tout autour de soi, et
une fois tout seul, on s’annihile, on se tue enfin, par dégoût. J’ai trop fait
de projets; me voici bloqué, impuissant. Et puis j’ai perdu le fil. Je pensais
toujours avoir le temps; ce que je ne faisais, ce qu’on m’empêchait de faire,
au milieu de tous mes ennuis et malgré mon infirmité de vue, je ne désespérais
jamais de m’y mettre un beau jour. - J’entassais tous mes plans dans une
armoire dont je portais toujours la clé sur moi, et j’ai perdu cette clé.
Enfin, je sens que l’état comateux où je suis, je ne pourrai le soulever. Je
m’occuperai, comme disent les gens qui ne font rien, et voilà tout”».
Ce trait mélancolique était peut-être ce qui marquait le plus la continuité
entre les arts précédents et l’impressionnisme.
comme un vieillard, à présent qu’il avait atteint la cinquantaine.
Expliquant cet état d’esprit, il écrivait à un ami : “… On se ferme comme une
porte, et non pas seulement sur ses amis. On supprime tout autour de soi, et
une fois tout seul, on s’annihile, on se tue enfin, par dégoût. J’ai trop fait
de projets; me voici bloqué, impuissant. Et puis j’ai perdu le fil. Je pensais
toujours avoir le temps; ce que je ne faisais, ce qu’on m’empêchait de faire,
au milieu de tous mes ennuis et malgré mon infirmité de vue, je ne désespérais
jamais de m’y mettre un beau jour. - J’entassais tous mes plans dans une
armoire dont je portais toujours la clé sur moi, et j’ai perdu cette clé.
Enfin, je sens que l’état comateux où je suis, je ne pourrai le soulever. Je
m’occuperai, comme disent les gens qui ne font rien, et voilà tout”».
Ce trait mélancolique était peut-être ce qui marquait le plus la continuité
entre les arts précédents et l’impressionnisme.
 |
| Monet. Madame Gaudibert. |
L’impressionnisme était un groupe divisé, divisé
sans doute sur des points artistiques, mais divisé surtout autour de questions
sociales. «Tandis que Manet, Degas et
Bazille étaient tous trois les représentants d’une bourgeoisie cultivée et
riche, la plupart de leurs compagnons [Césanne, Monet, Renoir] étaient issus d’un rang social inférieur».
Il était important pour tous ces artistes de trouver des débouchés économiques,
en de tels cas, passer des ententes avec des propriétaires de galeries.
Durand-Ruel les accueillit avec confiance, mais «chacun, ou presque, connaissait quelques collectionneurs qui lui
achetaient parfois des tableaux; le chanteur Faure et le banquier Hecht
s’intéressaient aux œuvres de Manet; un autre banquier, Arosa, protégeait
Pissarro; et Monet avait son mécène, Gaudibert, au Havre; mais il n’existait
pas encore de véritable marché pour leurs toiles. Il n’y avait pratiquement pas
de marchand pour s’occuper d’eux. […]
Le seul marchand établi qui manifestait alors quelque intérêt pour les œuvres
des jeunes, était le père Martin qui s’occupait de temps en temps des œuvres de
Corot et presque exclusivement de celles de Jongkind. Pissarro avait commencé à
traiter avec lui vers 1868, mais Martin ne payait ses toiles que vingt à
quarante francs,  suivant les dimensions, et les revendait à des prix qui
variaient entre soixante et quatre-vingts francs».
On connaît à quel point Théo, le frère de Vincent Van Gogh, travaillant dans
une galerie, fournissait à son frère tubes et toiles et s’efforçait, en retour,
de vendre de ses œuvres. Comme ils produisaient beaucoup, les peintres
impressionnistes avaient énormément besoin d’argent et lorsqu’enfin le marché
se créa avec l’atténuation des effets de la crise de 1873, il devenait le seul
débouché, vite congestionné, pour ce type d’art, les Salons le boudant obstinément.
Il fallait d’abord faire son nom, ce qui positionnait déjà avantageusement le
groupe. «Manet et Cézanne avaient tous
deux des ressources qui leur permettaient d’attendre. Degas aussi était
indépendant et avait même refusé, en 1869, un contrat proposé par un marchand
belge, Stevens, frère du peintre, contrat qui lui aurait assuré des revenus
annuels de douze mille francs. Mais pour les autres la participation au Salon
n’était pas seulement une question de principe. Ils étaient tous dans l’obligation
de vendre leurs œuvres et devaient sentir que cette interminable lutte avec le
jury les condamnait à l’isolement, en les privant du seul moyen d’exposer.
Après la création artistique elle-même, la chose essentielle était de montrer
les résultats de leurs efforts, d’essayer d’intéresser le public à leurs
intentions, leur labeur incessant et leurs découvertes».
La nécessité d’une union du groupe devait surmonter toutes les crises qui surgissaient
ici et là, l’égo des artistes conduisant à des conflits de personnalités.
suivant les dimensions, et les revendait à des prix qui
variaient entre soixante et quatre-vingts francs».
On connaît à quel point Théo, le frère de Vincent Van Gogh, travaillant dans
une galerie, fournissait à son frère tubes et toiles et s’efforçait, en retour,
de vendre de ses œuvres. Comme ils produisaient beaucoup, les peintres
impressionnistes avaient énormément besoin d’argent et lorsqu’enfin le marché
se créa avec l’atténuation des effets de la crise de 1873, il devenait le seul
débouché, vite congestionné, pour ce type d’art, les Salons le boudant obstinément.
Il fallait d’abord faire son nom, ce qui positionnait déjà avantageusement le
groupe. «Manet et Cézanne avaient tous
deux des ressources qui leur permettaient d’attendre. Degas aussi était
indépendant et avait même refusé, en 1869, un contrat proposé par un marchand
belge, Stevens, frère du peintre, contrat qui lui aurait assuré des revenus
annuels de douze mille francs. Mais pour les autres la participation au Salon
n’était pas seulement une question de principe. Ils étaient tous dans l’obligation
de vendre leurs œuvres et devaient sentir que cette interminable lutte avec le
jury les condamnait à l’isolement, en les privant du seul moyen d’exposer.
Après la création artistique elle-même, la chose essentielle était de montrer
les résultats de leurs efforts, d’essayer d’intéresser le public à leurs
intentions, leur labeur incessant et leurs découvertes».
La nécessité d’une union du groupe devait surmonter toutes les crises qui surgissaient
ici et là, l’égo des artistes conduisant à des conflits de personnalités.
 |
| Édouard Manet. Le déjeuner sur l'herbe, 1863. |
Car les impressionnistes formaient un groupe mal soudé. Socialement mal assorti, le
groupe impressionniste vécu les contre-coups de la fin pathétique du Second
Empire et de la crise économique de 1873. Mais la mouvance était à la mode et
on découvrit dans ce réaliste perfectionniste, Édouard Manet (1832-1883) qui,
en 1860, présentait Le Joueur de guitare espagnol, une nouvelle recrue pour l’impressionnisme : «cette peinture qui faisait s’ouvrir grands
tant d’yeux et tant de bouches de peintres, était signée d’un  nom nouveau :
Manet. Ce musicien espagnol était peint d’une certaine façon étrange, nouvelle,
dont les jeunes peintres étonnés croyaient avoir seuls le secret, peinture qui
tient le milieu entre celle dite réaliste et celle dite romantique…».
Manet délaissa, mais sans complètement l’abandonner, le paysage pour le
portrait. Puisque la photographie rendait désormais l’identique du tableau
obsolète, n’était-il pas audacieux de tirer avantage du procédé chromatique des
impressionnistes pour l’appliquer à la figure humaine? Manet, au départ, est
hors l’école impressionniste parmi lesquels il a des amis, Monet, Renoir et
Berthe Morisot. En 1862, il crée tout un scandale avec Le Déjeuner sur l’herbe où une femme nue entourée de trois hommes
vêtus est qualifié d’obscène tant il ridiculise le genre propre à l’académisme.
Manet exposa l’année d’après son Olympia tout
aussi répréhensible. Mais cela importait peu au peintre puisqu’il était
ambitieux et que le scandale rapporte toujours : «Ce que je veux aujourd’hui, c’est gagner de l’argent», lançait-il
au cours de l’été 1868.
Manet pouvait encore passé pour un peintre réaliste, même si son monde n’était
pas celui de Courbet, mais son réalisme tanguait davantage du côté des
impressionnistes. Il suffit de comparer son Exécution
de Maximilien de 1868 avec ses tableaux du début de la décennie, Le Déjeuner sur l’herbe par exemple,
pour mesurer toute la différence. Puis, ce patriote convaincu s’engagea dans la
guerre franco-prussienne de 1870. Au retour, il illustra des scènes tragiques
des Barricades de la Commune de
Paris, puis le portrait de Georges
Clemenceau alors que la position du Tigre
était encore radicale-socialiste. Manet, qui devait mourir de la syphilis
en 1883, ne s’intéressa plus qu’à produire des scènes marines et, à l’opposé,
l’atmosphère des milieux de café concert. Un tel homme resta toujours à l’abri
des crises financières, mais ce n’était pas le cas de tous les
impressionnistes.
nom nouveau :
Manet. Ce musicien espagnol était peint d’une certaine façon étrange, nouvelle,
dont les jeunes peintres étonnés croyaient avoir seuls le secret, peinture qui
tient le milieu entre celle dite réaliste et celle dite romantique…».
Manet délaissa, mais sans complètement l’abandonner, le paysage pour le
portrait. Puisque la photographie rendait désormais l’identique du tableau
obsolète, n’était-il pas audacieux de tirer avantage du procédé chromatique des
impressionnistes pour l’appliquer à la figure humaine? Manet, au départ, est
hors l’école impressionniste parmi lesquels il a des amis, Monet, Renoir et
Berthe Morisot. En 1862, il crée tout un scandale avec Le Déjeuner sur l’herbe où une femme nue entourée de trois hommes
vêtus est qualifié d’obscène tant il ridiculise le genre propre à l’académisme.
Manet exposa l’année d’après son Olympia tout
aussi répréhensible. Mais cela importait peu au peintre puisqu’il était
ambitieux et que le scandale rapporte toujours : «Ce que je veux aujourd’hui, c’est gagner de l’argent», lançait-il
au cours de l’été 1868.
Manet pouvait encore passé pour un peintre réaliste, même si son monde n’était
pas celui de Courbet, mais son réalisme tanguait davantage du côté des
impressionnistes. Il suffit de comparer son Exécution
de Maximilien de 1868 avec ses tableaux du début de la décennie, Le Déjeuner sur l’herbe par exemple,
pour mesurer toute la différence. Puis, ce patriote convaincu s’engagea dans la
guerre franco-prussienne de 1870. Au retour, il illustra des scènes tragiques
des Barricades de la Commune de
Paris, puis le portrait de Georges
Clemenceau alors que la position du Tigre
était encore radicale-socialiste. Manet, qui devait mourir de la syphilis
en 1883, ne s’intéressa plus qu’à produire des scènes marines et, à l’opposé,
l’atmosphère des milieux de café concert. Un tel homme resta toujours à l’abri
des crises financières, mais ce n’était pas le cas de tous les
impressionnistes.
 |
| Édouard Manet. Exécution de l'empereur Maximilien, 1867. |
La crise économique de 1873 ne pouvant favoriser
le mécénat ni la vente de tableaux, pour se concerter, certains des membres
organisèrent une coopérative en 1874. Celle-ci ne sut traverser les
tempêtes : «La  tentative
coopératiste de 1874 fit long feu, surtout avec le fiasco commercial de
l’exposition [chez le photographe Nadar]. Le 17 décembre 1874, dans l’atelier de Renoir, l’assemblée générale de
la Société anonyme coopérative des artistes, etc., décida la liquidation.
Toutes dettes extérieures payées, le passif de la Société s’élevait encore à 3
713 francs (avancés par les sociétaires), alors qu’il ne restait dans la caisse
que 277,99 francs. Chaque membre était donc redevable de 184,50 francs, pour
solder les dettes intérieures. Mais l’exposition avait été un succès
symbolique : 3 500 visiteurs, une critique en général pas défavorable. Le
groupe comprit qu’il pouvait se radicaliser…».
Malgré ce premier échec, une seconde coopérative s’organisa qui ne dura guère
plus longtemps. En 1877, la scission reposa cette fois sur un conflit
tentative
coopératiste de 1874 fit long feu, surtout avec le fiasco commercial de
l’exposition [chez le photographe Nadar]. Le 17 décembre 1874, dans l’atelier de Renoir, l’assemblée générale de
la Société anonyme coopérative des artistes, etc., décida la liquidation.
Toutes dettes extérieures payées, le passif de la Société s’élevait encore à 3
713 francs (avancés par les sociétaires), alors qu’il ne restait dans la caisse
que 277,99 francs. Chaque membre était donc redevable de 184,50 francs, pour
solder les dettes intérieures. Mais l’exposition avait été un succès
symbolique : 3 500 visiteurs, une critique en général pas défavorable. Le
groupe comprit qu’il pouvait se radicaliser…».
Malgré ce premier échec, une seconde coopérative s’organisa qui ne dura guère
plus longtemps. En 1877, la scission reposa cette fois sur un conflit  de
personnalités : «“Je souhaite,
répondit Cézanne, que l’exposition de notre coopérative soit un four si nous
devons exposer avec Monet. Vous me trouverez canaille, mais d’abord son affaire
propre avant tout… Je concluerai en disant comme vous, que puisqu’il se trouve
une tendance commune entre quelques-uns d’entre nous, espérons que la nécessité
nous forcera à agir de concert, et que l’intérêt et la réussite fortifieront le
lien que bien souvent la bonne volonté n’aurait pas suffi à consolider…” C’est
en raison de cette attitude que Cézanne, Pissarro et Guillaumin finiront par
donner leur démission à L’Union Artistique».
Mais il est vrai que celui qui souffrit le plus de l’injustice financière parmi
les impressionnistes reste Van Gogh et il n’y avait pas que le critique G.
Albert Aurier pour s’en scandaliser en 1889 : «Mais quoi qu’il arrive, quand bien même la mode viendrait de payer ses
toiles - ce qui est peu probable
de
personnalités : «“Je souhaite,
répondit Cézanne, que l’exposition de notre coopérative soit un four si nous
devons exposer avec Monet. Vous me trouverez canaille, mais d’abord son affaire
propre avant tout… Je concluerai en disant comme vous, que puisqu’il se trouve
une tendance commune entre quelques-uns d’entre nous, espérons que la nécessité
nous forcera à agir de concert, et que l’intérêt et la réussite fortifieront le
lien que bien souvent la bonne volonté n’aurait pas suffi à consolider…” C’est
en raison de cette attitude que Cézanne, Pissarro et Guillaumin finiront par
donner leur démission à L’Union Artistique».
Mais il est vrai que celui qui souffrit le plus de l’injustice financière parmi
les impressionnistes reste Van Gogh et il n’y avait pas que le critique G.
Albert Aurier pour s’en scandaliser en 1889 : «Mais quoi qu’il arrive, quand bien même la mode viendrait de payer ses
toiles - ce qui est peu probable  - aux prix des infamies de M. Meissonier, je
ne pense pas que beaucoup de sincérité puisse jamais entrer en cette tardive
admiration du gros public. Vincent van Gogh est, à la fois, trop simple et trop
subtil pour l’esprit bourgeois contemporain. Il ne sera jamais pleinement
compris que de ses frères, les artistes, et des heureux du petit peuple, du
tout petit peuple…».
Ce petit peuple que les impressionnistes peignait sous la lumière du soleil ou
les brumes de la pluie ne semblait pas les intéresser autrement que comme
objets à figurer. Le peu d’engagement social des impressionnistes qui
survécurent à l’effondrement des années 1880 se remarqua lorsque éclata la
célèbre Affaire : «Pendant l’affaire Dreyfus, alors que Monet
peint des reflets sur l’eau, que Degas s’avère anti-dreyfusard acharné, ce sont
les peintres ultra-académiques et soi-disant “bien pensants” qui soutiennent la
lutte de Zola, comme Débat-Ponsan dans sa Vérité sortant du puits, retenuepar deux spadassins qui fit scandale. Il
en va de même de l’engagement social. On a voulu associer les difficultés de
certains impressionnistes au paupérisme ouvrier, en oubliant que ces peintres
étaient par leur origine et par leur métier même des bourgeois […]. Le problème des impressionnistes n’est pas
un problème social mais un problème esthétique, celui de la non reconnaissance
par le public d’une prise de position plastique […]. Les vrais artistes socialisants sont les peintres pompiers».
En fait, il n’y avait que l’art pompier qui restait payant pour les artistes;
les tableaux historiques trouvaient preneur auprès de l’État et les marines
restaient un succès propre aux exercices d’académies.
- aux prix des infamies de M. Meissonier, je
ne pense pas que beaucoup de sincérité puisse jamais entrer en cette tardive
admiration du gros public. Vincent van Gogh est, à la fois, trop simple et trop
subtil pour l’esprit bourgeois contemporain. Il ne sera jamais pleinement
compris que de ses frères, les artistes, et des heureux du petit peuple, du
tout petit peuple…».
Ce petit peuple que les impressionnistes peignait sous la lumière du soleil ou
les brumes de la pluie ne semblait pas les intéresser autrement que comme
objets à figurer. Le peu d’engagement social des impressionnistes qui
survécurent à l’effondrement des années 1880 se remarqua lorsque éclata la
célèbre Affaire : «Pendant l’affaire Dreyfus, alors que Monet
peint des reflets sur l’eau, que Degas s’avère anti-dreyfusard acharné, ce sont
les peintres ultra-académiques et soi-disant “bien pensants” qui soutiennent la
lutte de Zola, comme Débat-Ponsan dans sa Vérité sortant du puits, retenuepar deux spadassins qui fit scandale. Il
en va de même de l’engagement social. On a voulu associer les difficultés de
certains impressionnistes au paupérisme ouvrier, en oubliant que ces peintres
étaient par leur origine et par leur métier même des bourgeois […]. Le problème des impressionnistes n’est pas
un problème social mais un problème esthétique, celui de la non reconnaissance
par le public d’une prise de position plastique […]. Les vrais artistes socialisants sont les peintres pompiers».
En fait, il n’y avait que l’art pompier qui restait payant pour les artistes;
les tableaux historiques trouvaient preneur auprès de l’État et les marines
restaient un succès propre aux exercices d’académies.
 |
| Vincent Van Gogh. Chambre de Van Gogh, 1888. |
 L’artiste qui marqua le passage de
l’impressionnisme au post-impressionnisme reste Paul Cézanne (1839-1906). Le
peintre d’Aix-en-Provence, influencé par Manet et Courbet devait influencer à
son tour Van Gogh et Picasso. Il est donc une courroie historique majeure dans
le développement de l’art à la fin du XIXe siècle. En lui, toutes les
contradictions prêtées au mouvement se révèlent : «L’erreur courante est de proclamer, à la fois, que Cézanne est un
novateur et de le louer pour avoir ramené la tradition. Cézanne est
impressionniste au départ. Il cultive la petite sensation, et il demeure
jusqu’au bout, fidèle, dans une certaine mesure, à l’idéal de sa jeunesse :
chaque fois qu’il module, qu’il note la valeur des couleurs dégradées sur un
objet au sens où l’impressionnisme de la première époque l’avait défini, chaque
fois qu’il prend, en somme, pour point de départ de son travail un paysage ou
un objet défini suivant l’ancienne conception de l’espace, chaque fois si l’on
veut qu’il cherche à
L’artiste qui marqua le passage de
l’impressionnisme au post-impressionnisme reste Paul Cézanne (1839-1906). Le
peintre d’Aix-en-Provence, influencé par Manet et Courbet devait influencer à
son tour Van Gogh et Picasso. Il est donc une courroie historique majeure dans
le développement de l’art à la fin du XIXe siècle. En lui, toutes les
contradictions prêtées au mouvement se révèlent : «L’erreur courante est de proclamer, à la fois, que Cézanne est un
novateur et de le louer pour avoir ramené la tradition. Cézanne est
impressionniste au départ. Il cultive la petite sensation, et il demeure
jusqu’au bout, fidèle, dans une certaine mesure, à l’idéal de sa jeunesse :
chaque fois qu’il module, qu’il note la valeur des couleurs dégradées sur un
objet au sens où l’impressionnisme de la première époque l’avait défini, chaque
fois qu’il prend, en somme, pour point de départ de son travail un paysage ou
un objet défini suivant l’ancienne conception de l’espace, chaque fois si l’on
veut qu’il cherche à  modifier la notation de sensations enregistrées en
fonction du respect des anciens découpages, représentatifs d’une action
pratique accoutumée. Mais il est, au contraire, novateur chaque fois qu’il
renonce au morcellement classique des figures changeantes de la nature en
objets significatifs d’actions particulières ou collectives déterminées,
c’est-à-dire, au fond, chaque fois qu’il établit de nouvelles liaisons entre
des fragments de sa perception expérimentale, abstraction faite des usages ou des
légendes. Son originalité véritable n’est pas de noter autrement des éléments
connus, ni de ramener des sensations aiguës à des schèmes pratiques antérieurs.
Elle consiste dans l’attribution d’un intérêt à des parties nouvelles de
l’expérience optique. Parti d’une sensation hallucinante de la nature telle que
l’avaient écrite ses prédécesseurs, il parvient, par
modifier la notation de sensations enregistrées en
fonction du respect des anciens découpages, représentatifs d’une action
pratique accoutumée. Mais il est, au contraire, novateur chaque fois qu’il
renonce au morcellement classique des figures changeantes de la nature en
objets significatifs d’actions particulières ou collectives déterminées,
c’est-à-dire, au fond, chaque fois qu’il établit de nouvelles liaisons entre
des fragments de sa perception expérimentale, abstraction faite des usages ou des
légendes. Son originalité véritable n’est pas de noter autrement des éléments
connus, ni de ramener des sensations aiguës à des schèmes pratiques antérieurs.
Elle consiste dans l’attribution d’un intérêt à des parties nouvelles de
l’expérience optique. Parti d’une sensation hallucinante de la nature telle que
l’avaient écrite ses prédécesseurs, il parvient, par  un choix difficile, à
isoler un petit nombre de fragments significatifs dépourvus de valeur classée.
Il crée un monde à la fois fragmentaire et organique, en fonction de quelques
intentions très simples, imposant comme loi à son œuvre la certitude d’une
vérité particulière - autant pirandellien que bergsonien».
Mais pour Venturi, Cézanne apporte des qualités personnelles au diapason des
attentes de la démarche impressionniste : «L’éclat chromatique incomparable de Cézanne, son intensité, sa sérénité
et sa fermeté proviennent des mêmes qualités que sa forme. Lui aussi, Pissarro
s’est servi des rapports de ton des couleurs; c’est même lui qui les a enseignés
à Cézanne. Mais l’effet de couleur en rapport avec sa forme et la variété des
éléments de l’œuvre de Pissarro sont tels qu’on y sent une certaine dispersion
tant de la forme que de l’harmonie chromatique. D’autre part, la structure
prend tant d’importance chez Cézanne qu’elle favorise l’ampleur des zones de
couleur en même temps que leur simplification et la
un choix difficile, à
isoler un petit nombre de fragments significatifs dépourvus de valeur classée.
Il crée un monde à la fois fragmentaire et organique, en fonction de quelques
intentions très simples, imposant comme loi à son œuvre la certitude d’une
vérité particulière - autant pirandellien que bergsonien».
Mais pour Venturi, Cézanne apporte des qualités personnelles au diapason des
attentes de la démarche impressionniste : «L’éclat chromatique incomparable de Cézanne, son intensité, sa sérénité
et sa fermeté proviennent des mêmes qualités que sa forme. Lui aussi, Pissarro
s’est servi des rapports de ton des couleurs; c’est même lui qui les a enseignés
à Cézanne. Mais l’effet de couleur en rapport avec sa forme et la variété des
éléments de l’œuvre de Pissarro sont tels qu’on y sent une certaine dispersion
tant de la forme que de l’harmonie chromatique. D’autre part, la structure
prend tant d’importance chez Cézanne qu’elle favorise l’ampleur des zones de
couleur en même temps que leur simplification et la  force de leur harmonie.
C’étaient surtout les rapports qui lui importaient. “Il n’y a pas de peinture
claire ni sombre; il n’y a que des rapports de couleur. Si ceux-ci sont
réalisés correctement, l’harmonie naît automatiquement”».
Si l’impressionnisme est un genre génial au
sens ou Max Scheler emploie ce terme, Cézanne restera toujours le génie, le géant de la production au
moment où elle atteint son paroxysme. À travers son œuvre, Cézanne demeure un
classique dans la mesure où il tient au réalisme. Il reste fidèle à la méthode
de Claude Bernard, poussant l’observation jusqu’à peindre la même montagne Sainte-Victoire, du même point de vue, selon les différentes heures de la
journée afin d’en voir se modifier la luminosité selon le passage du soleil.
Enfin, il est fidèle au mouvement en traduisant l’atmosphère des hameaux de
Provence, des silhouettes à l’horizon embrumées par la chaleur ou encore des
hommes attablés qui jouent aux cartes. Pour Venturi : «Dans une
force de leur harmonie.
C’étaient surtout les rapports qui lui importaient. “Il n’y a pas de peinture
claire ni sombre; il n’y a que des rapports de couleur. Si ceux-ci sont
réalisés correctement, l’harmonie naît automatiquement”».
Si l’impressionnisme est un genre génial au
sens ou Max Scheler emploie ce terme, Cézanne restera toujours le génie, le géant de la production au
moment où elle atteint son paroxysme. À travers son œuvre, Cézanne demeure un
classique dans la mesure où il tient au réalisme. Il reste fidèle à la méthode
de Claude Bernard, poussant l’observation jusqu’à peindre la même montagne Sainte-Victoire, du même point de vue, selon les différentes heures de la
journée afin d’en voir se modifier la luminosité selon le passage du soleil.
Enfin, il est fidèle au mouvement en traduisant l’atmosphère des hameaux de
Provence, des silhouettes à l’horizon embrumées par la chaleur ou encore des
hommes attablés qui jouent aux cartes. Pour Venturi : «Dans une  œuvre d’art, ce qui importe, ce
sont les rapports entre les images; aussi la représentation de Cézanne est-elle
parfaitement objective, non par rapport à la nature, mais par rapport à l’art.
Dans la nature “proche” et “lointain” sont termes matériels d’un monde fini.
L’œuvre de Cézanne est si cohérente, elle se suffit si bien qu’elle
n’appartient à aucun monde particulier. Elle est un monde en elle-même,
appartenant à l’infini et à l’universel, avec la solennité des choses qui
vivent éternellement».
Pour ces mêmes raisons, Francastel est justifié d’affirmer que : «ce n’est pas seulement un univers
géographique dont Cézanne s’évade, mais un univers mental dans lequel les
fonctions réciproques des êtres et des choses sont arrêtées. L’art renonce à
l’anecdote et à l’histoire pour se faire empirisme et panthéisme; il écrit
l’histoire des choses, pommes, compotier, montagne; de ce qu’elles signifient
dans le tissu de la vie sentimentale quotidienne d’hommes pour qui se modifient
sans cesse aussi les possibilités d’accès et de transformation de la matière.
En ce sens, l’art contemporain possède moins encore un caractère social qu’un
caractère objectif. Il est l’art d’une nouvelle époque de mécanisation des
forces de la nature, serrant de plus près l’évolution humaine que la société
qui demeure attardée».
Du seul Cézanne, Francastel en vient à l'absorber dans l'ensemble de l'art contemporain, ce qui finit par effacer la spécificité de Cézanne.
œuvre d’art, ce qui importe, ce
sont les rapports entre les images; aussi la représentation de Cézanne est-elle
parfaitement objective, non par rapport à la nature, mais par rapport à l’art.
Dans la nature “proche” et “lointain” sont termes matériels d’un monde fini.
L’œuvre de Cézanne est si cohérente, elle se suffit si bien qu’elle
n’appartient à aucun monde particulier. Elle est un monde en elle-même,
appartenant à l’infini et à l’universel, avec la solennité des choses qui
vivent éternellement».
Pour ces mêmes raisons, Francastel est justifié d’affirmer que : «ce n’est pas seulement un univers
géographique dont Cézanne s’évade, mais un univers mental dans lequel les
fonctions réciproques des êtres et des choses sont arrêtées. L’art renonce à
l’anecdote et à l’histoire pour se faire empirisme et panthéisme; il écrit
l’histoire des choses, pommes, compotier, montagne; de ce qu’elles signifient
dans le tissu de la vie sentimentale quotidienne d’hommes pour qui se modifient
sans cesse aussi les possibilités d’accès et de transformation de la matière.
En ce sens, l’art contemporain possède moins encore un caractère social qu’un
caractère objectif. Il est l’art d’une nouvelle époque de mécanisation des
forces de la nature, serrant de plus près l’évolution humaine que la société
qui demeure attardée».
Du seul Cézanne, Francastel en vient à l'absorber dans l'ensemble de l'art contemporain, ce qui finit par effacer la spécificité de Cézanne.
 |
| Paul Cézanne. Les joueurs de cartes, 1892-1895. |
Le caractère de Edgar Degas (1834-1917) fut
celui d’un irascible qui n’eut pas cependant le génie de  Cézanne. Pissarro était
sa bête noire. Comme le rappelle Rewald, «il
n’y avait personne, parmi les écrivains et les peintres, qui ne conçût une vive
estime pour cet artiste doux et calme qui joignait une profonde bonté à un
indomptable esprit combatif. Plus soucieux que les autres des problèmes
sociaux, il n’avait rien de la frivolité désinvolte de Degas, ni du snobisme de
Manet. Passionnément intéressé par les questions politiques, socialiste à
tendances anarchistes, athée convaincu, il rattachait la lutte des peintres à
la situation générale de l’artiste dans la société moderne. Mais si radicales
que fussent ses opinions, il ne s’y mêlait pas de haine; tout ce qu’il disait
était éclairé par l’altruisme et une pureté d’intention qui forçaient le
respect des autres. Tous ses camarades connaissaient ses difficultés
matérielles et admiraient l’absence d’amertume, voire la gaieté avec laquelle
il abordait les questions les plus graves».
Degas était antisémite alors que Pissarro ne cachait pas ses origines juives.
Le mépris était sans doute ce qui allait le mieux à Degas. Le peintre
Caillebotte écrivit ainsi à son sujet à Pissarro : «Non, cet homme est aigri. - Il n’occupa pas la grande place qu’il
devrait occuper par son talent, et, quoiqu’il ne l’avouera jamais, il en veut à
la terre entière».
Gauguin, au même correspondant, notera chez Degas qu’«il y a chez cet homme un esprit de travers qui démolit tout».
S’il y avait chez Degas une personnalité si désagréable, c’est probablement
parce que ce peintre, avantagé de fortune, hésitait quant à ses possibilités.
Degas nous révèle «cet aveu dans une
lettre adressée à son vieil ami Évariste de Valernes : “Je viens vous demander
pardon d’une chose qui revient souvent dans votre conversation et plus souvent
dans votre pensée: c’est d’avoir été au cours de nos longs rapports d’art, ou
d’avoir semblé être dur avec vous. Je
l’étais singulièrement pour moi-même, vous devez bien vous le rappeler, puisque
vous avez été amené à me le reprocher et à vous étonner de ce que j’avais si
peu de confiance en moi. J’étais ou je semblais dur avec tout le monde, par une
sorte d’entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise
humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu’il me
semblait que mes calculs d’art étaient si justes. Je boudais contre tout le
monde et contre moi. Je vous demande bien pardon si, sous le prétexte de ce
damné art, j’ai blessé votre très noble et très intelligent esprit, peut-être
même votre cœur”».
Certes, beaucoup éprouvent des doutes face à eux-mêmes et de la mauvaise humeur
et ne sont pas antisémites pour autant. Les excuses de Degas relèvent moins
d’une conscience malheureuse qui se reconnaît comme malheureuse, mais plutôt
une conscience de grand bourgeois qui passe ses frustrations érotiques pour les
jeunes filles sur le dos des défavorisés de la société : «Duranty nota au sujet de Degas : “[…]
l’appelait-on l’inventeur du clair-obscur social”. Une des idées chères à Degas
était, en effet, “l’inopportunité d’un art à la portée des classes pauvres et
permettant de livrer des tableaux au prix de treize sols.” Alors que de telles
opinions devaient être violemment contestées par Pissarro, toujours, comme
Monet, préoccupé de questions sociales, Degas provoquait plus d’étonnement
encore par sa tendance à prendre au sérieux et même à défendre des œuvres où
ses auditeurs ne discernaient aucune qualité».
Cézanne. Pissarro était
sa bête noire. Comme le rappelle Rewald, «il
n’y avait personne, parmi les écrivains et les peintres, qui ne conçût une vive
estime pour cet artiste doux et calme qui joignait une profonde bonté à un
indomptable esprit combatif. Plus soucieux que les autres des problèmes
sociaux, il n’avait rien de la frivolité désinvolte de Degas, ni du snobisme de
Manet. Passionnément intéressé par les questions politiques, socialiste à
tendances anarchistes, athée convaincu, il rattachait la lutte des peintres à
la situation générale de l’artiste dans la société moderne. Mais si radicales
que fussent ses opinions, il ne s’y mêlait pas de haine; tout ce qu’il disait
était éclairé par l’altruisme et une pureté d’intention qui forçaient le
respect des autres. Tous ses camarades connaissaient ses difficultés
matérielles et admiraient l’absence d’amertume, voire la gaieté avec laquelle
il abordait les questions les plus graves».
Degas était antisémite alors que Pissarro ne cachait pas ses origines juives.
Le mépris était sans doute ce qui allait le mieux à Degas. Le peintre
Caillebotte écrivit ainsi à son sujet à Pissarro : «Non, cet homme est aigri. - Il n’occupa pas la grande place qu’il
devrait occuper par son talent, et, quoiqu’il ne l’avouera jamais, il en veut à
la terre entière».
Gauguin, au même correspondant, notera chez Degas qu’«il y a chez cet homme un esprit de travers qui démolit tout».
S’il y avait chez Degas une personnalité si désagréable, c’est probablement
parce que ce peintre, avantagé de fortune, hésitait quant à ses possibilités.
Degas nous révèle «cet aveu dans une
lettre adressée à son vieil ami Évariste de Valernes : “Je viens vous demander
pardon d’une chose qui revient souvent dans votre conversation et plus souvent
dans votre pensée: c’est d’avoir été au cours de nos longs rapports d’art, ou
d’avoir semblé être dur avec vous. Je
l’étais singulièrement pour moi-même, vous devez bien vous le rappeler, puisque
vous avez été amené à me le reprocher et à vous étonner de ce que j’avais si
peu de confiance en moi. J’étais ou je semblais dur avec tout le monde, par une
sorte d’entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise
humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu’il me
semblait que mes calculs d’art étaient si justes. Je boudais contre tout le
monde et contre moi. Je vous demande bien pardon si, sous le prétexte de ce
damné art, j’ai blessé votre très noble et très intelligent esprit, peut-être
même votre cœur”».
Certes, beaucoup éprouvent des doutes face à eux-mêmes et de la mauvaise humeur
et ne sont pas antisémites pour autant. Les excuses de Degas relèvent moins
d’une conscience malheureuse qui se reconnaît comme malheureuse, mais plutôt
une conscience de grand bourgeois qui passe ses frustrations érotiques pour les
jeunes filles sur le dos des défavorisés de la société : «Duranty nota au sujet de Degas : “[…]
l’appelait-on l’inventeur du clair-obscur social”. Une des idées chères à Degas
était, en effet, “l’inopportunité d’un art à la portée des classes pauvres et
permettant de livrer des tableaux au prix de treize sols.” Alors que de telles
opinions devaient être violemment contestées par Pissarro, toujours, comme
Monet, préoccupé de questions sociales, Degas provoquait plus d’étonnement
encore par sa tendance à prendre au sérieux et même à défendre des œuvres où
ses auditeurs ne discernaient aucune qualité».
 L’harmonie ne régna pas davantage parmi les
post-impressionnistes. Van Gogh (1853-1890), par son esprit évangéliste, fut
celui qui semble en avoir le plus souffert. Rewald souligne ainsi que «c’est van Gogh qui résuma le mieux la
situation, et parlant sans ambages des “désastreuses guerres civiles” du groupe
impressionniste, dans lesquelles “de part et d’autre on cherche à se manger le
nez avec un zèle digne d’une meilleure destination”».
Il rappelait à ses collègues que «les
artistes japonais ont pratiqué très souvent l’échange, expliquait-il dans une
lettre à Bernard, cela prouve qu’ils s’aimaient entre eux; qu’ils vivaient
justement dans une sorte de vie fraternelle, naturellement, et non pas dans les
intrigues. Plus nous
L’harmonie ne régna pas davantage parmi les
post-impressionnistes. Van Gogh (1853-1890), par son esprit évangéliste, fut
celui qui semble en avoir le plus souffert. Rewald souligne ainsi que «c’est van Gogh qui résuma le mieux la
situation, et parlant sans ambages des “désastreuses guerres civiles” du groupe
impressionniste, dans lesquelles “de part et d’autre on cherche à se manger le
nez avec un zèle digne d’une meilleure destination”».
Il rappelait à ses collègues que «les
artistes japonais ont pratiqué très souvent l’échange, expliquait-il dans une
lettre à Bernard, cela prouve qu’ils s’aimaient entre eux; qu’ils vivaient
justement dans une sorte de vie fraternelle, naturellement, et non pas dans les
intrigues. Plus nous  leur ressemblerons sous ce respect-là, mieux l’on s’en
trouvera».
Son ami Gauguin n’était pas le moins à pratiquer la querelle, lui qui : «se répandait en invectives contre Seurat et
Signac. Pissarro, qui avait vu déjà tant de disputes stériles parmi les vieux
impressionnistes, voyait maintenant la jeune génération continuer dans le même
esprit d’intolérance. Il ne cacha pas la peine qu’il en ressentait, lorsqu’il
écrivit à son fils aîné en novembre : “Les hostilités continuent de plus en
plus parmi les impressionnistes romantiques. Ils se réunissent très régulièrement.
Degas lui-même vient au Café. Gauguin est redevenu très intime de Degas et va
le voir souvent. Curieux, n’est-ce pas, cette bascule des intérêts! - Oubliées,
les avanies de l’année passée au bord de la mer, oubliés les sarcasmes du
Maître contre le sectaire [Gauguin]… Moi, naïf, je le défendait à cor et à cri
contre les uns et les autres. C’est bien humain et bien triste”».
Camille Pissarro n’avait pas de lui une bonne impression, comme il l’exprime
dans une lettre à son fils Lucien en 1891 : «Gauguin n’est pas un voyant, c’est un malin qui a senti un retour de la
bourgeoisie en arrière, par suite des grandes idées de solidarité qui germent
dans le peuple - idée inconsciente, mais féconde et la seule légitime! Les
symbolistes sont dans le même cas! Aussi, il faut
leur ressemblerons sous ce respect-là, mieux l’on s’en
trouvera».
Son ami Gauguin n’était pas le moins à pratiquer la querelle, lui qui : «se répandait en invectives contre Seurat et
Signac. Pissarro, qui avait vu déjà tant de disputes stériles parmi les vieux
impressionnistes, voyait maintenant la jeune génération continuer dans le même
esprit d’intolérance. Il ne cacha pas la peine qu’il en ressentait, lorsqu’il
écrivit à son fils aîné en novembre : “Les hostilités continuent de plus en
plus parmi les impressionnistes romantiques. Ils se réunissent très régulièrement.
Degas lui-même vient au Café. Gauguin est redevenu très intime de Degas et va
le voir souvent. Curieux, n’est-ce pas, cette bascule des intérêts! - Oubliées,
les avanies de l’année passée au bord de la mer, oubliés les sarcasmes du
Maître contre le sectaire [Gauguin]… Moi, naïf, je le défendait à cor et à cri
contre les uns et les autres. C’est bien humain et bien triste”».
Camille Pissarro n’avait pas de lui une bonne impression, comme il l’exprime
dans une lettre à son fils Lucien en 1891 : «Gauguin n’est pas un voyant, c’est un malin qui a senti un retour de la
bourgeoisie en arrière, par suite des grandes idées de solidarité qui germent
dans le peuple - idée inconsciente, mais féconde et la seule légitime! Les
symbolistes sont dans le même cas! Aussi, il faut  les combattre comme la peste».
Seurat, pour sa part, tint à se distinguer du mouvement impressionniste sans
trahir ce qui le distinguait des autres courants artistiques : «Afin d’éviter toute confusion entre les
impressionnistes de la “vieille garde” d’une part et Seurat et ses camarades de
l’autre, Fénéon inventa le mot néo-impressionnisme, bien que le peintre eût
préféré la désignation plus précise de chromo-luminarisme. Signac expliqua plus
tard que si ses amis et lui adoptèrent le terme néo-impressionnisme, “ce ne fut
pas pour flagorner le succès [les impressionnistes étaient encore en pleine
lutte], mais pour rendre hommage à l’effort des précurseurs et marquer, sous la
divergence des procédés, la communauté de but : la lumière et la couleur. C’est
dans ce sens que doit être entendu ce mot néo-impressionnistes, car la
technique qu’emploient ces peintres n’a rien d’impressionniste; autant celle de
leurs devanciers est d’instinct et d’instantanéité, autant la leur est de
réflexion et de permanence”».
Théoricien et praticien, Seurat ramenait la construction figurative des yeux au
cerveau, c’est-à-dire qu’il maîtrisait si bien intellectuellement l’art du
contraste des couleurs qu’il les appliquait sans spontanéité, plutôt au prix
d’un dur labeur. Comme le souligne Rewald : «Ici, contrairement aux
les combattre comme la peste».
Seurat, pour sa part, tint à se distinguer du mouvement impressionniste sans
trahir ce qui le distinguait des autres courants artistiques : «Afin d’éviter toute confusion entre les
impressionnistes de la “vieille garde” d’une part et Seurat et ses camarades de
l’autre, Fénéon inventa le mot néo-impressionnisme, bien que le peintre eût
préféré la désignation plus précise de chromo-luminarisme. Signac expliqua plus
tard que si ses amis et lui adoptèrent le terme néo-impressionnisme, “ce ne fut
pas pour flagorner le succès [les impressionnistes étaient encore en pleine
lutte], mais pour rendre hommage à l’effort des précurseurs et marquer, sous la
divergence des procédés, la communauté de but : la lumière et la couleur. C’est
dans ce sens que doit être entendu ce mot néo-impressionnistes, car la
technique qu’emploient ces peintres n’a rien d’impressionniste; autant celle de
leurs devanciers est d’instinct et d’instantanéité, autant la leur est de
réflexion et de permanence”».
Théoricien et praticien, Seurat ramenait la construction figurative des yeux au
cerveau, c’est-à-dire qu’il maîtrisait si bien intellectuellement l’art du
contraste des couleurs qu’il les appliquait sans spontanéité, plutôt au prix
d’un dur labeur. Comme le souligne Rewald : «Ici, contrairement aux  impressionnistes, il ne faisait aucun effort
pour retenir des effets fugitifs, mais cherchait à transposer ce qu’il avait
observé sur place en une harmonie de lignes et de couleurs rigoureusement établie.
Écartant tout ce qui paraissait superflu, insistant sur les contours et la
structure, il se refusait aux charmes sensuels qui avaient captivé les
impressionnistes et sacrifiait les sensations spontanées à une stylisation
presque rigide. Ne voulant pas retenir l’aspect d’un paysage à un instant
spécifique, il s’efforçait de fixer sa “silhouette du jour entier”. Lorsqu’il
rencontra Pissarro en 1885, Seurat travaillait depuis une année entière à une
nouvelle composition, Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande-Jatte, où se trouvent résumées toutes ces
conceptions».
Cette œuvre est immense, géniale, impression…
nante. Sans doute la plus grande des post-impressionnistes, mais elle reste
froide, établissant une distance entre le spectateur et la toile. Voilà
peut-être pourquoi elle souleva, comme à l’origine des impressionnismes, la
risée parmi les critiques : «En
raison des bruits qui circulaient au sujet de la toile de Seurat, la nouvelle
exposition excita d’avance une très vive curiosité. George Moore entendit dire
par un ami qu’il y avait un grand tableau en trois couleurs : jaune claire pour
la lumière, brun pour l’ombre et tout le reste bleu ciel. On disait en outre
qu’il s’y trouvait une dame avec un singe dont la queue en spirale avait un mètre
de long. Moore se hâta d’aller au vernissage, et bien que la toile ne
correspondît pas exactement à la description, il y avait effectivement un singe
et d’autres détails suffisamment étranges pour déchaîner le rire de la foule,
“un rire bruyant, poussé à l’excès dans le désir de faire le plus de peine
possible”».
En effet, il n’y avait rien de la chaleur que dégageaient les Van Gogh, les
Gauguin, les Toulouse-Lautrec.
impressionnistes, il ne faisait aucun effort
pour retenir des effets fugitifs, mais cherchait à transposer ce qu’il avait
observé sur place en une harmonie de lignes et de couleurs rigoureusement établie.
Écartant tout ce qui paraissait superflu, insistant sur les contours et la
structure, il se refusait aux charmes sensuels qui avaient captivé les
impressionnistes et sacrifiait les sensations spontanées à une stylisation
presque rigide. Ne voulant pas retenir l’aspect d’un paysage à un instant
spécifique, il s’efforçait de fixer sa “silhouette du jour entier”. Lorsqu’il
rencontra Pissarro en 1885, Seurat travaillait depuis une année entière à une
nouvelle composition, Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande-Jatte, où se trouvent résumées toutes ces
conceptions».
Cette œuvre est immense, géniale, impression…
nante. Sans doute la plus grande des post-impressionnistes, mais elle reste
froide, établissant une distance entre le spectateur et la toile. Voilà
peut-être pourquoi elle souleva, comme à l’origine des impressionnismes, la
risée parmi les critiques : «En
raison des bruits qui circulaient au sujet de la toile de Seurat, la nouvelle
exposition excita d’avance une très vive curiosité. George Moore entendit dire
par un ami qu’il y avait un grand tableau en trois couleurs : jaune claire pour
la lumière, brun pour l’ombre et tout le reste bleu ciel. On disait en outre
qu’il s’y trouvait une dame avec un singe dont la queue en spirale avait un mètre
de long. Moore se hâta d’aller au vernissage, et bien que la toile ne
correspondît pas exactement à la description, il y avait effectivement un singe
et d’autres détails suffisamment étranges pour déchaîner le rire de la foule,
“un rire bruyant, poussé à l’excès dans le désir de faire le plus de peine
possible”».
En effet, il n’y avait rien de la chaleur que dégageaient les Van Gogh, les
Gauguin, les Toulouse-Lautrec.
 |
| Georges Seurat. Parade de cirque, 1887-1888 |
Mais Seurat fit des convertis parmi la vieille garde des impressionnistes, en
particulier Pissarro qui «fut
immédiatement séduit par les théories et la technique de Seurat; sans hésiter,
il embrassa ses vues.  Dans une lettre à Durand-Ruel, il expliqua que ce qu’il
voulait dorénavant, c’était “rechercher la synthèse moderne par des moyens basés
sur la science, lesquels seront basés sur la théorie des couleurs découverte
par M. Chevreul, et d’après les expériences de Maxwell et des mensurations de
O. N. Rood : substituer le mélange optique au mélange des pigments, autrement
dit, la décomposition des tons en leurs éléments constitutifs, parce que ce
mélange optique suscite des luminosités beaucoup plus intenses que le mélange
des pigments”. Et avec sa modestie caractéristique, Pissarro insistait sur le
fait que c’était “M. Seurat, artiste de grande valeur, qui a été le premier à
avoir l’idée et à appliquer la théorie scientifiquement après
Dans une lettre à Durand-Ruel, il expliqua que ce qu’il
voulait dorénavant, c’était “rechercher la synthèse moderne par des moyens basés
sur la science, lesquels seront basés sur la théorie des couleurs découverte
par M. Chevreul, et d’après les expériences de Maxwell et des mensurations de
O. N. Rood : substituer le mélange optique au mélange des pigments, autrement
dit, la décomposition des tons en leurs éléments constitutifs, parce que ce
mélange optique suscite des luminosités beaucoup plus intenses que le mélange
des pigments”. Et avec sa modestie caractéristique, Pissarro insistait sur le
fait que c’était “M. Seurat, artiste de grande valeur, qui a été le premier à
avoir l’idée et à appliquer la théorie scientifiquement après  l’avoir étudiée à
fond. Je n’ai fait que suivre…” Dès que Pissarro se fut joint à Seurat et à
Signac, il commença à considérer ses anciens camarades comme des
impressionnistes romantiques, soulignant ainsi les différences de principes qui
les séparaient du nouveau groupe d’impressionnistes scientifiques».
Scientifique, le mot était juste. Une nouvelle sorte de réalisme étranger à
celui de Courbet et du premier Manet faisait son apparition. Seurat «était fasciné par l’idée que la couleur,
soumisse à des lois fixes, “se peut enseigner comme la musique”. Parmi ces lois
s’en trouve une établie par Chevreul selon laquelle “le contraste simultané des
couleurs renferme tous les phénomènes de modification que des objets
diversement colorés paraissent éprouver dans la composition physique et la
hauteur du ton de leurs couleurs respectives lorsqu’on les voit simultanément”.
L’un des éléments essentiels de la théorie des contrastes simultanés est fondé
sur le point que deux couleurs contiguës s’influencent, chacune imposant à sa
voisine sa propre complémentaire (la plus claire devenant plus claire et la
plus sombre plus foncée)».
Plutôt que de se laisser aller à traduire les perceptions visuelles reçues par
l’œil
l’avoir étudiée à
fond. Je n’ai fait que suivre…” Dès que Pissarro se fut joint à Seurat et à
Signac, il commença à considérer ses anciens camarades comme des
impressionnistes romantiques, soulignant ainsi les différences de principes qui
les séparaient du nouveau groupe d’impressionnistes scientifiques».
Scientifique, le mot était juste. Une nouvelle sorte de réalisme étranger à
celui de Courbet et du premier Manet faisait son apparition. Seurat «était fasciné par l’idée que la couleur,
soumisse à des lois fixes, “se peut enseigner comme la musique”. Parmi ces lois
s’en trouve une établie par Chevreul selon laquelle “le contraste simultané des
couleurs renferme tous les phénomènes de modification que des objets
diversement colorés paraissent éprouver dans la composition physique et la
hauteur du ton de leurs couleurs respectives lorsqu’on les voit simultanément”.
L’un des éléments essentiels de la théorie des contrastes simultanés est fondé
sur le point que deux couleurs contiguës s’influencent, chacune imposant à sa
voisine sa propre complémentaire (la plus claire devenant plus claire et la
plus sombre plus foncée)».
Plutôt que de se laisser aller à traduire les perceptions visuelles reçues par
l’œil  et transmises du cerveau à la main du peintre, la main de Seurat, partant
du modèle de Chevreul, reconstruisait, sans avoir à l’observer, une scène
imaginaire. Les contrastes colorés finissaient par devenir une nouvelle ligne à
partir de pointillés de couleurs complémentaires, longue et minutieuse adresse
qui a fait le génie de Seurat. Parmi les post-impressionnistes, on appela sa
méthode le pointillisme : «Seurat et ses associés évitaient
soigneusement le mot pointillisme dans leurs discussions et parlaient toujours
de divisionnisme, un terme qui embrassait toutes leurs innovations. […] Divisionnisme, selon la définition de
Signac, signifie “s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur
et de l’harmonie: par le mélange optique de pigments uniquement purs (toutes
les teintes du prisme et tous leurs tons); par la séparation des divers
éléments (couleur locale, couleur d’éclairage, leurs réactions); par
l’équilibre de ces éléments et leurs proportions (selon les lois du contraste,
de la dégradation et de l’irradiation); par le choix d’une touche proportionnée
à la dimension du tableau”».
Seurat, Signac et le britannique Sisley travaillèrent en pointillistes et offrirent un nouveau défi à la composition picturale.
et transmises du cerveau à la main du peintre, la main de Seurat, partant
du modèle de Chevreul, reconstruisait, sans avoir à l’observer, une scène
imaginaire. Les contrastes colorés finissaient par devenir une nouvelle ligne à
partir de pointillés de couleurs complémentaires, longue et minutieuse adresse
qui a fait le génie de Seurat. Parmi les post-impressionnistes, on appela sa
méthode le pointillisme : «Seurat et ses associés évitaient
soigneusement le mot pointillisme dans leurs discussions et parlaient toujours
de divisionnisme, un terme qui embrassait toutes leurs innovations. […] Divisionnisme, selon la définition de
Signac, signifie “s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur
et de l’harmonie: par le mélange optique de pigments uniquement purs (toutes
les teintes du prisme et tous leurs tons); par la séparation des divers
éléments (couleur locale, couleur d’éclairage, leurs réactions); par
l’équilibre de ces éléments et leurs proportions (selon les lois du contraste,
de la dégradation et de l’irradiation); par le choix d’une touche proportionnée
à la dimension du tableau”».
Seurat, Signac et le britannique Sisley travaillèrent en pointillistes et offrirent un nouveau défi à la composition picturale.
 |
| Paul Signac. Palais des papes à Avignon,1900. |
Ce défi devint si stimulant qu’il fut exporté
dans d’autres domaines, dans l’interprétation dramaturgique par 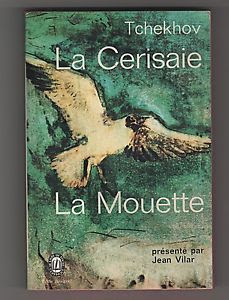 exemple. Ibsen,
mais surtout Tchékov se prêtaient admirablement à cette nouvelle méthode :
«Nous appelons pointilliste une technique
dramaturgique dans laquelle chaque geste, chaque parole n’a pas plus
d’importance en soi que le point de couleur dans un tableau impressionniste,
alors que l’ensemble de ces points prend un sens prodigieusement éloquent.
Naturellement, au théâtre, cet ensemble ne peut se situer que dans l’image
mentale du spectateur, c’est lui qui doit à chaque instant faire la synthèse
entre ce qu’il voit et ce qui a précédé. Il est difficile de voir La
Mouette, Les trois Sœurs ou La
Cerisaie sans être frappé du manque de
commune mesure entre l’insignifiance du dialogue et la portée immense et
profonde des significations, ce déséquilibre est
exemple. Ibsen,
mais surtout Tchékov se prêtaient admirablement à cette nouvelle méthode :
«Nous appelons pointilliste une technique
dramaturgique dans laquelle chaque geste, chaque parole n’a pas plus
d’importance en soi que le point de couleur dans un tableau impressionniste,
alors que l’ensemble de ces points prend un sens prodigieusement éloquent.
Naturellement, au théâtre, cet ensemble ne peut se situer que dans l’image
mentale du spectateur, c’est lui qui doit à chaque instant faire la synthèse
entre ce qu’il voit et ce qui a précédé. Il est difficile de voir La
Mouette, Les trois Sœurs ou La
Cerisaie sans être frappé du manque de
commune mesure entre l’insignifiance du dialogue et la portée immense et
profonde des significations, ce déséquilibre est  l’origine du mouvement si
particulier à ces drames».
Certes, toutes comparaisons entre les genres artistiques et littéraires
conservent quelque chose de douteux, mais pour P. Ginestier, «les techniques de Tchékhov et d’Ibsen sont
fondamentalement les mêmes, mais la facture d’Ibsen est plus resserrée, le
symbole moins diffus, la progression plus dramatique au sens traditionnel du
mot. Cependant, ces deux auteurs ont su saisir tout le tragique quotidien de la
condition humaine et les conflits qu’ils dépeignent - jeunes, vieux; artistes,
béotiens; riches, pauvres; hommes, femmes - sont fondamentalement les mêmes. De
plus, ces deux dramaturges ont une technique impressionniste, mais alors la
chronologie est inversée, car Tchékhov fait penser à Claude Monet alors
qu’Ibsen rappelle Van Gogh…».
Mais le pointilliste ne fut pas tout le post-impressionnisme. On parlait
beaucoup du «groupe de Pont-Aven
[Gauguin, Bernard], [qui] fusionne
bientôt avec d’autres peintres comme Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels, Paul
Ranson et Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier servant de trait d’union. Ensuite
Pierre Bonnard, Aristide Maillol et Édouard Vuillard rejoignent les rangs. En
1892, ils fondent le groupe des Nabis (Les prophètes) qui cultive une forme de
symbolisme quelque peu différent de celui de Pont-Aven».
l’origine du mouvement si
particulier à ces drames».
Certes, toutes comparaisons entre les genres artistiques et littéraires
conservent quelque chose de douteux, mais pour P. Ginestier, «les techniques de Tchékhov et d’Ibsen sont
fondamentalement les mêmes, mais la facture d’Ibsen est plus resserrée, le
symbole moins diffus, la progression plus dramatique au sens traditionnel du
mot. Cependant, ces deux auteurs ont su saisir tout le tragique quotidien de la
condition humaine et les conflits qu’ils dépeignent - jeunes, vieux; artistes,
béotiens; riches, pauvres; hommes, femmes - sont fondamentalement les mêmes. De
plus, ces deux dramaturges ont une technique impressionniste, mais alors la
chronologie est inversée, car Tchékhov fait penser à Claude Monet alors
qu’Ibsen rappelle Van Gogh…».
Mais le pointilliste ne fut pas tout le post-impressionnisme. On parlait
beaucoup du «groupe de Pont-Aven
[Gauguin, Bernard], [qui] fusionne
bientôt avec d’autres peintres comme Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels, Paul
Ranson et Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier servant de trait d’union. Ensuite
Pierre Bonnard, Aristide Maillol et Édouard Vuillard rejoignent les rangs. En
1892, ils fondent le groupe des Nabis (Les prophètes) qui cultive une forme de
symbolisme quelque peu différent de celui de Pont-Aven».
L’impressionnisme n’attendit pas les
pointillistes pour influencer lettres et autres arts, la musique en
particulier : «Dès la fin de la
première décennie du siècle, grâce aux impressionnistes, la composition se
transforma radicalement. Depuis Mozart jusqu’à la fin du XIXe siècle, la
musique avait été constituée  par des éléments de construction assez larges :
gammes, arpèges, longues cadences. Mais, vers la fin du siècle, ces structures
furent rejetées. La musique se trouva réduite à des notes individuelles ou,
tout au plus, à de courts motifs. Comme en architecture, en peinture et dans
les métiers d’art, l’accent fut mis sur les matériaux de base, les couleurs
primaires et la substance primitive».
Mais on ne savait pas précisément ce que voulait dire l’impressionnisme en
musique, et certains musiciens se virent accoler ce titre sans l’avoir
revendiqué, ainsi Claude Debussy qui «avait
obtenu un prix de Rome. Il avait visité Bayreuth et Moscou, connaissait les
écrits des symbolistes et des préraphaélites, et son nom s’était déjà trouvé
associé au terme d’“impressionnisme” […].
En 1885 le jury du Prix de Rome considère que le Printemps manifeste un “oubli
de l’importance de la précision dans la ligne et dans la forme” et un “vague
impressionnisme” qui met en péril la “vérité” de l’œuvre d’art».
Plus naturellement, l’impressionnisme trouva des répondants dans le monde de la
photographie puis du cinéma. Il est vrai que l’impressionnisme avait subi
l’influence de la nouvelle invention du milieu du XIXe siècle : «L’influence largement exercée par la
photographie sur les impressionnistes est un lieu commun de l’histoire de
l’art. Ce ne serait en effet pas exagérer beaucoup que de dire, avec Stieglitz,
que “les peintres
par des éléments de construction assez larges :
gammes, arpèges, longues cadences. Mais, vers la fin du siècle, ces structures
furent rejetées. La musique se trouva réduite à des notes individuelles ou,
tout au plus, à de courts motifs. Comme en architecture, en peinture et dans
les métiers d’art, l’accent fut mis sur les matériaux de base, les couleurs
primaires et la substance primitive».
Mais on ne savait pas précisément ce que voulait dire l’impressionnisme en
musique, et certains musiciens se virent accoler ce titre sans l’avoir
revendiqué, ainsi Claude Debussy qui «avait
obtenu un prix de Rome. Il avait visité Bayreuth et Moscou, connaissait les
écrits des symbolistes et des préraphaélites, et son nom s’était déjà trouvé
associé au terme d’“impressionnisme” […].
En 1885 le jury du Prix de Rome considère que le Printemps manifeste un “oubli
de l’importance de la précision dans la ligne et dans la forme” et un “vague
impressionnisme” qui met en péril la “vérité” de l’œuvre d’art».
Plus naturellement, l’impressionnisme trouva des répondants dans le monde de la
photographie puis du cinéma. Il est vrai que l’impressionnisme avait subi
l’influence de la nouvelle invention du milieu du XIXe siècle : «L’influence largement exercée par la
photographie sur les impressionnistes est un lieu commun de l’histoire de
l’art. Ce ne serait en effet pas exagérer beaucoup que de dire, avec Stieglitz,
que “les peintres  impressionnistes adoptent un style de composition qui est
strictement photographique”. La traduction photographique de la réalité en
zones d’ombre et de lumière fortement contrastées, le découpage libre ou
arbitraire de l’image dans le cadre de la photo, l’indifférence des photographes à rendre l’espace, et particulièrement l’arrière-plan,
intelligible : voilà pour l’essentiel ce qui a inspiré aux peintres
impressionnistes leurs professions d’intérêt scientifique pour les propriétés
de la lumière, leurs recherches de perspectives aplaties d’angles insolites, de
formes décentrées, tronquées par le bord de la toile. (“Ils peignent la vie par
pièces et morceaux”, comme le faisait remarquer Stieglitz en 1909.) Détail
historique : c’est dans le studio de Nadar, à Paris, boulevard des Capucines,
que se tînt en avril 1874 la toute première exposition impressionniste».
Bien avant Jean Renoir – fils du peintre Auguste – qui tourna son film Une
impressionnistes adoptent un style de composition qui est
strictement photographique”. La traduction photographique de la réalité en
zones d’ombre et de lumière fortement contrastées, le découpage libre ou
arbitraire de l’image dans le cadre de la photo, l’indifférence des photographes à rendre l’espace, et particulièrement l’arrière-plan,
intelligible : voilà pour l’essentiel ce qui a inspiré aux peintres
impressionnistes leurs professions d’intérêt scientifique pour les propriétés
de la lumière, leurs recherches de perspectives aplaties d’angles insolites, de
formes décentrées, tronquées par le bord de la toile. (“Ils peignent la vie par
pièces et morceaux”, comme le faisait remarquer Stieglitz en 1909.) Détail
historique : c’est dans le studio de Nadar, à Paris, boulevard des Capucines,
que se tînt en avril 1874 la toute première exposition impressionniste».
Bien avant Jean Renoir – fils du peintre Auguste – qui tourna son film Une  partie de campagne durant l’été 1936
en s’inspirant des thèmes et des textures de l’art impressionniste, il y eut
Léon Poirier qui «appartenait à la
famille de Berthe Morizot, disciple de Manet. Il y a dans certaines images de Jocelyn ou de La Brière comme un prolongement de l’Impressionnisme pictural. Poirier,
Baroncelli composent les premiers films français où la nature devient une
présence. L’“impression” que les novateurs vont tenter de dégager par le jeu
combiné des plans et des rythmes, ces romantiques le demandent à la lumière qui
baigne un paysage et lui donne son caractère».
On a également considéré certains films d’Abel Gance (1889-1981) comme relevant
de l’impressionnisme, surtout à travers ses expériences liées au mouvement de
la caméra; dans La Roue (1923) «c’était le mouvement qui était à la base de
cette innovation qui a fait dire à Germaine Dulac : “L’ère de l’impressionnisme
commençait, ramenant au mouvement par le rythme, cherchant à créer l’émotion
par la sensation”».
Jean Epstein (1897-1953), plus romantique, produisait des images métissées de
symbolisme et d’impressionnisme.
partie de campagne durant l’été 1936
en s’inspirant des thèmes et des textures de l’art impressionniste, il y eut
Léon Poirier qui «appartenait à la
famille de Berthe Morizot, disciple de Manet. Il y a dans certaines images de Jocelyn ou de La Brière comme un prolongement de l’Impressionnisme pictural. Poirier,
Baroncelli composent les premiers films français où la nature devient une
présence. L’“impression” que les novateurs vont tenter de dégager par le jeu
combiné des plans et des rythmes, ces romantiques le demandent à la lumière qui
baigne un paysage et lui donne son caractère».
On a également considéré certains films d’Abel Gance (1889-1981) comme relevant
de l’impressionnisme, surtout à travers ses expériences liées au mouvement de
la caméra; dans La Roue (1923) «c’était le mouvement qui était à la base de
cette innovation qui a fait dire à Germaine Dulac : “L’ère de l’impressionnisme
commençait, ramenant au mouvement par le rythme, cherchant à créer l’émotion
par la sensation”».
Jean Epstein (1897-1953), plus romantique, produisait des images métissées de
symbolisme et d’impressionnisme.
 |
| Gustave Caillebotte. La place de l'Europe, temps de pluie. 1877. |
 |
| Roger Fry. Virginia Woolf |
Et les lettres? Comment, encore ici, rapprocher
l’écriture de l’art pictural? Quel auteur, outre la contemporanéité
chronologique, pourrait être considéré comme impressionniste? Comment définir l’impressionnisme en littérature?
Pour Albérès, en appelant à une auteur qu’il considère du genre, Virginia Woolf, «l’impressionnisme exprime un
certain besoin de revenir aux sources, à la source confuse mais pure des
impressions : “Examinez un instant un homme commun dans une journée banale.
L’esprit reçoit une myriade d’impressions - triviales, fantastiques,
évanescentes, ou gravées au burin d’acier (…). Ainsi, si l’écrivain était un
homme libre et non un esclave, s’il pouvait écrire ce qu’il veut et non ce
qu’il doit écrire, s’il pouvait fonder son œuvre sur sa sensation et non sur
une convention, il n’y aurait pas d’intrigue, de comédie, de tragédie (…). La
vie n’est pas une série de lampions bien ordonnée; la vie est un halo lumineux,
une enveloppe transparente qui nous entoure, depuis la naissance de notre
conscience jusqu’à sa mort”».
La comparaison serait donc acceptable dans la mesure où l’impression devient un élément qui émergerait du récit en touches
contrastées : «Ainsi, avant que
fussent formulées après 1920 les théories de l’impressionnisme, Conrad  et Henry James découvraient déjà un procédé impressionniste : que les faits rapportés,
minutieusement et légèrement peints sur une toile, suggèrent derrière cette
toile, en transparence, une autre réalité indéfinissable. Sous la surface
pittoresque du conte alerte ou fascinant s’imposent le mystère et la profondeur
de l’événement, qui échappent au conte. […] Ce “quelque chose de plus” est déjà l’essentiel du roman
impressionniste : la sensation que derrière le récit objectif - qui devient
alors insuffisant -, au-delà même de la conscience que les personnages prennent
des événements qu’ils vivent, il existe une réalité impénétrable de l’événement…».
En vérité, il y a eu autant de styles impressionnistes en littérature qu’il y
en a eu en peinture. Entre Woolf, Proust, Conrad, que de différences, mais que
de ressemblances aussi; parce que chacun cherchait à imprégner ses romans d’une
atmosphère dont les lecteurs pourraient partager des impressions profondes,
voire même intimes que les critiques ont usé du terme impressionniste pour les qualifier. On peut s’étonner d’y retrouver
le poète symboliste Mallarmé dont nous avons parlé au sous-chapitre précédent. Car
«les
et Henry James découvraient déjà un procédé impressionniste : que les faits rapportés,
minutieusement et légèrement peints sur une toile, suggèrent derrière cette
toile, en transparence, une autre réalité indéfinissable. Sous la surface
pittoresque du conte alerte ou fascinant s’imposent le mystère et la profondeur
de l’événement, qui échappent au conte. […] Ce “quelque chose de plus” est déjà l’essentiel du roman
impressionniste : la sensation que derrière le récit objectif - qui devient
alors insuffisant -, au-delà même de la conscience que les personnages prennent
des événements qu’ils vivent, il existe une réalité impénétrable de l’événement…».
En vérité, il y a eu autant de styles impressionnistes en littérature qu’il y
en a eu en peinture. Entre Woolf, Proust, Conrad, que de différences, mais que
de ressemblances aussi; parce que chacun cherchait à imprégner ses romans d’une
atmosphère dont les lecteurs pourraient partager des impressions profondes,
voire même intimes que les critiques ont usé du terme impressionniste pour les qualifier. On peut s’étonner d’y retrouver
le poète symboliste Mallarmé dont nous avons parlé au sous-chapitre précédent. Car
«les  impressionnistes le séduisent parce
que leur esthétique est près de la sienne. Ils laissent deviner plus qu’ils
n’expriment…».
Lui-même, finalement, reconnaîtra l’effort de rattacher sa poésie à la nouvelle
peinture lorsque dans une lettre à son ami Cazalis de 1864, il avouera : «…j’invente une langue qui doit
nécessairement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en
ces deux mots : peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit».
Les peintres impressionnistes étaient ses amis et comme eux, comme les
symbolistes aussi, il refusait de se laisser mettre en cage, même au nom de
l’histoire de l’art : «Mallarmé n’est pas un grand paysagiste. D’abord parce qu’il se défend d’être descriptif,
et parce qu’il a conservé, de ses débuts parnassiens ou de ses dons natifs, une
pudeur de sentiment, une retenue d’émotion que les impassibles n’ont montré ni
plus sévères ni plus constantes. […]
sur la forêt de Fontainebleau, sur “la quiétude menteuse de riches bois
suspendant alentour quelque extraordinaire état d’illusion”, “l’extatique
torpeur des feuillages”, l’étincellement d’un juillet de flammes ou d’un
octobre pompeux, sur la buée d’argent glaçant les saules et les verdures qui
encadrent les ruisseaux et les fleuves, il a des peintures dignes de ses amis
impressionnistes».
Mallarmé se voulait peut-être impressionniste, mais tout Mallarmé ne porte pas
la marque de l’impressionnisme.
impressionnistes le séduisent parce
que leur esthétique est près de la sienne. Ils laissent deviner plus qu’ils
n’expriment…».
Lui-même, finalement, reconnaîtra l’effort de rattacher sa poésie à la nouvelle
peinture lorsque dans une lettre à son ami Cazalis de 1864, il avouera : «…j’invente une langue qui doit
nécessairement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en
ces deux mots : peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit».
Les peintres impressionnistes étaient ses amis et comme eux, comme les
symbolistes aussi, il refusait de se laisser mettre en cage, même au nom de
l’histoire de l’art : «Mallarmé n’est pas un grand paysagiste. D’abord parce qu’il se défend d’être descriptif,
et parce qu’il a conservé, de ses débuts parnassiens ou de ses dons natifs, une
pudeur de sentiment, une retenue d’émotion que les impassibles n’ont montré ni
plus sévères ni plus constantes. […]
sur la forêt de Fontainebleau, sur “la quiétude menteuse de riches bois
suspendant alentour quelque extraordinaire état d’illusion”, “l’extatique
torpeur des feuillages”, l’étincellement d’un juillet de flammes ou d’un
octobre pompeux, sur la buée d’argent glaçant les saules et les verdures qui
encadrent les ruisseaux et les fleuves, il a des peintures dignes de ses amis
impressionnistes».
Mallarmé se voulait peut-être impressionniste, mais tout Mallarmé ne porte pas
la marque de l’impressionnisme.
Les romanciers qui furent de grands voyageurs,
qui eurent l’occasion de voir des paysages inconnus en Occident, qui vécurent
avec des peuples ou dans des endroits d’où se dégageaient une atmosphère
exotique furent, en littérature, ceux qui se rapprochèrent le plus de
l’impressionnisme. De tous, Pierre Loti est sans doute celui qui offre une
poésie s’inscrivant remarquablement dans la veine impressionniste. Louis Marie
 Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-1923) laissa des descriptions des pêcheurs
d’Islande (Pêcheur d’Islande, 1886)
aussi bien que des sérails ottomans (Aziyadé,
1879), des geisha du Japon (Madame
Chrysanthème, 1887) que l’exploration du temple d’Angkor Vat, enfin Tahiti
où la reine Pomaré lui donna ce surnom de Loti. Bref, Loti a visité toutes les
parties du monde en tant qu’officier de marine et, parallèlement à l’évolution
des peintres impressionnistes, il a développé une qualité littéraire dans les
paysages qui se perfectionne de roman en roman. Ainsi, Loti «ne s’est pas encore avisé, en écrivant Aziyadé, de traiter le décor turc autrement qu’en
peintre. Ses descriptions pour la plupart alignent les détails précis, ou
ordonnent les touches de couleur selon une technique impressionniste. Le
Stamboul féerique, cette découverte de Loti, n’apparaît qu’une seule fois dans
son premier roman. […] ce panorama
nocturne de Stamboul est fort éloigné des descriptions habituelles dans Aziyadé et dont un exemple nous est donné par ce
tableau (esquisse plutôt), de Salonique : elle “n’est plus bientôt qu’une tache
grise qui s’étale sur des montagnes jaunes et arides, une tache hérissée de
pointes blanches qui sont des minarets et de pointes noires qui sont des cyprès».
Pour Hassan El Nouty, c’est lorsque Loti s’attarde à décrire la rencontre du
désert tunisien et de la mer qu’il atteint la perfection de son art : «Et cependant, rien n’égale en splendeur le
monde désertique. Loti, peintre, ne se surpasse dans aucune autre œuvre. Le
désert, après l’Oued-el-Aïn, c’est “le royaume du gris, du gris mat, comme
saupoudré de cendre et veiné çà et là de brun ardent”. Quelle munificence dans
le tableau de la mer et du désert : “L’ensemble des choses est rose, mais il
est comme barré en son milieu par une longue bande infinie, presque noire à
force d’être intensément bleue, et qu’il
Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-1923) laissa des descriptions des pêcheurs
d’Islande (Pêcheur d’Islande, 1886)
aussi bien que des sérails ottomans (Aziyadé,
1879), des geisha du Japon (Madame
Chrysanthème, 1887) que l’exploration du temple d’Angkor Vat, enfin Tahiti
où la reine Pomaré lui donna ce surnom de Loti. Bref, Loti a visité toutes les
parties du monde en tant qu’officier de marine et, parallèlement à l’évolution
des peintres impressionnistes, il a développé une qualité littéraire dans les
paysages qui se perfectionne de roman en roman. Ainsi, Loti «ne s’est pas encore avisé, en écrivant Aziyadé, de traiter le décor turc autrement qu’en
peintre. Ses descriptions pour la plupart alignent les détails précis, ou
ordonnent les touches de couleur selon une technique impressionniste. Le
Stamboul féerique, cette découverte de Loti, n’apparaît qu’une seule fois dans
son premier roman. […] ce panorama
nocturne de Stamboul est fort éloigné des descriptions habituelles dans Aziyadé et dont un exemple nous est donné par ce
tableau (esquisse plutôt), de Salonique : elle “n’est plus bientôt qu’une tache
grise qui s’étale sur des montagnes jaunes et arides, une tache hérissée de
pointes blanches qui sont des minarets et de pointes noires qui sont des cyprès».
Pour Hassan El Nouty, c’est lorsque Loti s’attarde à décrire la rencontre du
désert tunisien et de la mer qu’il atteint la perfection de son art : «Et cependant, rien n’égale en splendeur le
monde désertique. Loti, peintre, ne se surpasse dans aucune autre œuvre. Le
désert, après l’Oued-el-Aïn, c’est “le royaume du gris, du gris mat, comme
saupoudré de cendre et veiné çà et là de brun ardent”. Quelle munificence dans
le tableau de la mer et du désert : “L’ensemble des choses est rose, mais il
est comme barré en son milieu par une longue bande infinie, presque noire à
force d’être intensément bleue, et qu’il  faudrait peindre avec du bleu de
Prusse pur légèrement zébré de vert émeraude. Cette bande, c’est la mer,
l’invraisemblable mer d’Akabah; elle coupe le désert en deux nettement,
crûment: elle en fait deux parts, deux zones d’une couleur d’hortensia, d’un
rose exquis de nuage de soir, où, par opposition avec ces eaux aux couleurs
trop violentes et aux contours trop durs, tout semble vaporeux, indécis à force
de miroiter et d’éblouir, où tout étincelle de nacre, de granit et de mica, où
tout tremble de chaleur et de mirage…”».
La capacité de décrire l’atmosphère plutôt que les lignes géographiques, ce qui
relevait de l’officier de marine plus que du poète, suffit à en faire un
véritable artiste impressionniste. «Certes
Loti le magicien transfigure toujours ce qu’il touche, et étire sur les choses
un voile de poésie ou de féerie. À Hébron, il “marche dans une buée de
poussière, dans une odeur d’épices et d’ambre”. [En Galilée], il déroule sur le ciel un léger “voile de
vapeurs ténues, comme pour tamiser un peu le soleil… comme pour protéger tant
de myriades de petites corolles légères…”».
Mais Loti n’est pas le seul à avoir eu ce talent. Lorsque la fille du président
de la République, Lucie Félix-Faure (1866-1913), dont on cru un instant à un
éventuel mariage avec Marcel Proust, décrit à son tour le Moyen-Orient, «les mosquées d’Égypte se réduisent à des
taches de couleurs : “Fins minarets roses”, dans un ciel bleu tendre, et que le
soleil transforme en “lumières roses”. Le pays même ne serait qu’une immense
palette verte semée de points bleus, qui sont les robes des fellahs, et où le
lac Timsah représente “une turquoise verdie enchâssée par les sables”».
faudrait peindre avec du bleu de
Prusse pur légèrement zébré de vert émeraude. Cette bande, c’est la mer,
l’invraisemblable mer d’Akabah; elle coupe le désert en deux nettement,
crûment: elle en fait deux parts, deux zones d’une couleur d’hortensia, d’un
rose exquis de nuage de soir, où, par opposition avec ces eaux aux couleurs
trop violentes et aux contours trop durs, tout semble vaporeux, indécis à force
de miroiter et d’éblouir, où tout étincelle de nacre, de granit et de mica, où
tout tremble de chaleur et de mirage…”».
La capacité de décrire l’atmosphère plutôt que les lignes géographiques, ce qui
relevait de l’officier de marine plus que du poète, suffit à en faire un
véritable artiste impressionniste. «Certes
Loti le magicien transfigure toujours ce qu’il touche, et étire sur les choses
un voile de poésie ou de féerie. À Hébron, il “marche dans une buée de
poussière, dans une odeur d’épices et d’ambre”. [En Galilée], il déroule sur le ciel un léger “voile de
vapeurs ténues, comme pour tamiser un peu le soleil… comme pour protéger tant
de myriades de petites corolles légères…”».
Mais Loti n’est pas le seul à avoir eu ce talent. Lorsque la fille du président
de la République, Lucie Félix-Faure (1866-1913), dont on cru un instant à un
éventuel mariage avec Marcel Proust, décrit à son tour le Moyen-Orient, «les mosquées d’Égypte se réduisent à des
taches de couleurs : “Fins minarets roses”, dans un ciel bleu tendre, et que le
soleil transforme en “lumières roses”. Le pays même ne serait qu’une immense
palette verte semée de points bleus, qui sont les robes des fellahs, et où le
lac Timsah représente “une turquoise verdie enchâssée par les sables”».
 |
| Pierre Loti dans son bureau. |
 |
| Édouard Manet. Portrait d'Émile Zola |
 |
| Paul Cézanne. Portrait d'Émile Zola, |
 |
| Vincent Van Gogh. Nuit étoilée, 1889. |
 Les deux auteurs français dont on peut dire que
l’impressionnisme fut tout entier dans la composition de leurs œuvres, c’est
Marcel Proust (1871-1922) et Alain-Fournier (1886-1914).
Albérès nous dit qu’«aborder la réalité
uniquement à travers les impressions est la découverte de Proust. Ne louait-il
pas Mme de Sévigné parce “qu’elle nous présente les choses dans l’ordre de
nos perceptions, au lieu de les expliquer
d’abord par leur cause”? La grande œuvre de PROUST
apparaît, cependant, au premier abord comme une longue chronique mondaine mêlée
à la biographie du narrateur. Les grands moments en sont longs, compacts, et il
faut une coupure entre les divers tomes pour les séparer, pour faire avancer le
temps du récit : l’enfance d’un enfant nerveux à Combray, le personnage de
Swann qui se détache parmi les relations de ses parents, la présence
solennelle, d’un autre côté, de la famille de Guermantes. Brusquement,
l’histoire des amours de Swann et d’Odette de Crécy, récit à la troisième
personne, nous éloigne du narrateur, et permet de faire “passer” le temps.
Marcel reparaît dans
À l’ombre des jeunes filles en fleur, adolescent
amoureux de la petite Gilberte Swann, avec qui il joue aux Champs-Élysées. Puis
les saisons à Balbec, les jeunes filles, une première apparition de Saint-Loup,
de Charlus. À partir du Côté de Guermantes, Marcel est adulte et c’est, à Paris, la vie mondaine, les salons, Verdurin,
Guermantes, Cottard. De
Les deux auteurs français dont on peut dire que
l’impressionnisme fut tout entier dans la composition de leurs œuvres, c’est
Marcel Proust (1871-1922) et Alain-Fournier (1886-1914).
Albérès nous dit qu’«aborder la réalité
uniquement à travers les impressions est la découverte de Proust. Ne louait-il
pas Mme de Sévigné parce “qu’elle nous présente les choses dans l’ordre de
nos perceptions, au lieu de les expliquer
d’abord par leur cause”? La grande œuvre de PROUST
apparaît, cependant, au premier abord comme une longue chronique mondaine mêlée
à la biographie du narrateur. Les grands moments en sont longs, compacts, et il
faut une coupure entre les divers tomes pour les séparer, pour faire avancer le
temps du récit : l’enfance d’un enfant nerveux à Combray, le personnage de
Swann qui se détache parmi les relations de ses parents, la présence
solennelle, d’un autre côté, de la famille de Guermantes. Brusquement,
l’histoire des amours de Swann et d’Odette de Crécy, récit à la troisième
personne, nous éloigne du narrateur, et permet de faire “passer” le temps.
Marcel reparaît dans
À l’ombre des jeunes filles en fleur, adolescent
amoureux de la petite Gilberte Swann, avec qui il joue aux Champs-Élysées. Puis
les saisons à Balbec, les jeunes filles, une première apparition de Saint-Loup,
de Charlus. À partir du Côté de Guermantes, Marcel est adulte et c’est, à Paris, la vie mondaine, les salons, Verdurin,
Guermantes, Cottard. De  cette période se détachent deux “massifs” amoureux :
Sodome et Gomorrhe, et la longue aventure
de l’auteur avec Albertine. Enfin, dans le dernier livre, Le Temps retrouvé une dernière revue des personnages,
vieillis, à l’époque de la guerre».
Aucun autre auteur ne peut revendiquer une proximité semblable avec les
intentions et la méthode picturale des impressionnistes. Proust a hérité de la
mélancolie qui hantait les tableaux de Monet, de Degas et de Pissarro. Au-delà
des descriptions de la réalité du monde, au-delà des intrigues et des aventures
qui ont tant habité les romans du XIXe siècle, la méthode impressionniste en
littérature oblige à un repli sur soi. Repli mélancolique disions-nous, car
conduit toujours à la désillusion et au désenchantement des expériences
antérieures. «Rendre à l’impression sa vérité première. Car nous ne nous
soucions pas de nos impressions: nous nous dépêchons et les interpréter, pour
les expliquer à nous-mêmes ou à autrui : c’est le début du mensonge romanesque.
Au contraire, derrière les explications, Proust recherche la réalité première,
le senti dans sa vérité originelle et, semble-t-il,
absolue. Art difficile, que de réapprendre à sentir pleinement: étant la
première, la sensation est le plus tôt oubliée, déformée, fanée. Et il faut par
suite ruser avec l’esprit et la prendre
cette période se détachent deux “massifs” amoureux :
Sodome et Gomorrhe, et la longue aventure
de l’auteur avec Albertine. Enfin, dans le dernier livre, Le Temps retrouvé une dernière revue des personnages,
vieillis, à l’époque de la guerre».
Aucun autre auteur ne peut revendiquer une proximité semblable avec les
intentions et la méthode picturale des impressionnistes. Proust a hérité de la
mélancolie qui hantait les tableaux de Monet, de Degas et de Pissarro. Au-delà
des descriptions de la réalité du monde, au-delà des intrigues et des aventures
qui ont tant habité les romans du XIXe siècle, la méthode impressionniste en
littérature oblige à un repli sur soi. Repli mélancolique disions-nous, car
conduit toujours à la désillusion et au désenchantement des expériences
antérieures. «Rendre à l’impression sa vérité première. Car nous ne nous
soucions pas de nos impressions: nous nous dépêchons et les interpréter, pour
les expliquer à nous-mêmes ou à autrui : c’est le début du mensonge romanesque.
Au contraire, derrière les explications, Proust recherche la réalité première,
le senti dans sa vérité originelle et, semble-t-il,
absolue. Art difficile, que de réapprendre à sentir pleinement: étant la
première, la sensation est le plus tôt oubliée, déformée, fanée. Et il faut par
suite ruser avec l’esprit et la prendre  en défaut, pour revenir à l’intuition
primordiale».
C’est la fameuse proclamation de Proust qui situe son œuvre romanesque face à
la littérature antérieure : «L’histoire
des personnages est l’histoire de ses impressions; sa propre histoire est aussi
celle des héros».
Et le mot impression n’est pas lancé
ici par hasard, comme chez Monet pour son Voilier
d’Argenteuil. Proust écrit, «dans Jean
Santeuil cet étonnant passage sur Monet :
“Quand, le soleil perçant déjà, la rivière dort encore dans les songes du
brouillard, nous ne la voyons pas plus qu’elle ne se voit elle-même. Ici c’est
déjà la rivière, mais là la vue est arrêtée, on ne voit plus rien que le néant,
une brume qui empêche qu’on ne voie plus loin. À cet endroit de la toile,
peindre ni ce qu’on voit puisqu’on ne voit rien, ni ce qu’on ne voit pas
puisqu’on ne doit peindre que ce qu’on voit, mais peindre qu’on ne voit pas,
que la défaillance de l’œil qui ne peut pas voguer sur le brouillard lui soit
infligée sur la toile comme sur la rivière, c’est bien beau”».
en défaut, pour revenir à l’intuition
primordiale».
C’est la fameuse proclamation de Proust qui situe son œuvre romanesque face à
la littérature antérieure : «L’histoire
des personnages est l’histoire de ses impressions; sa propre histoire est aussi
celle des héros».
Et le mot impression n’est pas lancé
ici par hasard, comme chez Monet pour son Voilier
d’Argenteuil. Proust écrit, «dans Jean
Santeuil cet étonnant passage sur Monet :
“Quand, le soleil perçant déjà, la rivière dort encore dans les songes du
brouillard, nous ne la voyons pas plus qu’elle ne se voit elle-même. Ici c’est
déjà la rivière, mais là la vue est arrêtée, on ne voit plus rien que le néant,
une brume qui empêche qu’on ne voie plus loin. À cet endroit de la toile,
peindre ni ce qu’on voit puisqu’on ne voit rien, ni ce qu’on ne voit pas
puisqu’on ne doit peindre que ce qu’on voit, mais peindre qu’on ne voit pas,
que la défaillance de l’œil qui ne peut pas voguer sur le brouillard lui soit
infligée sur la toile comme sur la rivière, c’est bien beau”».
Cette expérience a été reprise en Angleterre par
la romancière Virginia Woolf (1882-1941). Woolf, comme Proust et Joyce est
l’une de ces auteurs qui travaillent sur le temps, à la manière dont Cézanne
observait selon les heures l’ensoleillement de la montagne Sainte-Victoire.
Comment en une journée, Clarissa, Marcel ou Stephen pouvaient-ils passer dans
des états contrastants d’attitudes, de caractères, bref d’atmosphère
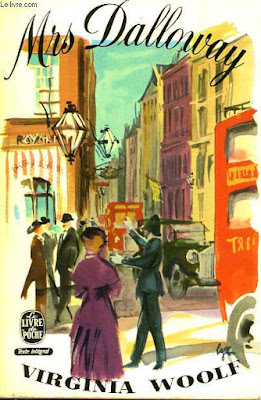 intérieure? «L’homme n’est rien, qu’un
rapport entre la conscience et les choses et, dans ce bref rapport, flamboient
la richesse et la mortalité de la vie. À son extrême, l’art impressionniste
livre son ressort et sa matière; l’avidité, pour s’assurer de vivre, d’étaler
autour de soi le monde sensible, et de renouveler ses noces avec lui, dans la
brume des mariages mystiques et périssables. Dans tous les livres de Virginia
Woolf, des êtres terriblement préoccupés d’eux-mêmes s’enfoncent dans leurs sensations, craignant sans cesse de ne rien trouver devant cette avidité
intérieure, redoutant que ce fragile lien s’efface entre le monde et la
conscience, comme il arrive à Septimus Warren Smith : “Il était saisi, surtout
le soir, de ces foudroyants accès de peur. Il ne sentait plus rien.”
Ravissement, au contraire, de se trouver sensible encore aux rumeurs et aux
couleurs du monde, de s’apercevoir que l’on aime la vie: “Qui sait pourquoi
nous l’aimons ainsi, pourquoi nous le voyons ainsi, pourquoi nous l’élevons
autour de nous, la construisons, la détruisons - et la recréons à chaque
minute? Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, leur
tumulte, dans le fracas, dans le vacarme, voitures, autos, omnibus, camions,
hommes-sandwich traînant et oscillant, orchestres, orgues de Barbarie, dans le
triomphe et dans le tintement et dans le chant étranger d,un aéroplane
au-dessus de sa tête, il y avait ce qu’elle aimai t: la vie, Londres, ce moment
de juin” [V. Woolf. Mrs Dalloway]».
Le monde devient cette réalité impénétrable, ténébreuse, dont il est possible
toutefois de s’arrêter à en observer la surface. Parfois, les nuages se
dissipent et la personnalité se révèle dans ses coloris, ses tons, ses
modifications. Pour le voir, il faut cesser d’être retenu par la fausseté de
l’intrigue, il faut rentrer dans le caractère des personnages qui demeurent
seul digne d’intérêt : «Sous la surface
de l’existence, apparaît peu à peu sa transparence… L’honnête roman
intérieure? «L’homme n’est rien, qu’un
rapport entre la conscience et les choses et, dans ce bref rapport, flamboient
la richesse et la mortalité de la vie. À son extrême, l’art impressionniste
livre son ressort et sa matière; l’avidité, pour s’assurer de vivre, d’étaler
autour de soi le monde sensible, et de renouveler ses noces avec lui, dans la
brume des mariages mystiques et périssables. Dans tous les livres de Virginia
Woolf, des êtres terriblement préoccupés d’eux-mêmes s’enfoncent dans leurs sensations, craignant sans cesse de ne rien trouver devant cette avidité
intérieure, redoutant que ce fragile lien s’efface entre le monde et la
conscience, comme il arrive à Septimus Warren Smith : “Il était saisi, surtout
le soir, de ces foudroyants accès de peur. Il ne sentait plus rien.”
Ravissement, au contraire, de se trouver sensible encore aux rumeurs et aux
couleurs du monde, de s’apercevoir que l’on aime la vie: “Qui sait pourquoi
nous l’aimons ainsi, pourquoi nous le voyons ainsi, pourquoi nous l’élevons
autour de nous, la construisons, la détruisons - et la recréons à chaque
minute? Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, leur
tumulte, dans le fracas, dans le vacarme, voitures, autos, omnibus, camions,
hommes-sandwich traînant et oscillant, orchestres, orgues de Barbarie, dans le
triomphe et dans le tintement et dans le chant étranger d,un aéroplane
au-dessus de sa tête, il y avait ce qu’elle aimai t: la vie, Londres, ce moment
de juin” [V. Woolf. Mrs Dalloway]».
Le monde devient cette réalité impénétrable, ténébreuse, dont il est possible
toutefois de s’arrêter à en observer la surface. Parfois, les nuages se
dissipent et la personnalité se révèle dans ses coloris, ses tons, ses
modifications. Pour le voir, il faut cesser d’être retenu par la fausseté de
l’intrigue, il faut rentrer dans le caractère des personnages qui demeurent
seul digne d’intérêt : «Sous la surface
de l’existence, apparaît peu à peu sa transparence… L’honnête roman  réaliste
éclairait dans ses moindres recoins une réalité offerte à toutes les
investigations et à toutes les enquêtes, l’impressionnisme ne se fie plus à
cette docilité et à cette présence immédiate du monde : “Tâchons de croire, dit
Virginia Woolf, que la vie est un objet solide, un globe que nous pouvons faire
tourner sous nos doigts. Tâchons de croire qu’on peut en faire un récit simple
et logique, en finir avec l’amour par exemple, et passer au chapitre suivant…”
Mais en vain… Pour la sensibilité nouvelle la vie est une profondeur trouble où
la lumière de la conscience miroite seulement, se diffracte et s’épanouit avant
de se perdre, comme les rayons du soleil lentement diffusés, puis absorbés dans
l’eau, jusqu’à la cécité des profondeurs… Multiple, tourbillonnante, faite de
poussières lumineuses suspendues dans le vide, la réalité impressionniste ne se
raconte pas, ne se décrit même point. Les paroles, les gestes menus des hommes,
hésitations et arabesques, indiquent à peine quelques lignes, à la surface de
cette nébuleuse qui est la réalité, qui est la “Vie”. Le lecteur est ainsi
transporté dans un univers en fusion, déconcerté par une optique nouvelle…».
Voilà pourquoi Albérès en appelle avant tout au pointillisme dans le cas des
romans de Virginia Woolf : «Ce roman
pointilliste et inépuisable semble avoir découvert une autre profondeur de la
vie : un “niveau” océanique qui n’avait pas encore été exploré, celui où
l’impression compte plus que les raisons et les vérités objectives… On ne
saurait le condamner en le réduisant à une tentative purement esthétique :
qu’est-ce qui est plus “vrai”, la représentation habituelle et raisonnable des
choses qui constitue notre vie commune, ou bien nos
réaliste
éclairait dans ses moindres recoins une réalité offerte à toutes les
investigations et à toutes les enquêtes, l’impressionnisme ne se fie plus à
cette docilité et à cette présence immédiate du monde : “Tâchons de croire, dit
Virginia Woolf, que la vie est un objet solide, un globe que nous pouvons faire
tourner sous nos doigts. Tâchons de croire qu’on peut en faire un récit simple
et logique, en finir avec l’amour par exemple, et passer au chapitre suivant…”
Mais en vain… Pour la sensibilité nouvelle la vie est une profondeur trouble où
la lumière de la conscience miroite seulement, se diffracte et s’épanouit avant
de se perdre, comme les rayons du soleil lentement diffusés, puis absorbés dans
l’eau, jusqu’à la cécité des profondeurs… Multiple, tourbillonnante, faite de
poussières lumineuses suspendues dans le vide, la réalité impressionniste ne se
raconte pas, ne se décrit même point. Les paroles, les gestes menus des hommes,
hésitations et arabesques, indiquent à peine quelques lignes, à la surface de
cette nébuleuse qui est la réalité, qui est la “Vie”. Le lecteur est ainsi
transporté dans un univers en fusion, déconcerté par une optique nouvelle…».
Voilà pourquoi Albérès en appelle avant tout au pointillisme dans le cas des
romans de Virginia Woolf : «Ce roman
pointilliste et inépuisable semble avoir découvert une autre profondeur de la
vie : un “niveau” océanique qui n’avait pas encore été exploré, celui où
l’impression compte plus que les raisons et les vérités objectives… On ne
saurait le condamner en le réduisant à une tentative purement esthétique :
qu’est-ce qui est plus “vrai”, la représentation habituelle et raisonnable des
choses qui constitue notre vie commune, ou bien nos  impressions premières,
avant qu’elles soient réduites à un commun dénominateur, ces sensations brutes,
personnelles et vertigineuses, colorées, indistinctes comme la poussière du
temps, qui sont l’élément originel de notre vie consciente? Nous avons pris
pour règle, sauf dans l’enfance, dans le rêve et dans la psychanalyse, de les
refouler ou de les rationaliser… Pour les impressionnistes, elles constituent
la vérité première, la matière originelle et indéfinissable de l’existence. De
Virginia Woolf à Nathalie Sarraute, tout un art existe, qui cherche à saisir le
jaillissement premier de l’impression, le “courant de conscience” et il n’est
que trop aisé d’évoquer à ce sujet l’ombre de Bergson. Alors que le roman
traditionnel donne une vérité intellectualisée et mécanisée, le roman
impressionniste livre le flux incohérent et dynamique de la “vie vécue”, le sentiment
profond de l’existence».
Si l’impressionnisme identifié dans les œuvres de Virginia Woolf en appelle à
l’impression qui jaillit des relations entre les personnages et leur retour
intime, la sensibilité à l’existence est un thème proprement du XXe siècle.
Ici, l’impressionnisme en littérature nous rappelle qu’il est un tard venu et
qu’il se distingue franchement du naturalisme de Zola malgré ses références aux
peintres impressionnistes.
impressions premières,
avant qu’elles soient réduites à un commun dénominateur, ces sensations brutes,
personnelles et vertigineuses, colorées, indistinctes comme la poussière du
temps, qui sont l’élément originel de notre vie consciente? Nous avons pris
pour règle, sauf dans l’enfance, dans le rêve et dans la psychanalyse, de les
refouler ou de les rationaliser… Pour les impressionnistes, elles constituent
la vérité première, la matière originelle et indéfinissable de l’existence. De
Virginia Woolf à Nathalie Sarraute, tout un art existe, qui cherche à saisir le
jaillissement premier de l’impression, le “courant de conscience” et il n’est
que trop aisé d’évoquer à ce sujet l’ombre de Bergson. Alors que le roman
traditionnel donne une vérité intellectualisée et mécanisée, le roman
impressionniste livre le flux incohérent et dynamique de la “vie vécue”, le sentiment
profond de l’existence».
Si l’impressionnisme identifié dans les œuvres de Virginia Woolf en appelle à
l’impression qui jaillit des relations entre les personnages et leur retour
intime, la sensibilité à l’existence est un thème proprement du XXe siècle.
Ici, l’impressionnisme en littérature nous rappelle qu’il est un tard venu et
qu’il se distingue franchement du naturalisme de Zola malgré ses références aux
peintres impressionnistes.
 |
| Toulouse Lautrec. Loïe Fuller aux Folies-Bergères |
 L’achèvement de cette fresque qu’est La recherche du temps perdu de Proust coïncide avec la Grande Guerre,
accompagne chronologiquement la fin de l’art impressionniste. Le suicide de Van
Gogh (1890), le départ de Gauguin pour Tahiti un an plus tard et le décès de
Seurat (1891), marquent avec la mort du post-impressionnisme la fin de la
mouvance en peinture. Ce n’est plus dans la nature, ni même dans les rues de
Paris ou les guinguettes que s’acheva l’impressionnisme, pas même dans les
coulisses des salles de ballet fréquentées par Degas, mais aux Folies-Bergères, avec le nain
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Descendant de la vieille noblesse des ducs de
Toulouse, victime dans son enfance de deux accidents successifs qui le
laissèrent infirme des jambes, alcoolique, excentrique, pathétique, ce créateur
d’affiches remarquables est à placer aux côtés de Van Gogh pour la tristesse et
la souffrance d’une existence apparemment condamnée sans lendemains, des
lendemains qui vinrent seulement après leur mort. L’impression restait fixée à
l’œuvre que son auteur vivait une malédiction dont il semblait le seul
responsable : «D’emblée l’artiste a
fait son choix, le plus catholique qui soit : s’abandonner corps et âme à la
chute. Pour le corps ce fut facile, la nature lui ayant donné un sérieux coup
de main. Restait l’âme… Restait à s’abandonner à la paulinienne corruption, à
l’originelle ignominie, mieux à la provoquer, en toute conscience, en toute
volonté, à la pousser et à la vivre jusqu’à ses ultimes conséquences».
Il est paradoxal que, côtoyant le développement de l’expressionnisme à travers
le fauvisme puis le futurisme, l’impressionnisme fut le mode d’après lequel les
peintres de guerre exprimèrent la réalité vécue des tranchées, des tirs d’obus
et
L’achèvement de cette fresque qu’est La recherche du temps perdu de Proust coïncide avec la Grande Guerre,
accompagne chronologiquement la fin de l’art impressionniste. Le suicide de Van
Gogh (1890), le départ de Gauguin pour Tahiti un an plus tard et le décès de
Seurat (1891), marquent avec la mort du post-impressionnisme la fin de la
mouvance en peinture. Ce n’est plus dans la nature, ni même dans les rues de
Paris ou les guinguettes que s’acheva l’impressionnisme, pas même dans les
coulisses des salles de ballet fréquentées par Degas, mais aux Folies-Bergères, avec le nain
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Descendant de la vieille noblesse des ducs de
Toulouse, victime dans son enfance de deux accidents successifs qui le
laissèrent infirme des jambes, alcoolique, excentrique, pathétique, ce créateur
d’affiches remarquables est à placer aux côtés de Van Gogh pour la tristesse et
la souffrance d’une existence apparemment condamnée sans lendemains, des
lendemains qui vinrent seulement après leur mort. L’impression restait fixée à
l’œuvre que son auteur vivait une malédiction dont il semblait le seul
responsable : «D’emblée l’artiste a
fait son choix, le plus catholique qui soit : s’abandonner corps et âme à la
chute. Pour le corps ce fut facile, la nature lui ayant donné un sérieux coup
de main. Restait l’âme… Restait à s’abandonner à la paulinienne corruption, à
l’originelle ignominie, mieux à la provoquer, en toute conscience, en toute
volonté, à la pousser et à la vivre jusqu’à ses ultimes conséquences».
Il est paradoxal que, côtoyant le développement de l’expressionnisme à travers
le fauvisme puis le futurisme, l’impressionnisme fut le mode d’après lequel les
peintres de guerre exprimèrent la réalité vécue des tranchées, des tirs d’obus
et  de canons et des mêlées humaines sanglantes. Est-ce à dire que la guerre
n’exprimait rien sinon que d’elles ne pouvaient jaillir que des impressions impératives
à transmettre au monde? Si les impressionnistes américains eurent tendance à
reprendre les thèmes naturels qu’ils avaient appris de leurs maîtres français,
très vite ils s’orientèrent vers l’impression issue des changements sociaux et
culturels qui frappaient de grandes villes comme New York (Everett Shinn) ou la
tranquillité paisible des intérieurs (Mary Cassatt). Le post-impressionniste
allemand donna en Walter Sickert (1860-1942) une figure inquiétante dont les
tableaux confinaient parfois à l’horreur ou du moins à l’angoisse, comme ce
tableau sensé avoir été peint dans une chambre qu’aurait occupée Jack
l’Éventreur. La romancière Patricia Cornwell reste persuadée que Sickert serait
bien le tueur en série de Whitechapel, bien que depuis on aurait confirmé que
le véritable Jack l’Éventreur aurait été un suspect de l’époque, Aaron
Kosminski, un coiffeur d’origine polonaise. N’empêche. «Dessiner des morts n’était pas une chose inhabituelle chez Sickert.
Durant la Première Guerre mondiale, il était obsédé par les soldats blessés et
agonisants, leurs uniformes et leurs armes. Il en collectionna un certain
nombre et maintint
de canons et des mêlées humaines sanglantes. Est-ce à dire que la guerre
n’exprimait rien sinon que d’elles ne pouvaient jaillir que des impressions impératives
à transmettre au monde? Si les impressionnistes américains eurent tendance à
reprendre les thèmes naturels qu’ils avaient appris de leurs maîtres français,
très vite ils s’orientèrent vers l’impression issue des changements sociaux et
culturels qui frappaient de grandes villes comme New York (Everett Shinn) ou la
tranquillité paisible des intérieurs (Mary Cassatt). Le post-impressionniste
allemand donna en Walter Sickert (1860-1942) une figure inquiétante dont les
tableaux confinaient parfois à l’horreur ou du moins à l’angoisse, comme ce
tableau sensé avoir été peint dans une chambre qu’aurait occupée Jack
l’Éventreur. La romancière Patricia Cornwell reste persuadée que Sickert serait
bien le tueur en série de Whitechapel, bien que depuis on aurait confirmé que
le véritable Jack l’Éventreur aurait été un suspect de l’époque, Aaron
Kosminski, un coiffeur d’origine polonaise. N’empêche. «Dessiner des morts n’était pas une chose inhabituelle chez Sickert.
Durant la Première Guerre mondiale, il était obsédé par les soldats blessés et
agonisants, leurs uniformes et leurs armes. Il en collectionna un certain
nombre et maintint  des relations intimes avec des bénévoles de la Croix-Rouge, à
qui il demandait de le prévenir quand de malheureux patients n’avaient plus
besoin de leurs uniformes».
Dessiner des champs de batailles, des tranchées, des cadavres mutilés, ce
n’était pas au départ dans le programme des impressionnistes, quels que furent leurs
tendances ou leurs styles. Une décadence, voire une déchéance c’était produite
au cours des années. Comment l’expliquer? «L’impressionnisme
[…] était tellement récent, tellement
puissant et si étroitement associé à l’humiliation de 1870 qu’il devint
progressivement la “bête noire” artistique non seulement de la droite, mais
aussi de l’avant-garde soi-disant progressiste. En outre, en cette époque
d’urgence nationale, son esthétique rebelle - son refus des pratiques
académiques - rendait l’impressionnisme encore moins recommandable. Lhote, en
1916, tout en reconnaissant que les artistes contemporains pouvaient encore
tirer profit des enseignements de l’impressionnisme, n’en estimait pas moins
que le mouvement constituait un précédent hautement problématique. […] Le célèbre aphorisme de Picasso -
“Travailler avec trois couleurs, trop de couleurs font de l’impressionnisme” -
que nous connaissons grâce aux carnets tenus par Cocteau…».
Y avait-il véritablement trop de couleurs
pour que l’humeur chagrine des peintres impressionnistes puissent réellement
établir une mouvance capable d’être un nouveau classicisme, et cela, malgré le
génie qui l’avait porté sur les eaux?⌛
des relations intimes avec des bénévoles de la Croix-Rouge, à
qui il demandait de le prévenir quand de malheureux patients n’avaient plus
besoin de leurs uniformes».
Dessiner des champs de batailles, des tranchées, des cadavres mutilés, ce
n’était pas au départ dans le programme des impressionnistes, quels que furent leurs
tendances ou leurs styles. Une décadence, voire une déchéance c’était produite
au cours des années. Comment l’expliquer? «L’impressionnisme
[…] était tellement récent, tellement
puissant et si étroitement associé à l’humiliation de 1870 qu’il devint
progressivement la “bête noire” artistique non seulement de la droite, mais
aussi de l’avant-garde soi-disant progressiste. En outre, en cette époque
d’urgence nationale, son esthétique rebelle - son refus des pratiques
académiques - rendait l’impressionnisme encore moins recommandable. Lhote, en
1916, tout en reconnaissant que les artistes contemporains pouvaient encore
tirer profit des enseignements de l’impressionnisme, n’en estimait pas moins
que le mouvement constituait un précédent hautement problématique. […] Le célèbre aphorisme de Picasso -
“Travailler avec trois couleurs, trop de couleurs font de l’impressionnisme” -
que nous connaissons grâce aux carnets tenus par Cocteau…».
Y avait-il véritablement trop de couleurs
pour que l’humeur chagrine des peintres impressionnistes puissent réellement
établir une mouvance capable d’être un nouveau classicisme, et cela, malgré le
génie qui l’avait porté sur les eaux?⌛
 |
| Vincent Van Gogh. Le champ de blé aux corbeaux, 1890. |
Montréal
28 avril 2016
P. Muray. Le dix-neuvième
siècle à travers les âges, Paris, Denoël, Col. L’infini, 1999, p. 75.
M. Eksteins. Le sacre du
printemps, Paris, Plon, 1991, p. 46


 comme par ses
différentes ruptures internes, il marqua une rupture avec la continuité de
l’histoire de l’art. Pour Philippe Muray, dans son dix-neuvième siècle à travers les âges, l’Occident «avait connu les
paradis de la chair de Titien, Tintoret, Véronèse, Rubens, les constellations
de femmes nues offertes aux souverains catholiques. Le monde déraidi, comme dit
sublimement Claudel, où passe le souffle de l’esprit, où s’ouvrent les chemins
de la nuit obscure et des estuaires du ciel. Les émissions vénitiennes de
lumière laser d’un côté, de l’autre les féeries dans le puisard de Bosch ou
Brueghel. Cocagnes et Tentations. Le 19e, c’est une tout autre affaire. D’abord
une excursion exotique, les fauves, plumes, palmes, oiseaux de feu, lianes :
Delacroix, Gros, Géricault, Ingres, Barye, Chassériau, Odilon Redon. Nymphes, odalisques, culs-de-lampes. Gothique, Gustave Doré. Puis l’apparente fuite
comme par ses
différentes ruptures internes, il marqua une rupture avec la continuité de
l’histoire de l’art. Pour Philippe Muray, dans son dix-neuvième siècle à travers les âges, l’Occident «avait connu les
paradis de la chair de Titien, Tintoret, Véronèse, Rubens, les constellations
de femmes nues offertes aux souverains catholiques. Le monde déraidi, comme dit
sublimement Claudel, où passe le souffle de l’esprit, où s’ouvrent les chemins
de la nuit obscure et des estuaires du ciel. Les émissions vénitiennes de
lumière laser d’un côté, de l’autre les féeries dans le puisard de Bosch ou
Brueghel. Cocagnes et Tentations. Le 19e, c’est une tout autre affaire. D’abord
une excursion exotique, les fauves, plumes, palmes, oiseaux de feu, lianes :
Delacroix, Gros, Géricault, Ingres, Barye, Chassériau, Odilon Redon. Nymphes, odalisques, culs-de-lampes. Gothique, Gustave Doré. Puis l’apparente fuite  à la
campagne : Millet, Pissarro, Sisley. Ou encore Gauguin, la nef bardée d’idoles
polynésiennes partie à la recherche de l’Empire du soleil. Mais tout cela en
même temps raconte un effondrement, et on peut appeler cette décomposition
minutieuse “impressionnisme”, ce n’est jamais qu’un malentendu de plus. Le
fameux passage à la lumière ou aux couleurs pures n’annonce que l’implosion
dans un trou noir de tout ce qui, en même temps que c’est peint, disparaît en
lambeaux et en amas, en particules et nébuleuses. “Nous sommes au quatrième
quart d’un siècle qui finira par une révolution colossale”, écrivait encore Van Gogh. Mais une chose importe, continuait-il, “c’est de ne pas être dupe de la
fausseté de son époque, pas au point toutefois qu’on n’y repère les heures
malsaines, étouffantes et déprimées qui précèdent l’orage”».[1]
Philippe Muray, qui s’en prend impitoyablement à tous les mythes du XIXe
siècle, se rallie à la tradition des refusés.
Il participe au mythe impressionniste en enchérissant sur les dénonciations
qui ont commencé dès la production des premières toiles du genre. L’historien
de l’art, Pierre Francastel, longtemps avant lui, avait nuancé le mythe :
«Si l’on admet que c’est avec
l’impressionnisme que se pose vraiment la question de l’effondrement de
l’ancien espace plastique, encore faut-il distinguer. Je ne songe pas un moment
à soutenir l’idée absurde, que les impressionnistes ont été, tout d’un coup,
des novateurs et rien d’autre. Ils ont, au contraire, cheminé péniblement, à
petits coups, avec des repentirs, des fausses voies. Ils ont été, dans
l’ensemble, des précurseurs plutôt que des réalisateurs».[2]
Mais, là encore, Francastel ne dit pas qu’ils n’ont été que les dupes de la
fausseté de leur temps. Herbert Read s’approche un peu plus près de la vérité,
lorsqu’il leur reconnaît «une prise de
conscience de problèmes dialectiques dans la démarche artistique elle-même, qui
ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de sa situation
par rapport à la connaissance. Le vieux langage de l’art ne convenait désormais
plus à la connaissance humaine : un nouveau langage devait être créé, syllabe
par syllabe, image par image, avant que l’art puisse encore une fois être
nécessité sociale aussi bien qu’individuelle».[3]
à la
campagne : Millet, Pissarro, Sisley. Ou encore Gauguin, la nef bardée d’idoles
polynésiennes partie à la recherche de l’Empire du soleil. Mais tout cela en
même temps raconte un effondrement, et on peut appeler cette décomposition
minutieuse “impressionnisme”, ce n’est jamais qu’un malentendu de plus. Le
fameux passage à la lumière ou aux couleurs pures n’annonce que l’implosion
dans un trou noir de tout ce qui, en même temps que c’est peint, disparaît en
lambeaux et en amas, en particules et nébuleuses. “Nous sommes au quatrième
quart d’un siècle qui finira par une révolution colossale”, écrivait encore Van Gogh. Mais une chose importe, continuait-il, “c’est de ne pas être dupe de la
fausseté de son époque, pas au point toutefois qu’on n’y repère les heures
malsaines, étouffantes et déprimées qui précèdent l’orage”».[1]
Philippe Muray, qui s’en prend impitoyablement à tous les mythes du XIXe
siècle, se rallie à la tradition des refusés.
Il participe au mythe impressionniste en enchérissant sur les dénonciations
qui ont commencé dès la production des premières toiles du genre. L’historien
de l’art, Pierre Francastel, longtemps avant lui, avait nuancé le mythe :
«Si l’on admet que c’est avec
l’impressionnisme que se pose vraiment la question de l’effondrement de
l’ancien espace plastique, encore faut-il distinguer. Je ne songe pas un moment
à soutenir l’idée absurde, que les impressionnistes ont été, tout d’un coup,
des novateurs et rien d’autre. Ils ont, au contraire, cheminé péniblement, à
petits coups, avec des repentirs, des fausses voies. Ils ont été, dans
l’ensemble, des précurseurs plutôt que des réalisateurs».[2]
Mais, là encore, Francastel ne dit pas qu’ils n’ont été que les dupes de la
fausseté de leur temps. Herbert Read s’approche un peu plus près de la vérité,
lorsqu’il leur reconnaît «une prise de
conscience de problèmes dialectiques dans la démarche artistique elle-même, qui
ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de sa situation
par rapport à la connaissance. Le vieux langage de l’art ne convenait désormais
plus à la connaissance humaine : un nouveau langage devait être créé, syllabe
par syllabe, image par image, avant que l’art puisse encore une fois être
nécessité sociale aussi bien qu’individuelle».[3] 
 difficultés à trancher : «Rappel
historique : Monet, Pissarro, Sisley et quelques autres peintres ont formé une
“société anonyme” qui expose cent soixante-cinq toiles en 1874 dans l’ancien
atelier de Nadar. La majorité des critiques considère ces œuvres comme bâclées,
et Louis Leroy, journaliste du Charivari, lance le mot “impressionniste” - par
allusion au tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).
Initialement, c’est tantôt Manet, tantôt Monet qui est considéré comme le “roi
de l’impressionnisme”, et les artistes impressionnistes ne revendiquent cette
dénomination qu’à partir de leur troisième exposition de 1877. Leurs
détracteurs parlent de “peinture de communards”, d’“école démocratique”,
d’“école des taches”, mais aussi de nihilisme et de “lugubrisme”. “L’enrôlement
de l’impressionnisme dans les rangs du réalisme [puis du naturalisme] se fit
naturellement, dans la logique d’une évidence”. (Denys Riout)».[4]
Le 25 avril 1874, au lendemain de l’exposition chez Nadar qui fut un succès
d’estime plus qu’un succès financier – la coopérative formée par les
impressionnistes allait imploser peu après -, en effet, un article signé Louis
Leroy paraissait dans Le Charivari titré
L’Exposition des impressionnistes, et
le critique de se moquer : «veuillez
me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du
tableaux…; que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil
levant. Impression, j’en étais sûr. Je me
disais aussi, puisque je suis
difficultés à trancher : «Rappel
historique : Monet, Pissarro, Sisley et quelques autres peintres ont formé une
“société anonyme” qui expose cent soixante-cinq toiles en 1874 dans l’ancien
atelier de Nadar. La majorité des critiques considère ces œuvres comme bâclées,
et Louis Leroy, journaliste du Charivari, lance le mot “impressionniste” - par
allusion au tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).
Initialement, c’est tantôt Manet, tantôt Monet qui est considéré comme le “roi
de l’impressionnisme”, et les artistes impressionnistes ne revendiquent cette
dénomination qu’à partir de leur troisième exposition de 1877. Leurs
détracteurs parlent de “peinture de communards”, d’“école démocratique”,
d’“école des taches”, mais aussi de nihilisme et de “lugubrisme”. “L’enrôlement
de l’impressionnisme dans les rangs du réalisme [puis du naturalisme] se fit
naturellement, dans la logique d’une évidence”. (Denys Riout)».[4]
Le 25 avril 1874, au lendemain de l’exposition chez Nadar qui fut un succès
d’estime plus qu’un succès financier – la coopérative formée par les
impressionnistes allait imploser peu après -, en effet, un article signé Louis
Leroy paraissait dans Le Charivari titré
L’Exposition des impressionnistes, et
le critique de se moquer : «veuillez
me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du
tableaux…; que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil
levant. Impression, j’en étais sûr. Je me
disais aussi, puisque je suis  impressionné, il doit y avoir de l’impression
là-dedans…».[5]
Le mythe commence donc autour du nom du groupe. Impression, impressionnistes,
impressionnisme : de la diversité des œuvres, on passait à l’unité de
mouvance artistique. Mais le rigolo faisait écho à ce que les artistes
eux-mêmes en disaient : «Monet
lui-même a expliqué… qu’il avait envoyé une toile faite au Havre, de sa fenêtre
: du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant.
“On me demande le titre pour le catalogue; ça ne pouvait vraiment pas passer
pour une vue du Havre. Je répondis : Mettez Impression!” En effet, cette œuvre fut inscrite au catalogue comme: Impression, Soleil levant (c’était une des deux versions représentant le port que l’artiste
avait peintes en 1872)».[6]
Cette version est sans doute la plus crédible pour l’origine du mot impression. Mais Monet en pensait-il
lui-même être à l’origine d’un mouvement? Pour leur historien John Rewald, des
artistes se réunissaient fréquemment et partageaient leurs théories sur la
nature, l’art et le regard. Cela aussi appartenait au mythe : «Réunis presque par le hasard, ils avaient
accepté leur sort commun de même qu’ils allaient accepter qu’on les désigne
comme “impressionnistes”, mot inventé par un critique malveillant pour
ridiculiser leurs efforts».[7]
Le mythe reposait autant sur l’hostilité originelle, puis permanente au
mouvement qu’à l’anecdote racontée par Monet.
impressionné, il doit y avoir de l’impression
là-dedans…».[5]
Le mythe commence donc autour du nom du groupe. Impression, impressionnistes,
impressionnisme : de la diversité des œuvres, on passait à l’unité de
mouvance artistique. Mais le rigolo faisait écho à ce que les artistes
eux-mêmes en disaient : «Monet
lui-même a expliqué… qu’il avait envoyé une toile faite au Havre, de sa fenêtre
: du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant.
“On me demande le titre pour le catalogue; ça ne pouvait vraiment pas passer
pour une vue du Havre. Je répondis : Mettez Impression!” En effet, cette œuvre fut inscrite au catalogue comme: Impression, Soleil levant (c’était une des deux versions représentant le port que l’artiste
avait peintes en 1872)».[6]
Cette version est sans doute la plus crédible pour l’origine du mot impression. Mais Monet en pensait-il
lui-même être à l’origine d’un mouvement? Pour leur historien John Rewald, des
artistes se réunissaient fréquemment et partageaient leurs théories sur la
nature, l’art et le regard. Cela aussi appartenait au mythe : «Réunis presque par le hasard, ils avaient
accepté leur sort commun de même qu’ils allaient accepter qu’on les désigne
comme “impressionnistes”, mot inventé par un critique malveillant pour
ridiculiser leurs efforts».[7]
Le mythe reposait autant sur l’hostilité originelle, puis permanente au
mouvement qu’à l’anecdote racontée par Monet. 
 recherche de paysages
qu’il peindrait dans le style néo-classique. Peu à peu toutefois, son style
s’imprégna de la luminosité et les traits, s’ils ne disparurent pas, n’empêchaient
plus la magie des effets de lumières de jouer sur les murs de L’entrée du port à La Rochelle (1851) ou
sur le Pont et moulin près de Mantes (1860-1865).
Comme le remarque Lionello Venturi, chez Corot, «les contrastes de lumière et ombre sont sacrifiés dans ses peintures au
règne absolu des demi-tons et des nuances, ce qui lui fait gagner en
délicatesse et en grâce ce qu’il perdait en robustesse et en énergie. La
lumière solaire de Rome lui avait suggéré l’énergie des contrastes, et
l’énergie fut pour lui l’antidote nécessaire d’un laisser aller qui constituait
un danger constant pour sa nature simple et bonne. Une conséquence importante
de la vision en masse par tons de lumière est qu’il faut renoncer à un premier
plan naturel. Bien mieux, pour interpréter la nature et non pas la reproduire,
Corot met au premier plan du tableau un point éloigné du pays et, bien plutôt
qu’il ne représente matériellement les détails des objets, il participe à la
vie imprimée sur les objets par les lumières et les ombres. Ainsi arrive-t-il à
transformer les choses en valeurs de vie. Comme la valeur est l’infini alors
que l’objet est le fini, pour découvrir l’infini dans le fini, l’artiste doit
se détacher de son sujet par une vision aussi éloignée matériellement que
proche spirituellement. Il ne conduit pas l’observateur par la main dans la
profondeur de l’espace naturel, mais lui présente un objet vu en surface où il
est à la fois proche et
recherche de paysages
qu’il peindrait dans le style néo-classique. Peu à peu toutefois, son style
s’imprégna de la luminosité et les traits, s’ils ne disparurent pas, n’empêchaient
plus la magie des effets de lumières de jouer sur les murs de L’entrée du port à La Rochelle (1851) ou
sur le Pont et moulin près de Mantes (1860-1865).
Comme le remarque Lionello Venturi, chez Corot, «les contrastes de lumière et ombre sont sacrifiés dans ses peintures au
règne absolu des demi-tons et des nuances, ce qui lui fait gagner en
délicatesse et en grâce ce qu’il perdait en robustesse et en énergie. La
lumière solaire de Rome lui avait suggéré l’énergie des contrastes, et
l’énergie fut pour lui l’antidote nécessaire d’un laisser aller qui constituait
un danger constant pour sa nature simple et bonne. Une conséquence importante
de la vision en masse par tons de lumière est qu’il faut renoncer à un premier
plan naturel. Bien mieux, pour interpréter la nature et non pas la reproduire,
Corot met au premier plan du tableau un point éloigné du pays et, bien plutôt
qu’il ne représente matériellement les détails des objets, il participe à la
vie imprimée sur les objets par les lumières et les ombres. Ainsi arrive-t-il à
transformer les choses en valeurs de vie. Comme la valeur est l’infini alors
que l’objet est le fini, pour découvrir l’infini dans le fini, l’artiste doit
se détacher de son sujet par une vision aussi éloignée matériellement que
proche spirituellement. Il ne conduit pas l’observateur par la main dans la
profondeur de l’espace naturel, mais lui présente un objet vu en surface où il
est à la fois proche et  lointain, mais vu comme constituant un tout se
suffisant à lui-même. aussi bien le proche que le lointain appartiennent au
monde de l’infini, au monde de l’art, distinct du monde de la nature. C’est la
raison pour laquelle un peu de terre grossière, un fleuve trouble, un pont en
ruines et quelques collines éloignées sont devenus un absolu de l’art, une des
merveilles du monde».[8]
Ce qui caractérisait Corot, c’était précisément ce qui empêcha Barbizon d’aller
plus loin dans la recherche chromatique dans laquelle devait triompher
l’impressionnisme. Corot, ajoute le même historien, «n’a pas permis à sa fantaisie de s’élancer au-delà de la réalité; il
s’est efforcé de retenir son imagination créatrice dans les limites de la
réalité, la réalité naturelle qu’il voyait. Donc, Corot était un réaliste, mais
d’un genre spécial puisqu’il se refusait à peindre les détails objectifs des
choses, comme le voulaient les réalistes. Renonçant aux détails, il resta
fidèle à son impression de lumière et d’ombre et s’arrêta dès qu’il eut réalisé
cette impression. La réaction dramatique à la lutte de la lumière et de l’ombre
au premier plan, et l’extase devant la clarté de l’horizon humain, furent
complètement absorbées et fondues dans son impression visuelle».[9]
lointain, mais vu comme constituant un tout se
suffisant à lui-même. aussi bien le proche que le lointain appartiennent au
monde de l’infini, au monde de l’art, distinct du monde de la nature. C’est la
raison pour laquelle un peu de terre grossière, un fleuve trouble, un pont en
ruines et quelques collines éloignées sont devenus un absolu de l’art, une des
merveilles du monde».[8]
Ce qui caractérisait Corot, c’était précisément ce qui empêcha Barbizon d’aller
plus loin dans la recherche chromatique dans laquelle devait triompher
l’impressionnisme. Corot, ajoute le même historien, «n’a pas permis à sa fantaisie de s’élancer au-delà de la réalité; il
s’est efforcé de retenir son imagination créatrice dans les limites de la
réalité, la réalité naturelle qu’il voyait. Donc, Corot était un réaliste, mais
d’un genre spécial puisqu’il se refusait à peindre les détails objectifs des
choses, comme le voulaient les réalistes. Renonçant aux détails, il resta
fidèle à son impression de lumière et d’ombre et s’arrêta dès qu’il eut réalisé
cette impression. La réaction dramatique à la lutte de la lumière et de l’ombre
au premier plan, et l’extase devant la clarté de l’horizon humain, furent
complètement absorbées et fondues dans son impression visuelle».[9]
 moins peu courtois : «Aux
Salons ses toiles avaient été régulièrement l’objet d’attaques violentes; même
Théophile Gautier, favorable cependant aux recherches nouvelles, ne put
s’empêcher d’écrire : “Il est vraiment dommage que ce paysagiste, d’un
sentiment si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une impression et
néglige à ce point les détails. Ces tableaux ne sont plus que des ébauches, et
des ébauches peu avancées… Chaque objet se dessine par un contour apparent ou
réel et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des taches de couleur
juxtaposées”. Mais le but de Daubigny était justement de résumer des
impressions (en 1865 un critique l’avait même appelé le “chef de l’école de
l’impression”) et il était prêt à sacrifier une partie de la vérité littérale à
la recherche d’une expression plus fidèle des aspects sans cesse changeants de
la nature».[10]
Tout cela se passait bien avant le Salon
des refusés. Rappelons l’anecdote. Pour le Salon officiel, le jury composé d’artistes académiciens avait
refusé 3 000 des 5 000 œuvres présentées. L’empereur Napoléon III,
moins peu courtois : «Aux
Salons ses toiles avaient été régulièrement l’objet d’attaques violentes; même
Théophile Gautier, favorable cependant aux recherches nouvelles, ne put
s’empêcher d’écrire : “Il est vraiment dommage que ce paysagiste, d’un
sentiment si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une impression et
néglige à ce point les détails. Ces tableaux ne sont plus que des ébauches, et
des ébauches peu avancées… Chaque objet se dessine par un contour apparent ou
réel et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des taches de couleur
juxtaposées”. Mais le but de Daubigny était justement de résumer des
impressions (en 1865 un critique l’avait même appelé le “chef de l’école de
l’impression”) et il était prêt à sacrifier une partie de la vérité littérale à
la recherche d’une expression plus fidèle des aspects sans cesse changeants de
la nature».[10]
Tout cela se passait bien avant le Salon
des refusés. Rappelons l’anecdote. Pour le Salon officiel, le jury composé d’artistes académiciens avait
refusé 3 000 des 5 000 œuvres présentées. L’empereur Napoléon III,  trouvant
même que la purge était excessive, patronna le Salon des refusés qui s’ouvrit le 15 mai 1863 au Palais de
l’Industrie au grand dam des académiciens. 1 200 œuvres furent exposées dans
douze salles annexes, parmi lesquelles des toiles de Manet. Parmi ces artistes,
de futurs peintres impressionnistes. Nul doute qu’on y parla beaucoup d’impression, du moins presque autant
qu’au Café Guerbois : «Il paraît certain
que le mot impression fut souvent
prononcé au cours de ces discussions. Les critiques l’employaient depuis
quelque temps pour caractériser les efforts des paysagistes comme Corot,
Daubigny et Jongkind; [Théodore]
Rousseau lui-même avait parlé de ses tentatives pour rester fidèle “à
l’impression vierge de la nature” et Manet, bien qu’il ne fût pas
essentiellement intéressé par le paysage, avait insisté, à l’occasion de sa
grande exposition de 1867, pour dire que son intention était de “communiquer
son impression”. Albert Wolff, critique plutôt hostile aux jeunes peintres,
venait d’écrire justement à propos de Manet qu’il rendait “admirablement la
première impression de la nature”. D’après son ami Proust, Manet se servait du
terme impression déjà depuis une
dizaine d’années environ».[11]
Précisons toutefois que nous ne sommes pas rendus encore à l’ère de
l’impressionnisme, mais toujours sous la mouvance de Barbizon.
trouvant
même que la purge était excessive, patronna le Salon des refusés qui s’ouvrit le 15 mai 1863 au Palais de
l’Industrie au grand dam des académiciens. 1 200 œuvres furent exposées dans
douze salles annexes, parmi lesquelles des toiles de Manet. Parmi ces artistes,
de futurs peintres impressionnistes. Nul doute qu’on y parla beaucoup d’impression, du moins presque autant
qu’au Café Guerbois : «Il paraît certain
que le mot impression fut souvent
prononcé au cours de ces discussions. Les critiques l’employaient depuis
quelque temps pour caractériser les efforts des paysagistes comme Corot,
Daubigny et Jongkind; [Théodore]
Rousseau lui-même avait parlé de ses tentatives pour rester fidèle “à
l’impression vierge de la nature” et Manet, bien qu’il ne fût pas
essentiellement intéressé par le paysage, avait insisté, à l’occasion de sa
grande exposition de 1867, pour dire que son intention était de “communiquer
son impression”. Albert Wolff, critique plutôt hostile aux jeunes peintres,
venait d’écrire justement à propos de Manet qu’il rendait “admirablement la
première impression de la nature”. D’après son ami Proust, Manet se servait du
terme impression déjà depuis une
dizaine d’années environ».[11]
Précisons toutefois que nous ne sommes pas rendus encore à l’ère de
l’impressionnisme, mais toujours sous la mouvance de Barbizon.

 découvert à un moment donné une nouvelle
méthode de représenter l’univers et elle se serait ensuite diffusée
internationalement. Les faits sont présentés absolument comme si
l’impressionnisme était une recette qui restait à découvrir, comme on trouve un
produit naturel encore inconnu dans la nature. Toute l’histoire de
l’impressionnisme telle que M. Rewald la conçoit se réduit en somme au récit
d’une série de rencontres entre quelques jeunes gens travaillant à Paris vers
la même époque et à la mise au point progressive entre eux tous d’un procédé
technique. On retrouve ici l’erreur d’optique qui a présidé jadis à la
formation des thèses relatives aux origines de la Renaissance. Même illusion de
l’existence d’une sorte de formule toute prête dans la nature ou dans le
cerveau humain et qu’il s’agit de mettre au jour. […] [I]l a rassemblé des anecdotes sur la vie des
peintres impressionnistes. Il s’est refusé à poser le problème du style, il a
méconnu le fait que, toute leur vie, les impressionnistes - et c’est ce qui
fait leur grandeur - ont tâtonné et que le mouvement dont ils ont été les
initiateurs ne s’est pas terminé un beau soir d’été parce que le dernier mot
d’une certaine méthode était trouvé, tandis que déjà leurs successeurs passaient
à la recherche de
découvert à un moment donné une nouvelle
méthode de représenter l’univers et elle se serait ensuite diffusée
internationalement. Les faits sont présentés absolument comme si
l’impressionnisme était une recette qui restait à découvrir, comme on trouve un
produit naturel encore inconnu dans la nature. Toute l’histoire de
l’impressionnisme telle que M. Rewald la conçoit se réduit en somme au récit
d’une série de rencontres entre quelques jeunes gens travaillant à Paris vers
la même époque et à la mise au point progressive entre eux tous d’un procédé
technique. On retrouve ici l’erreur d’optique qui a présidé jadis à la
formation des thèses relatives aux origines de la Renaissance. Même illusion de
l’existence d’une sorte de formule toute prête dans la nature ou dans le
cerveau humain et qu’il s’agit de mettre au jour. […] [I]l a rassemblé des anecdotes sur la vie des
peintres impressionnistes. Il s’est refusé à poser le problème du style, il a
méconnu le fait que, toute leur vie, les impressionnistes - et c’est ce qui
fait leur grandeur - ont tâtonné et que le mouvement dont ils ont été les
initiateurs ne s’est pas terminé un beau soir d’été parce que le dernier mot
d’une certaine méthode était trouvé, tandis que déjà leurs successeurs passaient
à la recherche de  la formule suivante, toute prête dans les magasins de
l’histoire».[14]
La critique de Francastel, plus intéressée par la sociologie de l’art que par
les anecdotes truculentes, vise surtout à souligner les faiblesses du livre de
Rewald. Mais il montre à quel point il est difficile de parler des
impressionnistes sans participer du mythe, soit en bien soit en mal.
L’importance que le XXe siècle leur a accordée s’est étendue dans l’espace et
dans le temps. Il existe un impressionnisme jusqu’aux Étas-Unis, bien
évidemment, mais tous ces impressionnismes nationaux sont effacés pour laisser
la place au seul mouvement parisien : «Les
réalisations de l’impressionnisme étaient devenues le patrimoine commun, point
de départ pour de nouvelles conquêtes. Il est exact, néanmoins, que les jeunes
avaient fini par rejeter la plupart des principes impressionnistes, que les
fauves, les cubistes, les expressionnistes, les futuristes, les dadaïstes, les
surréalistes avaient
la formule suivante, toute prête dans les magasins de
l’histoire».[14]
La critique de Francastel, plus intéressée par la sociologie de l’art que par
les anecdotes truculentes, vise surtout à souligner les faiblesses du livre de
Rewald. Mais il montre à quel point il est difficile de parler des
impressionnistes sans participer du mythe, soit en bien soit en mal.
L’importance que le XXe siècle leur a accordée s’est étendue dans l’espace et
dans le temps. Il existe un impressionnisme jusqu’aux Étas-Unis, bien
évidemment, mais tous ces impressionnismes nationaux sont effacés pour laisser
la place au seul mouvement parisien : «Les
réalisations de l’impressionnisme étaient devenues le patrimoine commun, point
de départ pour de nouvelles conquêtes. Il est exact, néanmoins, que les jeunes
avaient fini par rejeter la plupart des principes impressionnistes, que les
fauves, les cubistes, les expressionnistes, les futuristes, les dadaïstes, les
surréalistes avaient  successivement ouvert des horizons tout à fait nouveau.
Mais leurs efforts avaient été alimentés par l’œuvre de Cézanne, Gauguin, van
Gogh et Seurat qui, tous, étaient passés par une phase impressionniste. Si
l’influence directe de l’impressionnisme sur l’art contemporain peut paraître
parfois négligeable, si de tous les maîtres du XXe siècle, seul Bonnard a
continué à développer son propre style dans un esprit authentiquement
impressionniste, ce fut néanmoins l’art de Monet et de ses compagnons qui
abolit d’innombrables préjugés et ouvrit la route à des hardiesses de plus en
plus grandes de technique, de couleur et d’abstraction».[15]
Rewald a effectivement tort de ne pas s’être intéressé à l’impressionnisme hors
du cercle parisien, excluant par le fait même les recherches esthétiques faites
ailleurs, dans d’autres nations occidentales. Et, comme il se doit, l’expansion
dans l’espace du mythe français de l’impressionnisme trouve son équivalent dans
l’étirement dans le temps. L’impressionnisme français remonte dans le passé
jusqu’à marginaliser les tendances existantes, réaliste, naturaliste et
symboliste, puis à avaler ses prédécesseurs de Barbizon : «À cent lieux de la théâtralité de la
peinture académique, émergent dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers
balbutiements de la modernité picturale. En se fondant sur l’expérience
visuelle concrète, l’artiste, promoteur de ce qui
successivement ouvert des horizons tout à fait nouveau.
Mais leurs efforts avaient été alimentés par l’œuvre de Cézanne, Gauguin, van
Gogh et Seurat qui, tous, étaient passés par une phase impressionniste. Si
l’influence directe de l’impressionnisme sur l’art contemporain peut paraître
parfois négligeable, si de tous les maîtres du XXe siècle, seul Bonnard a
continué à développer son propre style dans un esprit authentiquement
impressionniste, ce fut néanmoins l’art de Monet et de ses compagnons qui
abolit d’innombrables préjugés et ouvrit la route à des hardiesses de plus en
plus grandes de technique, de couleur et d’abstraction».[15]
Rewald a effectivement tort de ne pas s’être intéressé à l’impressionnisme hors
du cercle parisien, excluant par le fait même les recherches esthétiques faites
ailleurs, dans d’autres nations occidentales. Et, comme il se doit, l’expansion
dans l’espace du mythe français de l’impressionnisme trouve son équivalent dans
l’étirement dans le temps. L’impressionnisme français remonte dans le passé
jusqu’à marginaliser les tendances existantes, réaliste, naturaliste et
symboliste, puis à avaler ses prédécesseurs de Barbizon : «À cent lieux de la théâtralité de la
peinture académique, émergent dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers
balbutiements de la modernité picturale. En se fondant sur l’expérience
visuelle concrète, l’artiste, promoteur de ce qui  va devenir la révolution
impressionniste, peint ce qu’il observe et ce qu’il sent, bref, réalise
directement une expérience. Le caractère est profondément novateur, moderne :
en exprimant une réalité mouvante, fugitive, l’œuvre réalisée par l’artiste
cesse d’être une simple représentation pour donner naissance à une réalité
vivante, perceptive».[16]
Ne voilà-t-il pas que l’impressionnisme succède pour le remplacer au romantisme
(rejet de la théâtralité) et englobe
par le fait même tous les peintres qui ont travaillé sur l’expérience chromatique
et l’observation. Or, comme nous l’avons vu précédemment, réalistes et
symbolistes avaient chacun leurs soucis d’approcher méthodiquement l’expérience
visuelle et l’observation de l’espace figuratif. C’est ce que nous entendons
par l’aspect positivement amplificateur du mythe de l’impressionnisme, mais il
y a également un aspect négativement réducteur lié aux commentaires
désobligeants qui se sont manifestés dès l’époque et sur lequel, le génie
impressionniste apparaît comme la victime d’une injuste persécution et qui se
résume par cet encart d’Albert Wolff paru dans Le Figaro du 3 avril 1876 : «La
rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau
désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une
exposition qu’on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les
drapeaux qui décorent la façade, entre, et à ses yeux épouvantés s’offre un
spectacle cruel : cinq à six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux
atteints de la folie de l’ambition, s’y sont donné rendez-vous pour exposer
leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j’ai
le cœur serré…».[17]
va devenir la révolution
impressionniste, peint ce qu’il observe et ce qu’il sent, bref, réalise
directement une expérience. Le caractère est profondément novateur, moderne :
en exprimant une réalité mouvante, fugitive, l’œuvre réalisée par l’artiste
cesse d’être une simple représentation pour donner naissance à une réalité
vivante, perceptive».[16]
Ne voilà-t-il pas que l’impressionnisme succède pour le remplacer au romantisme
(rejet de la théâtralité) et englobe
par le fait même tous les peintres qui ont travaillé sur l’expérience chromatique
et l’observation. Or, comme nous l’avons vu précédemment, réalistes et
symbolistes avaient chacun leurs soucis d’approcher méthodiquement l’expérience
visuelle et l’observation de l’espace figuratif. C’est ce que nous entendons
par l’aspect positivement amplificateur du mythe de l’impressionnisme, mais il
y a également un aspect négativement réducteur lié aux commentaires
désobligeants qui se sont manifestés dès l’époque et sur lequel, le génie
impressionniste apparaît comme la victime d’une injuste persécution et qui se
résume par cet encart d’Albert Wolff paru dans Le Figaro du 3 avril 1876 : «La
rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau
désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une
exposition qu’on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les
drapeaux qui décorent la façade, entre, et à ses yeux épouvantés s’offre un
spectacle cruel : cinq à six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux
atteints de la folie de l’ambition, s’y sont donné rendez-vous pour exposer
leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j’ai
le cœur serré…».[17]
 par les rieurs. C’est à leur
corps défendant, finalement, que le mot finit par leur être imposer au fond de
la gorge : «Le mot impressionnisme, inventé par esprit de dérision, devait
bientôt être accepté par le groupe d’amis. Malgré la répugnance manifestée par
Renoir pour tout ce qui pouvait leur donner l’apparence de constituer une
nouvelle école artistique, malgré l’hostilité de Degas à admettre l’application
de ce terme à son art, et malgré l’obstination de Zola à appeler ces peintres
“naturalistes”, le mot nouveau devait rester. Bien que chargé de ridicule et
vague en lui-même, ce vocable semblait aussi bon que tout autre pour souligner
l’élément commun de leurs efforts. Aucun terme, à lui seul, ne pouvait
prétendre définir avec précision les tendances d’un groupe de peintres qui
mettaient leurs propres sensations au-dessus de tout programme artistique. Mais
quelle qu’ait été la signification du mot “impressionnisme” à l’origine, son
vrai sens devait être formulé non par des critiques ironiques mais par les
peintres eux-mêmes. C’est ainsi que de leur milieu, et sans doute avec leur
consentement, vint la première définition du terme. C’est un ami de Renoir qui
la proposa bientôt, en écrivant : “Traiter un sujet pour les tons et non pour
le sujet lui-même, voilà ce qui distingue les impressionnistes des autres peintres”».[19] L’historien d’art Venturi a essayé de trouver une raison plus profonde de la
part des critiques qui ont rejeté l’œuvre
des impressionnistes. Il avance comme explication que «l’atmosphère
par les rieurs. C’est à leur
corps défendant, finalement, que le mot finit par leur être imposer au fond de
la gorge : «Le mot impressionnisme, inventé par esprit de dérision, devait
bientôt être accepté par le groupe d’amis. Malgré la répugnance manifestée par
Renoir pour tout ce qui pouvait leur donner l’apparence de constituer une
nouvelle école artistique, malgré l’hostilité de Degas à admettre l’application
de ce terme à son art, et malgré l’obstination de Zola à appeler ces peintres
“naturalistes”, le mot nouveau devait rester. Bien que chargé de ridicule et
vague en lui-même, ce vocable semblait aussi bon que tout autre pour souligner
l’élément commun de leurs efforts. Aucun terme, à lui seul, ne pouvait
prétendre définir avec précision les tendances d’un groupe de peintres qui
mettaient leurs propres sensations au-dessus de tout programme artistique. Mais
quelle qu’ait été la signification du mot “impressionnisme” à l’origine, son
vrai sens devait être formulé non par des critiques ironiques mais par les
peintres eux-mêmes. C’est ainsi que de leur milieu, et sans doute avec leur
consentement, vint la première définition du terme. C’est un ami de Renoir qui
la proposa bientôt, en écrivant : “Traiter un sujet pour les tons et non pour
le sujet lui-même, voilà ce qui distingue les impressionnistes des autres peintres”».[19] L’historien d’art Venturi a essayé de trouver une raison plus profonde de la
part des critiques qui ont rejeté l’œuvre
des impressionnistes. Il avance comme explication que «l’atmosphère  impressionniste suggérée par les vibrations de couleurs
séparées et pleine de reflets des lumières était le motif central de l’artiste
: aussi celui-ci accentuait-il l’effet de la surface et diminuait-il l’illusion
de la profondeur. Cela était dû à l’intime cohérence de la vision; mais nombre
de critiques ne s’en aperçurent pas, et, confondant la peinture en surface avec
la peinture superficielle, critiquèrent les impressionnistes en ce pourquoi précisément, ils auraient dû les louer; car il n'existe aucune loi esthétique imposant à la peinture
impressionniste suggérée par les vibrations de couleurs
séparées et pleine de reflets des lumières était le motif central de l’artiste
: aussi celui-ci accentuait-il l’effet de la surface et diminuait-il l’illusion
de la profondeur. Cela était dû à l’intime cohérence de la vision; mais nombre
de critiques ne s’en aperçurent pas, et, confondant la peinture en surface avec
la peinture superficielle, critiquèrent les impressionnistes en ce pourquoi précisément, ils auraient dû les louer; car il n'existe aucune loi esthétique imposant à la peinture  un effet à trois dimensions. Enfin la conception même du
mouvement fut toute nouvelle chez les impressionnistes. Étant donné que
l’origine de leur peinture se trouve dans les reflets de l’eau, l’effet
d’ensemble fut un effet de mouvement perpétuel, de vibrations cosmiques. Le
moindre objet statique introduit par inadvertance au milieu de cette vibration détruisait
entièrement l’effet. Réaliser la vibration cosmique signifia pour eux révéler
l’impression de l’énergie qui est la vie de la nature. La lumière vibrante
imprimée dans toute chose représente la vie et la vigueur».[20]
Inutile de préciser que Venturi défend l’apport des impressionnistes,
contrairement à l’anthropologue Gilbert Durand : «Le cas de l’Impressionnisme est bien significatif : en un sens il est
l’aboutissement triomphant du naturalisme romantique. Mais ce n’est qu’une
apparence. En profondeur, il n’est que l’envahissement scientiste et prométhéen
de la sensibilité, via les lois de Chevreul sur la lumière qui sont aux
antipodes de la Farbenlehre de Gœthe, tandis que le choix du nom de l’école
elle-même, “impressionnisme”, ramène et réduit la nature à un codage purement
psychologique. Car l’apologie décadente et scientiste de la paranoïa marie avec
bonheur la dissection scientiste des données naturelles et la frénésie
envahissante des pulsions du moi».[21]
Comme on peut le constater, la querelle autour des impressionnistes n’est pas
terminée.
un effet à trois dimensions. Enfin la conception même du
mouvement fut toute nouvelle chez les impressionnistes. Étant donné que
l’origine de leur peinture se trouve dans les reflets de l’eau, l’effet
d’ensemble fut un effet de mouvement perpétuel, de vibrations cosmiques. Le
moindre objet statique introduit par inadvertance au milieu de cette vibration détruisait
entièrement l’effet. Réaliser la vibration cosmique signifia pour eux révéler
l’impression de l’énergie qui est la vie de la nature. La lumière vibrante
imprimée dans toute chose représente la vie et la vigueur».[20]
Inutile de préciser que Venturi défend l’apport des impressionnistes,
contrairement à l’anthropologue Gilbert Durand : «Le cas de l’Impressionnisme est bien significatif : en un sens il est
l’aboutissement triomphant du naturalisme romantique. Mais ce n’est qu’une
apparence. En profondeur, il n’est que l’envahissement scientiste et prométhéen
de la sensibilité, via les lois de Chevreul sur la lumière qui sont aux
antipodes de la Farbenlehre de Gœthe, tandis que le choix du nom de l’école
elle-même, “impressionnisme”, ramène et réduit la nature à un codage purement
psychologique. Car l’apologie décadente et scientiste de la paranoïa marie avec
bonheur la dissection scientiste des données naturelles et la frénésie
envahissante des pulsions du moi».[21]
Comme on peut le constater, la querelle autour des impressionnistes n’est pas
terminée. guerre, le fameux plan Dawes signé le 24
juillet 1924, chargé de prêter aux débiteurs le montant à rembourser,
l’économiste Paul Auld commenta par cette figure de style : «Que reste-t-il alors à ces esprits sérieux
qui croient que le monde est détraqué? Il faut d’une manière ou d’une autre
convaincre le prêteur, dans son propre intérêt. Aussi, on adopte la méthode
impressionniste. Le détail est séparé de l’ensemble du sujet, et l’on peint le
danger comme quelque chose de vague, sombre et mystérieux».[22]
La méthode impressionniste consisterait-elle à séparer les détails de
l’ensemble du sujet, tout cela sur fond brumeux? Que la chose soit exacte ou
non en ce qui a trait au plan Dawes, ou le fait que l’économie serait une
affaire de perception impressionniste,
la facture impressionniste pourrait se résumer à cette phrase. Mais ce ne
serait là que le résultat, nous n’en sommes pas encore à la définition même du
processus créatif. Pour cela, il faut interroger l’intention des artistes. Que
voulait un peintre classé dans la catégorie impressionniste lorsqu’il se
trouvait devant sa toile? «C’est Manet,
le précurseur, qui fut le premier à déclarer qu’il voulait être “de son temps”
et peindre “ce qu’il voyait”. Autrement dit, inspirés par Courbet, les
impressionnistes étaient avant tout des réalistes qui rejetaient les légendes
chrétiennes, la flatterie sociale et l’esthétique académique afin de révéler,
au lieu d’interpréter, le monde qui les entourait. Rejetant l’idée consacrée
selon laquelle la peinture était une activité cérébrale, les impressionnistes,
dans leurs essais optiques, comptaient sur l’œil humain pour transmettre la
réalité sans médiation mentale. En conséquence, ils quittèrent leurs ateliers
sombres pour le grand jour de la société, de la ville et de la campagne».[23]
L’œil. Pour un impressionniste, tout est dans l’œil, le regard, bref la
perception visuelle; ce qui le distingue d’un peintre réaliste comme Courbet.
La sensibilité l’emporte sur la
guerre, le fameux plan Dawes signé le 24
juillet 1924, chargé de prêter aux débiteurs le montant à rembourser,
l’économiste Paul Auld commenta par cette figure de style : «Que reste-t-il alors à ces esprits sérieux
qui croient que le monde est détraqué? Il faut d’une manière ou d’une autre
convaincre le prêteur, dans son propre intérêt. Aussi, on adopte la méthode
impressionniste. Le détail est séparé de l’ensemble du sujet, et l’on peint le
danger comme quelque chose de vague, sombre et mystérieux».[22]
La méthode impressionniste consisterait-elle à séparer les détails de
l’ensemble du sujet, tout cela sur fond brumeux? Que la chose soit exacte ou
non en ce qui a trait au plan Dawes, ou le fait que l’économie serait une
affaire de perception impressionniste,
la facture impressionniste pourrait se résumer à cette phrase. Mais ce ne
serait là que le résultat, nous n’en sommes pas encore à la définition même du
processus créatif. Pour cela, il faut interroger l’intention des artistes. Que
voulait un peintre classé dans la catégorie impressionniste lorsqu’il se
trouvait devant sa toile? «C’est Manet,
le précurseur, qui fut le premier à déclarer qu’il voulait être “de son temps”
et peindre “ce qu’il voyait”. Autrement dit, inspirés par Courbet, les
impressionnistes étaient avant tout des réalistes qui rejetaient les légendes
chrétiennes, la flatterie sociale et l’esthétique académique afin de révéler,
au lieu d’interpréter, le monde qui les entourait. Rejetant l’idée consacrée
selon laquelle la peinture était une activité cérébrale, les impressionnistes,
dans leurs essais optiques, comptaient sur l’œil humain pour transmettre la
réalité sans médiation mentale. En conséquence, ils quittèrent leurs ateliers
sombres pour le grand jour de la société, de la ville et de la campagne».[23]
L’œil. Pour un impressionniste, tout est dans l’œil, le regard, bref la
perception visuelle; ce qui le distingue d’un peintre réaliste comme Courbet.
La sensibilité l’emporte sur la  réflexion logique, le goût scientiste se
déplace de la forme vers les mécanismes de la perception sensorielle des couleurs. En cela, les
impressionnistes firent un pas de plus vers la reproduction de la réalité qui
ne perçoit pas les lignes, mais seulement les formes par l’éclairage et les
dispositions : «Il ne s’agit plus de
représenter la réalité, mais ce qui apparaît à l’artiste à l’issue d’une
observation pénétrante : la vie en mouvement à travers la palpitation vitale de
la nature et la réalité mouvante des phénomènes, les restituant par la force
des couleurs et des lumières, dimensions essentielles des productions
impressionnistes. Paul Smith parle “de la volonté affichée par les peintres de
traduire la moindre information visuelle arrachée au spectacle mouvant du
réel”. L’artiste est résolument moderne; il réalise un brouillage conduisant à
une dissolution de la forme, une liberté du sujet, favorisant l’expression de
la couleur et de la lumière, transformant le tableau, contrairement à la tradition
académique, en espace perceptif, vivant. L’œuvre devient dynamique et vibrante,
la fonction de l’art vise avant tout une expérience. Voilà une caractéristique
essentielle de la modernité artistique».[24]
Par contre, les impressionnistes complétèrent parfaitement la rupture amorcée
par le réalisme de Courbet : «Sans
souscrire aux spéculations idéologiques sur la “visibilité pure” […], nous devons admettre cependant que, dans
la pratique picturale, Courbet et les impressionnistes opposent la visibilité
comme production à la visibilité
comme représentation. Cette
restitution matérialiste passe effectivement par la dé-nomination du réel,
c’est-à-dire par l’exercice d’une amnésie verbale devant le motif».[25]
Cette distinction est essentielle.
réflexion logique, le goût scientiste se
déplace de la forme vers les mécanismes de la perception sensorielle des couleurs. En cela, les
impressionnistes firent un pas de plus vers la reproduction de la réalité qui
ne perçoit pas les lignes, mais seulement les formes par l’éclairage et les
dispositions : «Il ne s’agit plus de
représenter la réalité, mais ce qui apparaît à l’artiste à l’issue d’une
observation pénétrante : la vie en mouvement à travers la palpitation vitale de
la nature et la réalité mouvante des phénomènes, les restituant par la force
des couleurs et des lumières, dimensions essentielles des productions
impressionnistes. Paul Smith parle “de la volonté affichée par les peintres de
traduire la moindre information visuelle arrachée au spectacle mouvant du
réel”. L’artiste est résolument moderne; il réalise un brouillage conduisant à
une dissolution de la forme, une liberté du sujet, favorisant l’expression de
la couleur et de la lumière, transformant le tableau, contrairement à la tradition
académique, en espace perceptif, vivant. L’œuvre devient dynamique et vibrante,
la fonction de l’art vise avant tout une expérience. Voilà une caractéristique
essentielle de la modernité artistique».[24]
Par contre, les impressionnistes complétèrent parfaitement la rupture amorcée
par le réalisme de Courbet : «Sans
souscrire aux spéculations idéologiques sur la “visibilité pure” […], nous devons admettre cependant que, dans
la pratique picturale, Courbet et les impressionnistes opposent la visibilité
comme production à la visibilité
comme représentation. Cette
restitution matérialiste passe effectivement par la dé-nomination du réel,
c’est-à-dire par l’exercice d’une amnésie verbale devant le motif».[25]
Cette distinction est essentielle.  encore théâtralisées chez Courbet à des scènes sans autre mise en scène
que celle de la nature et de l’instant, car on le verra surtout avec Cézanne,
le temps entre dans la composition impressionniste comme jamais depuis l’âge
baroque. Cézanne est à Courbet ce qu’un Caravage était à un Piero della
Francesca. Il y a donc une opposition structurelle entre Courbet d’un côté et
les impressionnistes de l’autre. Comme le dit Vincent Fauque en citant
Cézanne : «L’impressionnisme est
moderne en ce sens qu’il instaure quelque chose de “primitif”, d’instinctif. À
travers “une apologie de la sensation immédiate et pure, l’impressionniste voit
et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibrations
colorées”. Restituer au spectateur les impressions du peintre et le convier à
une expérience, voilà un des aspects essentiels que revêt le caractère de la
modernité et qui explique la surprise, déconcertante par nature, et la
réprobation avec laquelle vont être accueillies les premières productions
picturales des impressionnistes. Il ne s’agit plus de représenter, en
dépeignant objectivement un sujet, mais de faire place à la sensation
qu’éprouve le peintre et qu’il s’efforce de faire partager au spectateur;
démarche subjective par définition. “Peindre d’après nature ce n’est pas copier
l’objectif, c’est réaliser ses sensations”, nous dira Cézanne».[26]
Voilà pourquoi il est permis d’affirmer que «l’impressionnisme fut une réaction au
encore théâtralisées chez Courbet à des scènes sans autre mise en scène
que celle de la nature et de l’instant, car on le verra surtout avec Cézanne,
le temps entre dans la composition impressionniste comme jamais depuis l’âge
baroque. Cézanne est à Courbet ce qu’un Caravage était à un Piero della
Francesca. Il y a donc une opposition structurelle entre Courbet d’un côté et
les impressionnistes de l’autre. Comme le dit Vincent Fauque en citant
Cézanne : «L’impressionnisme est
moderne en ce sens qu’il instaure quelque chose de “primitif”, d’instinctif. À
travers “une apologie de la sensation immédiate et pure, l’impressionniste voit
et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibrations
colorées”. Restituer au spectateur les impressions du peintre et le convier à
une expérience, voilà un des aspects essentiels que revêt le caractère de la
modernité et qui explique la surprise, déconcertante par nature, et la
réprobation avec laquelle vont être accueillies les premières productions
picturales des impressionnistes. Il ne s’agit plus de représenter, en
dépeignant objectivement un sujet, mais de faire place à la sensation
qu’éprouve le peintre et qu’il s’efforce de faire partager au spectateur;
démarche subjective par définition. “Peindre d’après nature ce n’est pas copier
l’objectif, c’est réaliser ses sensations”, nous dira Cézanne».[26]
Voilà pourquoi il est permis d’affirmer que «l’impressionnisme fut une réaction au  réalisme, à l’objectivité du
réalisme, et une affirmation des droits de la subjectivité, de la personnalité
de l’artiste. Ce détachement par rapport à l’objectivité était un idéal - mais
point un idéal intellectuel - précisément parce qu’il était fondé sur la
sensation. L’impressionnisme fut aussi une réaction au romantisme, une révolte
contre les passions humaines, d’ordre littéraire, historique ou politique qu’on
avait introduites dans l’art».[27]
Ce sont les impressionnistes qui finissent par représenter le naturalisme en
peinture. La question, contrairement à celle décrite par Zola dans L’œuvre n’est pas entre Cézanne et
Manet, mais bien entre Courbet et Cézanne : «Son naturalisme radical le conduit à une attitude originale, bien que
simple, répétant toute approche dogmatique. Son attitude le conduit à
“explorer” le monde et à en
réalisme, à l’objectivité du
réalisme, et une affirmation des droits de la subjectivité, de la personnalité
de l’artiste. Ce détachement par rapport à l’objectivité était un idéal - mais
point un idéal intellectuel - précisément parce qu’il était fondé sur la
sensation. L’impressionnisme fut aussi une réaction au romantisme, une révolte
contre les passions humaines, d’ordre littéraire, historique ou politique qu’on
avait introduites dans l’art».[27]
Ce sont les impressionnistes qui finissent par représenter le naturalisme en
peinture. La question, contrairement à celle décrite par Zola dans L’œuvre n’est pas entre Cézanne et
Manet, mais bien entre Courbet et Cézanne : «Son naturalisme radical le conduit à une attitude originale, bien que
simple, répétant toute approche dogmatique. Son attitude le conduit à
“explorer” le monde et à en  exprimer la réalité telle qu’elle est ressentie.
Cette primauté de l’instinct et de la spontanéité amène le peintre à conférer à
ce qui est perçu plus d’importance qu’à ce qui est vu. Pour Giulio Argan, “il
s’agit de soustraire la sensation visuelle à toute expérience, à toute idée
reçue ou comportement préexistant susceptible d’en altérer l’instantanéité”».[28] En cet instant, le terme impressionnisme fut sur le point d’être remplacé par celui de naturalisme : «Au début, Duranty appelle l’impressionnisme la “Nouvelle Peinture”.
Puis, les peintres du groupe sont nommé les Naturalistes, ce qui pouvait plaire
à Zola quand il faisait l’éloge de Manet. Mais les novateurs furent qualifiés
d’Impressionnistes quand Claude Monet, en 1874, exposa chez Nadar, boulevard
des Capucines, le tableau qu’on peut voir aujourd’hui au Musée Marmottan, et
qu’il intitula: Impression, lever de soleil. “Ça ne peut vraiment pas passer
pour une vue du Havre, pensait Monet, en mal de titre, devant ce lever de
soleil sur un port, mettez : impression”».[29]
exprimer la réalité telle qu’elle est ressentie.
Cette primauté de l’instinct et de la spontanéité amène le peintre à conférer à
ce qui est perçu plus d’importance qu’à ce qui est vu. Pour Giulio Argan, “il
s’agit de soustraire la sensation visuelle à toute expérience, à toute idée
reçue ou comportement préexistant susceptible d’en altérer l’instantanéité”».[28] En cet instant, le terme impressionnisme fut sur le point d’être remplacé par celui de naturalisme : «Au début, Duranty appelle l’impressionnisme la “Nouvelle Peinture”.
Puis, les peintres du groupe sont nommé les Naturalistes, ce qui pouvait plaire
à Zola quand il faisait l’éloge de Manet. Mais les novateurs furent qualifiés
d’Impressionnistes quand Claude Monet, en 1874, exposa chez Nadar, boulevard
des Capucines, le tableau qu’on peut voir aujourd’hui au Musée Marmottan, et
qu’il intitula: Impression, lever de soleil. “Ça ne peut vraiment pas passer
pour une vue du Havre, pensait Monet, en mal de titre, devant ce lever de
soleil sur un port, mettez : impression”».[29]
 équipement des peintres se ramenait à une boîte qu'il devenait facile de déplacer vers l’extérieur. Les peintres, en sortant de leur studio,
se heurtaient au monde industriel, laid, bruyant et puant. Aussi, se
dirigèrent-ils vers des endroits plus beaux, plus calmes, plus
odoriférants : «Au cours des années
qui précédèrent 1870, trois jeunes gens : Monet, Renoir et Pissarro peignaient
les rives de la Seine et de l’Oise. C’étaient des peintres réalistes, attentifs
aux effets produits par la lumière dans l’eau, au mouvement, à la vie de ces
reflets, conscients des divisions de couleur qu’opère la transparence de l’eau,
dispensant ainsi le peintre d’employer, dans les ombres, des tons foncés. Ils
furent donc amenés à éclaircir leur palette et séparèrent les tons sur la toile
non pour suivre quelque théorie mais en raison de leur expérience spontanée de
la réalité. Pendant quelque temps, ils peignirent l’eau de cette façon
nouvelle, mais les collines, les arbres, les maisons et le ciel dans la
tradition réaliste, si bien que leurs toiles n’avaient pas d’équilibre. Afin
d’éviter cette erreur, ils s’efforcèrent de peindre tous les objets naturels -
et
équipement des peintres se ramenait à une boîte qu'il devenait facile de déplacer vers l’extérieur. Les peintres, en sortant de leur studio,
se heurtaient au monde industriel, laid, bruyant et puant. Aussi, se
dirigèrent-ils vers des endroits plus beaux, plus calmes, plus
odoriférants : «Au cours des années
qui précédèrent 1870, trois jeunes gens : Monet, Renoir et Pissarro peignaient
les rives de la Seine et de l’Oise. C’étaient des peintres réalistes, attentifs
aux effets produits par la lumière dans l’eau, au mouvement, à la vie de ces
reflets, conscients des divisions de couleur qu’opère la transparence de l’eau,
dispensant ainsi le peintre d’employer, dans les ombres, des tons foncés. Ils
furent donc amenés à éclaircir leur palette et séparèrent les tons sur la toile
non pour suivre quelque théorie mais en raison de leur expérience spontanée de
la réalité. Pendant quelque temps, ils peignirent l’eau de cette façon
nouvelle, mais les collines, les arbres, les maisons et le ciel dans la
tradition réaliste, si bien que leurs toiles n’avaient pas d’équilibre. Afin
d’éviter cette erreur, ils s’efforcèrent de peindre tous les objets naturels -
et 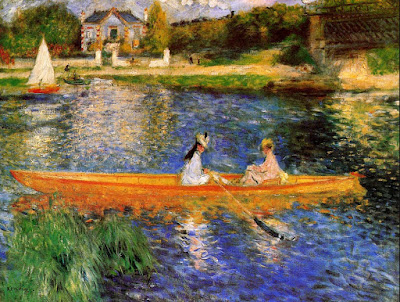 jusqu’aux personnages humains - de la même façon qu’ils avaient peint l’eau.
Ils créèrent donc toutes leurs images non pas seul on une forme abstraite, non
pas en clair-obscur, mais comme un reflet de lumière réel ou imaginaire. De la
nature, ils n’avaient choisi qu’un seul élément - la lumière - pour interpréter
la nature entière. La lumière, alors, ne fut plus un élément de la réalité,
mais un principe de style. L’impressionnisme était né».[32]
Il fallut une dizaine d’années pour que l’expérience porta ses fruits. Vers
1883, Renoir «commença à se rendre compte
que, travaillant en plein air, il avait été trop préoccupé des phénomènes de
lumière pour prêter une attention suffisante à d’autres problèmes. “En peignant
directement devant la nature, disait Renoir, on en arrive à ne plus chercher
que l’effet, à ne plus composer, et on tombe vite dans la monotonie”. Si grand
était son mépris pour ce qu’il avait réalisé jusqu’alors qu’il se prit d’une
véritable haine pour l’impressionnisme. Par réaction, il peignit plusieurs
toiles où chaque détail - y compris le feuillage des arbres - était d’abord
soigneusement tracé à l’encre, avant d’être coloré».[33]
La grande quantité d’œuvres peintes produites pendant la décennie des années
1870 semble avoir déjà atteint une certaine saturation au début des années
1880.
jusqu’aux personnages humains - de la même façon qu’ils avaient peint l’eau.
Ils créèrent donc toutes leurs images non pas seul on une forme abstraite, non
pas en clair-obscur, mais comme un reflet de lumière réel ou imaginaire. De la
nature, ils n’avaient choisi qu’un seul élément - la lumière - pour interpréter
la nature entière. La lumière, alors, ne fut plus un élément de la réalité,
mais un principe de style. L’impressionnisme était né».[32]
Il fallut une dizaine d’années pour que l’expérience porta ses fruits. Vers
1883, Renoir «commença à se rendre compte
que, travaillant en plein air, il avait été trop préoccupé des phénomènes de
lumière pour prêter une attention suffisante à d’autres problèmes. “En peignant
directement devant la nature, disait Renoir, on en arrive à ne plus chercher
que l’effet, à ne plus composer, et on tombe vite dans la monotonie”. Si grand
était son mépris pour ce qu’il avait réalisé jusqu’alors qu’il se prit d’une
véritable haine pour l’impressionnisme. Par réaction, il peignit plusieurs
toiles où chaque détail - y compris le feuillage des arbres - était d’abord
soigneusement tracé à l’encre, avant d’être coloré».[33]
La grande quantité d’œuvres peintes produites pendant la décennie des années
1870 semble avoir déjà atteint une certaine saturation au début des années
1880.
 de Courbet et défenseur
du style réaliste reconnaissait la valeur de l’un des premiers peintres,
Jongkind (1819-1891), d’origine néerlandaise, dont on peut dire qu’il fut
impressionniste : «“Moi je l’aime,
ce Jongkind, avait déclaré Castagnary, l’ami de Courbet, il est artiste
jusqu’au bout des ongles; je lui trouve une vraie et rare sensibilité. Chez lui
tout gît dans l’impression.” Pour rester fidèle à ses impressions, Jongkind
s’ingénia à représenter dans ses toiles non ce qu’il savait de son sujet, mais
ce qu’il apercevait dans des conditions atmosphériques données. Avant de venir
à Honfleur dans l’été de 1864, il avait peint deux vues de l’abside de
Notre-Dame [de Paris], une fois dans
la lumière argentée d’un matinée d’hiver, une autre sous le ciel embrasé du
couchant. Plusieurs semaines et plusieurs mois peut-être séparent ces deux
études, mais dans chaque cas l’artiste avait
de Courbet et défenseur
du style réaliste reconnaissait la valeur de l’un des premiers peintres,
Jongkind (1819-1891), d’origine néerlandaise, dont on peut dire qu’il fut
impressionniste : «“Moi je l’aime,
ce Jongkind, avait déclaré Castagnary, l’ami de Courbet, il est artiste
jusqu’au bout des ongles; je lui trouve une vraie et rare sensibilité. Chez lui
tout gît dans l’impression.” Pour rester fidèle à ses impressions, Jongkind
s’ingénia à représenter dans ses toiles non ce qu’il savait de son sujet, mais
ce qu’il apercevait dans des conditions atmosphériques données. Avant de venir
à Honfleur dans l’été de 1864, il avait peint deux vues de l’abside de
Notre-Dame [de Paris], une fois dans
la lumière argentée d’un matinée d’hiver, une autre sous le ciel embrasé du
couchant. Plusieurs semaines et plusieurs mois peut-être séparent ces deux
études, mais dans chaque cas l’artiste avait  tenu à se placer exactement au
même endroit et à reproduire ce qu’il voyait. Tandis que sous la lumière vive
chaque détail architectural lui était apparu clairement, ces mêmes détails
s’étaient confondus dans la masse indistincte de l’abside au soleil couchant;
et Jongkind avait renoncé alors à tracer les arcs-boutants puisqu’il ne pouvait
plus nettement les voir. En substituant ainsi la forme apparente à la forme
réelle, Jongkind - comme Constable et Boudin avant lui - faisait des conditions
atmosphériques son véritable sujet d’étude. Monet allait bientôt le suivre dans
cette voie, peignant une rouge normande, un jour sous un ciel nuageux, et un
autre jour sous la neige. En observant comment les couleurs soi-disant locales
et les formes familières variaient selon les changements subis par leur
entourage, il fit un pas décisif vers la pleine compréhension de la nature».[34]
Rien ne laissait présager, sinon cette atmosphère
propre aux œuvres de Jongkind que ce dernier finirait par aller à
contre-courant de la vague réaliste de l’époque. Au contraire, tandis que
l’aventure de Courbet s’achevait dans le four de la Commune de Paris, celle des
impressionnistes allait s’imposer au cours de la décennie qui suivrait :
tenu à se placer exactement au
même endroit et à reproduire ce qu’il voyait. Tandis que sous la lumière vive
chaque détail architectural lui était apparu clairement, ces mêmes détails
s’étaient confondus dans la masse indistincte de l’abside au soleil couchant;
et Jongkind avait renoncé alors à tracer les arcs-boutants puisqu’il ne pouvait
plus nettement les voir. En substituant ainsi la forme apparente à la forme
réelle, Jongkind - comme Constable et Boudin avant lui - faisait des conditions
atmosphériques son véritable sujet d’étude. Monet allait bientôt le suivre dans
cette voie, peignant une rouge normande, un jour sous un ciel nuageux, et un
autre jour sous la neige. En observant comment les couleurs soi-disant locales
et les formes familières variaient selon les changements subis par leur
entourage, il fit un pas décisif vers la pleine compréhension de la nature».[34]
Rien ne laissait présager, sinon cette atmosphère
propre aux œuvres de Jongkind que ce dernier finirait par aller à
contre-courant de la vague réaliste de l’époque. Au contraire, tandis que
l’aventure de Courbet s’achevait dans le four de la Commune de Paris, celle des
impressionnistes allait s’imposer au cours de la décennie qui suivrait :  «Dans leur effort pour atteindre ce but et
trouver une expression plus fidèle à la première impression que donne
l’apparence des choses, les impressionnistes avaient créé un style nouveau.
S’étant complètement dégagés des principes traditionnels, ils avaient élaboré
ce style de manière à pouvoir suivre en toute liberté la voie des découvertes
que leur suggérait leur sensibilité intense. En agissant de cette manière, ils
renonçaient à toute prétention de recréer la réalité. Rejetant l’objectivité du
réalisme, ils avaient choisi un seul élément de la réalité - la lumière - pour
interpréter la nature tout entière. Ce nouveau point de vue avait petit à petit
amené les peintres à établir une nouvelle palette et à inventer une nouvelle
technique, adaptés à leurs efforts, pour capter le jeu fluide de la lumière.
L’observation attentive de la lumière les avait conduits à supprimer les ombres
noires traditionnelles et à adopter des couleurs claires. Elle les avait
conduits également à subordonner la notion abstraite de couleur locale à
l’effet atmosphérique
«Dans leur effort pour atteindre ce but et
trouver une expression plus fidèle à la première impression que donne
l’apparence des choses, les impressionnistes avaient créé un style nouveau.
S’étant complètement dégagés des principes traditionnels, ils avaient élaboré
ce style de manière à pouvoir suivre en toute liberté la voie des découvertes
que leur suggérait leur sensibilité intense. En agissant de cette manière, ils
renonçaient à toute prétention de recréer la réalité. Rejetant l’objectivité du
réalisme, ils avaient choisi un seul élément de la réalité - la lumière - pour
interpréter la nature tout entière. Ce nouveau point de vue avait petit à petit
amené les peintres à établir une nouvelle palette et à inventer une nouvelle
technique, adaptés à leurs efforts, pour capter le jeu fluide de la lumière.
L’observation attentive de la lumière les avait conduits à supprimer les ombres
noires traditionnelles et à adopter des couleurs claires. Elle les avait
conduits également à subordonner la notion abstraite de couleur locale à
l’effet atmosphérique  général. En appliquant la couleur en touches
perceptibles, ils avaient réussi à adoucir les contours des objets et à les
fondre avec leur entourage. Cette technique leur avait, de plus, permis
d’introduire une couleur dans la zone d’une autre sans la dégrader ni la
perdre, diversifiant ainsi les coloris. Mais surtout, la multitude de touches
apparentes et leurs contrastes avaient contribué à exprimer ou à suggérer
l’activité, la vibration de la lumière et à les recréer, dans une certaine
mesure, sur la toile. D’autre part, cette exécution par petites touches vives
semblait convenir le mieux à leurs efforts pour saisir des aspects rapidement
changeants. Puisque la main est plus lente que l’œil - prompt à percevoir les
effets instantanés - une technique permettait aux peintres un travail rapide
était essentielle pour qu’ils puissent traduire leurs perceptions sans trop de
retard. Faisant allusion à ces problèmes, Renoir avait coutume de dire : “En
plein air on triche tout le temps”. Cependant la “tricherie” consistait
simplement à faire un choix parmi la multitude d’aspects qu’offrait la nature,
afin de transposer les miracles de la lumière en un langage de couleurs et à
deux dimensions, et aussi à rendre l’aspect choisi avec les tons et l’exécution
qui se rapprochaient le plus de l’impression reçue».[35]
Si Renoir, en 1883, pouvait remarquer une certaine saturation de
l’impressionnisme, les expériences se poursuivaient et allaient finir par
varier complètement le regard des premiers peintres de la tendance. Le
post-impressionnisme triompherait, à travers différentes approches, au cours
des deux décennies qui séparent la fin du siècle.
général. En appliquant la couleur en touches
perceptibles, ils avaient réussi à adoucir les contours des objets et à les
fondre avec leur entourage. Cette technique leur avait, de plus, permis
d’introduire une couleur dans la zone d’une autre sans la dégrader ni la
perdre, diversifiant ainsi les coloris. Mais surtout, la multitude de touches
apparentes et leurs contrastes avaient contribué à exprimer ou à suggérer
l’activité, la vibration de la lumière et à les recréer, dans une certaine
mesure, sur la toile. D’autre part, cette exécution par petites touches vives
semblait convenir le mieux à leurs efforts pour saisir des aspects rapidement
changeants. Puisque la main est plus lente que l’œil - prompt à percevoir les
effets instantanés - une technique permettait aux peintres un travail rapide
était essentielle pour qu’ils puissent traduire leurs perceptions sans trop de
retard. Faisant allusion à ces problèmes, Renoir avait coutume de dire : “En
plein air on triche tout le temps”. Cependant la “tricherie” consistait
simplement à faire un choix parmi la multitude d’aspects qu’offrait la nature,
afin de transposer les miracles de la lumière en un langage de couleurs et à
deux dimensions, et aussi à rendre l’aspect choisi avec les tons et l’exécution
qui se rapprochaient le plus de l’impression reçue».[35]
Si Renoir, en 1883, pouvait remarquer une certaine saturation de
l’impressionnisme, les expériences se poursuivaient et allaient finir par
varier complètement le regard des premiers peintres de la tendance. Le
post-impressionnisme triompherait, à travers différentes approches, au cours
des deux décennies qui séparent la fin du siècle.

 innovation qui satisfaisait au scientisme issu du
positivisme. On ne saurait trouver tendance artistique plus voué à la
reproduction du réel puisque de l’objet observé, on passait à la méthode
d’observation. Il y a une épistémologie à l’origine du travail des
impressionnistes. L’un des premiers peintres à prendre son matériel et à sortir
à l’extérieur de son atelier s’appelait Eugène Boudin (1824-1898). Comme il
était originaire du Calvados et vivait à proximité de l’océan, sa nature était
essentiellement maritime. Comme élève, il avait le jeune Claude Monet
(1840-1926) : «Au lieu de brosser de
jolis tableaux de genre, il s’était mis à faire des études en plein air. Tout
ce qu’il rapporta de Paris était la conviction que : “les romantiques ont fait
leur temps. Il faut désormais chercher les simples beautés de la nature, la
nature bien vue dans toute sa variété, sa fraîcheur.” Cette conviction, Boudin
souhaitait à présent la communiquer à son jeune élève, et Monet la partagea
bientôt, car non seulement il regardait travailler Boudin, mais il profitait
encore de sa conversation. Boudin avait à la fois un œil sensible et un esprit
clair. Il savait exprimer ses observations et son expérience en paroles
simples. “Tout ce qui est peint directement et sur place, disait-il, par
exemple, a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu’on ne
retrouve plus dans l’atelier.” Il spécifiait qu’il fait “montrer un entêtement
extrême à rester dans l’impression primitive, qui est la bonne”, en insistant
sur le fait que “ce n’est pas un morceau qui doit frapper dans un tableau, mais
bien l’ensemble”».[36]
Boudin situait le travail cérébral du peintre dans la mémoire, entre
l’impression laissée par le déjà vu dont
le travail devait conduire à la création artistique comme un inédit. Personne n’avait vu ce que seul
le peintre avait pu voir sur la plage en peignant les reflets de la mer et les
nuages poussés par le vent.
innovation qui satisfaisait au scientisme issu du
positivisme. On ne saurait trouver tendance artistique plus voué à la
reproduction du réel puisque de l’objet observé, on passait à la méthode
d’observation. Il y a une épistémologie à l’origine du travail des
impressionnistes. L’un des premiers peintres à prendre son matériel et à sortir
à l’extérieur de son atelier s’appelait Eugène Boudin (1824-1898). Comme il
était originaire du Calvados et vivait à proximité de l’océan, sa nature était
essentiellement maritime. Comme élève, il avait le jeune Claude Monet
(1840-1926) : «Au lieu de brosser de
jolis tableaux de genre, il s’était mis à faire des études en plein air. Tout
ce qu’il rapporta de Paris était la conviction que : “les romantiques ont fait
leur temps. Il faut désormais chercher les simples beautés de la nature, la
nature bien vue dans toute sa variété, sa fraîcheur.” Cette conviction, Boudin
souhaitait à présent la communiquer à son jeune élève, et Monet la partagea
bientôt, car non seulement il regardait travailler Boudin, mais il profitait
encore de sa conversation. Boudin avait à la fois un œil sensible et un esprit
clair. Il savait exprimer ses observations et son expérience en paroles
simples. “Tout ce qui est peint directement et sur place, disait-il, par
exemple, a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu’on ne
retrouve plus dans l’atelier.” Il spécifiait qu’il fait “montrer un entêtement
extrême à rester dans l’impression primitive, qui est la bonne”, en insistant
sur le fait que “ce n’est pas un morceau qui doit frapper dans un tableau, mais
bien l’ensemble”».[36]
Boudin situait le travail cérébral du peintre dans la mémoire, entre
l’impression laissée par le déjà vu dont
le travail devait conduire à la création artistique comme un inédit. Personne n’avait vu ce que seul
le peintre avait pu voir sur la plage en peignant les reflets de la mer et les
nuages poussés par le vent.
 soleil reflété par les objets tend, à
force de clarté, à les ramener à cette unité lumineuse qui fond ses sept rayons
prismatiques en un seul éclat incolore, qui est la lumière. D’intuition en
intuition, ils en sont arrivés peu à peu à décomposer la lueur solaire en ses rayons,
en ses éléments, et à recomposer son unité par l’harmonie générale des
irisations qu’ils répandent sur leurs toiles. Au point de vue de la délicatesse
de l’œil, de la subtile pénétration du coloris, c’est un résultat tout à fait
extraordinaire. Le plus savant physicien ne pourrait rien reprocher à leurs
analyses de la lumière».[37]
Des découvertes du chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) (mort à 102
ans!), dont la loi du contraste simultané
des couleurs énoncée dans un lourd mémoire de 750 pages en 1839 et qui
affirme qu’une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance
complémentaire dans le ton, les complémentaires s’éclairent mutuellement et les
couleurs non complémentaires paraissent sales comme
soleil reflété par les objets tend, à
force de clarté, à les ramener à cette unité lumineuse qui fond ses sept rayons
prismatiques en un seul éclat incolore, qui est la lumière. D’intuition en
intuition, ils en sont arrivés peu à peu à décomposer la lueur solaire en ses rayons,
en ses éléments, et à recomposer son unité par l’harmonie générale des
irisations qu’ils répandent sur leurs toiles. Au point de vue de la délicatesse
de l’œil, de la subtile pénétration du coloris, c’est un résultat tout à fait
extraordinaire. Le plus savant physicien ne pourrait rien reprocher à leurs
analyses de la lumière».[37]
Des découvertes du chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) (mort à 102
ans!), dont la loi du contraste simultané
des couleurs énoncée dans un lourd mémoire de 750 pages en 1839 et qui
affirme qu’une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance
complémentaire dans le ton, les complémentaires s’éclairent mutuellement et les
couleurs non complémentaires paraissent sales comme  lorsqu’un jaune placé près
d’un vert prend une nuance violette. Delacroix la connaissait, probablement,
mais ce furent les impressionnistes qui s’appliquèrent à l’élaborer dans leurs
toiles. En tant que chimiste, Chevreul travaillait pour l’industrie teinturière
qui cherchait à améliorer les tons de leurs produits. En important cette loi
dans le monde de la peinture, l’impressionnisme opéra selon les principes
épistémologiques de l’expérimentation. «La
qualité la plus évidente des impressionnistes, celle qui leur a été le plus
rapidement reconnue, c’est d’avoir fait usage d’une gamme de couleurs plus
claire que tous les autres peintres depuis le XVIe siècle. Cela provient de la
séparation des couleurs; la fusion optique de deux lumières
lorsqu’un jaune placé près
d’un vert prend une nuance violette. Delacroix la connaissait, probablement,
mais ce furent les impressionnistes qui s’appliquèrent à l’élaborer dans leurs
toiles. En tant que chimiste, Chevreul travaillait pour l’industrie teinturière
qui cherchait à améliorer les tons de leurs produits. En important cette loi
dans le monde de la peinture, l’impressionnisme opéra selon les principes
épistémologiques de l’expérimentation. «La
qualité la plus évidente des impressionnistes, celle qui leur a été le plus
rapidement reconnue, c’est d’avoir fait usage d’une gamme de couleurs plus
claire que tous les autres peintres depuis le XVIe siècle. Cela provient de la
séparation des couleurs; la fusion optique de deux lumières  distinctes sur la
toile étant beaucoup plus brillante que le mélange de deux teintes sur cette
toile. Si on mélange deux teintes, du bleu et du jaune, on obtient un vert
grisâtre moins intense que le bleu et le jaune primitifs. Mais si on juxtapose
le bleu et le jaune sur la toile, à une certaine distance, l’œil voit le vert
qui en résulte beaucoup plus intense que celui qui provient du mélange des deux
teintes. Les impressionnistes n’ont jamais fait un emploi systématique de cette
fusion de lumières, mais ils n’en ont pas moins atteint un effet clair et
intense par la subtilité de leur sensibilité chromatique, la plus fine que l’on
trouve dans toute l’histoire de l’art».[38]
Du contrapposto de l’âge baroque qui
expérimentait sur les contrastes entre l’obscurité et la lumière, les
impressionnistes expérimentaient désormais sur les contrastes entre les
différentes couleurs, primaires et complémentaires. Observer la nature et en
chercher une transposition fidèle des contrastes lumineux à la manière des
peintres hollandais du XVIIe siècle, mais en insistant davantage sur les perceptions
chromatiques plutôt que la composition théâtrale
en atelier fut leur apport incontestable.
distinctes sur la
toile étant beaucoup plus brillante que le mélange de deux teintes sur cette
toile. Si on mélange deux teintes, du bleu et du jaune, on obtient un vert
grisâtre moins intense que le bleu et le jaune primitifs. Mais si on juxtapose
le bleu et le jaune sur la toile, à une certaine distance, l’œil voit le vert
qui en résulte beaucoup plus intense que celui qui provient du mélange des deux
teintes. Les impressionnistes n’ont jamais fait un emploi systématique de cette
fusion de lumières, mais ils n’en ont pas moins atteint un effet clair et
intense par la subtilité de leur sensibilité chromatique, la plus fine que l’on
trouve dans toute l’histoire de l’art».[38]
Du contrapposto de l’âge baroque qui
expérimentait sur les contrastes entre l’obscurité et la lumière, les
impressionnistes expérimentaient désormais sur les contrastes entre les
différentes couleurs, primaires et complémentaires. Observer la nature et en
chercher une transposition fidèle des contrastes lumineux à la manière des
peintres hollandais du XVIIe siècle, mais en insistant davantage sur les perceptions
chromatiques plutôt que la composition théâtrale
en atelier fut leur apport incontestable.
 ont été les premiers à sentir la nécessité de déformer pour trouver la forme
des couleurs séparées - ce qui était plus facile à faire dans un ciel, un
fleuve, une barque, que dans un personnage humain. C’est une des raisons pour
lesquelles l’impressionnisme naquit dans la peinture de paysage, et ne fut
appliqué que plus tard à la figure humaine».[39] Nous pouvons observer par cette œuvre que «la lumière est l’élément qui révèle l’apparence de la réalité, et ce
que les impressionnistes ont peint, précisément, ce n’est pas la réalité, mais
l’apparence. Ils concentrèrent leur attention sur l’apparence avec une
conscience plus nette que les peintres précédents. Or saisir l’apparence est
une forme de la sensation, aussi libre que possible à l’égard de la
connaissance et de la volonté. Cela revient à dire que les impressionnistes
restèrent fidèles à leurs sensations, à leurs impressions sur la nature, et
qu’ils trouvèrent une forme plus proche que toutes celles qu’on avait trouvées
avant eux de la première impression et de l’apparence. Elle était plus proche à
cause de la vive sensibilité de ces peintres, et de la conscience qu’ils
avaient de la valeur absolue en art de l’apparence des choses. Au lieu de
sous-estimer leurs impressions, ils gardèrent leur liberté à l’égard des
principes traditionnels de la forme abstraite».[40] C'est ainsi qu'en poursuivant la veine réaliste/naturaliste, l'impressionnisme finit par la briser pour reconnaître que la seule réalité qui nous saute aux yeux n'est qu'une apparence. Que la réalité est ancrée plus profondément et que nous n'en percevons que la surface trouble. On ne retrouvera donc pas de métaphysique dans les tableaux impressionnistes et lorsque certains de leurs peintres se laisseront tenter par l'idéologie, ce sera pour célébrer des fêtes patriotiques, comme chez Monet encore, avec les célébrations de l'Exposition universelle de Paris, le 30 juin 1878. Mais
ont été les premiers à sentir la nécessité de déformer pour trouver la forme
des couleurs séparées - ce qui était plus facile à faire dans un ciel, un
fleuve, une barque, que dans un personnage humain. C’est une des raisons pour
lesquelles l’impressionnisme naquit dans la peinture de paysage, et ne fut
appliqué que plus tard à la figure humaine».[39] Nous pouvons observer par cette œuvre que «la lumière est l’élément qui révèle l’apparence de la réalité, et ce
que les impressionnistes ont peint, précisément, ce n’est pas la réalité, mais
l’apparence. Ils concentrèrent leur attention sur l’apparence avec une
conscience plus nette que les peintres précédents. Or saisir l’apparence est
une forme de la sensation, aussi libre que possible à l’égard de la
connaissance et de la volonté. Cela revient à dire que les impressionnistes
restèrent fidèles à leurs sensations, à leurs impressions sur la nature, et
qu’ils trouvèrent une forme plus proche que toutes celles qu’on avait trouvées
avant eux de la première impression et de l’apparence. Elle était plus proche à
cause de la vive sensibilité de ces peintres, et de la conscience qu’ils
avaient de la valeur absolue en art de l’apparence des choses. Au lieu de
sous-estimer leurs impressions, ils gardèrent leur liberté à l’égard des
principes traditionnels de la forme abstraite».[40] C'est ainsi qu'en poursuivant la veine réaliste/naturaliste, l'impressionnisme finit par la briser pour reconnaître que la seule réalité qui nous saute aux yeux n'est qu'une apparence. Que la réalité est ancrée plus profondément et que nous n'en percevons que la surface trouble. On ne retrouvera donc pas de métaphysique dans les tableaux impressionnistes et lorsque certains de leurs peintres se laisseront tenter par l'idéologie, ce sera pour célébrer des fêtes patriotiques, comme chez Monet encore, avec les célébrations de l'Exposition universelle de Paris, le 30 juin 1878. Mais  à travers le Voilier à Argenteuil, nous découvrons la bacchanale qui se dégage de l'esprit impressionniste. Finis les mystères macabres des symbolistes. «Le
ciel et l’eau sont dominés par le coucher du soleil avec des tons orange,
jaunes et violets vibrant dans l’enthousiasme païen pour une fête orgiaque et
cependant équilibrés par les verts et par les bleus. Le voilier, à peine en
dehors du centre de la toile, peint d’un vert terne et presque neutre, est,
pour la lumière, une espèce de limite, tandis qu’au ciel, le soleil, en son
dernier salut de chaque jour, répand tout son trésor de pierreries et le
réfléchi dans l’eau. Le voilier, par son opacité, suggère la venue du soir, le
calme après la fête. L’excitation créatrice de Monet est visible dans les
couleurs séparées et dans la clarté de la palette, aussi bien que dans les
coups de pinceau furieux. Il semble plongé dans le mouvement des couleurs et
dans la vibration de la lumière; il est en proie, devant la nature, à un
émerveillement. Et pourtant au milieu d’une telle profusion de richesse, il
n’est pas joyeux; il sent la fin proche et c’est ce sentiment de mélancolie diffuse que donnent l’harmonie des couleurs et l’humanité de la nature».[41]
à travers le Voilier à Argenteuil, nous découvrons la bacchanale qui se dégage de l'esprit impressionniste. Finis les mystères macabres des symbolistes. «Le
ciel et l’eau sont dominés par le coucher du soleil avec des tons orange,
jaunes et violets vibrant dans l’enthousiasme païen pour une fête orgiaque et
cependant équilibrés par les verts et par les bleus. Le voilier, à peine en
dehors du centre de la toile, peint d’un vert terne et presque neutre, est,
pour la lumière, une espèce de limite, tandis qu’au ciel, le soleil, en son
dernier salut de chaque jour, répand tout son trésor de pierreries et le
réfléchi dans l’eau. Le voilier, par son opacité, suggère la venue du soir, le
calme après la fête. L’excitation créatrice de Monet est visible dans les
couleurs séparées et dans la clarté de la palette, aussi bien que dans les
coups de pinceau furieux. Il semble plongé dans le mouvement des couleurs et
dans la vibration de la lumière; il est en proie, devant la nature, à un
émerveillement. Et pourtant au milieu d’une telle profusion de richesse, il
n’est pas joyeux; il sent la fin proche et c’est ce sentiment de mélancolie diffuse que donnent l’harmonie des couleurs et l’humanité de la nature».[41]
 machines fumantes, tout cela
offrait des sujets nouveaux et passionnants; sans se lasser, Monet installait son
chevalet dans différents coins de la gare. Comme Degas aimait à le faire, il
étudiait le même motif sous des aspects multiples, saisissant avec vigueur et
subtilité à la fois le caractère spécifique du lieu et son atmosphère propre.
Duranty aurait pu reconnaître dans ces études la conquête d’une des scènes les
plus caractéristiques de la vie contemporaine, si le point de vue de Monet
n’avait pas été dépourvu de toute préoccupation sociale. Il voyait dans cette
gare de chemin de fer un prétexte plutôt qu’un but en soi; il découvrait et
fouillait tous les aspects picturaux du machinisme, mais ne faisait aucun
commentaire sur sa laideur, son utilité ou sa beauté, ni sur ses rapports avec
l’homme».[42]
Camille Pissarro (1830-1903) également
machines fumantes, tout cela
offrait des sujets nouveaux et passionnants; sans se lasser, Monet installait son
chevalet dans différents coins de la gare. Comme Degas aimait à le faire, il
étudiait le même motif sous des aspects multiples, saisissant avec vigueur et
subtilité à la fois le caractère spécifique du lieu et son atmosphère propre.
Duranty aurait pu reconnaître dans ces études la conquête d’une des scènes les
plus caractéristiques de la vie contemporaine, si le point de vue de Monet
n’avait pas été dépourvu de toute préoccupation sociale. Il voyait dans cette
gare de chemin de fer un prétexte plutôt qu’un but en soi; il découvrait et
fouillait tous les aspects picturaux du machinisme, mais ne faisait aucun
commentaire sur sa laideur, son utilité ou sa beauté, ni sur ses rapports avec
l’homme».[42]
Camille Pissarro (1830-1903) également  délaissera quelquefois la nature pour
décrire des paysages urbains : la Seine et ses bateaux, les rues bondées
par les omnibus et les calèches, les passants sur un pavé mouillé, des scènes
de nuit éclairées au gaz. Au moment où Renoir considérait que le genre
s’installait de manière trop classique, les impressionnistes poussèrent plus
loin dans l’inventivité en travaillant sur les compositions atmosphériques : «Chez Louis Anquetin, nous trouvons une autre
recherche de la forme fermée. En 1887, il expose sa méthode pour trouver une
synthèse coloristique. Elle consiste à regarder un paysage à travers des
plaques de verre de différentes couleurs. Cette idée est née d’un événement
tout particulier. Dans la maison de son enfance, il y avait une véranda avec
une porte aux vitres polychromes jaunes, vertes, rouges et bleues, comme il
était de bon ton dans les maisons bourgeoises des années 70 et 80. En regardant
le paysage à travers ces vitres, le gamin de seize ans remarqua que
l’atmosphère changeait selon la couleur de la vitre. Que ce soit le matin ou le
soir, ces vitres avaient un effet particulier: le vert donnait une impression
de fraîcheur matinale, le bleu l’illusion d’un clair de lune, le rouge
l’effervescence d’un coucher de soleil et le jaune la
délaissera quelquefois la nature pour
décrire des paysages urbains : la Seine et ses bateaux, les rues bondées
par les omnibus et les calèches, les passants sur un pavé mouillé, des scènes
de nuit éclairées au gaz. Au moment où Renoir considérait que le genre
s’installait de manière trop classique, les impressionnistes poussèrent plus
loin dans l’inventivité en travaillant sur les compositions atmosphériques : «Chez Louis Anquetin, nous trouvons une autre
recherche de la forme fermée. En 1887, il expose sa méthode pour trouver une
synthèse coloristique. Elle consiste à regarder un paysage à travers des
plaques de verre de différentes couleurs. Cette idée est née d’un événement
tout particulier. Dans la maison de son enfance, il y avait une véranda avec
une porte aux vitres polychromes jaunes, vertes, rouges et bleues, comme il
était de bon ton dans les maisons bourgeoises des années 70 et 80. En regardant
le paysage à travers ces vitres, le gamin de seize ans remarqua que
l’atmosphère changeait selon la couleur de la vitre. Que ce soit le matin ou le
soir, ces vitres avaient un effet particulier: le vert donnait une impression
de fraîcheur matinale, le bleu l’illusion d’un clair de lune, le rouge
l’effervescence d’un coucher de soleil et le jaune la  chaleur du plein midi. Ce
système lui donne non seulement la clef d’une simplification coloristique, mais
aussi la possibilité de traduire les valeurs essentielles d’une atmosphère. Ce
principe - un monochromisme émotionnel - eut une grande importance, entre
autres pour van Gogh qui en est enthousiasmé. Anquetin représente à sa manière
la même aspiration vers l’abstraction et la simplification, et sa palette
montre aussi qu’il cherche à délimiter la surface, à créer un effet de synthèse».[43]
Il fallait non plus seulement ramener la nature telle que l’œil la percevait,
ce qui restera le propre des impressionnistes, mais il fallait désormais
travailler sur l’atmosphère qui se dégage des ondes que nous percevons, et non
seulement la luminosité ou la couleur, mais aussi la moiteur, la froidure, la
sécheresse, et toutes les atmosphères dans lesquelles les relations humaines
peuvent baigner. Ce sera-là l’essentiel des néo-impressionnistes et des
pointillistes qui pousseront le genre jusqu’à sa folie mégalomane avec Seurat
et son Un dimanche après-mdi à l’île de
la Grande Jatte peint entre 1884 et 1886. Après avoir «étudié les traités scientifiques de Chevreul, dont les théories sur
l’harmonie des couleurs avaient déjà intéressé Delacroix. C’est ainsi que
Seurat avait été amené à l’idée de réconcilier l’art avec la science,
conception bien en accord avec les courants idéologiques de l’époque qui
cherchaient à substituer la connaissance à l’intuition.
chaleur du plein midi. Ce
système lui donne non seulement la clef d’une simplification coloristique, mais
aussi la possibilité de traduire les valeurs essentielles d’une atmosphère. Ce
principe - un monochromisme émotionnel - eut une grande importance, entre
autres pour van Gogh qui en est enthousiasmé. Anquetin représente à sa manière
la même aspiration vers l’abstraction et la simplification, et sa palette
montre aussi qu’il cherche à délimiter la surface, à créer un effet de synthèse».[43]
Il fallait non plus seulement ramener la nature telle que l’œil la percevait,
ce qui restera le propre des impressionnistes, mais il fallait désormais
travailler sur l’atmosphère qui se dégage des ondes que nous percevons, et non
seulement la luminosité ou la couleur, mais aussi la moiteur, la froidure, la
sécheresse, et toutes les atmosphères dans lesquelles les relations humaines
peuvent baigner. Ce sera-là l’essentiel des néo-impressionnistes et des
pointillistes qui pousseront le genre jusqu’à sa folie mégalomane avec Seurat
et son Un dimanche après-mdi à l’île de
la Grande Jatte peint entre 1884 et 1886. Après avoir «étudié les traités scientifiques de Chevreul, dont les théories sur
l’harmonie des couleurs avaient déjà intéressé Delacroix. C’est ainsi que
Seurat avait été amené à l’idée de réconcilier l’art avec la science,
conception bien en accord avec les courants idéologiques de l’époque qui
cherchaient à substituer la connaissance à l’intuition.  Mettant à profit les
découvertes de Chevreul et d’autres savants, Seurat réduisit sa palette aux quatre couleurs fondamentales du cercle de Chevreul avec leurs tons intermédiaires :
bleu, bleu-violet, violet, violet-rouge,
rouge, rouge-orangé, orangé,
orangé-jaune, jaune, jaune-vert, vert,
vert-bleu et bleu de nouveau. Il mélangeait ces tons avec du blanc, mais pour
s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur et de l’harmonie,
il ne mélangeait jamais ces teintes entre elles. Pour remplacer le mélange des
pigments, il employait des petites taches de couleur pure, juxtaposées ou
entre-mêlées de telle manière que le mélange se faisait optiquement,
c’est-à-dire dans l’œil du spectateur. Il donna à ce procédé le nom de
divisionnisme. Il remplaça le “désordre” des coups de pinceau impressionnistes
par une exécution méticuleuse, faite de taches soigneusement posées, qui
donnait à ses œuvres une certaine austérité, une atmosphère de calme et de
stabilité. Abandonnant l’expression spontanée des sensations, prônée par les
impressionnistes, et ne laissant rien au hasard, il trouva dans l’observation stricte
des lois de l’optique une discipline et le moyen de réalisations nouvelles».[44]
Entre l’atmosphère chaude et moite des tableaux de Van Gogh et les tableaux
quasi psychédéliques, froids et secs de Seurat, il semblait que la tendance
impressionniste atteignait les limites de ses possibilités, mais du pointillisme nous reparlerons.
Mettant à profit les
découvertes de Chevreul et d’autres savants, Seurat réduisit sa palette aux quatre couleurs fondamentales du cercle de Chevreul avec leurs tons intermédiaires :
bleu, bleu-violet, violet, violet-rouge,
rouge, rouge-orangé, orangé,
orangé-jaune, jaune, jaune-vert, vert,
vert-bleu et bleu de nouveau. Il mélangeait ces tons avec du blanc, mais pour
s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur et de l’harmonie,
il ne mélangeait jamais ces teintes entre elles. Pour remplacer le mélange des
pigments, il employait des petites taches de couleur pure, juxtaposées ou
entre-mêlées de telle manière que le mélange se faisait optiquement,
c’est-à-dire dans l’œil du spectateur. Il donna à ce procédé le nom de
divisionnisme. Il remplaça le “désordre” des coups de pinceau impressionnistes
par une exécution méticuleuse, faite de taches soigneusement posées, qui
donnait à ses œuvres une certaine austérité, une atmosphère de calme et de
stabilité. Abandonnant l’expression spontanée des sensations, prônée par les
impressionnistes, et ne laissant rien au hasard, il trouva dans l’observation stricte
des lois de l’optique une discipline et le moyen de réalisations nouvelles».[44]
Entre l’atmosphère chaude et moite des tableaux de Van Gogh et les tableaux
quasi psychédéliques, froids et secs de Seurat, il semblait que la tendance
impressionniste atteignait les limites de ses possibilités, mais du pointillisme nous reparlerons.

 plupart des toiles impressionnistes est
strictement analogue à celui d’une toile classique. […] Les points d’appui de la composition s’estompent sous le semis des
touches colorées qui reproduisent le tremblement de la lumière, mais ramené à
ses lignes générales, le tableau suggère toujours le fameux espace cubique de
la Renaissance et l’on regarde toujours à travers la fameuse fenêtre ouverte
d’Alberti».[45]
Francastel tient à démentir une position qui donnerait aux impressionnistes le
fait d’avoir été les premiers à défaire le cadre du lieu visuel de l’art
occidental. D’une modernité l’autre, la seconde marquerait la fin de la
première instaurée à l’époque de la Renaissance. Comme les préraphélites
voulurent revenir à l’ère antérieure à la Renaissance, les impressionnistes
auraient réussi à faire un bond en avant, vers l’art contemporain qui leur
serait tributaire aujourd’hui. Moins qu’une
plupart des toiles impressionnistes est
strictement analogue à celui d’une toile classique. […] Les points d’appui de la composition s’estompent sous le semis des
touches colorées qui reproduisent le tremblement de la lumière, mais ramené à
ses lignes générales, le tableau suggère toujours le fameux espace cubique de
la Renaissance et l’on regarde toujours à travers la fameuse fenêtre ouverte
d’Alberti».[45]
Francastel tient à démentir une position qui donnerait aux impressionnistes le
fait d’avoir été les premiers à défaire le cadre du lieu visuel de l’art
occidental. D’une modernité l’autre, la seconde marquerait la fin de la
première instaurée à l’époque de la Renaissance. Comme les préraphélites
voulurent revenir à l’ère antérieure à la Renaissance, les impressionnistes
auraient réussi à faire un bond en avant, vers l’art contemporain qui leur
serait tributaire aujourd’hui. Moins qu’une  rupture, l’impressionnisme, selon
Francastel, n’en serait qu’une continuité historique : «Le procédé qui consiste à mettre en place
les lignes générales du sujet conformément aux formules traditionnelles
élaborées par la Renaissance, a donné naissance à un très grand nombre de
toiles impressionnistes et apparemment aux plus belles. Prenez les toiles les
plus floues, les plus suggestives de Monet, les Meules, les Cathédrales, les Ponts de Londres, vous constaterez toujours que
le schéma général de la composition est strictement traditionnel en ce qui
concerne le cadrage et la ségrégation des plans en profondeur. Si l’on devine
les paysages les plus vaporeux de l’impressionnisme, c’est précisément en
fonction de leur respect du système antérieur de figuration de l’espace. J’ai
proposé déjà de désigner ce phénomène du nom de “grille” impressionniste. On
dirait que les toiles ainsi composées sont constituées par la superposition de
deux images qui coïncident par quelques points suivant le procédé des
photographies chromatiques qui superposent avec des caches plusieurs séries
d’enregistrements dans l’absolu respect d’un certain nombre de repères. Le
système de représentation colorée de l’univers vient se superposer ici au
canevas fourni par un petit nombre d’éléments linéaires empruntés à la
figuration renaissante de l’espace».[46]
Est-ce à dire que Francastel ne reconnaît aucun apport de la mouvance
impressionniste?
rupture, l’impressionnisme, selon
Francastel, n’en serait qu’une continuité historique : «Le procédé qui consiste à mettre en place
les lignes générales du sujet conformément aux formules traditionnelles
élaborées par la Renaissance, a donné naissance à un très grand nombre de
toiles impressionnistes et apparemment aux plus belles. Prenez les toiles les
plus floues, les plus suggestives de Monet, les Meules, les Cathédrales, les Ponts de Londres, vous constaterez toujours que
le schéma général de la composition est strictement traditionnel en ce qui
concerne le cadrage et la ségrégation des plans en profondeur. Si l’on devine
les paysages les plus vaporeux de l’impressionnisme, c’est précisément en
fonction de leur respect du système antérieur de figuration de l’espace. J’ai
proposé déjà de désigner ce phénomène du nom de “grille” impressionniste. On
dirait que les toiles ainsi composées sont constituées par la superposition de
deux images qui coïncident par quelques points suivant le procédé des
photographies chromatiques qui superposent avec des caches plusieurs séries
d’enregistrements dans l’absolu respect d’un certain nombre de repères. Le
système de représentation colorée de l’univers vient se superposer ici au
canevas fourni par un petit nombre d’éléments linéaires empruntés à la
figuration renaissante de l’espace».[46]
Est-ce à dire que Francastel ne reconnaît aucun apport de la mouvance
impressionniste?



 comme un vieillard, à présent qu’il avait atteint la cinquantaine.
Expliquant cet état d’esprit, il écrivait à un ami : “… On se ferme comme une
porte, et non pas seulement sur ses amis. On supprime tout autour de soi, et
une fois tout seul, on s’annihile, on se tue enfin, par dégoût. J’ai trop fait
de projets; me voici bloqué, impuissant. Et puis j’ai perdu le fil. Je pensais
toujours avoir le temps; ce que je ne faisais, ce qu’on m’empêchait de faire,
au milieu de tous mes ennuis et malgré mon infirmité de vue, je ne désespérais
jamais de m’y mettre un beau jour. - J’entassais tous mes plans dans une
armoire dont je portais toujours la clé sur moi, et j’ai perdu cette clé.
Enfin, je sens que l’état comateux où je suis, je ne pourrai le soulever. Je
m’occuperai, comme disent les gens qui ne font rien, et voilà tout”».[51]
Ce trait mélancolique était peut-être ce qui marquait le plus la continuité
entre les arts précédents et l’impressionnisme.
comme un vieillard, à présent qu’il avait atteint la cinquantaine.
Expliquant cet état d’esprit, il écrivait à un ami : “… On se ferme comme une
porte, et non pas seulement sur ses amis. On supprime tout autour de soi, et
une fois tout seul, on s’annihile, on se tue enfin, par dégoût. J’ai trop fait
de projets; me voici bloqué, impuissant. Et puis j’ai perdu le fil. Je pensais
toujours avoir le temps; ce que je ne faisais, ce qu’on m’empêchait de faire,
au milieu de tous mes ennuis et malgré mon infirmité de vue, je ne désespérais
jamais de m’y mettre un beau jour. - J’entassais tous mes plans dans une
armoire dont je portais toujours la clé sur moi, et j’ai perdu cette clé.
Enfin, je sens que l’état comateux où je suis, je ne pourrai le soulever. Je
m’occuperai, comme disent les gens qui ne font rien, et voilà tout”».[51]
Ce trait mélancolique était peut-être ce qui marquait le plus la continuité
entre les arts précédents et l’impressionnisme.
 suivant les dimensions, et les revendait à des prix qui
variaient entre soixante et quatre-vingts francs».[53]
On connaît à quel point Théo, le frère de Vincent Van Gogh, travaillant dans
une galerie, fournissait à son frère tubes et toiles et s’efforçait, en retour,
de vendre de ses œuvres. Comme ils produisaient beaucoup, les peintres
impressionnistes avaient énormément besoin d’argent et lorsqu’enfin le marché
se créa avec l’atténuation des effets de la crise de 1873, il devenait le seul
débouché, vite congestionné, pour ce type d’art, les Salons le boudant obstinément.
Il fallait d’abord faire son nom, ce qui positionnait déjà avantageusement le
groupe. «Manet et Cézanne avaient tous
deux des ressources qui leur permettaient d’attendre. Degas aussi était
indépendant et avait même refusé, en 1869, un contrat proposé par un marchand
belge, Stevens, frère du peintre, contrat qui lui aurait assuré des revenus
annuels de douze mille francs. Mais pour les autres la participation au Salon
n’était pas seulement une question de principe. Ils étaient tous dans l’obligation
de vendre leurs œuvres et devaient sentir que cette interminable lutte avec le
jury les condamnait à l’isolement, en les privant du seul moyen d’exposer.
Après la création artistique elle-même, la chose essentielle était de montrer
les résultats de leurs efforts, d’essayer d’intéresser le public à leurs
intentions, leur labeur incessant et leurs découvertes».[54]
La nécessité d’une union du groupe devait surmonter toutes les crises qui surgissaient
ici et là, l’égo des artistes conduisant à des conflits de personnalités.
suivant les dimensions, et les revendait à des prix qui
variaient entre soixante et quatre-vingts francs».[53]
On connaît à quel point Théo, le frère de Vincent Van Gogh, travaillant dans
une galerie, fournissait à son frère tubes et toiles et s’efforçait, en retour,
de vendre de ses œuvres. Comme ils produisaient beaucoup, les peintres
impressionnistes avaient énormément besoin d’argent et lorsqu’enfin le marché
se créa avec l’atténuation des effets de la crise de 1873, il devenait le seul
débouché, vite congestionné, pour ce type d’art, les Salons le boudant obstinément.
Il fallait d’abord faire son nom, ce qui positionnait déjà avantageusement le
groupe. «Manet et Cézanne avaient tous
deux des ressources qui leur permettaient d’attendre. Degas aussi était
indépendant et avait même refusé, en 1869, un contrat proposé par un marchand
belge, Stevens, frère du peintre, contrat qui lui aurait assuré des revenus
annuels de douze mille francs. Mais pour les autres la participation au Salon
n’était pas seulement une question de principe. Ils étaient tous dans l’obligation
de vendre leurs œuvres et devaient sentir que cette interminable lutte avec le
jury les condamnait à l’isolement, en les privant du seul moyen d’exposer.
Après la création artistique elle-même, la chose essentielle était de montrer
les résultats de leurs efforts, d’essayer d’intéresser le public à leurs
intentions, leur labeur incessant et leurs découvertes».[54]
La nécessité d’une union du groupe devait surmonter toutes les crises qui surgissaient
ici et là, l’égo des artistes conduisant à des conflits de personnalités.
 nom nouveau :
Manet. Ce musicien espagnol était peint d’une certaine façon étrange, nouvelle,
dont les jeunes peintres étonnés croyaient avoir seuls le secret, peinture qui
tient le milieu entre celle dite réaliste et celle dite romantique…».[55]
Manet délaissa, mais sans complètement l’abandonner, le paysage pour le
portrait. Puisque la photographie rendait désormais l’identique du tableau
obsolète, n’était-il pas audacieux de tirer avantage du procédé chromatique des
impressionnistes pour l’appliquer à la figure humaine? Manet, au départ, est
hors l’école impressionniste parmi lesquels il a des amis, Monet, Renoir et
Berthe Morisot. En 1862, il crée tout un scandale avec Le Déjeuner sur l’herbe où une femme nue entourée de trois hommes
vêtus est qualifié d’obscène tant il ridiculise le genre propre à l’académisme.
Manet exposa l’année d’après son Olympia tout
aussi répréhensible. Mais cela importait peu au peintre puisqu’il était
ambitieux et que le scandale rapporte toujours : «Ce que je veux aujourd’hui, c’est gagner de l’argent», lançait-il
au cours de l’été 1868.[56]
Manet pouvait encore passé pour un peintre réaliste, même si son monde n’était
pas celui de Courbet, mais son réalisme tanguait davantage du côté des
impressionnistes. Il suffit de comparer son Exécution
de Maximilien de 1868 avec ses tableaux du début de la décennie, Le Déjeuner sur l’herbe par exemple,
pour mesurer toute la différence. Puis, ce patriote convaincu s’engagea dans la
guerre franco-prussienne de 1870. Au retour, il illustra des scènes tragiques
des Barricades de la Commune de
Paris, puis le portrait de Georges
Clemenceau alors que la position du Tigre
était encore radicale-socialiste. Manet, qui devait mourir de la syphilis
en 1883, ne s’intéressa plus qu’à produire des scènes marines et, à l’opposé,
l’atmosphère des milieux de café concert. Un tel homme resta toujours à l’abri
des crises financières, mais ce n’était pas le cas de tous les
impressionnistes.
nom nouveau :
Manet. Ce musicien espagnol était peint d’une certaine façon étrange, nouvelle,
dont les jeunes peintres étonnés croyaient avoir seuls le secret, peinture qui
tient le milieu entre celle dite réaliste et celle dite romantique…».[55]
Manet délaissa, mais sans complètement l’abandonner, le paysage pour le
portrait. Puisque la photographie rendait désormais l’identique du tableau
obsolète, n’était-il pas audacieux de tirer avantage du procédé chromatique des
impressionnistes pour l’appliquer à la figure humaine? Manet, au départ, est
hors l’école impressionniste parmi lesquels il a des amis, Monet, Renoir et
Berthe Morisot. En 1862, il crée tout un scandale avec Le Déjeuner sur l’herbe où une femme nue entourée de trois hommes
vêtus est qualifié d’obscène tant il ridiculise le genre propre à l’académisme.
Manet exposa l’année d’après son Olympia tout
aussi répréhensible. Mais cela importait peu au peintre puisqu’il était
ambitieux et que le scandale rapporte toujours : «Ce que je veux aujourd’hui, c’est gagner de l’argent», lançait-il
au cours de l’été 1868.[56]
Manet pouvait encore passé pour un peintre réaliste, même si son monde n’était
pas celui de Courbet, mais son réalisme tanguait davantage du côté des
impressionnistes. Il suffit de comparer son Exécution
de Maximilien de 1868 avec ses tableaux du début de la décennie, Le Déjeuner sur l’herbe par exemple,
pour mesurer toute la différence. Puis, ce patriote convaincu s’engagea dans la
guerre franco-prussienne de 1870. Au retour, il illustra des scènes tragiques
des Barricades de la Commune de
Paris, puis le portrait de Georges
Clemenceau alors que la position du Tigre
était encore radicale-socialiste. Manet, qui devait mourir de la syphilis
en 1883, ne s’intéressa plus qu’à produire des scènes marines et, à l’opposé,
l’atmosphère des milieux de café concert. Un tel homme resta toujours à l’abri
des crises financières, mais ce n’était pas le cas de tous les
impressionnistes.
 tentative
coopératiste de 1874 fit long feu, surtout avec le fiasco commercial de
l’exposition [chez le photographe Nadar]. Le 17 décembre 1874, dans l’atelier de Renoir, l’assemblée générale de
la Société anonyme coopérative des artistes, etc., décida la liquidation.
Toutes dettes extérieures payées, le passif de la Société s’élevait encore à 3
713 francs (avancés par les sociétaires), alors qu’il ne restait dans la caisse
que 277,99 francs. Chaque membre était donc redevable de 184,50 francs, pour
solder les dettes intérieures. Mais l’exposition avait été un succès
symbolique : 3 500 visiteurs, une critique en général pas défavorable. Le
groupe comprit qu’il pouvait se radicaliser…».[57]
Malgré ce premier échec, une seconde coopérative s’organisa qui ne dura guère
plus longtemps. En 1877, la scission reposa cette fois sur un conflit
tentative
coopératiste de 1874 fit long feu, surtout avec le fiasco commercial de
l’exposition [chez le photographe Nadar]. Le 17 décembre 1874, dans l’atelier de Renoir, l’assemblée générale de
la Société anonyme coopérative des artistes, etc., décida la liquidation.
Toutes dettes extérieures payées, le passif de la Société s’élevait encore à 3
713 francs (avancés par les sociétaires), alors qu’il ne restait dans la caisse
que 277,99 francs. Chaque membre était donc redevable de 184,50 francs, pour
solder les dettes intérieures. Mais l’exposition avait été un succès
symbolique : 3 500 visiteurs, une critique en général pas défavorable. Le
groupe comprit qu’il pouvait se radicaliser…».[57]
Malgré ce premier échec, une seconde coopérative s’organisa qui ne dura guère
plus longtemps. En 1877, la scission reposa cette fois sur un conflit  de
personnalités : «“Je souhaite,
répondit Cézanne, que l’exposition de notre coopérative soit un four si nous
devons exposer avec Monet. Vous me trouverez canaille, mais d’abord son affaire
propre avant tout… Je concluerai en disant comme vous, que puisqu’il se trouve
une tendance commune entre quelques-uns d’entre nous, espérons que la nécessité
nous forcera à agir de concert, et que l’intérêt et la réussite fortifieront le
lien que bien souvent la bonne volonté n’aurait pas suffi à consolider…” C’est
en raison de cette attitude que Cézanne, Pissarro et Guillaumin finiront par
donner leur démission à L’Union Artistique».[58]
Mais il est vrai que celui qui souffrit le plus de l’injustice financière parmi
les impressionnistes reste Van Gogh et il n’y avait pas que le critique G.
Albert Aurier pour s’en scandaliser en 1889 : «Mais quoi qu’il arrive, quand bien même la mode viendrait de payer ses
toiles - ce qui est peu probable
de
personnalités : «“Je souhaite,
répondit Cézanne, que l’exposition de notre coopérative soit un four si nous
devons exposer avec Monet. Vous me trouverez canaille, mais d’abord son affaire
propre avant tout… Je concluerai en disant comme vous, que puisqu’il se trouve
une tendance commune entre quelques-uns d’entre nous, espérons que la nécessité
nous forcera à agir de concert, et que l’intérêt et la réussite fortifieront le
lien que bien souvent la bonne volonté n’aurait pas suffi à consolider…” C’est
en raison de cette attitude que Cézanne, Pissarro et Guillaumin finiront par
donner leur démission à L’Union Artistique».[58]
Mais il est vrai que celui qui souffrit le plus de l’injustice financière parmi
les impressionnistes reste Van Gogh et il n’y avait pas que le critique G.
Albert Aurier pour s’en scandaliser en 1889 : «Mais quoi qu’il arrive, quand bien même la mode viendrait de payer ses
toiles - ce qui est peu probable  - aux prix des infamies de M. Meissonier, je
ne pense pas que beaucoup de sincérité puisse jamais entrer en cette tardive
admiration du gros public. Vincent van Gogh est, à la fois, trop simple et trop
subtil pour l’esprit bourgeois contemporain. Il ne sera jamais pleinement
compris que de ses frères, les artistes, et des heureux du petit peuple, du
tout petit peuple…».[59]
Ce petit peuple que les impressionnistes peignait sous la lumière du soleil ou
les brumes de la pluie ne semblait pas les intéresser autrement que comme
objets à figurer. Le peu d’engagement social des impressionnistes qui
survécurent à l’effondrement des années 1880 se remarqua lorsque éclata la
célèbre Affaire : «Pendant l’affaire Dreyfus, alors que Monet
peint des reflets sur l’eau, que Degas s’avère anti-dreyfusard acharné, ce sont
les peintres ultra-académiques et soi-disant “bien pensants” qui soutiennent la
lutte de Zola, comme Débat-Ponsan dans sa Vérité sortant du puits, retenuepar deux spadassins qui fit scandale. Il
en va de même de l’engagement social. On a voulu associer les difficultés de
certains impressionnistes au paupérisme ouvrier, en oubliant que ces peintres
étaient par leur origine et par leur métier même des bourgeois […]. Le problème des impressionnistes n’est pas
un problème social mais un problème esthétique, celui de la non reconnaissance
par le public d’une prise de position plastique […]. Les vrais artistes socialisants sont les peintres pompiers».[60]
En fait, il n’y avait que l’art pompier qui restait payant pour les artistes;
les tableaux historiques trouvaient preneur auprès de l’État et les marines
restaient un succès propre aux exercices d’académies.
- aux prix des infamies de M. Meissonier, je
ne pense pas que beaucoup de sincérité puisse jamais entrer en cette tardive
admiration du gros public. Vincent van Gogh est, à la fois, trop simple et trop
subtil pour l’esprit bourgeois contemporain. Il ne sera jamais pleinement
compris que de ses frères, les artistes, et des heureux du petit peuple, du
tout petit peuple…».[59]
Ce petit peuple que les impressionnistes peignait sous la lumière du soleil ou
les brumes de la pluie ne semblait pas les intéresser autrement que comme
objets à figurer. Le peu d’engagement social des impressionnistes qui
survécurent à l’effondrement des années 1880 se remarqua lorsque éclata la
célèbre Affaire : «Pendant l’affaire Dreyfus, alors que Monet
peint des reflets sur l’eau, que Degas s’avère anti-dreyfusard acharné, ce sont
les peintres ultra-académiques et soi-disant “bien pensants” qui soutiennent la
lutte de Zola, comme Débat-Ponsan dans sa Vérité sortant du puits, retenuepar deux spadassins qui fit scandale. Il
en va de même de l’engagement social. On a voulu associer les difficultés de
certains impressionnistes au paupérisme ouvrier, en oubliant que ces peintres
étaient par leur origine et par leur métier même des bourgeois […]. Le problème des impressionnistes n’est pas
un problème social mais un problème esthétique, celui de la non reconnaissance
par le public d’une prise de position plastique […]. Les vrais artistes socialisants sont les peintres pompiers».[60]
En fait, il n’y avait que l’art pompier qui restait payant pour les artistes;
les tableaux historiques trouvaient preneur auprès de l’État et les marines
restaient un succès propre aux exercices d’académies.
 L’artiste qui marqua le passage de
l’impressionnisme au post-impressionnisme reste Paul Cézanne (1839-1906). Le
peintre d’Aix-en-Provence, influencé par Manet et Courbet devait influencer à
son tour Van Gogh et Picasso. Il est donc une courroie historique majeure dans
le développement de l’art à la fin du XIXe siècle. En lui, toutes les
contradictions prêtées au mouvement se révèlent : «L’erreur courante est de proclamer, à la fois, que Cézanne est un
novateur et de le louer pour avoir ramené la tradition. Cézanne est
impressionniste au départ. Il cultive la petite sensation, et il demeure
jusqu’au bout, fidèle, dans une certaine mesure, à l’idéal de sa jeunesse :
chaque fois qu’il module, qu’il note la valeur des couleurs dégradées sur un
objet au sens où l’impressionnisme de la première époque l’avait défini, chaque
fois qu’il prend, en somme, pour point de départ de son travail un paysage ou
un objet défini suivant l’ancienne conception de l’espace, chaque fois si l’on
veut qu’il cherche à
L’artiste qui marqua le passage de
l’impressionnisme au post-impressionnisme reste Paul Cézanne (1839-1906). Le
peintre d’Aix-en-Provence, influencé par Manet et Courbet devait influencer à
son tour Van Gogh et Picasso. Il est donc une courroie historique majeure dans
le développement de l’art à la fin du XIXe siècle. En lui, toutes les
contradictions prêtées au mouvement se révèlent : «L’erreur courante est de proclamer, à la fois, que Cézanne est un
novateur et de le louer pour avoir ramené la tradition. Cézanne est
impressionniste au départ. Il cultive la petite sensation, et il demeure
jusqu’au bout, fidèle, dans une certaine mesure, à l’idéal de sa jeunesse :
chaque fois qu’il module, qu’il note la valeur des couleurs dégradées sur un
objet au sens où l’impressionnisme de la première époque l’avait défini, chaque
fois qu’il prend, en somme, pour point de départ de son travail un paysage ou
un objet défini suivant l’ancienne conception de l’espace, chaque fois si l’on
veut qu’il cherche à  modifier la notation de sensations enregistrées en
fonction du respect des anciens découpages, représentatifs d’une action
pratique accoutumée. Mais il est, au contraire, novateur chaque fois qu’il
renonce au morcellement classique des figures changeantes de la nature en
objets significatifs d’actions particulières ou collectives déterminées,
c’est-à-dire, au fond, chaque fois qu’il établit de nouvelles liaisons entre
des fragments de sa perception expérimentale, abstraction faite des usages ou des
légendes. Son originalité véritable n’est pas de noter autrement des éléments
connus, ni de ramener des sensations aiguës à des schèmes pratiques antérieurs.
Elle consiste dans l’attribution d’un intérêt à des parties nouvelles de
l’expérience optique. Parti d’une sensation hallucinante de la nature telle que
l’avaient écrite ses prédécesseurs, il parvient, par
modifier la notation de sensations enregistrées en
fonction du respect des anciens découpages, représentatifs d’une action
pratique accoutumée. Mais il est, au contraire, novateur chaque fois qu’il
renonce au morcellement classique des figures changeantes de la nature en
objets significatifs d’actions particulières ou collectives déterminées,
c’est-à-dire, au fond, chaque fois qu’il établit de nouvelles liaisons entre
des fragments de sa perception expérimentale, abstraction faite des usages ou des
légendes. Son originalité véritable n’est pas de noter autrement des éléments
connus, ni de ramener des sensations aiguës à des schèmes pratiques antérieurs.
Elle consiste dans l’attribution d’un intérêt à des parties nouvelles de
l’expérience optique. Parti d’une sensation hallucinante de la nature telle que
l’avaient écrite ses prédécesseurs, il parvient, par  un choix difficile, à
isoler un petit nombre de fragments significatifs dépourvus de valeur classée.
Il crée un monde à la fois fragmentaire et organique, en fonction de quelques
intentions très simples, imposant comme loi à son œuvre la certitude d’une
vérité particulière - autant pirandellien que bergsonien».[61]
Mais pour Venturi, Cézanne apporte des qualités personnelles au diapason des
attentes de la démarche impressionniste : «L’éclat chromatique incomparable de Cézanne, son intensité, sa sérénité
et sa fermeté proviennent des mêmes qualités que sa forme. Lui aussi, Pissarro
s’est servi des rapports de ton des couleurs; c’est même lui qui les a enseignés
à Cézanne. Mais l’effet de couleur en rapport avec sa forme et la variété des
éléments de l’œuvre de Pissarro sont tels qu’on y sent une certaine dispersion
tant de la forme que de l’harmonie chromatique. D’autre part, la structure
prend tant d’importance chez Cézanne qu’elle favorise l’ampleur des zones de
couleur en même temps que leur simplification et la
un choix difficile, à
isoler un petit nombre de fragments significatifs dépourvus de valeur classée.
Il crée un monde à la fois fragmentaire et organique, en fonction de quelques
intentions très simples, imposant comme loi à son œuvre la certitude d’une
vérité particulière - autant pirandellien que bergsonien».[61]
Mais pour Venturi, Cézanne apporte des qualités personnelles au diapason des
attentes de la démarche impressionniste : «L’éclat chromatique incomparable de Cézanne, son intensité, sa sérénité
et sa fermeté proviennent des mêmes qualités que sa forme. Lui aussi, Pissarro
s’est servi des rapports de ton des couleurs; c’est même lui qui les a enseignés
à Cézanne. Mais l’effet de couleur en rapport avec sa forme et la variété des
éléments de l’œuvre de Pissarro sont tels qu’on y sent une certaine dispersion
tant de la forme que de l’harmonie chromatique. D’autre part, la structure
prend tant d’importance chez Cézanne qu’elle favorise l’ampleur des zones de
couleur en même temps que leur simplification et la  force de leur harmonie.
C’étaient surtout les rapports qui lui importaient. “Il n’y a pas de peinture
claire ni sombre; il n’y a que des rapports de couleur. Si ceux-ci sont
réalisés correctement, l’harmonie naît automatiquement”».[62]
Si l’impressionnisme est un genre génial au
sens ou Max Scheler emploie ce terme, Cézanne restera toujours le génie, le géant de la production au
moment où elle atteint son paroxysme. À travers son œuvre, Cézanne demeure un
classique dans la mesure où il tient au réalisme. Il reste fidèle à la méthode
de Claude Bernard, poussant l’observation jusqu’à peindre la même montagne Sainte-Victoire, du même point de vue, selon les différentes heures de la
journée afin d’en voir se modifier la luminosité selon le passage du soleil.
Enfin, il est fidèle au mouvement en traduisant l’atmosphère des hameaux de
Provence, des silhouettes à l’horizon embrumées par la chaleur ou encore des
hommes attablés qui jouent aux cartes. Pour Venturi : «Dans une
force de leur harmonie.
C’étaient surtout les rapports qui lui importaient. “Il n’y a pas de peinture
claire ni sombre; il n’y a que des rapports de couleur. Si ceux-ci sont
réalisés correctement, l’harmonie naît automatiquement”».[62]
Si l’impressionnisme est un genre génial au
sens ou Max Scheler emploie ce terme, Cézanne restera toujours le génie, le géant de la production au
moment où elle atteint son paroxysme. À travers son œuvre, Cézanne demeure un
classique dans la mesure où il tient au réalisme. Il reste fidèle à la méthode
de Claude Bernard, poussant l’observation jusqu’à peindre la même montagne Sainte-Victoire, du même point de vue, selon les différentes heures de la
journée afin d’en voir se modifier la luminosité selon le passage du soleil.
Enfin, il est fidèle au mouvement en traduisant l’atmosphère des hameaux de
Provence, des silhouettes à l’horizon embrumées par la chaleur ou encore des
hommes attablés qui jouent aux cartes. Pour Venturi : «Dans une  œuvre d’art, ce qui importe, ce
sont les rapports entre les images; aussi la représentation de Cézanne est-elle
parfaitement objective, non par rapport à la nature, mais par rapport à l’art.
Dans la nature “proche” et “lointain” sont termes matériels d’un monde fini.
L’œuvre de Cézanne est si cohérente, elle se suffit si bien qu’elle
n’appartient à aucun monde particulier. Elle est un monde en elle-même,
appartenant à l’infini et à l’universel, avec la solennité des choses qui
vivent éternellement».[63]
Pour ces mêmes raisons, Francastel est justifié d’affirmer que : «ce n’est pas seulement un univers
géographique dont Cézanne s’évade, mais un univers mental dans lequel les
fonctions réciproques des êtres et des choses sont arrêtées. L’art renonce à
l’anecdote et à l’histoire pour se faire empirisme et panthéisme; il écrit
l’histoire des choses, pommes, compotier, montagne; de ce qu’elles signifient
dans le tissu de la vie sentimentale quotidienne d’hommes pour qui se modifient
sans cesse aussi les possibilités d’accès et de transformation de la matière.
En ce sens, l’art contemporain possède moins encore un caractère social qu’un
caractère objectif. Il est l’art d’une nouvelle époque de mécanisation des
forces de la nature, serrant de plus près l’évolution humaine que la société
qui demeure attardée».[64]
Du seul Cézanne, Francastel en vient à l'absorber dans l'ensemble de l'art contemporain, ce qui finit par effacer la spécificité de Cézanne.
œuvre d’art, ce qui importe, ce
sont les rapports entre les images; aussi la représentation de Cézanne est-elle
parfaitement objective, non par rapport à la nature, mais par rapport à l’art.
Dans la nature “proche” et “lointain” sont termes matériels d’un monde fini.
L’œuvre de Cézanne est si cohérente, elle se suffit si bien qu’elle
n’appartient à aucun monde particulier. Elle est un monde en elle-même,
appartenant à l’infini et à l’universel, avec la solennité des choses qui
vivent éternellement».[63]
Pour ces mêmes raisons, Francastel est justifié d’affirmer que : «ce n’est pas seulement un univers
géographique dont Cézanne s’évade, mais un univers mental dans lequel les
fonctions réciproques des êtres et des choses sont arrêtées. L’art renonce à
l’anecdote et à l’histoire pour se faire empirisme et panthéisme; il écrit
l’histoire des choses, pommes, compotier, montagne; de ce qu’elles signifient
dans le tissu de la vie sentimentale quotidienne d’hommes pour qui se modifient
sans cesse aussi les possibilités d’accès et de transformation de la matière.
En ce sens, l’art contemporain possède moins encore un caractère social qu’un
caractère objectif. Il est l’art d’une nouvelle époque de mécanisation des
forces de la nature, serrant de plus près l’évolution humaine que la société
qui demeure attardée».[64]
Du seul Cézanne, Francastel en vient à l'absorber dans l'ensemble de l'art contemporain, ce qui finit par effacer la spécificité de Cézanne.
 Cézanne. Pissarro était
sa bête noire. Comme le rappelle Rewald, «il
n’y avait personne, parmi les écrivains et les peintres, qui ne conçût une vive
estime pour cet artiste doux et calme qui joignait une profonde bonté à un
indomptable esprit combatif. Plus soucieux que les autres des problèmes
sociaux, il n’avait rien de la frivolité désinvolte de Degas, ni du snobisme de
Manet. Passionnément intéressé par les questions politiques, socialiste à
tendances anarchistes, athée convaincu, il rattachait la lutte des peintres à
la situation générale de l’artiste dans la société moderne. Mais si radicales
que fussent ses opinions, il ne s’y mêlait pas de haine; tout ce qu’il disait
était éclairé par l’altruisme et une pureté d’intention qui forçaient le
respect des autres. Tous ses camarades connaissaient ses difficultés
matérielles et admiraient l’absence d’amertume, voire la gaieté avec laquelle
il abordait les questions les plus graves».[65]
Cézanne. Pissarro était
sa bête noire. Comme le rappelle Rewald, «il
n’y avait personne, parmi les écrivains et les peintres, qui ne conçût une vive
estime pour cet artiste doux et calme qui joignait une profonde bonté à un
indomptable esprit combatif. Plus soucieux que les autres des problèmes
sociaux, il n’avait rien de la frivolité désinvolte de Degas, ni du snobisme de
Manet. Passionnément intéressé par les questions politiques, socialiste à
tendances anarchistes, athée convaincu, il rattachait la lutte des peintres à
la situation générale de l’artiste dans la société moderne. Mais si radicales
que fussent ses opinions, il ne s’y mêlait pas de haine; tout ce qu’il disait
était éclairé par l’altruisme et une pureté d’intention qui forçaient le
respect des autres. Tous ses camarades connaissaient ses difficultés
matérielles et admiraient l’absence d’amertume, voire la gaieté avec laquelle
il abordait les questions les plus graves».[65]
 Degas était antisémite alors que Pissarro ne cachait pas ses origines juives.
Le mépris était sans doute ce qui allait le mieux à Degas. Le peintre
Caillebotte écrivit ainsi à son sujet à Pissarro : «Non, cet homme est aigri. - Il n’occupa pas la grande place qu’il
devrait occuper par son talent, et, quoiqu’il ne l’avouera jamais, il en veut à
la terre entière».[66]
Gauguin, au même correspondant, notera chez Degas qu’«il y a chez cet homme un esprit de travers qui démolit tout».[67]
S’il y avait chez Degas une personnalité si désagréable, c’est probablement
parce que ce peintre, avantagé de fortune, hésitait quant à ses possibilités.
Degas nous révèle «cet aveu dans une
lettre adressée à son vieil ami Évariste de Valernes : “Je viens vous demander
pardon d’une chose qui revient souvent dans votre conversation et plus souvent
dans votre pensée: c’est d’avoir été au cours de nos longs rapports d’art, ou
d’avoir semblé être dur avec vous. Je
l’étais singulièrement
Degas était antisémite alors que Pissarro ne cachait pas ses origines juives.
Le mépris était sans doute ce qui allait le mieux à Degas. Le peintre
Caillebotte écrivit ainsi à son sujet à Pissarro : «Non, cet homme est aigri. - Il n’occupa pas la grande place qu’il
devrait occuper par son talent, et, quoiqu’il ne l’avouera jamais, il en veut à
la terre entière».[66]
Gauguin, au même correspondant, notera chez Degas qu’«il y a chez cet homme un esprit de travers qui démolit tout».[67]
S’il y avait chez Degas une personnalité si désagréable, c’est probablement
parce que ce peintre, avantagé de fortune, hésitait quant à ses possibilités.
Degas nous révèle «cet aveu dans une
lettre adressée à son vieil ami Évariste de Valernes : “Je viens vous demander
pardon d’une chose qui revient souvent dans votre conversation et plus souvent
dans votre pensée: c’est d’avoir été au cours de nos longs rapports d’art, ou
d’avoir semblé être dur avec vous. Je
l’étais singulièrement  pour moi-même, vous devez bien vous le rappeler, puisque
vous avez été amené à me le reprocher et à vous étonner de ce que j’avais si
peu de confiance en moi. J’étais ou je semblais dur avec tout le monde, par une
sorte d’entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise
humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu’il me
semblait que mes calculs d’art étaient si justes. Je boudais contre tout le
monde et contre moi. Je vous demande bien pardon si, sous le prétexte de ce
damné art, j’ai blessé votre très noble et très intelligent esprit, peut-être
même votre cœur”».[68]
Certes, beaucoup éprouvent des doutes face à eux-mêmes et de la mauvaise humeur
et ne sont pas antisémites pour autant. Les excuses de Degas relèvent moins
d’une conscience malheureuse qui se reconnaît comme malheureuse, mais plutôt
une conscience de grand bourgeois qui passe ses frustrations érotiques pour les
jeunes filles sur le dos des défavorisés de la société : «Duranty nota au sujet de Degas : “[…]
l’appelait-on l’inventeur du clair-obscur social”. Une des idées chères à Degas
était, en effet, “l’inopportunité d’un art à la portée des classes pauvres et
permettant de livrer des tableaux au prix de treize sols.” Alors que de telles
opinions devaient être violemment contestées par Pissarro, toujours, comme
Monet, préoccupé de questions sociales, Degas provoquait plus d’étonnement
encore par sa tendance à prendre au sérieux et même à défendre des œuvres où
ses auditeurs ne discernaient aucune qualité».[69]
pour moi-même, vous devez bien vous le rappeler, puisque
vous avez été amené à me le reprocher et à vous étonner de ce que j’avais si
peu de confiance en moi. J’étais ou je semblais dur avec tout le monde, par une
sorte d’entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise
humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu’il me
semblait que mes calculs d’art étaient si justes. Je boudais contre tout le
monde et contre moi. Je vous demande bien pardon si, sous le prétexte de ce
damné art, j’ai blessé votre très noble et très intelligent esprit, peut-être
même votre cœur”».[68]
Certes, beaucoup éprouvent des doutes face à eux-mêmes et de la mauvaise humeur
et ne sont pas antisémites pour autant. Les excuses de Degas relèvent moins
d’une conscience malheureuse qui se reconnaît comme malheureuse, mais plutôt
une conscience de grand bourgeois qui passe ses frustrations érotiques pour les
jeunes filles sur le dos des défavorisés de la société : «Duranty nota au sujet de Degas : “[…]
l’appelait-on l’inventeur du clair-obscur social”. Une des idées chères à Degas
était, en effet, “l’inopportunité d’un art à la portée des classes pauvres et
permettant de livrer des tableaux au prix de treize sols.” Alors que de telles
opinions devaient être violemment contestées par Pissarro, toujours, comme
Monet, préoccupé de questions sociales, Degas provoquait plus d’étonnement
encore par sa tendance à prendre au sérieux et même à défendre des œuvres où
ses auditeurs ne discernaient aucune qualité».[69] L’harmonie ne régna pas davantage parmi les
post-impressionnistes. Van Gogh (1853-1890), par son esprit évangéliste, fut
celui qui semble en avoir le plus souffert. Rewald souligne ainsi que «c’est van Gogh qui résuma le mieux la
situation, et parlant sans ambages des “désastreuses guerres civiles” du groupe
impressionniste, dans lesquelles “de part et d’autre on cherche à se manger le
nez avec un zèle digne d’une meilleure destination”».[70]
Il rappelait à ses collègues que «les
artistes japonais ont pratiqué très souvent l’échange, expliquait-il dans une
lettre à Bernard, cela prouve qu’ils s’aimaient entre eux; qu’ils vivaient
justement dans une sorte de vie fraternelle, naturellement, et non pas dans les
intrigues. Plus nous
L’harmonie ne régna pas davantage parmi les
post-impressionnistes. Van Gogh (1853-1890), par son esprit évangéliste, fut
celui qui semble en avoir le plus souffert. Rewald souligne ainsi que «c’est van Gogh qui résuma le mieux la
situation, et parlant sans ambages des “désastreuses guerres civiles” du groupe
impressionniste, dans lesquelles “de part et d’autre on cherche à se manger le
nez avec un zèle digne d’une meilleure destination”».[70]
Il rappelait à ses collègues que «les
artistes japonais ont pratiqué très souvent l’échange, expliquait-il dans une
lettre à Bernard, cela prouve qu’ils s’aimaient entre eux; qu’ils vivaient
justement dans une sorte de vie fraternelle, naturellement, et non pas dans les
intrigues. Plus nous  leur ressemblerons sous ce respect-là, mieux l’on s’en
trouvera».[71]
Son ami Gauguin n’était pas le moins à pratiquer la querelle, lui qui : «se répandait en invectives contre Seurat et
Signac. Pissarro, qui avait vu déjà tant de disputes stériles parmi les vieux
impressionnistes, voyait maintenant la jeune génération continuer dans le même
esprit d’intolérance. Il ne cacha pas la peine qu’il en ressentait, lorsqu’il
écrivit à son fils aîné en novembre : “Les hostilités continuent de plus en
plus parmi les impressionnistes romantiques. Ils se réunissent très régulièrement.
Degas lui-même vient au Café. Gauguin est redevenu très intime de Degas et va
le voir souvent. Curieux, n’est-ce pas, cette bascule des intérêts! - Oubliées,
les avanies de l’année passée au bord de la mer, oubliés les sarcasmes du
Maître contre le sectaire [Gauguin]… Moi, naïf, je le défendait à cor et à cri
contre les uns et les autres. C’est bien humain et bien triste”».[72]
Camille Pissarro n’avait pas de lui une bonne impression, comme il l’exprime
dans une lettre à son fils Lucien en 1891 : «Gauguin n’est pas un voyant, c’est un malin qui a senti un retour de la
bourgeoisie en arrière, par suite des grandes idées de solidarité qui germent
dans le peuple - idée inconsciente, mais féconde et la seule légitime! Les
symbolistes sont dans le même cas! Aussi, il faut
leur ressemblerons sous ce respect-là, mieux l’on s’en
trouvera».[71]
Son ami Gauguin n’était pas le moins à pratiquer la querelle, lui qui : «se répandait en invectives contre Seurat et
Signac. Pissarro, qui avait vu déjà tant de disputes stériles parmi les vieux
impressionnistes, voyait maintenant la jeune génération continuer dans le même
esprit d’intolérance. Il ne cacha pas la peine qu’il en ressentait, lorsqu’il
écrivit à son fils aîné en novembre : “Les hostilités continuent de plus en
plus parmi les impressionnistes romantiques. Ils se réunissent très régulièrement.
Degas lui-même vient au Café. Gauguin est redevenu très intime de Degas et va
le voir souvent. Curieux, n’est-ce pas, cette bascule des intérêts! - Oubliées,
les avanies de l’année passée au bord de la mer, oubliés les sarcasmes du
Maître contre le sectaire [Gauguin]… Moi, naïf, je le défendait à cor et à cri
contre les uns et les autres. C’est bien humain et bien triste”».[72]
Camille Pissarro n’avait pas de lui une bonne impression, comme il l’exprime
dans une lettre à son fils Lucien en 1891 : «Gauguin n’est pas un voyant, c’est un malin qui a senti un retour de la
bourgeoisie en arrière, par suite des grandes idées de solidarité qui germent
dans le peuple - idée inconsciente, mais féconde et la seule légitime! Les
symbolistes sont dans le même cas! Aussi, il faut  les combattre comme la peste».[73]
Seurat, pour sa part, tint à se distinguer du mouvement impressionniste sans
trahir ce qui le distinguait des autres courants artistiques : «Afin d’éviter toute confusion entre les
impressionnistes de la “vieille garde” d’une part et Seurat et ses camarades de
l’autre, Fénéon inventa le mot néo-impressionnisme, bien que le peintre eût
préféré la désignation plus précise de chromo-luminarisme. Signac expliqua plus
tard que si ses amis et lui adoptèrent le terme néo-impressionnisme, “ce ne fut
pas pour flagorner le succès [les impressionnistes étaient encore en pleine
lutte], mais pour rendre hommage à l’effort des précurseurs et marquer, sous la
divergence des procédés, la communauté de but : la lumière et la couleur. C’est
dans ce sens que doit être entendu ce mot néo-impressionnistes, car la
technique qu’emploient ces peintres n’a rien d’impressionniste; autant celle de
leurs devanciers est d’instinct et d’instantanéité, autant la leur est de
réflexion et de permanence”».[74]
Théoricien et praticien, Seurat ramenait la construction figurative des yeux au
cerveau, c’est-à-dire qu’il maîtrisait si bien intellectuellement l’art du
contraste des couleurs qu’il les appliquait sans spontanéité, plutôt au prix
d’un dur labeur. Comme le souligne Rewald : «Ici, contrairement aux
les combattre comme la peste».[73]
Seurat, pour sa part, tint à se distinguer du mouvement impressionniste sans
trahir ce qui le distinguait des autres courants artistiques : «Afin d’éviter toute confusion entre les
impressionnistes de la “vieille garde” d’une part et Seurat et ses camarades de
l’autre, Fénéon inventa le mot néo-impressionnisme, bien que le peintre eût
préféré la désignation plus précise de chromo-luminarisme. Signac expliqua plus
tard que si ses amis et lui adoptèrent le terme néo-impressionnisme, “ce ne fut
pas pour flagorner le succès [les impressionnistes étaient encore en pleine
lutte], mais pour rendre hommage à l’effort des précurseurs et marquer, sous la
divergence des procédés, la communauté de but : la lumière et la couleur. C’est
dans ce sens que doit être entendu ce mot néo-impressionnistes, car la
technique qu’emploient ces peintres n’a rien d’impressionniste; autant celle de
leurs devanciers est d’instinct et d’instantanéité, autant la leur est de
réflexion et de permanence”».[74]
Théoricien et praticien, Seurat ramenait la construction figurative des yeux au
cerveau, c’est-à-dire qu’il maîtrisait si bien intellectuellement l’art du
contraste des couleurs qu’il les appliquait sans spontanéité, plutôt au prix
d’un dur labeur. Comme le souligne Rewald : «Ici, contrairement aux  impressionnistes, il ne faisait aucun effort
pour retenir des effets fugitifs, mais cherchait à transposer ce qu’il avait
observé sur place en une harmonie de lignes et de couleurs rigoureusement établie.
Écartant tout ce qui paraissait superflu, insistant sur les contours et la
structure, il se refusait aux charmes sensuels qui avaient captivé les
impressionnistes et sacrifiait les sensations spontanées à une stylisation
presque rigide. Ne voulant pas retenir l’aspect d’un paysage à un instant
spécifique, il s’efforçait de fixer sa “silhouette du jour entier”. Lorsqu’il
rencontra Pissarro en 1885, Seurat travaillait depuis une année entière à une
nouvelle composition, Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande-Jatte, où se trouvent résumées toutes ces
conceptions».[75]
Cette œuvre est immense, géniale, impression…
nante. Sans doute la plus grande des post-impressionnistes, mais elle reste
froide, établissant une distance entre le spectateur et la toile. Voilà
peut-être pourquoi elle souleva, comme à l’origine des impressionnismes, la
risée parmi les critiques : «En
raison des bruits qui circulaient au sujet de la toile de Seurat, la nouvelle
exposition excita d’avance une très vive curiosité. George Moore entendit dire
par un ami qu’il y avait un grand tableau en trois couleurs : jaune claire pour
la lumière, brun pour l’ombre et tout le reste bleu ciel. On disait en outre
qu’il s’y trouvait une dame avec un singe dont la queue en spirale avait un mètre
de long. Moore se hâta d’aller au vernissage, et bien que la toile ne
correspondît pas exactement à la description, il y avait effectivement un singe
et d’autres détails suffisamment étranges pour déchaîner le rire de la foule,
“un rire bruyant, poussé à l’excès dans le désir de faire le plus de peine
possible”».[76]
En effet, il n’y avait rien de la chaleur que dégageaient les Van Gogh, les
Gauguin, les Toulouse-Lautrec.
impressionnistes, il ne faisait aucun effort
pour retenir des effets fugitifs, mais cherchait à transposer ce qu’il avait
observé sur place en une harmonie de lignes et de couleurs rigoureusement établie.
Écartant tout ce qui paraissait superflu, insistant sur les contours et la
structure, il se refusait aux charmes sensuels qui avaient captivé les
impressionnistes et sacrifiait les sensations spontanées à une stylisation
presque rigide. Ne voulant pas retenir l’aspect d’un paysage à un instant
spécifique, il s’efforçait de fixer sa “silhouette du jour entier”. Lorsqu’il
rencontra Pissarro en 1885, Seurat travaillait depuis une année entière à une
nouvelle composition, Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande-Jatte, où se trouvent résumées toutes ces
conceptions».[75]
Cette œuvre est immense, géniale, impression…
nante. Sans doute la plus grande des post-impressionnistes, mais elle reste
froide, établissant une distance entre le spectateur et la toile. Voilà
peut-être pourquoi elle souleva, comme à l’origine des impressionnismes, la
risée parmi les critiques : «En
raison des bruits qui circulaient au sujet de la toile de Seurat, la nouvelle
exposition excita d’avance une très vive curiosité. George Moore entendit dire
par un ami qu’il y avait un grand tableau en trois couleurs : jaune claire pour
la lumière, brun pour l’ombre et tout le reste bleu ciel. On disait en outre
qu’il s’y trouvait une dame avec un singe dont la queue en spirale avait un mètre
de long. Moore se hâta d’aller au vernissage, et bien que la toile ne
correspondît pas exactement à la description, il y avait effectivement un singe
et d’autres détails suffisamment étranges pour déchaîner le rire de la foule,
“un rire bruyant, poussé à l’excès dans le désir de faire le plus de peine
possible”».[76]
En effet, il n’y avait rien de la chaleur que dégageaient les Van Gogh, les
Gauguin, les Toulouse-Lautrec.
 Dans une lettre à Durand-Ruel, il expliqua que ce qu’il
voulait dorénavant, c’était “rechercher la synthèse moderne par des moyens basés
sur la science, lesquels seront basés sur la théorie des couleurs découverte
par M. Chevreul, et d’après les expériences de Maxwell et des mensurations de
O. N. Rood : substituer le mélange optique au mélange des pigments, autrement
dit, la décomposition des tons en leurs éléments constitutifs, parce que ce
mélange optique suscite des luminosités beaucoup plus intenses que le mélange
des pigments”. Et avec sa modestie caractéristique, Pissarro insistait sur le
fait que c’était “M. Seurat, artiste de grande valeur, qui a été le premier à
avoir l’idée et à appliquer la théorie scientifiquement après
Dans une lettre à Durand-Ruel, il expliqua que ce qu’il
voulait dorénavant, c’était “rechercher la synthèse moderne par des moyens basés
sur la science, lesquels seront basés sur la théorie des couleurs découverte
par M. Chevreul, et d’après les expériences de Maxwell et des mensurations de
O. N. Rood : substituer le mélange optique au mélange des pigments, autrement
dit, la décomposition des tons en leurs éléments constitutifs, parce que ce
mélange optique suscite des luminosités beaucoup plus intenses que le mélange
des pigments”. Et avec sa modestie caractéristique, Pissarro insistait sur le
fait que c’était “M. Seurat, artiste de grande valeur, qui a été le premier à
avoir l’idée et à appliquer la théorie scientifiquement après  l’avoir étudiée à
fond. Je n’ai fait que suivre…” Dès que Pissarro se fut joint à Seurat et à
Signac, il commença à considérer ses anciens camarades comme des
impressionnistes romantiques, soulignant ainsi les différences de principes qui
les séparaient du nouveau groupe d’impressionnistes scientifiques».[77]
Scientifique, le mot était juste. Une nouvelle sorte de réalisme étranger à
celui de Courbet et du premier Manet faisait son apparition. Seurat «était fasciné par l’idée que la couleur,
soumisse à des lois fixes, “se peut enseigner comme la musique”. Parmi ces lois
s’en trouve une établie par Chevreul selon laquelle “le contraste simultané des
couleurs renferme tous les phénomènes de modification que des objets
diversement colorés paraissent éprouver dans la composition physique et la
hauteur du ton de leurs couleurs respectives lorsqu’on les voit simultanément”.
L’un des éléments essentiels de la théorie des contrastes simultanés est fondé
sur le point que deux couleurs contiguës s’influencent, chacune imposant à sa
voisine sa propre complémentaire (la plus claire devenant plus claire et la
plus sombre plus foncée)».[78]
Plutôt que de se laisser aller à traduire les perceptions visuelles reçues par
l’œil
l’avoir étudiée à
fond. Je n’ai fait que suivre…” Dès que Pissarro se fut joint à Seurat et à
Signac, il commença à considérer ses anciens camarades comme des
impressionnistes romantiques, soulignant ainsi les différences de principes qui
les séparaient du nouveau groupe d’impressionnistes scientifiques».[77]
Scientifique, le mot était juste. Une nouvelle sorte de réalisme étranger à
celui de Courbet et du premier Manet faisait son apparition. Seurat «était fasciné par l’idée que la couleur,
soumisse à des lois fixes, “se peut enseigner comme la musique”. Parmi ces lois
s’en trouve une établie par Chevreul selon laquelle “le contraste simultané des
couleurs renferme tous les phénomènes de modification que des objets
diversement colorés paraissent éprouver dans la composition physique et la
hauteur du ton de leurs couleurs respectives lorsqu’on les voit simultanément”.
L’un des éléments essentiels de la théorie des contrastes simultanés est fondé
sur le point que deux couleurs contiguës s’influencent, chacune imposant à sa
voisine sa propre complémentaire (la plus claire devenant plus claire et la
plus sombre plus foncée)».[78]
Plutôt que de se laisser aller à traduire les perceptions visuelles reçues par
l’œil  et transmises du cerveau à la main du peintre, la main de Seurat, partant
du modèle de Chevreul, reconstruisait, sans avoir à l’observer, une scène
imaginaire. Les contrastes colorés finissaient par devenir une nouvelle ligne à
partir de pointillés de couleurs complémentaires, longue et minutieuse adresse
qui a fait le génie de Seurat. Parmi les post-impressionnistes, on appela sa
méthode le pointillisme : «Seurat et ses associés évitaient
soigneusement le mot pointillisme dans leurs discussions et parlaient toujours
de divisionnisme, un terme qui embrassait toutes leurs innovations. […] Divisionnisme, selon la définition de
Signac, signifie “s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur
et de l’harmonie: par le mélange optique de pigments uniquement purs (toutes
les teintes du prisme et tous leurs tons); par la séparation des divers
éléments (couleur locale, couleur d’éclairage, leurs réactions); par
l’équilibre de ces éléments et leurs proportions (selon les lois du contraste,
de la dégradation et de l’irradiation); par le choix d’une touche proportionnée
à la dimension du tableau”».[79]
Seurat, Signac et le britannique Sisley travaillèrent en pointillistes et offrirent un nouveau défi à la composition picturale.
et transmises du cerveau à la main du peintre, la main de Seurat, partant
du modèle de Chevreul, reconstruisait, sans avoir à l’observer, une scène
imaginaire. Les contrastes colorés finissaient par devenir une nouvelle ligne à
partir de pointillés de couleurs complémentaires, longue et minutieuse adresse
qui a fait le génie de Seurat. Parmi les post-impressionnistes, on appela sa
méthode le pointillisme : «Seurat et ses associés évitaient
soigneusement le mot pointillisme dans leurs discussions et parlaient toujours
de divisionnisme, un terme qui embrassait toutes leurs innovations. […] Divisionnisme, selon la définition de
Signac, signifie “s’assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la couleur
et de l’harmonie: par le mélange optique de pigments uniquement purs (toutes
les teintes du prisme et tous leurs tons); par la séparation des divers
éléments (couleur locale, couleur d’éclairage, leurs réactions); par
l’équilibre de ces éléments et leurs proportions (selon les lois du contraste,
de la dégradation et de l’irradiation); par le choix d’une touche proportionnée
à la dimension du tableau”».[79]
Seurat, Signac et le britannique Sisley travaillèrent en pointillistes et offrirent un nouveau défi à la composition picturale.
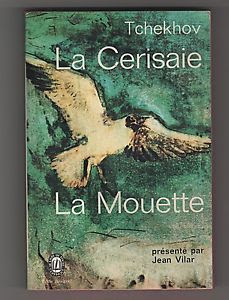 exemple. Ibsen,
mais surtout Tchékov se prêtaient admirablement à cette nouvelle méthode :
«Nous appelons pointilliste une technique
dramaturgique dans laquelle chaque geste, chaque parole n’a pas plus
d’importance en soi que le point de couleur dans un tableau impressionniste,
alors que l’ensemble de ces points prend un sens prodigieusement éloquent.
Naturellement, au théâtre, cet ensemble ne peut se situer que dans l’image
mentale du spectateur, c’est lui qui doit à chaque instant faire la synthèse
entre ce qu’il voit et ce qui a précédé. Il est difficile de voir La
Mouette, Les trois Sœurs ou La
Cerisaie sans être frappé du manque de
commune mesure entre l’insignifiance du dialogue et la portée immense et
profonde des significations, ce déséquilibre est
exemple. Ibsen,
mais surtout Tchékov se prêtaient admirablement à cette nouvelle méthode :
«Nous appelons pointilliste une technique
dramaturgique dans laquelle chaque geste, chaque parole n’a pas plus
d’importance en soi que le point de couleur dans un tableau impressionniste,
alors que l’ensemble de ces points prend un sens prodigieusement éloquent.
Naturellement, au théâtre, cet ensemble ne peut se situer que dans l’image
mentale du spectateur, c’est lui qui doit à chaque instant faire la synthèse
entre ce qu’il voit et ce qui a précédé. Il est difficile de voir La
Mouette, Les trois Sœurs ou La
Cerisaie sans être frappé du manque de
commune mesure entre l’insignifiance du dialogue et la portée immense et
profonde des significations, ce déséquilibre est  l’origine du mouvement si
particulier à ces drames».[80]
Certes, toutes comparaisons entre les genres artistiques et littéraires
conservent quelque chose de douteux, mais pour P. Ginestier, «les techniques de Tchékhov et d’Ibsen sont
fondamentalement les mêmes, mais la facture d’Ibsen est plus resserrée, le
symbole moins diffus, la progression plus dramatique au sens traditionnel du
mot. Cependant, ces deux auteurs ont su saisir tout le tragique quotidien de la
condition humaine et les conflits qu’ils dépeignent - jeunes, vieux; artistes,
béotiens; riches, pauvres; hommes, femmes - sont fondamentalement les mêmes. De
plus, ces deux dramaturges ont une technique impressionniste, mais alors la
chronologie est inversée, car Tchékhov fait penser à Claude Monet alors
qu’Ibsen rappelle Van Gogh…».[81]
Mais le pointilliste ne fut pas tout le post-impressionnisme. On parlait
beaucoup du «groupe de Pont-Aven
[Gauguin, Bernard], [qui] fusionne
bientôt avec d’autres peintres comme Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels, Paul
Ranson et Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier servant de trait d’union. Ensuite
Pierre Bonnard, Aristide Maillol et Édouard Vuillard rejoignent les rangs. En
1892, ils fondent le groupe des Nabis (Les prophètes) qui cultive une forme de
symbolisme quelque peu différent de celui de Pont-Aven».[82]
l’origine du mouvement si
particulier à ces drames».[80]
Certes, toutes comparaisons entre les genres artistiques et littéraires
conservent quelque chose de douteux, mais pour P. Ginestier, «les techniques de Tchékhov et d’Ibsen sont
fondamentalement les mêmes, mais la facture d’Ibsen est plus resserrée, le
symbole moins diffus, la progression plus dramatique au sens traditionnel du
mot. Cependant, ces deux auteurs ont su saisir tout le tragique quotidien de la
condition humaine et les conflits qu’ils dépeignent - jeunes, vieux; artistes,
béotiens; riches, pauvres; hommes, femmes - sont fondamentalement les mêmes. De
plus, ces deux dramaturges ont une technique impressionniste, mais alors la
chronologie est inversée, car Tchékhov fait penser à Claude Monet alors
qu’Ibsen rappelle Van Gogh…».[81]
Mais le pointilliste ne fut pas tout le post-impressionnisme. On parlait
beaucoup du «groupe de Pont-Aven
[Gauguin, Bernard], [qui] fusionne
bientôt avec d’autres peintres comme Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels, Paul
Ranson et Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier servant de trait d’union. Ensuite
Pierre Bonnard, Aristide Maillol et Édouard Vuillard rejoignent les rangs. En
1892, ils fondent le groupe des Nabis (Les prophètes) qui cultive une forme de
symbolisme quelque peu différent de celui de Pont-Aven».[82] par des éléments de construction assez larges :
gammes, arpèges, longues cadences. Mais, vers la fin du siècle, ces structures
furent rejetées. La musique se trouva réduite à des notes individuelles ou,
tout au plus, à de courts motifs. Comme en architecture, en peinture et dans
les métiers d’art, l’accent fut mis sur les matériaux de base, les couleurs
primaires et la substance primitive».[83]
Mais on ne savait pas précisément ce que voulait dire l’impressionnisme en
musique, et certains musiciens se virent accoler ce titre sans l’avoir
revendiqué, ainsi Claude Debussy qui «avait
obtenu un prix de Rome. Il avait visité Bayreuth et Moscou, connaissait les
écrits des symbolistes et des préraphaélites, et son nom s’était déjà trouvé
associé au terme d’“impressionnisme” […].
En 1885 le jury du Prix de Rome considère que le Printemps manifeste un “oubli
de l’importance de la précision dans la ligne et dans la forme” et un “vague
impressionnisme” qui met en péril la “vérité” de l’œuvre d’art».[84]
Plus naturellement, l’impressionnisme trouva des répondants dans le monde de la
photographie puis du cinéma. Il est vrai que l’impressionnisme avait subi
l’influence de la nouvelle invention du milieu du XIXe siècle : «L’influence largement exercée par la
photographie sur les impressionnistes est un lieu commun de l’histoire de
l’art. Ce ne serait en effet pas exagérer beaucoup que de dire, avec Stieglitz,
que “les peintres
par des éléments de construction assez larges :
gammes, arpèges, longues cadences. Mais, vers la fin du siècle, ces structures
furent rejetées. La musique se trouva réduite à des notes individuelles ou,
tout au plus, à de courts motifs. Comme en architecture, en peinture et dans
les métiers d’art, l’accent fut mis sur les matériaux de base, les couleurs
primaires et la substance primitive».[83]
Mais on ne savait pas précisément ce que voulait dire l’impressionnisme en
musique, et certains musiciens se virent accoler ce titre sans l’avoir
revendiqué, ainsi Claude Debussy qui «avait
obtenu un prix de Rome. Il avait visité Bayreuth et Moscou, connaissait les
écrits des symbolistes et des préraphaélites, et son nom s’était déjà trouvé
associé au terme d’“impressionnisme” […].
En 1885 le jury du Prix de Rome considère que le Printemps manifeste un “oubli
de l’importance de la précision dans la ligne et dans la forme” et un “vague
impressionnisme” qui met en péril la “vérité” de l’œuvre d’art».[84]
Plus naturellement, l’impressionnisme trouva des répondants dans le monde de la
photographie puis du cinéma. Il est vrai que l’impressionnisme avait subi
l’influence de la nouvelle invention du milieu du XIXe siècle : «L’influence largement exercée par la
photographie sur les impressionnistes est un lieu commun de l’histoire de
l’art. Ce ne serait en effet pas exagérer beaucoup que de dire, avec Stieglitz,
que “les peintres  impressionnistes adoptent un style de composition qui est
strictement photographique”. La traduction photographique de la réalité en
zones d’ombre et de lumière fortement contrastées, le découpage libre ou
arbitraire de l’image dans le cadre de la photo, l’indifférence des photographes à rendre l’espace, et particulièrement l’arrière-plan,
intelligible : voilà pour l’essentiel ce qui a inspiré aux peintres
impressionnistes leurs professions d’intérêt scientifique pour les propriétés
de la lumière, leurs recherches de perspectives aplaties d’angles insolites, de
formes décentrées, tronquées par le bord de la toile. (“Ils peignent la vie par
pièces et morceaux”, comme le faisait remarquer Stieglitz en 1909.) Détail
historique : c’est dans le studio de Nadar, à Paris, boulevard des Capucines,
que se tînt en avril 1874 la toute première exposition impressionniste».[85]
Bien avant Jean Renoir – fils du peintre Auguste – qui tourna son film Une
impressionnistes adoptent un style de composition qui est
strictement photographique”. La traduction photographique de la réalité en
zones d’ombre et de lumière fortement contrastées, le découpage libre ou
arbitraire de l’image dans le cadre de la photo, l’indifférence des photographes à rendre l’espace, et particulièrement l’arrière-plan,
intelligible : voilà pour l’essentiel ce qui a inspiré aux peintres
impressionnistes leurs professions d’intérêt scientifique pour les propriétés
de la lumière, leurs recherches de perspectives aplaties d’angles insolites, de
formes décentrées, tronquées par le bord de la toile. (“Ils peignent la vie par
pièces et morceaux”, comme le faisait remarquer Stieglitz en 1909.) Détail
historique : c’est dans le studio de Nadar, à Paris, boulevard des Capucines,
que se tînt en avril 1874 la toute première exposition impressionniste».[85]
Bien avant Jean Renoir – fils du peintre Auguste – qui tourna son film Une  partie de campagne durant l’été 1936
en s’inspirant des thèmes et des textures de l’art impressionniste, il y eut
Léon Poirier qui «appartenait à la
famille de Berthe Morizot, disciple de Manet. Il y a dans certaines images de Jocelyn ou de La Brière comme un prolongement de l’Impressionnisme pictural. Poirier,
Baroncelli composent les premiers films français où la nature devient une
présence. L’“impression” que les novateurs vont tenter de dégager par le jeu
combiné des plans et des rythmes, ces romantiques le demandent à la lumière qui
baigne un paysage et lui donne son caractère».[86]
On a également considéré certains films d’Abel Gance (1889-1981) comme relevant
de l’impressionnisme, surtout à travers ses expériences liées au mouvement de
la caméra; dans La Roue (1923) «c’était le mouvement qui était à la base de
cette innovation qui a fait dire à Germaine Dulac : “L’ère de l’impressionnisme
commençait, ramenant au mouvement par le rythme, cherchant à créer l’émotion
par la sensation”».[87]
Jean Epstein (1897-1953), plus romantique, produisait des images métissées de
symbolisme et d’impressionnisme.
partie de campagne durant l’été 1936
en s’inspirant des thèmes et des textures de l’art impressionniste, il y eut
Léon Poirier qui «appartenait à la
famille de Berthe Morizot, disciple de Manet. Il y a dans certaines images de Jocelyn ou de La Brière comme un prolongement de l’Impressionnisme pictural. Poirier,
Baroncelli composent les premiers films français où la nature devient une
présence. L’“impression” que les novateurs vont tenter de dégager par le jeu
combiné des plans et des rythmes, ces romantiques le demandent à la lumière qui
baigne un paysage et lui donne son caractère».[86]
On a également considéré certains films d’Abel Gance (1889-1981) comme relevant
de l’impressionnisme, surtout à travers ses expériences liées au mouvement de
la caméra; dans La Roue (1923) «c’était le mouvement qui était à la base de
cette innovation qui a fait dire à Germaine Dulac : “L’ère de l’impressionnisme
commençait, ramenant au mouvement par le rythme, cherchant à créer l’émotion
par la sensation”».[87]
Jean Epstein (1897-1953), plus romantique, produisait des images métissées de
symbolisme et d’impressionnisme.

 et Henry James découvraient déjà un procédé impressionniste : que les faits rapportés,
minutieusement et légèrement peints sur une toile, suggèrent derrière cette
toile, en transparence, une autre réalité indéfinissable. Sous la surface
pittoresque du conte alerte ou fascinant s’imposent le mystère et la profondeur
de l’événement, qui échappent au conte. […] Ce “quelque chose de plus” est déjà l’essentiel du roman
impressionniste : la sensation que derrière le récit objectif - qui devient
alors insuffisant -, au-delà même de la conscience que les personnages prennent
des événements qu’ils vivent, il existe une réalité impénétrable de l’événement…».[89]
En vérité, il y a eu autant de styles impressionnistes en littérature qu’il y
en a eu en peinture. Entre Woolf, Proust, Conrad, que de différences, mais que
de ressemblances aussi; parce que chacun cherchait à imprégner ses romans d’une
atmosphère dont les lecteurs pourraient partager des impressions profondes,
voire même intimes que les critiques ont usé du terme impressionniste pour les qualifier. On peut s’étonner d’y retrouver
le poète symboliste Mallarmé dont nous avons parlé au sous-chapitre précédent. Car
«les
et Henry James découvraient déjà un procédé impressionniste : que les faits rapportés,
minutieusement et légèrement peints sur une toile, suggèrent derrière cette
toile, en transparence, une autre réalité indéfinissable. Sous la surface
pittoresque du conte alerte ou fascinant s’imposent le mystère et la profondeur
de l’événement, qui échappent au conte. […] Ce “quelque chose de plus” est déjà l’essentiel du roman
impressionniste : la sensation que derrière le récit objectif - qui devient
alors insuffisant -, au-delà même de la conscience que les personnages prennent
des événements qu’ils vivent, il existe une réalité impénétrable de l’événement…».[89]
En vérité, il y a eu autant de styles impressionnistes en littérature qu’il y
en a eu en peinture. Entre Woolf, Proust, Conrad, que de différences, mais que
de ressemblances aussi; parce que chacun cherchait à imprégner ses romans d’une
atmosphère dont les lecteurs pourraient partager des impressions profondes,
voire même intimes que les critiques ont usé du terme impressionniste pour les qualifier. On peut s’étonner d’y retrouver
le poète symboliste Mallarmé dont nous avons parlé au sous-chapitre précédent. Car
«les  impressionnistes le séduisent parce
que leur esthétique est près de la sienne. Ils laissent deviner plus qu’ils
n’expriment…».[90]
Lui-même, finalement, reconnaîtra l’effort de rattacher sa poésie à la nouvelle
peinture lorsque dans une lettre à son ami Cazalis de 1864, il avouera : «…j’invente une langue qui doit
nécessairement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en
ces deux mots : peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit».[91]
Les peintres impressionnistes étaient ses amis et comme eux, comme les
symbolistes aussi, il refusait de se laisser mettre en cage, même au nom de
l’histoire de l’art : «Mallarmé n’est pas un grand paysagiste. D’abord parce qu’il se défend d’être descriptif,
et parce qu’il a conservé, de ses débuts parnassiens ou de ses dons natifs, une
pudeur de sentiment, une retenue d’émotion que les impassibles n’ont montré ni
plus sévères ni plus constantes. […]
sur la forêt de Fontainebleau, sur “la quiétude menteuse de riches bois
suspendant alentour quelque extraordinaire état d’illusion”, “l’extatique
torpeur des feuillages”, l’étincellement d’un juillet de flammes ou d’un
octobre pompeux, sur la buée d’argent glaçant les saules et les verdures qui
encadrent les ruisseaux et les fleuves, il a des peintures dignes de ses amis
impressionnistes».[92]
Mallarmé se voulait peut-être impressionniste, mais tout Mallarmé ne porte pas
la marque de l’impressionnisme.
impressionnistes le séduisent parce
que leur esthétique est près de la sienne. Ils laissent deviner plus qu’ils
n’expriment…».[90]
Lui-même, finalement, reconnaîtra l’effort de rattacher sa poésie à la nouvelle
peinture lorsque dans une lettre à son ami Cazalis de 1864, il avouera : «…j’invente une langue qui doit
nécessairement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en
ces deux mots : peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit».[91]
Les peintres impressionnistes étaient ses amis et comme eux, comme les
symbolistes aussi, il refusait de se laisser mettre en cage, même au nom de
l’histoire de l’art : «Mallarmé n’est pas un grand paysagiste. D’abord parce qu’il se défend d’être descriptif,
et parce qu’il a conservé, de ses débuts parnassiens ou de ses dons natifs, une
pudeur de sentiment, une retenue d’émotion que les impassibles n’ont montré ni
plus sévères ni plus constantes. […]
sur la forêt de Fontainebleau, sur “la quiétude menteuse de riches bois
suspendant alentour quelque extraordinaire état d’illusion”, “l’extatique
torpeur des feuillages”, l’étincellement d’un juillet de flammes ou d’un
octobre pompeux, sur la buée d’argent glaçant les saules et les verdures qui
encadrent les ruisseaux et les fleuves, il a des peintures dignes de ses amis
impressionnistes».[92]
Mallarmé se voulait peut-être impressionniste, mais tout Mallarmé ne porte pas
la marque de l’impressionnisme. Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-1923) laissa des descriptions des pêcheurs
d’Islande (Pêcheur d’Islande, 1886)
aussi bien que des sérails ottomans (Aziyadé,
1879), des geisha du Japon (Madame
Chrysanthème, 1887) que l’exploration du temple d’Angkor Vat, enfin Tahiti
où la reine Pomaré lui donna ce surnom de Loti. Bref, Loti a visité toutes les
parties du monde en tant qu’officier de marine et, parallèlement à l’évolution
des peintres impressionnistes, il a développé une qualité littéraire dans les
paysages qui se perfectionne de roman en roman. Ainsi, Loti «ne s’est pas encore avisé, en écrivant Aziyadé, de traiter le décor turc autrement qu’en
peintre. Ses descriptions pour la plupart alignent les détails précis, ou
Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-1923) laissa des descriptions des pêcheurs
d’Islande (Pêcheur d’Islande, 1886)
aussi bien que des sérails ottomans (Aziyadé,
1879), des geisha du Japon (Madame
Chrysanthème, 1887) que l’exploration du temple d’Angkor Vat, enfin Tahiti
où la reine Pomaré lui donna ce surnom de Loti. Bref, Loti a visité toutes les
parties du monde en tant qu’officier de marine et, parallèlement à l’évolution
des peintres impressionnistes, il a développé une qualité littéraire dans les
paysages qui se perfectionne de roman en roman. Ainsi, Loti «ne s’est pas encore avisé, en écrivant Aziyadé, de traiter le décor turc autrement qu’en
peintre. Ses descriptions pour la plupart alignent les détails précis, ou
 ordonnent les touches de couleur selon une technique impressionniste. Le
Stamboul féerique, cette découverte de Loti, n’apparaît qu’une seule fois dans
son premier roman. […] ce panorama
nocturne de Stamboul est fort éloigné des descriptions habituelles dans Aziyadé et dont un exemple nous est donné par ce
tableau (esquisse plutôt), de Salonique : elle “n’est plus bientôt qu’une tache
grise qui s’étale sur des montagnes jaunes et arides, une tache hérissée de
pointes blanches qui sont des minarets et de pointes noires qui sont des cyprès».[93]
Pour Hassan El Nouty, c’est lorsque Loti s’attarde à décrire la rencontre du
désert tunisien et de la mer qu’il atteint la perfection de son art : «Et cependant, rien n’égale en splendeur le
monde désertique. Loti, peintre, ne se surpasse dans aucune autre œuvre. Le
désert, après l’Oued-el-Aïn, c’est “le royaume du gris, du gris mat, comme
saupoudré de cendre et veiné çà et là de brun ardent”. Quelle munificence dans
le tableau de la mer et du désert : “L’ensemble des choses est rose, mais il
est comme barré en son milieu par une longue bande infinie, presque noire à
force d’être intensément bleue, et qu’il
ordonnent les touches de couleur selon une technique impressionniste. Le
Stamboul féerique, cette découverte de Loti, n’apparaît qu’une seule fois dans
son premier roman. […] ce panorama
nocturne de Stamboul est fort éloigné des descriptions habituelles dans Aziyadé et dont un exemple nous est donné par ce
tableau (esquisse plutôt), de Salonique : elle “n’est plus bientôt qu’une tache
grise qui s’étale sur des montagnes jaunes et arides, une tache hérissée de
pointes blanches qui sont des minarets et de pointes noires qui sont des cyprès».[93]
Pour Hassan El Nouty, c’est lorsque Loti s’attarde à décrire la rencontre du
désert tunisien et de la mer qu’il atteint la perfection de son art : «Et cependant, rien n’égale en splendeur le
monde désertique. Loti, peintre, ne se surpasse dans aucune autre œuvre. Le
désert, après l’Oued-el-Aïn, c’est “le royaume du gris, du gris mat, comme
saupoudré de cendre et veiné çà et là de brun ardent”. Quelle munificence dans
le tableau de la mer et du désert : “L’ensemble des choses est rose, mais il
est comme barré en son milieu par une longue bande infinie, presque noire à
force d’être intensément bleue, et qu’il  faudrait peindre avec du bleu de
Prusse pur légèrement zébré de vert émeraude. Cette bande, c’est la mer,
l’invraisemblable mer d’Akabah; elle coupe le désert en deux nettement,
crûment: elle en fait deux parts, deux zones d’une couleur d’hortensia, d’un
rose exquis de nuage de soir, où, par opposition avec ces eaux aux couleurs
trop violentes et aux contours trop durs, tout semble vaporeux, indécis à force
de miroiter et d’éblouir, où tout étincelle de nacre, de granit et de mica, où
tout tremble de chaleur et de mirage…”».[94]
La capacité de décrire l’atmosphère plutôt que les lignes géographiques, ce qui
relevait de l’officier de marine plus que du poète, suffit à en faire un
véritable artiste impressionniste. «Certes
Loti le magicien transfigure toujours ce qu’il touche, et étire sur les choses
un voile de poésie ou de féerie. À Hébron, il “marche dans une buée de
poussière, dans une odeur d’épices et d’ambre”. [En Galilée], il déroule sur le ciel un léger “voile de
vapeurs ténues, comme pour tamiser un peu le soleil… comme pour protéger tant
de myriades de petites corolles légères…”».[95]
Mais Loti n’est pas le seul à avoir eu ce talent. Lorsque la fille du président
de la République, Lucie Félix-Faure (1866-1913), dont on cru un instant à un
éventuel mariage avec Marcel Proust, décrit à son tour le Moyen-Orient, «les mosquées d’Égypte se réduisent à des
taches de couleurs : “Fins minarets roses”, dans un ciel bleu tendre, et que le
soleil transforme en “lumières roses”. Le pays même ne serait qu’une immense
palette verte semée de points bleus, qui sont les robes des fellahs, et où le
lac Timsah représente “une turquoise verdie enchâssée par les sables”».[96]
faudrait peindre avec du bleu de
Prusse pur légèrement zébré de vert émeraude. Cette bande, c’est la mer,
l’invraisemblable mer d’Akabah; elle coupe le désert en deux nettement,
crûment: elle en fait deux parts, deux zones d’une couleur d’hortensia, d’un
rose exquis de nuage de soir, où, par opposition avec ces eaux aux couleurs
trop violentes et aux contours trop durs, tout semble vaporeux, indécis à force
de miroiter et d’éblouir, où tout étincelle de nacre, de granit et de mica, où
tout tremble de chaleur et de mirage…”».[94]
La capacité de décrire l’atmosphère plutôt que les lignes géographiques, ce qui
relevait de l’officier de marine plus que du poète, suffit à en faire un
véritable artiste impressionniste. «Certes
Loti le magicien transfigure toujours ce qu’il touche, et étire sur les choses
un voile de poésie ou de féerie. À Hébron, il “marche dans une buée de
poussière, dans une odeur d’épices et d’ambre”. [En Galilée], il déroule sur le ciel un léger “voile de
vapeurs ténues, comme pour tamiser un peu le soleil… comme pour protéger tant
de myriades de petites corolles légères…”».[95]
Mais Loti n’est pas le seul à avoir eu ce talent. Lorsque la fille du président
de la République, Lucie Félix-Faure (1866-1913), dont on cru un instant à un
éventuel mariage avec Marcel Proust, décrit à son tour le Moyen-Orient, «les mosquées d’Égypte se réduisent à des
taches de couleurs : “Fins minarets roses”, dans un ciel bleu tendre, et que le
soleil transforme en “lumières roses”. Le pays même ne serait qu’une immense
palette verte semée de points bleus, qui sont les robes des fellahs, et où le
lac Timsah représente “une turquoise verdie enchâssée par les sables”».[96]
 «Jamais Conrad
n’omet de dire que le soleil s’avance dans le ciel et que le même paysage
apparaît sous une autre lumière; et aussi que la vie est un perpétuel
changement. C’est pourquoi, au lieu de descriptions étendues, dont le résultat
serait de pétrifier le paysage et d’en faire l’immuable toile de fond d’une
foule d’événements se succédant sur le même espace, il procède à l’ordinaire par
petites touches descriptives (ne dépassant guère une dizaine de lignes) et il
laisse s’écouler un laps de temps restreint, de façon à les glisser entre des
récits d’événements et des appréciations sur la conduite des personnages. De
telle sorte que la coexistence et la commune évolution de ce qui se passe dans
l’homme et avec l’homme et de ce qui se passe en même temps dans la nature qui
l’entoure, nous soient sans interruption présentées et créent pour nous une
seule vision».[97]
Ujeski, son biographe, cite pour exemple un passage tiré de Lord Jim : «Le pays s’étendait devant nos yeux : la vaste étendue des forêts noires
ondulait sous le soleil comme une mer, avec les lueurs des rivières sinueuses,
les taches grises des villages et ça et là une clairière, îlot de lumière parmi
les îlots sombres des cimes de verdure. Une mélancolie planait sur ce paysage
vaste et monotone où la lumière tombait comme dans un abîme. La terre absorbait
les rayons du soleil; très loin seulement, le long de la côte, l’océan vide, lisse
et poli sous sa brume ténue, semblait dresser vers le ciel son mur d’acier».[98]
Ne reconnaîtrait-on pas là la mélancolie de Monet?
«Jamais Conrad
n’omet de dire que le soleil s’avance dans le ciel et que le même paysage
apparaît sous une autre lumière; et aussi que la vie est un perpétuel
changement. C’est pourquoi, au lieu de descriptions étendues, dont le résultat
serait de pétrifier le paysage et d’en faire l’immuable toile de fond d’une
foule d’événements se succédant sur le même espace, il procède à l’ordinaire par
petites touches descriptives (ne dépassant guère une dizaine de lignes) et il
laisse s’écouler un laps de temps restreint, de façon à les glisser entre des
récits d’événements et des appréciations sur la conduite des personnages. De
telle sorte que la coexistence et la commune évolution de ce qui se passe dans
l’homme et avec l’homme et de ce qui se passe en même temps dans la nature qui
l’entoure, nous soient sans interruption présentées et créent pour nous une
seule vision».[97]
Ujeski, son biographe, cite pour exemple un passage tiré de Lord Jim : «Le pays s’étendait devant nos yeux : la vaste étendue des forêts noires
ondulait sous le soleil comme une mer, avec les lueurs des rivières sinueuses,
les taches grises des villages et ça et là une clairière, îlot de lumière parmi
les îlots sombres des cimes de verdure. Une mélancolie planait sur ce paysage
vaste et monotone où la lumière tombait comme dans un abîme. La terre absorbait
les rayons du soleil; très loin seulement, le long de la côte, l’océan vide, lisse
et poli sous sa brume ténue, semblait dresser vers le ciel son mur d’acier».[98]
Ne reconnaîtrait-on pas là la mélancolie de Monet?

 en plein air, “c’est le mouvement réaliste,
déclenché par Courbet et libéré des entraves du métier, cherchant la vérité
dans les jeux innombrables de la lumière”. (Salon de 1879). Cette filiation
Courbet-Manet-impressionnisme semble aller de soi pour beaucoup de critiques de
son temps, qu’il s’agisse ou non de détracteurs du mouvement».[99]
Pour les critiques, il est toujours possible d’établir un pont entre les
descriptions de Zola et l’espace figuratif des œuvres impressionnistes. On peut
trouver fantaisiste le pont que la critique Joy Newton érige entre Zola et
Degas : «Quand il fait un tableau
d’un beau sujet, le peintre impressionniste ne s’occupe pas exclusivement de
ses aspects lyriques. Le but principal de Degas, par exemple, n’est pas de
représenter de belles danseuses, flattées par les feux de la rampe, quoique le
sujet se prête à une telle interprétation de la grâce; il préfère dépeindre la
danseuse fatiguée qui dénoue ses chaussons de ballet, ou qui se frotte une
jambe. La représentation des sujets modernes et communs est également un des
traits du naturalisme; évoquons par exemple les longs passages de Zola sur la
viande et les poissons dans “Le Ventre de Paris”, ou sur les effets de vapeur
au lavoir de “L’Assommoir”».[100]
La délicatesse de Degas nous apparaît pourtant tout à l’opposé du voyeurisme de
l’écrivain. Mais lorsque Zola en vient à décrire la nature ou le fardeau de ses
personnages, il est possible de reconnaître, au-delà du naturaliste qu’il ne
cessera jamais d’être, le peintre d’atmosphère moite comme dans La faute de l’abbé Mouret ou du lavoir
de L’assommoir. On y reconnaît même
le décor qui serait celui d’un tableau de Van Gogh : «Pour Zola, comme pour les peintres, c’est surtout la clarté du soleil
qui est la source du beau. […] À
travers les œuvres du peintre, on peut suivre à la trace le même attrait de la
lumière, à la fois pour elle-même,
en plein air, “c’est le mouvement réaliste,
déclenché par Courbet et libéré des entraves du métier, cherchant la vérité
dans les jeux innombrables de la lumière”. (Salon de 1879). Cette filiation
Courbet-Manet-impressionnisme semble aller de soi pour beaucoup de critiques de
son temps, qu’il s’agisse ou non de détracteurs du mouvement».[99]
Pour les critiques, il est toujours possible d’établir un pont entre les
descriptions de Zola et l’espace figuratif des œuvres impressionnistes. On peut
trouver fantaisiste le pont que la critique Joy Newton érige entre Zola et
Degas : «Quand il fait un tableau
d’un beau sujet, le peintre impressionniste ne s’occupe pas exclusivement de
ses aspects lyriques. Le but principal de Degas, par exemple, n’est pas de
représenter de belles danseuses, flattées par les feux de la rampe, quoique le
sujet se prête à une telle interprétation de la grâce; il préfère dépeindre la
danseuse fatiguée qui dénoue ses chaussons de ballet, ou qui se frotte une
jambe. La représentation des sujets modernes et communs est également un des
traits du naturalisme; évoquons par exemple les longs passages de Zola sur la
viande et les poissons dans “Le Ventre de Paris”, ou sur les effets de vapeur
au lavoir de “L’Assommoir”».[100]
La délicatesse de Degas nous apparaît pourtant tout à l’opposé du voyeurisme de
l’écrivain. Mais lorsque Zola en vient à décrire la nature ou le fardeau de ses
personnages, il est possible de reconnaître, au-delà du naturaliste qu’il ne
cessera jamais d’être, le peintre d’atmosphère moite comme dans La faute de l’abbé Mouret ou du lavoir
de L’assommoir. On y reconnaît même
le décor qui serait celui d’un tableau de Van Gogh : «Pour Zola, comme pour les peintres, c’est surtout la clarté du soleil
qui est la source du beau. […] À
travers les œuvres du peintre, on peut suivre à la trace le même attrait de la
lumière, à la fois pour elle-même,  comme chez les Impressionnistes ou comme
chez Zola jusqu’aux années 1880, et pour sa valeur symbolique, comme dans les
œuvres postérieures de Zola. Il y a un développement caractéristique, de la
lueur indistincte d’une lampe dans un tableau qui souligne la misère de
l’existence comme “Mangeurs de pommes de terre" (1885), ou des lumières du gaz dans une peinture sinistre comme “Café de nuit” (1888), jusqu’à la clarté
incommensurable des astres apocalyptiques dans un tableau tel que “Nuit étoilée” (1889). Dans toute l’œuvre de Van Gogh, il y a une sensibilité
profonde envers le soleil, semblable à celle de l’écrivain. Tandis que les
Impressionnistes se limitaient aux reflets de la lumière, Van Gogh, comme Zola,
emploie le soleil à sa source comme le symbole d’une clarté qui représente
l’aspiration humaine et l’espoir. Dans “Paris”, Zola parle du soleil en ces
termes : “…Le soleil est l’unique justice, brûlant au ciel pour tout le monde,
donnant du même geste, au pauvre comme au riche, sa magnificence, sa lumière,
sa chaleur, qui sont la source de toute vie”».[101]
Il est certain que toutes ces liaisons sont d’abord le fait de critiques
littéraires ou artistiques qui reconnaissent mutuellement des voies de passage,
mais on ne peut nier une certaine correspondance entre certaines œuvres sans
pour autant mettre à l’identique le style d’un peintre avec celui d’un
littéraire.
comme chez les Impressionnistes ou comme
chez Zola jusqu’aux années 1880, et pour sa valeur symbolique, comme dans les
œuvres postérieures de Zola. Il y a un développement caractéristique, de la
lueur indistincte d’une lampe dans un tableau qui souligne la misère de
l’existence comme “Mangeurs de pommes de terre" (1885), ou des lumières du gaz dans une peinture sinistre comme “Café de nuit” (1888), jusqu’à la clarté
incommensurable des astres apocalyptiques dans un tableau tel que “Nuit étoilée” (1889). Dans toute l’œuvre de Van Gogh, il y a une sensibilité
profonde envers le soleil, semblable à celle de l’écrivain. Tandis que les
Impressionnistes se limitaient aux reflets de la lumière, Van Gogh, comme Zola,
emploie le soleil à sa source comme le symbole d’une clarté qui représente
l’aspiration humaine et l’espoir. Dans “Paris”, Zola parle du soleil en ces
termes : “…Le soleil est l’unique justice, brûlant au ciel pour tout le monde,
donnant du même geste, au pauvre comme au riche, sa magnificence, sa lumière,
sa chaleur, qui sont la source de toute vie”».[101]
Il est certain que toutes ces liaisons sont d’abord le fait de critiques
littéraires ou artistiques qui reconnaissent mutuellement des voies de passage,
mais on ne peut nier une certaine correspondance entre certaines œuvres sans
pour autant mettre à l’identique le style d’un peintre avec celui d’un
littéraire.

 auteurs s’attardent
aux relations entre les personnages plutôt qu’à l’intrigue elle-même. C’est ce
qui arrive dans le théâtre de Tchékov a-t-on dit. C’est ce qui arrive également
dans les romans de l’Américain anglomane, William James : «C’est la relation entre les êtres, entre
êtres et choses, plutôt que leur valeur en soi, que James cherche à étudier.
Aucune impression ne se présente dans son esprit à l’état isolé, “chacune
d’elle baigne dans une des lumières… qui lui viennent de toutes les autres. […] Il projette toujours un halo imaginatif
autour de ses sujets et ajoute une portée morale au réel; actions, paysages ou
objets ne sont plus re-présentés mais animés par une lumière intérieure. C’est
chez lui le procédé du peintre, celui de Manet, par exemple, qui, lui aussi,
changeait radicalement à cette époque le point de vue du peintre devant la
réalité. Dans ses œuvres, James essaie d’exprimer une relation, sa relation,
avec le réel. Il a écrit qu’un “roman dans sa définition la plus large est une
impression personnelle et directe de la vie”».[102]
Sur le continent européen, l’impressionnisme dans la littérature est intimement
lié à la nouvelle problématique que représent le temps. Proust, par exemple,
reste lié à tous ceux dont le temps est une ou la matière de leurs
travaux : Einstein, Bergson, Woolf, Joyce, Heidegger… appartiennent à
cette grande découverte physique et métaphysique de la durée et du passage du
temps qui transforme tout sur son passage : les choses, les êtres, les
humains, la vie.
auteurs s’attardent
aux relations entre les personnages plutôt qu’à l’intrigue elle-même. C’est ce
qui arrive dans le théâtre de Tchékov a-t-on dit. C’est ce qui arrive également
dans les romans de l’Américain anglomane, William James : «C’est la relation entre les êtres, entre
êtres et choses, plutôt que leur valeur en soi, que James cherche à étudier.
Aucune impression ne se présente dans son esprit à l’état isolé, “chacune
d’elle baigne dans une des lumières… qui lui viennent de toutes les autres. […] Il projette toujours un halo imaginatif
autour de ses sujets et ajoute une portée morale au réel; actions, paysages ou
objets ne sont plus re-présentés mais animés par une lumière intérieure. C’est
chez lui le procédé du peintre, celui de Manet, par exemple, qui, lui aussi,
changeait radicalement à cette époque le point de vue du peintre devant la
réalité. Dans ses œuvres, James essaie d’exprimer une relation, sa relation,
avec le réel. Il a écrit qu’un “roman dans sa définition la plus large est une
impression personnelle et directe de la vie”».[102]
Sur le continent européen, l’impressionnisme dans la littérature est intimement
lié à la nouvelle problématique que représent le temps. Proust, par exemple,
reste lié à tous ceux dont le temps est une ou la matière de leurs
travaux : Einstein, Bergson, Woolf, Joyce, Heidegger… appartiennent à
cette grande découverte physique et métaphysique de la durée et du passage du
temps qui transforme tout sur son passage : les choses, les êtres, les
humains, la vie. Les deux auteurs français dont on peut dire que
l’impressionnisme fut tout entier dans la composition de leurs œuvres, c’est
Marcel Proust (1871-1922) et Alain-Fournier (1886-1914).[103]
Albérès nous dit qu’«aborder la réalité
uniquement à travers les impressions est la découverte de Proust. Ne louait-il
pas Mme de Sévigné parce “qu’elle nous présente les choses dans l’ordre de
nos perceptions, au lieu de les expliquer
d’abord par leur cause”? La grande œuvre de PROUST
apparaît, cependant, au premier abord comme une longue chronique mondaine mêlée
à la biographie du narrateur. Les grands moments en sont longs, compacts, et il
faut une coupure entre les divers tomes pour les séparer, pour faire avancer le
temps du récit : l’enfance d’un enfant nerveux à Combray, le personnage de
Swann qui se détache parmi les relations de ses parents, la présence
solennelle, d’un autre côté, de la famille de Guermantes. Brusquement,
l’histoire des amours de Swann et d’Odette de Crécy, récit à la troisième
personne, nous éloigne du narrateur, et permet de faire “passer” le temps.
Marcel reparaît dans
À l’ombre des jeunes filles en fleur, adolescent
amoureux de la petite Gilberte Swann, avec qui il joue aux Champs-Élysées. Puis
les saisons à Balbec, les jeunes filles, une première apparition de Saint-Loup,
de Charlus. À partir du Côté de Guermantes, Marcel est adulte et c’est, à Paris, la vie mondaine, les salons, Verdurin,
Guermantes, Cottard. De
Les deux auteurs français dont on peut dire que
l’impressionnisme fut tout entier dans la composition de leurs œuvres, c’est
Marcel Proust (1871-1922) et Alain-Fournier (1886-1914).[103]
Albérès nous dit qu’«aborder la réalité
uniquement à travers les impressions est la découverte de Proust. Ne louait-il
pas Mme de Sévigné parce “qu’elle nous présente les choses dans l’ordre de
nos perceptions, au lieu de les expliquer
d’abord par leur cause”? La grande œuvre de PROUST
apparaît, cependant, au premier abord comme une longue chronique mondaine mêlée
à la biographie du narrateur. Les grands moments en sont longs, compacts, et il
faut une coupure entre les divers tomes pour les séparer, pour faire avancer le
temps du récit : l’enfance d’un enfant nerveux à Combray, le personnage de
Swann qui se détache parmi les relations de ses parents, la présence
solennelle, d’un autre côté, de la famille de Guermantes. Brusquement,
l’histoire des amours de Swann et d’Odette de Crécy, récit à la troisième
personne, nous éloigne du narrateur, et permet de faire “passer” le temps.
Marcel reparaît dans
À l’ombre des jeunes filles en fleur, adolescent
amoureux de la petite Gilberte Swann, avec qui il joue aux Champs-Élysées. Puis
les saisons à Balbec, les jeunes filles, une première apparition de Saint-Loup,
de Charlus. À partir du Côté de Guermantes, Marcel est adulte et c’est, à Paris, la vie mondaine, les salons, Verdurin,
Guermantes, Cottard. De  cette période se détachent deux “massifs” amoureux :
Sodome et Gomorrhe, et la longue aventure
de l’auteur avec Albertine. Enfin, dans le dernier livre, Le Temps retrouvé une dernière revue des personnages,
vieillis, à l’époque de la guerre».[104]
Aucun autre auteur ne peut revendiquer une proximité semblable avec les
intentions et la méthode picturale des impressionnistes. Proust a hérité de la
mélancolie qui hantait les tableaux de Monet, de Degas et de Pissarro. Au-delà
des descriptions de la réalité du monde, au-delà des intrigues et des aventures
qui ont tant habité les romans du XIXe siècle, la méthode impressionniste en
littérature oblige à un repli sur soi. Repli mélancolique disions-nous, car
conduit toujours à la désillusion et au désenchantement des expériences
antérieures. «Rendre à l’impression sa vérité première. Car nous ne nous
soucions pas de nos impressions: nous nous dépêchons et les interpréter, pour
les expliquer à nous-mêmes ou à autrui : c’est le début du mensonge romanesque.
Au contraire, derrière les explications, Proust recherche la réalité première,
le senti dans sa vérité originelle et, semble-t-il,
absolue. Art difficile, que de réapprendre à sentir pleinement: étant la
première, la sensation est le plus tôt oubliée, déformée, fanée. Et il faut par
suite ruser avec l’esprit et la prendre
cette période se détachent deux “massifs” amoureux :
Sodome et Gomorrhe, et la longue aventure
de l’auteur avec Albertine. Enfin, dans le dernier livre, Le Temps retrouvé une dernière revue des personnages,
vieillis, à l’époque de la guerre».[104]
Aucun autre auteur ne peut revendiquer une proximité semblable avec les
intentions et la méthode picturale des impressionnistes. Proust a hérité de la
mélancolie qui hantait les tableaux de Monet, de Degas et de Pissarro. Au-delà
des descriptions de la réalité du monde, au-delà des intrigues et des aventures
qui ont tant habité les romans du XIXe siècle, la méthode impressionniste en
littérature oblige à un repli sur soi. Repli mélancolique disions-nous, car
conduit toujours à la désillusion et au désenchantement des expériences
antérieures. «Rendre à l’impression sa vérité première. Car nous ne nous
soucions pas de nos impressions: nous nous dépêchons et les interpréter, pour
les expliquer à nous-mêmes ou à autrui : c’est le début du mensonge romanesque.
Au contraire, derrière les explications, Proust recherche la réalité première,
le senti dans sa vérité originelle et, semble-t-il,
absolue. Art difficile, que de réapprendre à sentir pleinement: étant la
première, la sensation est le plus tôt oubliée, déformée, fanée. Et il faut par
suite ruser avec l’esprit et la prendre  en défaut, pour revenir à l’intuition
primordiale».[105]
C’est la fameuse proclamation de Proust qui situe son œuvre romanesque face à
la littérature antérieure : «L’histoire
des personnages est l’histoire de ses impressions; sa propre histoire est aussi
celle des héros».[106]
Et le mot impression n’est pas lancé
ici par hasard, comme chez Monet pour son Voilier
d’Argenteuil. Proust écrit, «dans Jean
Santeuil cet étonnant passage sur Monet :
“Quand, le soleil perçant déjà, la rivière dort encore dans les songes du
brouillard, nous ne la voyons pas plus qu’elle ne se voit elle-même. Ici c’est
déjà la rivière, mais là la vue est arrêtée, on ne voit plus rien que le néant,
une brume qui empêche qu’on ne voie plus loin. À cet endroit de la toile,
peindre ni ce qu’on voit puisqu’on ne voit rien, ni ce qu’on ne voit pas
puisqu’on ne doit peindre que ce qu’on voit, mais peindre qu’on ne voit pas,
que la défaillance de l’œil qui ne peut pas voguer sur le brouillard lui soit
infligée sur la toile comme sur la rivière, c’est bien beau”».
en défaut, pour revenir à l’intuition
primordiale».[105]
C’est la fameuse proclamation de Proust qui situe son œuvre romanesque face à
la littérature antérieure : «L’histoire
des personnages est l’histoire de ses impressions; sa propre histoire est aussi
celle des héros».[106]
Et le mot impression n’est pas lancé
ici par hasard, comme chez Monet pour son Voilier
d’Argenteuil. Proust écrit, «dans Jean
Santeuil cet étonnant passage sur Monet :
“Quand, le soleil perçant déjà, la rivière dort encore dans les songes du
brouillard, nous ne la voyons pas plus qu’elle ne se voit elle-même. Ici c’est
déjà la rivière, mais là la vue est arrêtée, on ne voit plus rien que le néant,
une brume qui empêche qu’on ne voie plus loin. À cet endroit de la toile,
peindre ni ce qu’on voit puisqu’on ne voit rien, ni ce qu’on ne voit pas
puisqu’on ne doit peindre que ce qu’on voit, mais peindre qu’on ne voit pas,
que la défaillance de l’œil qui ne peut pas voguer sur le brouillard lui soit
infligée sur la toile comme sur la rivière, c’est bien beau”».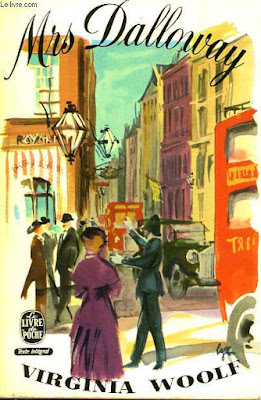 intérieure? «L’homme n’est rien, qu’un
rapport entre la conscience et les choses et, dans ce bref rapport, flamboient
la richesse et la mortalité de la vie. À son extrême, l’art impressionniste
livre son ressort et sa matière; l’avidité, pour s’assurer de vivre, d’étaler
autour de soi le monde sensible, et de renouveler ses noces avec lui, dans la
brume des mariages mystiques et périssables. Dans tous les livres de Virginia
Woolf, des êtres terriblement préoccupés d’eux-mêmes s’enfoncent dans leurs sensations, craignant sans cesse de ne rien trouver devant cette avidité
intérieure, redoutant que ce fragile lien s’efface entre le monde et la
conscience, comme il arrive à Septimus Warren Smith : “Il était saisi, surtout
le soir, de ces foudroyants accès de peur. Il ne sentait plus rien.”
Ravissement, au contraire, de se trouver sensible encore aux rumeurs et aux
couleurs du monde, de s’apercevoir que l’on aime la vie: “Qui sait pourquoi
nous l’aimons ainsi, pourquoi nous le voyons ainsi, pourquoi nous l’élevons
autour de nous, la construisons, la détruisons - et la recréons à chaque
minute? Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, leur
tumulte, dans le fracas, dans le vacarme, voitures, autos, omnibus, camions,
hommes-sandwich traînant et oscillant, orchestres, orgues de Barbarie, dans le
triomphe et dans le tintement et dans le chant étranger d,un aéroplane
au-dessus de sa tête, il y avait ce qu’elle aimai t: la vie, Londres, ce moment
de juin” [V. Woolf. Mrs Dalloway]».[107]
Le monde devient cette réalité impénétrable, ténébreuse, dont il est possible
toutefois de s’arrêter à en observer la surface. Parfois, les nuages se
dissipent et la personnalité se révèle dans ses coloris, ses tons, ses
modifications. Pour le voir, il faut cesser d’être retenu par la fausseté de
l’intrigue, il faut rentrer dans le caractère des personnages qui demeurent
seul digne d’intérêt : «Sous la surface
de l’existence, apparaît peu à peu sa transparence… L’honnête roman
intérieure? «L’homme n’est rien, qu’un
rapport entre la conscience et les choses et, dans ce bref rapport, flamboient
la richesse et la mortalité de la vie. À son extrême, l’art impressionniste
livre son ressort et sa matière; l’avidité, pour s’assurer de vivre, d’étaler
autour de soi le monde sensible, et de renouveler ses noces avec lui, dans la
brume des mariages mystiques et périssables. Dans tous les livres de Virginia
Woolf, des êtres terriblement préoccupés d’eux-mêmes s’enfoncent dans leurs sensations, craignant sans cesse de ne rien trouver devant cette avidité
intérieure, redoutant que ce fragile lien s’efface entre le monde et la
conscience, comme il arrive à Septimus Warren Smith : “Il était saisi, surtout
le soir, de ces foudroyants accès de peur. Il ne sentait plus rien.”
Ravissement, au contraire, de se trouver sensible encore aux rumeurs et aux
couleurs du monde, de s’apercevoir que l’on aime la vie: “Qui sait pourquoi
nous l’aimons ainsi, pourquoi nous le voyons ainsi, pourquoi nous l’élevons
autour de nous, la construisons, la détruisons - et la recréons à chaque
minute? Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, leur
tumulte, dans le fracas, dans le vacarme, voitures, autos, omnibus, camions,
hommes-sandwich traînant et oscillant, orchestres, orgues de Barbarie, dans le
triomphe et dans le tintement et dans le chant étranger d,un aéroplane
au-dessus de sa tête, il y avait ce qu’elle aimai t: la vie, Londres, ce moment
de juin” [V. Woolf. Mrs Dalloway]».[107]
Le monde devient cette réalité impénétrable, ténébreuse, dont il est possible
toutefois de s’arrêter à en observer la surface. Parfois, les nuages se
dissipent et la personnalité se révèle dans ses coloris, ses tons, ses
modifications. Pour le voir, il faut cesser d’être retenu par la fausseté de
l’intrigue, il faut rentrer dans le caractère des personnages qui demeurent
seul digne d’intérêt : «Sous la surface
de l’existence, apparaît peu à peu sa transparence… L’honnête roman  réaliste
éclairait dans ses moindres recoins une réalité offerte à toutes les
investigations et à toutes les enquêtes, l’impressionnisme ne se fie plus à
cette docilité et à cette présence immédiate du monde : “Tâchons de croire, dit
Virginia Woolf, que la vie est un objet solide, un globe que nous pouvons faire
tourner sous nos doigts. Tâchons de croire qu’on peut en faire un récit simple
et logique, en finir avec l’amour par exemple, et passer au chapitre suivant…”
Mais en vain… Pour la sensibilité nouvelle la vie est une profondeur trouble où
la lumière de la conscience miroite seulement, se diffracte et s’épanouit avant
de se perdre, comme les rayons du soleil lentement diffusés, puis absorbés dans
l’eau, jusqu’à la cécité des profondeurs… Multiple, tourbillonnante, faite de
poussières lumineuses suspendues dans le vide, la réalité impressionniste ne se
raconte pas, ne se décrit même point. Les paroles, les gestes menus des hommes,
hésitations et arabesques, indiquent à peine quelques lignes, à la surface de
cette nébuleuse qui est la réalité, qui est la “Vie”. Le lecteur est ainsi
transporté dans un univers en fusion, déconcerté par une optique nouvelle…».[108]
Voilà pourquoi Albérès en appelle avant tout au pointillisme dans le cas des
romans de Virginia Woolf : «Ce roman
pointilliste et inépuisable semble avoir découvert une autre profondeur de la
vie : un “niveau” océanique qui n’avait pas encore été exploré, celui où
l’impression compte plus que les raisons et les vérités objectives… On ne
saurait le condamner en le réduisant à une tentative purement esthétique :
qu’est-ce qui est plus “vrai”, la représentation habituelle et raisonnable des
choses qui constitue notre vie commune, ou bien nos
réaliste
éclairait dans ses moindres recoins une réalité offerte à toutes les
investigations et à toutes les enquêtes, l’impressionnisme ne se fie plus à
cette docilité et à cette présence immédiate du monde : “Tâchons de croire, dit
Virginia Woolf, que la vie est un objet solide, un globe que nous pouvons faire
tourner sous nos doigts. Tâchons de croire qu’on peut en faire un récit simple
et logique, en finir avec l’amour par exemple, et passer au chapitre suivant…”
Mais en vain… Pour la sensibilité nouvelle la vie est une profondeur trouble où
la lumière de la conscience miroite seulement, se diffracte et s’épanouit avant
de se perdre, comme les rayons du soleil lentement diffusés, puis absorbés dans
l’eau, jusqu’à la cécité des profondeurs… Multiple, tourbillonnante, faite de
poussières lumineuses suspendues dans le vide, la réalité impressionniste ne se
raconte pas, ne se décrit même point. Les paroles, les gestes menus des hommes,
hésitations et arabesques, indiquent à peine quelques lignes, à la surface de
cette nébuleuse qui est la réalité, qui est la “Vie”. Le lecteur est ainsi
transporté dans un univers en fusion, déconcerté par une optique nouvelle…».[108]
Voilà pourquoi Albérès en appelle avant tout au pointillisme dans le cas des
romans de Virginia Woolf : «Ce roman
pointilliste et inépuisable semble avoir découvert une autre profondeur de la
vie : un “niveau” océanique qui n’avait pas encore été exploré, celui où
l’impression compte plus que les raisons et les vérités objectives… On ne
saurait le condamner en le réduisant à une tentative purement esthétique :
qu’est-ce qui est plus “vrai”, la représentation habituelle et raisonnable des
choses qui constitue notre vie commune, ou bien nos  impressions premières,
avant qu’elles soient réduites à un commun dénominateur, ces sensations brutes,
personnelles et vertigineuses, colorées, indistinctes comme la poussière du
temps, qui sont l’élément originel de notre vie consciente? Nous avons pris
pour règle, sauf dans l’enfance, dans le rêve et dans la psychanalyse, de les
refouler ou de les rationaliser… Pour les impressionnistes, elles constituent
la vérité première, la matière originelle et indéfinissable de l’existence. De
Virginia Woolf à Nathalie Sarraute, tout un art existe, qui cherche à saisir le
jaillissement premier de l’impression, le “courant de conscience” et il n’est
que trop aisé d’évoquer à ce sujet l’ombre de Bergson. Alors que le roman
traditionnel donne une vérité intellectualisée et mécanisée, le roman
impressionniste livre le flux incohérent et dynamique de la “vie vécue”, le sentiment
profond de l’existence».[109]
Si l’impressionnisme identifié dans les œuvres de Virginia Woolf en appelle à
l’impression qui jaillit des relations entre les personnages et leur retour
intime, la sensibilité à l’existence est un thème proprement du XXe siècle.
Ici, l’impressionnisme en littérature nous rappelle qu’il est un tard venu et
qu’il se distingue franchement du naturalisme de Zola malgré ses références aux
peintres impressionnistes.
impressions premières,
avant qu’elles soient réduites à un commun dénominateur, ces sensations brutes,
personnelles et vertigineuses, colorées, indistinctes comme la poussière du
temps, qui sont l’élément originel de notre vie consciente? Nous avons pris
pour règle, sauf dans l’enfance, dans le rêve et dans la psychanalyse, de les
refouler ou de les rationaliser… Pour les impressionnistes, elles constituent
la vérité première, la matière originelle et indéfinissable de l’existence. De
Virginia Woolf à Nathalie Sarraute, tout un art existe, qui cherche à saisir le
jaillissement premier de l’impression, le “courant de conscience” et il n’est
que trop aisé d’évoquer à ce sujet l’ombre de Bergson. Alors que le roman
traditionnel donne une vérité intellectualisée et mécanisée, le roman
impressionniste livre le flux incohérent et dynamique de la “vie vécue”, le sentiment
profond de l’existence».[109]
Si l’impressionnisme identifié dans les œuvres de Virginia Woolf en appelle à
l’impression qui jaillit des relations entre les personnages et leur retour
intime, la sensibilité à l’existence est un thème proprement du XXe siècle.
Ici, l’impressionnisme en littérature nous rappelle qu’il est un tard venu et
qu’il se distingue franchement du naturalisme de Zola malgré ses références aux
peintres impressionnistes.
 L’achèvement de cette fresque qu’est La recherche du temps perdu de Proust coïncide avec la Grande Guerre,
accompagne chronologiquement la fin de l’art impressionniste. Le suicide de Van
Gogh (1890), le départ de Gauguin pour Tahiti un an plus tard et le décès de
Seurat (1891), marquent avec la mort du post-impressionnisme la fin de la
mouvance en peinture. Ce n’est plus dans la nature, ni même dans les rues de
Paris ou les guinguettes que s’acheva l’impressionnisme, pas même dans les
coulisses des salles de ballet fréquentées par Degas, mais aux Folies-Bergères, avec le nain
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Descendant de la vieille noblesse des ducs de
Toulouse, victime dans son enfance de deux accidents successifs qui le
laissèrent infirme des jambes, alcoolique, excentrique, pathétique, ce créateur
d’affiches remarquables est à placer aux côtés de Van Gogh pour la tristesse et
la souffrance d’une existence apparemment condamnée sans lendemains, des
lendemains qui vinrent seulement après leur mort. L’impression restait fixée à
l’œuvre que son auteur vivait une malédiction dont il semblait le seul
responsable : «D’emblée l’artiste a
fait son choix, le plus catholique qui soit : s’abandonner corps et âme à la
chute. Pour le corps ce fut facile, la nature lui ayant donné un sérieux coup
de main. Restait l’âme… Restait à s’abandonner à la paulinienne corruption, à
l’originelle ignominie, mieux à la provoquer, en toute conscience, en toute
volonté, à la pousser et à la vivre jusqu’à ses ultimes conséquences».[110]
Il est paradoxal que, côtoyant le développement de l’expressionnisme à travers
le fauvisme puis le futurisme, l’impressionnisme fut le mode d’après lequel les
peintres de guerre exprimèrent la réalité vécue des tranchées, des tirs d’obus
et
L’achèvement de cette fresque qu’est La recherche du temps perdu de Proust coïncide avec la Grande Guerre,
accompagne chronologiquement la fin de l’art impressionniste. Le suicide de Van
Gogh (1890), le départ de Gauguin pour Tahiti un an plus tard et le décès de
Seurat (1891), marquent avec la mort du post-impressionnisme la fin de la
mouvance en peinture. Ce n’est plus dans la nature, ni même dans les rues de
Paris ou les guinguettes que s’acheva l’impressionnisme, pas même dans les
coulisses des salles de ballet fréquentées par Degas, mais aux Folies-Bergères, avec le nain
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Descendant de la vieille noblesse des ducs de
Toulouse, victime dans son enfance de deux accidents successifs qui le
laissèrent infirme des jambes, alcoolique, excentrique, pathétique, ce créateur
d’affiches remarquables est à placer aux côtés de Van Gogh pour la tristesse et
la souffrance d’une existence apparemment condamnée sans lendemains, des
lendemains qui vinrent seulement après leur mort. L’impression restait fixée à
l’œuvre que son auteur vivait une malédiction dont il semblait le seul
responsable : «D’emblée l’artiste a
fait son choix, le plus catholique qui soit : s’abandonner corps et âme à la
chute. Pour le corps ce fut facile, la nature lui ayant donné un sérieux coup
de main. Restait l’âme… Restait à s’abandonner à la paulinienne corruption, à
l’originelle ignominie, mieux à la provoquer, en toute conscience, en toute
volonté, à la pousser et à la vivre jusqu’à ses ultimes conséquences».[110]
Il est paradoxal que, côtoyant le développement de l’expressionnisme à travers
le fauvisme puis le futurisme, l’impressionnisme fut le mode d’après lequel les
peintres de guerre exprimèrent la réalité vécue des tranchées, des tirs d’obus
et  de canons et des mêlées humaines sanglantes. Est-ce à dire que la guerre
n’exprimait rien sinon que d’elles ne pouvaient jaillir que des impressions impératives
à transmettre au monde? Si les impressionnistes américains eurent tendance à
reprendre les thèmes naturels qu’ils avaient appris de leurs maîtres français,
très vite ils s’orientèrent vers l’impression issue des changements sociaux et
culturels qui frappaient de grandes villes comme New York (Everett Shinn) ou la
tranquillité paisible des intérieurs (Mary Cassatt). Le post-impressionniste
allemand donna en Walter Sickert (1860-1942) une figure inquiétante dont les
tableaux confinaient parfois à l’horreur ou du moins à l’angoisse, comme ce
tableau sensé avoir été peint dans une chambre qu’aurait occupée Jack
l’Éventreur. La romancière Patricia Cornwell reste persuadée que Sickert serait
bien le tueur en série de Whitechapel, bien que depuis on aurait confirmé que
le véritable Jack l’Éventreur aurait été un suspect de l’époque, Aaron
Kosminski, un coiffeur d’origine polonaise. N’empêche. «Dessiner des morts n’était pas une chose inhabituelle chez Sickert.
Durant la Première Guerre mondiale, il était obsédé par les soldats blessés et
agonisants, leurs uniformes et leurs armes. Il en collectionna un certain
nombre et maintint
de canons et des mêlées humaines sanglantes. Est-ce à dire que la guerre
n’exprimait rien sinon que d’elles ne pouvaient jaillir que des impressions impératives
à transmettre au monde? Si les impressionnistes américains eurent tendance à
reprendre les thèmes naturels qu’ils avaient appris de leurs maîtres français,
très vite ils s’orientèrent vers l’impression issue des changements sociaux et
culturels qui frappaient de grandes villes comme New York (Everett Shinn) ou la
tranquillité paisible des intérieurs (Mary Cassatt). Le post-impressionniste
allemand donna en Walter Sickert (1860-1942) une figure inquiétante dont les
tableaux confinaient parfois à l’horreur ou du moins à l’angoisse, comme ce
tableau sensé avoir été peint dans une chambre qu’aurait occupée Jack
l’Éventreur. La romancière Patricia Cornwell reste persuadée que Sickert serait
bien le tueur en série de Whitechapel, bien que depuis on aurait confirmé que
le véritable Jack l’Éventreur aurait été un suspect de l’époque, Aaron
Kosminski, un coiffeur d’origine polonaise. N’empêche. «Dessiner des morts n’était pas une chose inhabituelle chez Sickert.
Durant la Première Guerre mondiale, il était obsédé par les soldats blessés et
agonisants, leurs uniformes et leurs armes. Il en collectionna un certain
nombre et maintint  des relations intimes avec des bénévoles de la Croix-Rouge, à
qui il demandait de le prévenir quand de malheureux patients n’avaient plus
besoin de leurs uniformes».[111]
Dessiner des champs de batailles, des tranchées, des cadavres mutilés, ce
n’était pas au départ dans le programme des impressionnistes, quels que furent leurs
tendances ou leurs styles. Une décadence, voire une déchéance c’était produite
au cours des années. Comment l’expliquer? «L’impressionnisme
[…] était tellement récent, tellement
puissant et si étroitement associé à l’humiliation de 1870 qu’il devint
progressivement la “bête noire” artistique non seulement de la droite, mais
aussi de l’avant-garde soi-disant progressiste. En outre, en cette époque
d’urgence nationale, son esthétique rebelle - son refus des pratiques
académiques - rendait l’impressionnisme encore moins recommandable. Lhote, en
1916, tout en reconnaissant que les artistes contemporains pouvaient encore
tirer profit des enseignements de l’impressionnisme, n’en estimait pas moins
que le mouvement constituait un précédent hautement problématique. […] Le célèbre aphorisme de Picasso -
“Travailler avec trois couleurs, trop de couleurs font de l’impressionnisme” -
que nous connaissons grâce aux carnets tenus par Cocteau…».[112]
Y avait-il véritablement trop de couleurs
pour que l’humeur chagrine des peintres impressionnistes puissent réellement
établir une mouvance capable d’être un nouveau classicisme, et cela, malgré le
génie qui l’avait porté sur les eaux?⌛
des relations intimes avec des bénévoles de la Croix-Rouge, à
qui il demandait de le prévenir quand de malheureux patients n’avaient plus
besoin de leurs uniformes».[111]
Dessiner des champs de batailles, des tranchées, des cadavres mutilés, ce
n’était pas au départ dans le programme des impressionnistes, quels que furent leurs
tendances ou leurs styles. Une décadence, voire une déchéance c’était produite
au cours des années. Comment l’expliquer? «L’impressionnisme
[…] était tellement récent, tellement
puissant et si étroitement associé à l’humiliation de 1870 qu’il devint
progressivement la “bête noire” artistique non seulement de la droite, mais
aussi de l’avant-garde soi-disant progressiste. En outre, en cette époque
d’urgence nationale, son esthétique rebelle - son refus des pratiques
académiques - rendait l’impressionnisme encore moins recommandable. Lhote, en
1916, tout en reconnaissant que les artistes contemporains pouvaient encore
tirer profit des enseignements de l’impressionnisme, n’en estimait pas moins
que le mouvement constituait un précédent hautement problématique. […] Le célèbre aphorisme de Picasso -
“Travailler avec trois couleurs, trop de couleurs font de l’impressionnisme” -
que nous connaissons grâce aux carnets tenus par Cocteau…».[112]
Y avait-il véritablement trop de couleurs
pour que l’humeur chagrine des peintres impressionnistes puissent réellement
établir une mouvance capable d’être un nouveau classicisme, et cela, malgré le
génie qui l’avait porté sur les eaux?⌛




















































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire